- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Svevo - Pirandello
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki
- 1930-1940
- 1930s
- Fitzgerald
- Hemingway
- Faulkner
- Koch
- Céline
- Bernanos
- Jouve
- DosPassos
- Kojève
- Miller-Nin
- Grosz - Dix
- Green
- Ortega y Gasset
- Wittgenstein
- Russell - Carnap
- Artaud
- Jaspers
- Sapir - Piaget
- Guillén
- Garcia Lorca
- Hammett
- A.Christie
- Heidegger
- Icaza
- Huxley
- Hubble
- Caldwell
- Steinbeck
- Waugh
- Blixen
- Rhys
- J.Roth - Doderer
- Aub
- Malraux-StExupéry
- DBarnes-NWest
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bataille
- Char-Michaux
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Bloch
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Lewin - Mayo - Maslow
- Montherlant
- Buzzati - Pavese
- Vittorini
- Fallada
- Malaparte
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Welty
- Boulgakov
- Tamiki - Yôkô
- Weil
- Gadda
- Broch
- Steeman
- Jouhandeau
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Ellison
- Bergman
- Baldwin
- Fromm
- Bradbury - A.C.Clarke
- Tennessee Williams
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Carpentier
- Mishima
- Salinger - Styron
- Pasternak
- Asturias
- O'Connor
- Hoffer
- Matute - MartinGaite
- 1960-1970
- 1960s
- Abe
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- U.Johnson - C.Wolf
- Heller - Toole
- Naipaul
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Onetti - Sábato
- Capote
- Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- McCarthy - Minsky
- Sillitoe
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- Lenz
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Dolls
- Ellis
- Cortázar
- Warhol
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- HarperLee
- Fuentes
- 1970-1980
- 1970s
- Habermas
- Handke
- GarciaMarquez
- Deleuze
- Derrida
- Beck
- Satir
- Kundera
- Hrabal
- Didion
- Guinzbourg
- Lovelock
- Vietnam
- H.S.Thompson - Bukowski
- Pynchon
- E.T.Hall
- Bateson - Watzlawick
- Carver
- Irving
- Milgram
- VargasLlosa
- Puig - Donoso
- Lasch-Sennett
- Crozier - Touraine
- Friedan-Greer
- Jacob-Monod
- Dawkins
- Beattie - Phillips
- Gaddis
- Rawls
- Zinoviev
- H.Searles
- Ballard
- Jong
- Kôno
- Calvino
- Ballester-Delibes
- ASchmidt
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact
- 1960s
- Abe
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- U.Johnson - C.Wolf
- Heller - Toole
- Naipaul
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Onetti - Sábato
- Capote
- Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- McCarthy - Minsky
- Sillitoe
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- Lenz
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Dolls
- Ellis
- Cortázar
- Warhol
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- HarperLee
- Fuentes

John Rechy (1931), "City of Night" (1963) - Hubert Selby Jr. (1928-2004), "Last Exit to Brooklyn" (1964), "The
Room" (1971), "Requiem for a Dream" (1979) - .....
Lastupdate: 31/12/2016
''These are not literary characters; these are real people. I knew these people. How can anybody look inside themselves and be surprised at the hatred and violence in the world? It's inside all of us.'' - Ni Selby ni Rechy ne croient à la liberté des corps dans une société telle que la notre : le corps, sexué, est un champ de bataille, la conscience un champ d'enregistrement instantané de multiples sensations et sentiments impossibles à maîtriser ...
L'essentiel de ma démarche, dit Selby, consiste à vouloir faire vivre au lecteur une expérience susceptible de l`émouvoir. Mon but n'est pas simplement de lui raconter une histoire, je veux qu`il vive ce qui arrive aux personnages du livre", des personnages bien réels qui ont vécu réellement ce qui est ici rapporté, tel quel, et c'est sans doute cette qualité cathartique d`expérience à partager qui fait la force âpre des romans de Selby, et principalement de "Last Exit to Brooklyn" : mais aussi et surtout, celle d'un être humain qui se sait condamné et tente de saisir par une écriture graphique, longue, saccadée, nue, un sentiment inéluctuable d'apocalypse personnelle sans possible rémission...
Dans "Last Exit", c’est le sexe, la violence, la masculinité toxique et le pouvoir qui agissent comme drogues sociales. Dans "Requiem", l’addiction est littérale : héroïne, amphétamines, télévision. Mais elle est aussi métaphorique : le rêve américain comme substance hallucinogène...

John Rechy (1931)
Né dans le quartier mexicain d'El Paso, sur le rio Grande, d'un père musicien raté devenu entre autres vendeur de piano, et d'une mère qui ne parlait qu'espagnol et l'oppressait quelque peu, John Rechy entre dans la littérature par le biais de quelques reportages et c'est dans le même style qu'il écrit ce "City of Night" (1963) qui, d'El Paso à La Nouvelle-Orléans, en passant par New-York, suit un espèce de gigolo homosexuel qui va croiser une multitude de types humains, de passe en passe, dans la pénombre d'un univers où le guette la dégradation. Lorsque John Rechy a publié son premier roman, "City of Night", en 1963, il gagnait encore sa vie comme prostitué dans les rues de Los Angeles : il ne s'attendait pas à ce qu'un livre traitant de la vie clandestine des homosexuels en Amérique lui rapporte tant d'argent : "It caught me out completely," says Rechy, now 74, and still living in Los Angeles. "I was bewildered. I did nothing at all to promote the book, even to the extent of denying that I wrote it. I felt that if I left the streets as soon as I had some success, I'd be betraying the world that I wrote about. And the truth is that I couldn't give it up. I'd been hustling for so long that it was a habit", dira-t-il en 2005. Quitter la rue aurait été trahir le monde sur et pour lequel j'avais écrit. Et c'est ainsi qu'a commencé pour lui une singulière double vie, que Rechy évoque avec dans une nouvelle autobiographie, "About My Life and the Kept Woman" : le jour, il était écrivain, côtoyait d'autres auteurs et enseignait même à l'UCLA. La nuit, il était de retour dans les rues, vendant du sexe aux hommes ("I wanted demarcation between the different areas of my life, and I fooled myself that I could keep them separate. I wanted to be treated one way as 'the writer', another way as 'the hustler', and if they crossed over I got very confused"). Mais on sait que lorsque le romancier britannique s'esr expatrié, Christopher Isherwood a invité Rechy chez lui pour parler d'écriture, avant de se jeter sur lui : "People hit on me all the time, far more than I say in the book. Looking back, I can see it was my own fault - I projected a very sexual image, and I shouldn't have been surprised when people responded".
Dans les années 1970, alors qu'il enseignais à l'UCLA, il finissait ses cours du soir, puis changeait de vêtements et descendais faire du tapin sur Santa Monica Boulevard... Rechy a continué d'écrire tout au long des années 1970 et 1980, détaillant les bas-fonds de sa vie sexuelle compulsive : "Numbers" (Groove Press, 1967) "Rushes" (Groove Press, 1979) et "The Sexual Outlaw". . La vie de Rechy a changé un soir de 1981, lorsque, alors qu'il était encore prostitué dans la quarantaine, il a été abordé par un jeune homme de 23 ans "et nous sommes ensemble depuis 27 ans" : Rechy a survécu à la rue, aux problèmes de drogue dans les années 1970, à l'épidémie de sida qui a tué nombre de ses amis dans les années 1980 et 1990, a écrit 15 livres, mais ses romans suivants n'auront pas la même force : "This Day's Death" (1970), "The Fourth Angel" (1973). Nous aimons penser que le monde a complètement changé, mais ce n'est pas le cas, écrira-t-il...
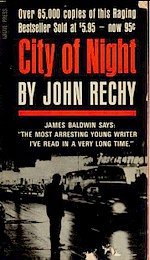
"City of Night" (1963)
Roman de la solitude et de la recherche incessante et furtive de l'amour dans dans cette immense Cité de la Nuit qu'est l'Amérique, Times Square à New York,
Pershing Square à Los Angeles, Hollywood Boulevard et quartier français de la Nouvelle-Orléans, autant de lieux à l'ombre desquels se dresse la scène gay des rencontres et ces personnages que
rejettent la nuit, hommes ou femmes, dont John Rechy dresse les portraits sans concession aucune : Chuck, l'étalon cow-boy, Chi-Chi et
Darling Dolly Dane, drag queens de la rue, M. King, le client acariâtre et, dominant tout le monde, la majestueuse drag diva de Los Angeles, Miss Destiny. Malgré les critiques, "City of Night"
s'est vendu en masse à un public avide de sensations. "Miss Destiny était très réelle, dira Rechy, c'était le nom qu'elle utilisait, et toutes ces histoires étaient basées sur mes souvenirs
d'elle. Nous sommes restés en contact pendant quelques années après la sortie du livre ; elle m'appelait au milieu de la nuit, disant qu'elle était avec un de ses "maris" qui ne croyait pas
qu'elle pouvait être un personnage d'un roman célèbre. Quant au narrateur anonyme de City of Night, c'est un jeune homme incapable d'aimer et acceptant l'argent des hommes afin de prouver qu'il
n'est pas homosexuel. Ce que Rechy confirmera de lui : "That's how I was. I was very passive. When I was growing up in Texas, I'd been seduced by women; when I moved to the streets, I was
bought by men. I never approached anyone, ever. It was about keeping an attitude of non-participation and distance, of being desired but never desiring. It was all subterfuge, a denial of my
sexuality"... (traduction Editions Gallimard).
"Times Square, New York, is an electric island floating on a larger island of lonesome parks and lonesome apartment houses and knifepointed buildings stretching Up. (I will think dazedly one night: Someday this city will tear its wharf-lined fringes from the ocean and soar in desperation to the Sky. . . .)
Times Square is the magnet for all the lonesome exiles jammed into this city. . . . And this is how I found that world of Times Square. In the incessantly running showers of the Sloane House YMCA the day I arrived in New York, the big hairy man made conversation with me; where
am I from and what am I doing and am I working yet (“No? Good. I mean good that you dont have to be anywhere at a set time.”), and will I come to his room and he’ll buy hamburgers. Hes a merchant marine, tanned from a recent Voyage to somefarwhere—on his way now to Boston with I imagine a roll of money big enough to make me greedy. Unfairly, Im almost broke
—$20.00 when I left Chicago, and one phone number what said nervously we must have lunch sometime. And no prospect of a job which will pay me before the money runs out.
In the tiny cubicle-room facing the courtyard across which a lonesome youngman, also undoubtedly just arrived in the City, played a doleful guitar by his window, we sit eating oniony greaseburgers and ignoring the persistent sound of the running showers. For a moment, I think it’s the hurricane.
Outside, in the hallway, doors open and close. The sound of feet walking up and down never stops. A hurried conversation outside, a door closes. Even before this man speaks it, I know that something of what Ive come to find in this city will soon be revealed in this room.
“They dont call this Y the French Embassy for nothing,” the merchant marine laughs. He has sized me up slyly: broke and green in the big city— and he said: “You wouldnt be broke if youd been at Mary’s last night—thats a place in the Village and everything goes.” He watches me evenly for some reaction, determining, Im sure, how far he can go how quickly. “So I spot this cute kid there—” Hes still studying me carefully, and when I dont say anything, he continues with more assurance: “So I spot him and I want him —yeah, sure, Im queer—whatya expect?” he challenges. He pauses longer this time, watching me still calculatingly. He goes on: “And the kid’s looking for maybe a pad to flop in and breakfast—bes not queer himself, I dont like em queer: If I did, Id go with a woman—why fuck around with substitutes? . . . So this kid goes with me—Im feeling Good, just off the ship, flush—I lay 50 bucks on him.”
A strange new excitement wells inside me.
He adds slyly, confident now that hes got me interested: “If youda been there I woulda preferred you. . . .” He places his hairy hand on my leg. “Unfortunately, Im almost broke now,” he says, “but I got some more pay coming soon.”
I stand up quickly; pause only for a moment at the door.
He calls after me: “Hell, if you decide to make that scene later, try Times Square—always good for a score. . . . And play it dumb—they dig that.”
"... À New York, Times Square est un îlot électrique, flottant sur une grande île, faite de parcs et d’immeubles solitaires et de buildings dont les flèches acérées dardent vers le Ciel. (Une nuit, dans mon hébétude, je devais me dire : Un jour, cette ville arrachera à l’Océan sa frange de quais et, désespérée, s’élancera vers le Ciel…)
Times Square est l’aimant qui attire tous les exilés, les solitaires prisonniers de la ville… et voici comment je découvris ce monde de Times Square.
Sous les douches qui coulaient sans arrêt dans le Y.M.C.A. de Sloane House, le jour de mon arrivée à New York, le gros type velu engagea la conversation, d’où est-ce que je viens, et qu’est-ce que je fais et est-ce que j’ai du travail (« Non ? Tant mieux. Je veux dire tant mieux que tu sois pas obligé de te trouver quelque part à une heure précise. ») et est-ce que je veux venir dans sa chambre, il achètera des hamburgers. C’est un marin, encore tout bronzé d’un récent voyage je ne sais où – en route maintenant pour Boston, avec, je suppose, une liasse de billets assez gros pour me mettre en appétit. Par malchance, je suis presque fauché – nanti seulement, à mon départ de Chicago, de 20 dollars et d’un numéro de téléphone, qui m’a répondu avec nervosité qu’on devrait s’arranger pour déjeuner ensemble un de ces jours. Et pas de travail en perspective pour me renflouer avant d’être tout à fait à court d’argent.
Dans la cellule minuscule qui donne sur la cour, où, en face, un jeune type solitaire, lui aussi sans doute fraîchement arrivé dans la ville, pince lugubrement une guitare près de sa fenêtre, nous mangeons des hamburgers à l’oignon, ignorant le ruissellement continu des douches. Un instant, je crois que c’est le bruit de l’ouragan.
Dans le couloir, des portes s’ouvrent et se ferment sans arrêt : des pas montent et descendent l’escalier. Dehors, une conversation précipitée, une porte claque.
Avant même que l’homme parle, je sais que, dans cette chambre, je vais avoir bientôt la révélation partielle de ce que je suis venu chercher dans cette ville.
« C’est pas pour rien qu’on appelle ce Y l’Ambassade de France », dit en riant le marin. Il m’a sournoisement jaugé : fauché et paumé dans la grande ville – et il continua : « Tu serais pas fauché si tu t’étais trouvé chez Mary hier soir – c’est une boîte du Village où y s’en passe de drôles. » Il m’observe posément, épiant mes réactions, se demandant, j’en suis sûr, s’il peut y aller carrément, et jusqu’où. « Alors, j’aperçois un de ces petits mignons. » Il continue de m’étudier soigneusement et, comme je ne réponds pas, il poursuit avec une assurance accrue : « Bon, je le vois et j’ai envie de lui – ouais, bien sûr, que je suis pédé – qu’est-ce que tu crois ? » me lance-t-il avec défi. Cette fois, il attend, m’observant toujours d’un air calculateur. Il continue : « Peut-être que le môme se cherche une piaule et un petit déjeuner – lui, il est pas pédé. D’ailleurs, j’aime pas les pédés : sinon, j’irais avec une fille – à quoi bon baiser des doublures ?… Donc, le môme me suit – je me sens Bien, je viens de débarquer, plein aux as – je lui offre 50 dollars. »
Je me sens envahi d’une excitation bizarre, nouvelle pour moi. Il ajoute avec ruse, persuadé cette fois qu’il a réussi à m’intéresser : « Si t’avais été là, je t’aurais préféré… » Il pose sa main velue sur ma jambe. « Malheureusement, maintenant, je suis presque fauché, regrette-t-il. Mais je ne tarderai pas à toucher un peu de fric. »
Je me lève vivement ; à la porte, je m’arrête seulement un instant.
Il me lance : « Merde, si tu décides d’essayer ce truc-là, va à Times Square – c’est le bon coin pour tapiner… Et prends l’air con. C’est ça qui leur plaît. »
"I stand on 42nd Street and Broadway looking at the sign flashing the news from the Times Tower like a scoreboard: The World is losing. The hurricane still menaces—the sky ashen with night rainclouds, and looking at it, which is suddenly like a shroud, I panic, I think about this wailing concrete island, and I cant even swim: an island—and the shrouded sky makes it a Cage.
Along this street, I see the young masculine men milling idly. Sometimes they walk up to older men and stand talking in soft tonea—going off together, or, if not, moving to talk to someone else.
The subway crowds surged in periodic waves, blank newyork faces, as if, for air, they had just crawled out of the little boxes in the automat for say a quarter and two nickels.
I feel explosively excited to be on this street—at the sight of the people and the lights, sensing the anarchy. . . . The merchant marine’s story about the youngman he had picked up -and the implied offer of sexmoney to me —have acted on me like a narcotic that makes me crave it.
Predictably (and the life I have come to find is unfolding swiftly before me) the newyork cop comes by, to Welcome me, I will think later. He was shaped appropriately like a zero. Watching his approach, the other aimless youngmen leave their stands along the street. Stopping before me, the cop says to me in a bored, automatic, knowing tone: “Why dont you go to the movies, kid? . . . I aint seen you before—so I dent feel like running you in.”
I take his advice. Two Sexy foreign movies at the Apollo theater: I surrender to the giant cavernous mouth with decaying brown seats for teeth —gobble!—Where you’ll see me often later, in the balcony. But I kept thinking about the hurricane. Im nervous.
Outside, the rain is coming furiously. I stand under the marquee wondering where to go. Im reacting instinctively to this world, studying the stances of other obviously drifting youngmen.
Then he walks by me, hat slouched to one side, dont-give-a-damn walk: a grayhaired middle-aged man—and says—exactly how he came on: verbatim: “I’ll give you ten, and I dont give a damn for you.” I follow the man, who has paused a few feet from me.
“What did you say?” I asked.
He looks at me steadily: “Was I wrong?” he asks me, but hes looking at
me smiling confidently.
“I just asked what you said.”
“You heard me,” he says, without looking at me now, completely sure
now. . . . “Weu, for chrissake, you wanna come or not?”
“Yes.”
Then come on, we’re getting wet.”
That world has opened its door, and I walk in."
(...)
Je me tiens à l’angle de la 42e Rue et de Broadway, et regarde en haut de Times Tower l’enseigne lumineuse, où courent les flashes, comme sur un tableau : Le Monde perd. La tornade menace toujours – le ciel est grisâtre, avec, ce soir, des nuages de pluie, et, en le regardant, trouvant tout à coup qu’il ressemble à un linceul, je m’affole, je pense à cette île de béton gémissante, et je ne sais même pas nager – et le linceul du ciel en fait une Cage.
Dans la rue, je regarde les jeunes hommes, l’air viril, tourner en rond, désœuvrés. Parfois ils accostent des types âgés et leur parlent à voix basse – s’éloignent avec eux, ou, sinon, s’adressent à un autre.
Les bouches du métro vomissent la foule par vagues régulières, visages new-yorkais, vides d’expression, qu’on croirait fraîchement sortis, pour prendre l’air, des petits casiers du self-service pour, mettons, quelques sous.
Ma présence dans cette rue – le spectacle de la foule et de ces lumières, l’intuition de l’anarchie qui m’entoure –, tout cela me remplit d’une surexcitation telle qu’il me semble que je vais exploser… Ce que m’a raconté le marin, l’histoire du jeune type qu’il a levé – son offre implicite de me payer pour coucher avec lui – m’ont fait l’effet d’une drogue qui exacerbe mon envie d’essayer.
Comme j’aurais pu le prévoir (la révélation de la vie que je suis venu chercher ici ne se fait guère attendre), le flic new-yorkais s’approche, pour m’Accueillir, me dirai-je par la suite. Il avait le physique de l’emploi, l’air d’un bon à rien. En le voyant approcher, ceux qui comme moi traînent sans but dans la rue abandonnent leur faction. Le flic s’arrête devant moi et me dit d’une voix morne, mécanique, sans illusions : « Pourquoi tu vas pas au cinéma, petit ? C’est la première fois que je te vois, c’est pour ça que j’ai pas envie de te coffrer. »
Je suis son conseil. À l’affiche de l’Apollo, deux films étrangers, Sexy. Je me laisse avaler par l’énorme gueule béante dont les sièges marron, délabrés, figurent les dents – elle m’engloutit ! On me verra souvent, par la suite, au balcon. Mais je pensais toujours à l’ouragan. Je me sens nerveux.
Dehors, il pleut à torrents. Je m’arrête sous la marquise, sans savoir où aller. Au contact de ce monde, je me laisse gouverner par mon instinct et observe les faits et gestes de ceux qui, de toute évidence, comme moi, traînent.
C’est alors qu’il s’approche, le chapeau penché sur l’oreille, avec son air de se foutre de tout : un homme entre deux âges, aux cheveux grisonnants – et il dit – exactement de la façon dont il s’est approché : textuellement : « Je te donnerai dix dollars et, si tu marches pas, je m’en fous. » Il s’est arrêté quelques pas plus loin, je le rattrape.
« Qu’avez-vous dit ? » lui demandai-je.
Il m’observe longuement. « Je me suis trompé ? » questionne-t-il, en me regardant avec un sourire plein d’assurance.
« Je demandais seulement ce que vous aviez dit.
— T’as bien entendu », fait-il, cette fois sans me regarder, et complètement rassuré. « Alors, bon Dieu, tu viens, oui ou non ?
— Oui.
— Alors, allons-y, on est en train de se faire tremper. »
Ce monde a ouvert sa porte, et j’y pénètre...."
La structure de "City of Night" de John Rechy suit une logique géographique, sociale et existentielle précise, où les rencontres du protagoniste (souvent assimilé à Rechy lui-même) dans les quatre parties (Los Angeles, San Francisco, New York, La Nouvelle-Orléans) révèlent une progression symbolique vers une prise de conscience qui se solde par une désillusion complète.
Aux jeunes prostitués occasionnels et drag queens flamboyantes succèdent des personnages plus tragiques et solitaires, derrière les masques, des mécanismes d'auto-destruction et de duperie mutuelle. Les rencontres révèlent la fragilité des identités construites et le besoin désespéré d'amour derrière la marchandisation des relations. Prostitués vieillissants, âmes perdues dans l'anonymat urbain ou marginaux en quête de reconnaissance éphémère, la solitude devient ici palpable. Les interactions sont réduites à des jeux de pouvoir et d'exploitation. La ville symbolise la déshumanisation totale, où chacun est interchangeable.
L'étape ultime expose l'échec des illusions. Jeremy, qui croyait en l'amour et la rédemption, est détruit par le système qu'il a servi. C'est le miroir brutal des espoirs du narrateur ...
La "ville de la nuit" n'est qu'un écosystème clos où les marginaux reproduisent l'oppression qu'ils fuient. La seule "vérité" est l'isolement fondamental de l'individu, masqué par des interactions éphémères ...
La structure de City of Night est une spirale descendante où des vignettes narratives (les rencontres avec des personnages spécifiques) sont enchâssées dans des méditations plus larges du narrateur sur l'univers qu'il traverse. Rechy utilise cette alternance pour passer du général (l'atmosphère d'une ville, la philosophie de la "city of night") au particulier (une relation transactionnelle précise qui illustre et incarne cette philosophie)....

CITY OF NIGHT - Part One
"LATER I WOULD THINK OF AMERICA as one vast City of Night stretching gaudily from Times Square to Hollywood Boulevard—jukebox-winking, rock-n-roll-moaning: America at night fusing its darkcities into the unmistakable shape of loneliness.
Remember Pershing Square and the apathetic palmtrees. Central Park and the frantic shadows. Movie theaters in the angry morning-hours. And wounded Chicago streets. . . . Horrormovie courtyards in the French Quarter—tawdry Mardi Gras floats with clowns tossing out glass beads, passing dumbly like life itself. . . Remember rock-n-roll sexmusic blasting from jukeboxes leering obscenely, blinking many-colored along the streets of America strung like a cheap necklace from 42nd Street to Market Street, San Francisco. . . .
One-night sex and cigarette smoke and rooms squashed in by loneliness. . . .
And I would remember lives lived out darkly in that vast City of Night, from all-night movies to Beverly Hills mansions.
But it should begin in El Paso, that journey through the cities of night. Should begin in El Paso, in Texas. And it begins in the Wind. . . . In a Southwest windstorm with the gray clouds like steel doors locking you in the world from Heaven.
I cant remember now how long that windstorm lasted—it might have been days—but perhaps it was only hours—because it was in that timeless time of my boyhood, ages six through eight..."
Los Angeles – Les Fondements d'un Monde - Le narrateur plante le décor de Pershing Square, cœur battant et névralgique de la vie clandestine de L.A. Il décrit l'économie rudimentaire de la drague, la hiérarchie entre les "queens" et les "hustlers", et pose les bases de sa propre posture : celle d'un observateur détaché qui se croit immunisé contre la dégradation émotionnelle qu'il perçoit chez les autres. C'est le manuel de survie du débutant.
MR. KING: Between Two Lions
Le narrateur rencontre un homme riche et plus âgé, "Mr. King", dans un bar. Celui-ci l'invite dans sa maison de luxe, où il garde deux lions en cage dans son jardin. La rencontre est sexuelle, mais teintée d'une étrange ritualisation. Mr. King expose sa philosophie de vie basée sur la puissance, le contrôle et la possession, se comparant lui-même à un lion, maître de son domaine.
Mr. King est la première incarnation majeure du pouvoir, le double visage du désir ; la cruauté dans les relations de pouvoir. Les lions sont un symbole évident de sa force sauvage et domestiquée. Il n'achète pas seulement du sexe ; il achète la soumission et l'admiration d'un jeune homme qu'il place symboliquement entre ses "griffes". Cette rencontre apprend au narrateur que les clients ne paient pas seulement pour un acte, mais pour jouer un rôle de domination dans un scénario qu'ils ont écrit. C'est une leçon sur la dynamique de pouvoir qui régit la "city of night".
PETE: A Quarter Ahead
Pete est une figure pathétique et répugnante, un homme qui erre dans Pershing Square en quête de compagnie masculine, mais qui est rejeté de tous. Il offre de minuscules sommes ("a quarter ahead") pour de l'affection ou de l'attention. Le narrateur assiste avec un mépris mêlé de pitié à sa solitude absolue.
Pete est le contrepoint absolu de Mr. King, la précarité. Il représente le bas de l'échelle économique et émotionnelle de ce monde. Si King achète le pouvoir, Pete tente d'acheter, pour quelques cents, un simulacre d'affection. Il est le spectre de la déchéance et de la solitude qui guette tous les habitants de la nuit. Il sert d'avertissement au narrateur : sans la jeunesse et la beauté qui sont son capital, il pourrait bien devenir Pete.
THE PROFESSOR: The Flight of the Angels
"L'homme, assis dans son lit, me soupesait du regard; il était énorme. Il tenait délicatement une cigarette au papier bleu pastel, en équilibre entre deux doigts bouffis. Il porte la cigarette à ses lèvres d’un geste affecté et s’entoure d’un nuage informe de fumée. Son visage rose le fait ressembler à un génie grotesque émergeant de la fumée.
L'autre main tient un mètre de couturière dont une partie est enroulée autour de son cou gras et flasque…. Il doit avoir la soixantaine. Le crâne est complètement rasé. De gros yeux noirs saillent derrière des verres épais, pareils à ces yeux bariolés que les enfants peignent sur les lunettes dont ils s’affublent, la veille de la Toussaint...."
Le Professeur est un client particulier que le narrateur rencontre à Los Angeles. Contrairement à la plupart des "johns" qui recherchent une satisfaction sexuelle simple, le Professeur est un intellectuel, un esthète et un philosophe mélancolique.
Il n'engage pas le narrateur primarily pour le sexe. Il le paie pour qu'il se déshabille et reste allongé sur son lit, afin qu'il puisse le contempler. Leurs rencontres sont principalement constituées de longues conversations où le Professeur expose sa vision du monde. Il est obsédé par la beauté masculine juvénile, qu'il voit comme un idéal éphémère et tragique. Il théorise la vie des jeunes hommes qu'il désire comme un "vol d'anges" – une trajectoire sublime mais vouée à la chute.
Le Professeur est bien plus qu'un client ; il est le miroir intellectuel du narrateur et le théoricien de la "city of night".
Le Professeur ne participe pas pleinement à la vie de la nuit ; il l'observe, la collectionne et l'analyse. Il représente la tentative de donner un sens, une structure narrative et même une beauté tragique à un monde que la société rejette comme sordide. "The Flight of the Angels" (Le Vol des Anges) est sa métaphore centrale. Pour lui, les jeunes hustlers (comme le narrateur) sont des "anges" : des êtres d'une beauté sublime et innocente (même si elle est feinte) qui sont en train de chuter. Leur "vol" est leur trajectoire à travers la nuit, une descente inéluctable vers la déchéance, la perte de leur beauté et la perte de leur innocence illusoire. Il n'essaie pas de les sauver ; il veut documenter et esthétiser leur chute, comme on observerait un phénomène naturel tragique et magnifique.
Son désir est donc profondément nostalgique et impossible. Il cherche à capturer une pureté qui n'existe pas ou qui est déjà corrompue. Il est amoureux d'une idée, pas d'une personne réelle. Le narrateur se présente comme un observateur détaché de la "city of night". Le Professeur lui montre un reflet de cette même posture, mais poussée à son extrême intellectuel. Cela crée un lien ambigu : le narrateur est à la fois l'objet d'étude du Professeur et son collègue observateur. Leurs conversations sont les premières à forcer le narrateur à penser sa propre condition en des termes philosophiques. Le Professeur lui fournit le vocabulaire de sa propre tragédie existentielle. Il est celui qui met des mots sur ce que le narrateur vit de manière instinctive et défensive.
Le "vol de l'ange" est exactement le voyage que le narrateur s'apprête à faire : de Los Angeles à La Nouvelle-Orléans, il va descendre les cercles de la nuit, rencontrant des figures de plus en plus désillusionnées et se rapprochant de la "chute" que le Professeur théorise. Le Professeur, dès le début, annonce la conclusion du livre : la désillusion complète.
Los Angeles est le terrain d'apprentissage. Le narrateur y rencontre les deux extrêmes de la transaction : le pouvoir absolu (King) et le désespoir absolu (Pete). Il commence à cartographier les règles de ce monde et forge son armure de détachement, croyant encore pouvoir naviguer entre ces pôles sans en être affecté ...

CITY OF NIGHT - Part Two
"La Californie du Sud, dont la forme rappelle celle d’un cercueil, est un immense sanatorium fleuri où ceux que ronge le mal de vivre viennent chercher une forme de guérison...
C’est la dernière étape, avant que le soleil ne disparaisse pour sombrer dans l'Océan noir, noir, et que la nuit, le plus souvent sans étoiles, ne tombe.
Il ne faut guère de temps pour s’apercevoir que l’on reste toujours séparé du Ciel, prisonnier de la couche de brouillard et de buée qui isole du Paradis, pourtant il y a le soleil, même en hiver, assez de soleil - c’est important - pour donner un bronzage sain et doré... Et les palmiers qui
courbent leurs cimes et frissonnent avec désinvolture.. l'herbe verte. les soirées fraîches, divinement fraîches, même après les après-midi torrides.
Et des fleurs...
Des roses, des roses !
Des pavots jaunes et orange, semblables à des allumettes qui s’enflamment et grésillent dans la brise. Des oiseaux de paradis aux longues langues pointues ; des lupins bleus et pourpres ; des arbres de Judée qui brandissent très haut, comme des torches, d’incroyables panaches de fleurs - le long de longues, d’interminables rangées de palmiers qui se dressent comme des phallus à la toison blanchie par le soleil...
Partout !
Et des tapis de fleurs, même en bordure des autoroutes frénétiques, où les voitures poursuivent leur course folle, en demi-cercles tourbillonnants - le Harbor Freeway se jette dans le Santa Ana Freeway, dans le Hollywood Freeway et, quand la circulation n’est pas trop intense, des longues rangées de voitures en files opposées, semblables à de froides armées d’acier assoiffées de Sang, monte un whooooush ! qui se répète comme le bruit de l'Océan infatigable, battu par
les vents, et les voitures se faufilent, se précipitent nulle part, quelque part...
N'importe où !...
Le long de la Côte, les plages s’étirent avec indifférence.
Ici, on pourrait pourrir sans s'en apercevoir.
Tout cela, je devais le voir et l’apprendre par la suite. Pour l'instant, je me trouve à la Gare routière, au milieu de West Coast Times Square, le quartier que délimitent Los Angeles Street, Main Street, Spring, Broadway, Hill - à peu près entre la 4° et la 7° Rue. .."
Derrière la flamboyance, le tragique affleure, derrière les masques, les stratégies de survie.
Le narrateur arrive à San Francisco, s'attendant peut-être à trouver une forme de fraternité. Au lieu de cela, il découvre une micro-société tout aussi vénale, mais plus structurée et hypocrite. Les méditations générales décrivent les bars comme le "Trap" et les hiérarchies sociales complexes entre les reines. C'est ici que le narrateur comprend que le "ghetto" peut être aussi cruel et aliénant que le monde extérieur...
Ces personnages illustrent la dépendance et la vanité. Skipper, le patriarche malade qui règne sur ses jeunes hustlers, montre comment la "famille" de substitution peut recréer des dynamiques de pouvoir malsaines. Chuck, le narcissique obsédé par son corps, incarne la terreur du vieillissement et la réduction de l'être à sa seule enveloppe physique.
MISS DESTINY: The Fabulous Wedding
Miss Destiny, une drag queen flamboyante, rêve et organise un mariage théâtral avec un homme hétérosexuel (souvent un hustler de passage). Cette cérémonie est un événement burlesque et grandiose, mêlant le glamour hollywoodien à la parodie la plus tragique. C'est un moment de rassemblement pour la communauté queer locale, une fête où le ridicule le plus apparent cache une quête de beauté et de reconnaissance désespérée.
Miss Destiny est l'un des personnages les plus importants du livre car elle cristallise le conflit entre la performance et l'authenticité, entre le rejet de la norme et le désir criant de s'y intégrer.
Son mariage est la performance ultime. Elle utilise les codes de l'institution la plus "normative" (le mariage) pour en faire une œuvre d'art queer et subversive. C'est un acte de résistance qui dit : "Nous existons, nous célébrons, et nous le faisons avec plus de style que vous."
Sous la couche de burlesque et d'ironie perce un désir profond et authentique de reconnaissance, d'amour et de stabilité. Le mariage n'est pas qu'une joke ; c'est une tentative pathétique et touchante de mimer le bonheur hétéronormatif pour en capter la respectabilité. Elle représente le désir universel d'être vu et validé, même – et surtout – quand on est rejeté par la société.
La fête est un château de cartes émotionnel. L'absence de vrai amour, le caractère éphémère de la célébration et le mépris que lui portent beaucoup de hustlers comme le narrateur (qui la voit comme une "folle" pitoyable) révèlent la profonde vulnérabilité et la solitude qui se cachent sous le maquillage et les robes. Elle est la conscience émotionnelle que le narrateur tente d'étouffer en lui-même.
CHUCK: Rope Heaven by the Neck
Chuck est un hustler beau et narcissique, obsédé par son apparence physique. Il est hanté par le suicide de son ami (ou amant), Pete, qui s'est pendu. Chuck est rongé par la culpabilité ("j'aurais dû être là") et exprime une rage intérieure, une violence rentrée qui se manifeste par des accès de colère et une froideur calculée. Le titre est évocateur : "Trouver le Ciel au bout d'une corde".
Chuck est le visage de l'homophobie internalisée, du trauma et de l'autodestruction qui ronge le monde clandestin.
Le suicide de Pete est un rappel brutal des conséquences désastreuses de la honte et du rejet. Chuck n'est pas seulement en deuil ; il est coupable de survivre. Cette culpabilité se transforme en une colère froide qu'il retourne contre lui-même et contre les autres. Il incarne l'idée que dans la "city of night", la violence la plus mortelle ne vient pas toujours de l'extérieur, mais de l'intérieur.
Son obsession pour son corps parfait est une réponse à ce trauma. C'est une tentative de contrôler au moins une part de son existence (son apparence) dans un monde qui lui échappe. Mais cette beauté est une armure vide ; elle ne peut le protéger de la douleur psychologique. Elle le rend objet et l'empêche de se connecter émotionnellement, le maintenant dans un isolement orgueilleux et misérable.
Chuck représente comment un acte de désespoir (le suicide) empoisonne ceux qui restent, perpétuant un cycle de douleur et de violence intériorisée au sein de la communauté.
SKIPPER: A Very Beautiful Boy?
Skipper est un hustler séduisant et narcissique, qui manipule les émotions. Il est l'incarnation du "beau garçon" qui comprend que son pouvoir réside autant dans son apparence physique que dans sa capacité à manipuler psychologiquement ceux qui le désirent. La relation avec le narrateur est bien celle d'une séduction suivie d'une profonde déception.
Skipper représente l'idéal apparent du hustler. Il est beau, désiré, et semble en parfait contrôle de ses transactions et de ses émotions. Pour le narrateur, encore en construction de son propre personnage, Skipper pourrait sembler être un modèle à suivre : quelqu'un qui a parfaitement maîtrisé les règles du jeu de la "city of night". Son vrai pouvoir ne réside pas seulement dans la vente de son corps, mais dans sa capacité à vendre l'illusion d'une connexion authentique. Il engage un jeu de séduction avec le narrateur qui dépasse la simple transaction sexuelle. Il offre des moments de proximité, de confidence apparente, faisant miroiter la possibilité d'une relation réelle, fondée sur autre chose que l'argent – peut-être sur une reconnaissance mutuelle, une forme d'amour ou de camaraderie dans la marginalité.
Le narrateur, malgré toute son armure cynique, projette sur Skipper un désir d'amour pur. Il baisse sa garde et croit, momentanément, avoir trouvé autre chose qu'une simple relation d'usage. Cet espoir est bien sûr trahi. Skipper révèle finalement son vrai visage : celui d'un manipulateur froid pour qui cette intimité n'était qu'un jeu de plus, une transaction émotionnelle complexe mais une transaction tout de même. La question du titre, "A Very Beautiful Boy?", devient alors amèrement ironique : la beauté extérieure cache-t-elle une belle âme ? La réponse est non.
Cette trahison est bien plus significative et blessante pour le narrateur qu'une simple arnaque financière. Elle signifie que même au sein de sa propre "tribu", dans ce monde marginal qui devrait être un refuge, la confiance et l'authenticité sont impossibles. Skipper prouve que la logique transactionnelle et manipulatrice de la "city of night" a corrompu les relations humaines dans leur essence même. L'échec de cette relation potentielle avec Skipper est un apprentissage brutal : il n'y a pas d'amour pur possible dans ce milieu, seulement des versions plus ou moins complexes de vente et d'achat.
Skipper n'est pas un avertissement sur la déchéance future (comme pourrait l'être Jeremy), mais une leçon sur la corruption du présent. Il est le miroir de ce que le narrateur pourrait devenir s'il poussait sa logique de détachement jusqu'à son paroxysme : non pas un hustler simplement insensible, mais un être qui instrumentalise l'émotion elle-même. Cette rencontre enseigne au narrateur que le plus grand danger ne vient pas des clients "johns" de l'extérieur, mais de ses pairs qui ont intériorisé et perfectionné les mécanismes de aliénation de la nuit.
San Francisco devait être un refuge ; il se révèle être un miroir grossissant des pathologies de la "city of night". À travers Miss Destiny, Chuck et Skipper, Rechy montre que la communauté marginale ne supprime pas les dynamiques de pouvoir, la violence, la honte et l'exploitation ; elle les reconfigure sous une forme nouvelle, parfois plus pernicieuse parce qu'elle se présente sous les traits de la "famille" ou de la "fête". Le narrateur comprend ici qu'il n'y a pas de salut dans le simple regroupement géographique. La désillusion s'approfondit, préparant le terrain pour la chute encore plus radicale de New York.

CITY OF NIGHT - Part Three
"De visage en visage, de chambre en chambre, de lit en lit, les contours du monde que j'avais choisi émergeaient - clairement mais sans signification définie. Chaque matin le soleil pâle se levait dans le ciel bleu-factice de Los Angeles, et chaque fois l’interminable résurrection de la journée commençait. Comme les palmiers qui bordaient les rues de la ville, le monde semblait hausser les épaules avec indifférence.
Suivit alors pour moi une période d’anarchie débridée tandis que je sentais ma vie tendre vers une sorte de nuit symbolique, tandis que s’accroissait journellement le nombre de ceux que je suivais. En compagnie de ces êtres innombrables - seulement aux moments où l’on me désirait - car après l’étreinte on redevenait étrangers - je me sentais électrisé de bonheur, comme si le cours implacable de la vie s'était arrêté, en équilibre à l'apogée de la jeunesse ; et pendant ces moments-là, la jeunesse restait suspendue immobile.
Bientôt je commençai à sentir que ce monde exigeait encore plus d’anarchie. Souvent je me rappelai l’homme que j'avais rencontré au cours de mon premier après-midi à Los Angeles, lorsque, son argent déjà dans mes mains, je m'étais soudain senti incapable de le voler. C'était là quelque chose d’inachevé : un test auquel j'avais échoué, préparé par ce monde d'élection... Mystérieusement vaguement le visage de l’homme continuait à me hanter.
Il y avait toujours, aussi, le narcissisme obsédant - ces douloureux interludes devant la glace - l’étrange désir désespéré d’être un monde à moi seul. Et d’une certaine manière, j'avais alors l'impression que seul le miroir pouvait juger ce qui en moi devait l'être.
Tandis que les semaines passaient, sous ce ciel barbouillé de brume, je m’arrêtai souvent au milieu de la turbulence sournoise de Pershing Square, l’observant fasciné.
Alors, une immense tristesse m’accablait aussi intense que si j'étais le seul à jamais l’avoir ressentie au spectacle de cette vie : épouvanté par le spectacle terrifiant de ce monde bouillonnant et déchu. Aussi par ces longs, longs après-midi, le parc devint-il le centre de ma vie..."
La troisième partie, située à New York, représente le cœur des ténèbres du voyage du narrateur. C'est le moment de la descente la plus profonde, où les illusions se dissipent pour laisser place à une lucidité brutale et désenchantée sur la nature du soi et de l'existence dans la "city of night". Les personnages qu'il rencontre ici sont les incarnations les plus extrêmes et les plus philosophiques de cette désillusion.
- LANCE: The Ghost of Esmeralda Drake III
Lance se présente comme un acteur raté, hanté par le fantôme d'une star de cinéma oubliée, Esmeralda Drake III, dont il prétend être le fils ou l'héritier spirituel. Il vit dans un monde de fantasmes cinématographiques, construisant une identité mythomane à partir des débris du rêve hollywoodien. Sa vie est une performance perpétuelle, un scénario où il est à la fois le héros et la victime.
Lance est le produit brisé du fantasme hollywoodien. Son personnage symbolise l'impossibilité pour beaucoup de ces marginaux d'accéder à la réussite et à la reconnaissance promises par le mythe américain. Ne pouvant être une star, il devient le fantôme d'une star, choisissant une grandeur imaginaire plutôt que l'insignifiance réelle.
Il pousse à son paroxysme le thème central du livre : la vie comme performance. Pour Lance, il n'y a pas de "vrai moi" derrière le masque ; le masque est son identité. Sa mythomanie n'est pas un mensonge, mais un mode de survie existentiel. Il représente la conviction que toute identité est une construction, une fiction que l'on choisit de jouer plus ou moins bien.
Lance agit comme un miroir grotesque et extrême pour le narrateur. Tous deux jouent un rôle (le hustler insensible), mais le narrateur croit encore qu'il cache un "vrai" soi. Lance, lui, a complètement fusionné avec son personnage. Il montre au narrateur l'aboutissement logique et dangereux de sa propre performance : la perte totale de toute authenticité dans le fantasme.
- SOMEONE: People Dont Have Wings
"Someone" (Quelqu'un) n'est pas un personnage individualisé mais une figure archétypale, une voix dans la nuit. Il énonce la phrase-clé : "Les gens n'ont pas d'ailes" ("People don't have wings"). Cette déclaration est une épiphanie négative, un constat d'échec existentiel lancé dans l'obscurité.
L'image des ailes est capitale. Elle symbolise la transcendance, l'évasion, l'élévation au-dessus de sa condition. L'affirmation "les gens n'ont pas d'ailes" est un démenti brutal de tout espoir de rédemption ou d'évasion. C'est la reconnaissance que les habitants de la "city of night" sont piégés, incapables de s'élever au-dessus de leur réalité sordide, de leur désespoir ou de leur nature profondément humaine et imparfaite.
Une évocation qui exprime un sentiment de déterminisme tragique. On ne naît pas avec des ailes pour s'envoler ; on est condamné à marcher, à ramper, à errer dans les rues froides de la nuit. C'est un rejet de toute croyance en un salut ou une transformation radicale.
Le fait que ce personnage soit anonyme ("Someone") donne à sa phrase un caractère universel. Ce n'est pas l'opinion d'un individu, c'est une loi fondamentale de l'univers de Rechy, énoncée par une voix collective. Le narrateur (et le lecteur) est confronté à cette vérité nue, sans fard, délivrée par un fantôme.
- NEIL: Masquerade
"«Un peu de thé?»
L'homme qui vient de me poser cette question est habillé de la façon suivante :
Hautes Culottes noires de policier qui lui moulent l’abdomen et épousent étroitement ses jambes torses et courtaudes ; bottes qui luisent d’un éclat vitreux et dépassent les chevilles de trente bons centimètres - clous d’argent disposés en triangle à la pointe de chaque botte, pour monter ensuite en spirale vers la tige comme un trèfle aux feuilles fantasques.
«Un sucre ou deux ? »
La ceinture - qui essaie en vain de comprimer son gros ventre (le serrant - quoique par ailleurs il ne fût pas exagérément gras - au point que sa respiration n’est qu’un halètement sourd et saccadé) mais ne réussit en fait qu’à le faire saillir par-dessus et par-dessous comme deux vieux pneus de chair bosselés et distendus - est noire elle aussi..."
Neil est un hustler cynique et intellectuel qui a pleinement embrassé la superficialité. Il ne croit pas à l'idée d'un "vrai soi" caché. Pour lui, la vie est une mascarade, une suite de déguisements et de rôles. Il revendique cette superficialité comme la seule forme de vérité accessible.
Là où Lance fuit dans le fantasme, Neil assume le jeu avec un détachement froid et intellectuel. Il est le théoricien de la mascarade. Il symbolise la réponse cynique à la prise de conscience de la performativité de l'identité : si tout est un masque, alors jouons bien notre rôle sans jamais croire à la pièce.
Sa position est radicale : prétendre qu'il y a une "profondeur" authentique est hypocrite. La seule honnêteté réside dans l'acceptation de la surface, du jeu, de la transaction sans illusion. C'est une forme de nihilisme actif qui refuse toute quête de sens comme étant naïve.
Neil offre une contre-argumentation au Professeur (qui, lui, cherche une forme de beauté ou de sens idéalisé même dans la transaction). Neil, lui, nie la possibilité même de trouver quoi que ce soit d'autre que ce qui est échangé : du sexe, de l'argent, une performance temporaire. Il est la conclusion logique et désespérante de la logique de la "city of night".
New York est le lieu de la révélation philosophique totale. À travers Lance, le narrateur voit la folie de la fusion avec son masque. À travers "Someone", il entend l'impossibilité de s'échapper de sa condition. À travers Neil, on lui présente la tentation cynique d'abandonner toute quête de sens. Cette triple confrontation le laisse vidé, sans illusion, ayant touché le fond de l'abîme métaphysique. Il a exploré toutes les réponses possibles (la fuite dans le fantasme, le désespoir existential, le cynisme) et les a trouvées toutes également vaines. Cette préparation est cruciale pour le finale apocalyptique et cathartique de La Nouvelle-Orléans.
"Et je marchai, cette nuit-là, le long du lac impassible dans la nuit - vers le nord, au-delà des silhouettes d’arbres sous lesquels des couples font l'amour... Le long du lac noir... Et je regardai derrière moi vers la ligne grandiose des gratte-ciel de Chicago: ce panorama magique qui enserre l’eau. Même les immeubles qui plus tôt ressemblaient à des géants s’avançant avec fatuité dans le lac, s’adoucissaient maintenant, fondaient leurs lignes en un réseau de feux étincelants, en un damier de lumières. Noire et mystérieuse, l’eau frémit en s’approchant incertaine de la rive. Le sillage miroitant d’une lumière lointaine brise l’eau sombre. Un type qui me suit depuis un moment m'accoste. Je dis non. Tandis qu’il s'éloigne, je regarde au loin, le long de la route, là où les voitures semblent rouler au ralenti sous la lumière blanc-bleu des réverbères qui s’'égrènent le long de la courbe.
Et Je vois:
Dominant la ligne des gratte-ciel, au sommet d’un grand building, un projecteur géant qui fouille la ville. Surnaturel, il glisse, tournoie sur l’eau sombre. Il flotte, s'élance au-dessus des gratte-ciel, enserre la cité nocturne.
Et follement excité, je me demande soudain si ce projecteur qui tourbillonne dans la nuit n’essaie pas en quelque sorte de tout embrasser - d’embrasser cette fusion de féroces contradictions qui est au cœur de cette légende qu'on appelle l'Amérique.
Et je sais ce que j'ai cherché au-delà de la souffrance volontaire et de la facilité du monde de Neil - quelque chose de momentanément perdu - retrouvé depuis dans le parc, les chambres de passage, la solitude des jungles : le monde de la souffrance non sollicitée, non souhaitée. retrouvé maintenant, comme une victoire, jusque dans le souvenir de Neil lui-même.
Et je pus penser à ce moment-là, pour la première fois vraiment : Il est possible de haïr ce monde abject et en même temps de l'aimer d’un amour abstrait et compatissant..."

CITY OF NIGHT - Part Four
"Tous les ans, vers le début de janvier, un étrange exode se prépare dans les Cités de la Nuit. D’est en ouest, un appel confidentiel court de bouche à oreille dans les villes noires.
Dans Times Square, au cœur de l’hiver tenace, alors que le vent cingle la Cité de béton comme une faux de glace, les hordes de jeunes vagabonds déguenillés remontent frileusement leurs cols et entendent l’appel. Sous les palmiers, par les nuits chaudes de Los Angeles, ils tressaillent d’une émotion secrète. Au Harry’s, au Wally’s. Sous les arcades qui bordent Main Street. Dans Pershing Square. Dans Hollywood Boulevard scintillant de lumière. Sous les lampes jaunes et grasses de chez Hooper. Le long de Market Street dans San Francisco l’humide, de la Septième Rue jusqu’au kiosque à journaux de Powell, piétinant peut-être dans la bruine, des ombres furtives perçoivent ce message encore étouffé qui retentira bientôt lancinant comme un tam-tam... À Chicago, dans Clark Street. Dans le Square - tandis que blottis dans la nuit glaciale ils attendent nonchalamment qu’une voiture s'arrête et que quelqu'un demande : voulez-vous Monter - cet appel effleure l'oreille des parias comme le vent qui souffle du lac de béton désert.
Dans Division Street. Dans les bars. À travers les autres cités de la nuit, l’appel se propage de plus en plus fort.
Et voici ce que dit cet appel: Mardi gras !
Dès le début Janvier (selon la date du Carême, et donc de Mardi Gras) de jeunes visages émaciés émaillent les grands chemins blanchis par l'hiver, des doigts se tendent dans la direction de Là-Bas, La Nouvelle-Orléans. Dans les autocars Greyhound en route pour le Sud, de jeunes types équipés parfois de guitares, voire de sacs rapiécés, dévisagent les jeunes filles qui lisent Véritables Confidences. De vieilles guimbardes capitonnées se lancent à l’assaut des grandes routes de l’Amérique aux mille masques.
L'exode a commencé..."
La quatrième et dernière partie, située à La Nouvelle-Orléans lors du Mardi Gras - Le Carnaval des Ombres et les Dernières Illusions -, fonctionne comme un finale opératique et apocalyptique. Le carnaval, avec ses masques et son excès ritualisé, devient la métaphore ultime de tout le livre : la vie comme performance désespérée et le dernier arrêt avant la prise de conscience finale. Les personnages rencontrés ici incarnent les derniers fantasmes et les dernières illusions à être démasqués. Le Mardi Gras est une purge collective, une dernière tentative pour noyer le désespoir dans le frénésie avant le retour au réel du Mercredi des Cendres. Le narrateur erre dans cette bacchanale en spectateur désabusé, observant les derniers actes du drame de la "city of night".
SYLVIA: All My Saintly Children
"... Tandis que mes yeux s’accoutumaient à la lumière glauque - une porte à tentures formant un double écran avec l’Extérieur, la première personne que je remarquai - outre les tapineurs, les tapettes, les michés entrevus au passage - fut une femme brune assise sur un tabouret contre le mur du bar. Elle se pencha vers moi, mais quand je m'installai près d’elle, me demandant si elle me connaissait, elle se détourna. Sous l'éclairage adéquat c’est une femme séduisante, d’une quarantaine d'années. Mais tandis que penchée vers le bar éclairé, elle porte son verre à ses lèvres violemment fardées, elle a l'air garce, endurci, de ces femmes qui dans les films tiennent les rôles d’ex-maîtresses des caïds de la pègre ..."
Sylvia est une figure maternelle de la communauté, une femme qui se présente comme une salvatrice. Elle recueille les âmes perdues, les "enfants" rejetés (jeunes hustlers, drag queens, marginaux), leur offrant un toit, de la nourriture et une forme d'affection. Cependant, son amour est conditionnel et étouffant. Elle exige une loyauté absolue, une adoration en retour, et utilise un langage religieux et guilt-laden pour manipuler et contrôler ceux qu'elle prétend sauver.
Sylvia représente l'illusion du salut par la communauté. Son personnage montre comment les figures d'autorité, même au sein de la marginalité, peuvent recréer des dynamiques de pouvoir et de manipulation. Elle n'offre pas un amour pur et inconditionnel, mais une transaction : la sécurité en échange de la soumission et de la perte d'autonomie.
Ses "enfants saintly" sont des proies idéales car ils portent en eux une immense culpabilité et un désir de rédemption. Sylvia exploite ce besoin pour asseoir son pouvoir. Elle symbolise l'idée que la quête d'une figure salvatrice (une mère, une sainte) est un leurre dangereux qui empêche l'individu de se sauver lui-même.
Comme Skipper à San Francisco (mais avec une autorité "maternelle" et "religieuse"), sa maison est une parodie de foyer, une famille fondée sur la dépendance et la culpabilité plutôt que sur l'amour libre. Elle est la dernière tentative du narrateur de trouver un refuge, qui se révèle être une autre prison.
CHI-CHI: Hey, World!
Chi-Chi est l'antithèse de la mélancolie de Miss Destiny. C'est une drag queen joyeuse, bruyante, provocante et résiliente. Elle affronte la pauvreté, le rejet et la violence non par la tragédie, mais par la fête, la moquerie et une affirmation de soi radicale. Son cri de "Hey, World!" est une déclaration d'existence face à un monde qui veut l'ignorer.
: Chi-Chi incarne une forme de résistance joyeuse. Là où d'autres sont brisés, elle utilise la drag comme une armure invincible. Sa performance n'est pas une fuite (comme pour Lance) mais une weaponisation de son identité. Elle dit : "Vous voulez me ridiculiser ? Je vais être plus ridicule, plus brillante, plus forte que vous ne pourriez jamais l'imaginer."
Son personnage montre que la survie dans la marginalité peut aussi passer par le refus de la victimisation. Elle ne mendie pas l'acceptation ; elle l'exige par sa simple présence exubérante. Elle représente une lueur d'espoir non pas dans le salut, mais dans la capacité à trouver de la joie et de la communauté dans la lutte même.
Dans la grisaille et le désespoir de la fin du voyage, Chi-Chi apporte une note de couleur et de vie. Elle rappelle que la "city of night" n'est pas seulement un lieu de désolation, mais aussi un lieu où des formes d'art, de solidarité et de courage uniques peuvent éclore.
JEREMY: White Sheets
Jeremy est un client qui semble chercher autre chose que le sexe. Il paie le narrateur pour qu'il se déshabille, puis se blottisse nu contre lui sous des draps blancs, dans une forme d'étreinte immobile et non sexuelle. Cette rencontre est étrange, silencieuse et intense, chargée d'une émotion et d'une tristesse profonde.
La scène des draps blancs est l'une des plus poignantes du livre. Jeremy ne paie pas pour un acte de corruption, mais pour un simulacre d'innocence perdue. Les draps blancs évoquent la pureté, la chasteté, peut-être l'enfance ou un amour idéalisé et non charnel. Il cherche une connexion humaine fondamentale qui a été perdue dans l'economie transactionnelle de la nuit.
Jeremy cherche désespérément à retrouver, ne serait-ce qu'un instant, la simplicité d'un contact humain authentique, sans le fard du désir sexuel explicite ou de la performance. Il paie pour de l'intimité sans transaction, ce qui est un paradoxe tragique. Son personnage montre que les "clients" eux-mêmes sont souvent des âmes perdues, en quête de quelque chose que l'argent ne peut réellement acheter.
Le titre "White Sheets" (Draps Blancs) a aussi une connotation funéraire. Cette quête est vouée à l'échec. Le narrateur n'est pas un ange rédempteur ; il est un participant cynique à ce rituel. La rencontre est profondément triste car elle révèle la soif d'amour et de pardon qui hante tous les habitants de la nuit, tout en affirmant l'impossibilité de l'étancher par des moyens artificiels. C'est le dernier et plus tragique des fantasmes auxquels le narrateur est confronté.
La Nouvelle-Orléans est le lieu de la synthèse et de la catharsis. À travers Sylvia, le narrateur rejette l'illusion du salut par une figure extérieure. À travers Chi-Chi, il entrevoit une forme de résistance joyeuse mais sait qu'elle n'est pas sa voie. Enfin, à travers Jeremy, il participe au fantasme ultime : celui de la rédemption et de l'innocence retrouvée, et en constate l'échec poignant.
"... Et me voilà pris au piège de ce monde qui, je le sais maintenant, m'a pourchassé aussi inexorablement qu’une ombre cherche sa source dans l’éclatant soleil...
Ce monde que j’ai aimé et haï, ce monde gris submergé ; ce monde qui n’est pas tellement différent du vôtre. Hors de la nuit et de l'ombre de la solitude, j'ai essayé comme vous de trouver une forme de Salut. Et la solitude et la peur sont en partie responsables : responsables du dégoût ; responsables du spectacle de tous ces gens qui essaient d'émouvoir et renoncent, s’avouant vaincus, trouvant des solutions de rechange qui ne sont que momentanées, pour
justifier leur lutte vaine vers la mort..."
Cette dernière étape laisse l'auteur complètement vide, mais aussi pleinement conscient. Il a tout vu, tout expérimenté, des transactions les plus vénales aux quêtes les plus métaphysiques. La désillusion est maintenant totale et achevée. La "city of night" n'a plus de secret pour lui, et il n'y a plus rien à y chercher. La fin du livre, où il erre sans but, rejetant même les avances, marque la fin de son voyage initiatique : il n'est plus un participant, mais un fantôme hanté par la pleine compréhension de l'absurdité et de la solitude radicale de cette existence. La prise de conscience est amère, mais elle est la seule forme de "vérité" qu'il aura réussi à extraire de la nuit.

Gus Van Sant s'inspirera de "City of Night" pour écrire le scénario de "My Own Private Idaho", sorti sur les écrans en 1991 avec River Phoenix et Keanu Reeves.
Mais il s'agit d'une réinterprétation libre, mêlée à d'autres influences (notamment "Henry IV" de Shakespeare).
Le Milieu est bien celui de la prostitution masculine de rue et de l'errance urbaine et nocturne, des marges LGBTQ+ (avant la visibilité actuelle), avec ses codes, ses dangers et ses hiérarchies.
La Structure Narrative est celle d'un road trip entre Portland, Seattle et Rome, qui rappelle la traversée des villes américaines chez Rechy (LA, SF, NY, La Nouvelle-Orléans) et des rencontres éphémères avec des figures tragiques (clients, prostitués vieillissants, marginaux).
Mike Waters (River Phoenix) incarne une version du Jeremy de Rechy : jeune prostitué naïf, en quête d'amour et de racines (sa recherche obsessionnelle de sa mère dans le film). Scott Favor (Keanu Reeves) reprend quant à lui des traits du narrateur de Rechy : observateur détaché, issu d'un milieu privilégié, qui utilise la rue comme espace de rébellion temporaire. Mais chez Van Sant, la rue est devenue un espace de liberté paradoxal (même précaire), où Mike trouve une forme de famille substitutive (les "street kings") et une vérité sur lui-même. L'amour existe (même non réciproque), il est la seule rédemption possible, bien qu'illusoire. "City of Night" offrait un constat désespéré ; "My Own Private Idaho" en est l'adaptation en fable tragique et lyrique, où la beauté persiste malgré la déchéance...
"City of Night" de John Rechy (1963) fut un Bestseller surprise dès sa sortie (plus de 50 000 exemplaires en 3 mois), depuis traduit en 20 langues et réédité continuellement. On se doute qu'il divisa violemment la critique, mais il est un texte fondateur de la littérature queer & underground. "My Own Private Idaho" de Gus Van Sant (1991) eut un succès relativement modeste mais devint immédiatement un film culte que renforça la mort tragique de River Phoenix (1993). Leur succès réel réside dans leur capacité à survivre aux controverses pour s’imposer comme des miroirs intemporels de la marginalité ..
À une époque où l'homosexualité était largement cachée, criminalisée et stigmatisée (bien avant les évènements de Stonewall, des émeutes qui éclatèrent en juin 1969 à New York, au Stonewall Inn, un bar fréquenté par des personnes LGBTQ+ dans le quartier de Greenwich Village, et qui furent une réaction collective contre les descentes policières fréquentes et violentes dans les bars gays : elles sont souvent considérées comme l'événement fondateur du mouvement moderne pour les droits LGBTQ+ aux États-Unis), Rechy a placé au centre de ses récits des personnages gays, drag queens, prostitués masculins, marginaux et exclus, avec une franchise et une crudité sans précédent. Il a donné une voix et une visibilité à des mondes souterrains largement ignorés ou caricaturés.
Ses premiers romans, notamment "City of Night", sont profondément ancrés dans son expérience vécue comme prostitué masculin itinérant. Il brouille les frontières entre réalité et fiction et décrit la violence, la sexualité explicite, la déchéance et la solitude avec un réalisme brutal : mais y intègre souvent des passages d'une grande beauté lyrique, presque incantatoire.
Son œuvre explore obsessionnellement la condition de l'étranger, de l'exclu, du "Outsider" (titre d'un de ses livres). Il dissèque la quête d'identité dans un monde hostile, le désir de reconnaissance et d'amour, et la construction de soi à travers, ou malgré, le regard des autres et la prostitution.
Rechy a toujours refusé d'être enfermé dans des cases ("écrivain gay", "écrivain chicano" - bien qu'il soit d'origine mexicaine). Son travail dérange, par sa crudité, son refus du politiquement correct et sa représentation sans fard de la complexité (souvent sombre) des désirs humains et des dynamiques de pouvoir, y compris au sein de la communauté gay.
Comment se construit-on lorsqu'on appartient à une minorité (sexuelle, ethnique, sociale) ? Comment négocier son identité entre désir personnel et attentes sociales, entre besoin d'appartenance et affirmation de sa différence ? Rechy montre les stratégies de survie et les masques que l'on porte.
Le corps est central chez Rechy : objet de désir, de transaction, de beauté, de déchéance, d'exploitation, mais aussi de résistance et d'affirmation de soi. La sexualité, souvent explicite, n'est pas gratuite ; elle est un prisme pour explorer le pouvoir, l'identité, la recherche de validation et parfois l'autodestruction.
"Numbers" (1967)
Un roman psychologique obsessionnel. Johnny Rio, un ancien prostitué vieillissant, retourne à Los Angeles et se lance dans un défi masochiste : avoir 30 rencontres sexuelles anonymes ("numbers") en 10 jours dans les parcs de la ville. Une exploration brutale de la peur du vieillissement, de la quête de validation par le sexe, de l'autodestruction et de l'identité.
(Éditions Laurence Viallet, 2018, pour la traduction française)
"The Sexual Outlaw" (1977)
Un ouvrage hybride, entre documentaire sociologique, manifeste et récit autobiographique. Rechy analyse et décrit de l'intérieur la "scène" sexuelle gay anonyme et clandestine (cruising, backrooms, parcs) de Los Angeles dans les années 70, avant le SIDA. C'est un plaidoyer provocateur pour la liberté sexuelle radicale et une chronique d'une époque révolue.
"Rushes" (1979)
Se déroulant presque entièrement dans un bar SM/Leather emblématique de l'époque (le "The Endup" à San Francisco), ce roman plonge dans les fantasmes, les jeux de pouvoir, les peurs et les désirs des clients d'un soir. Une exploration claustrophobe et intense des limites du désir et de la domination.
"The Miraculous Day of Amalia Gómez" (1991)
Un roman qui marque un tournant en mettant en scène une femme, Amalia Gómez, une Mexicaine-Américaine pauvre vivant à Los Angeles. Le roman explore sa lutte pour la survie, sa foi, ses désillusions et sa résilience face à la pauvreté, au machisme et aux défis de l'immigration. Une œuvre puissante sur la communauté Chicana et la condition féminine.
"About My Life and the Kept Woman" (2008)
Une autobiographie captivante qui retrace son enfance à El Paso dans une famille d'origine mexicaine, sa découverte précoce de son homosexualité, ses débuts difficiles en tant qu'écrivain, et bien sûr, les expériences qui ont nourri City of Night et ses autres romans. Essentiel pour comprendre l'homme derrière l'œuvre.

Hubert Selby Jr. (1928-2004)
Né à Brooklyn, fils d'Adalin et d'Hubert Selby Sr. un mineur de charbon du Kentucky qui a servi dans la marine marchande pendant plusieurs années jusqu'à la
naissance de son fils, Selby traverse dès son adolescence la maladie (la tuberculose) puis l'alcoolisme, héritage d'un père qui en est mort, enfin l'héroïne qui le conduit sur une vingtaine
d'années dans la marine marchande, en prison, à l'hôpital psychiatrique, au quasi coma, et à trois divorces. "Last Exit to Brooklyn" raconte dans une prose dès plus concise, "typographique", sa
descente aux enfers, une suite de nouvelles en fonds du quartier de Red Hook, le long des quais de Brooklyn, dans lesquelles des personnages sombrent dans l'obscénité et la violence, condamnés
inéluctables par "les horreurs d'une vie sans amour". Lorsqu'il fut publié en Angleterre en 1966, un jury l'a jugé obscène et a condamné son éditeur à une amende. Livre brutal -
choquant, épuisant, déprimant" (Times) et qui pourtant ne peut être facilement rejeté. Viennent ensuite, moins controversés, "The Room" (1971), "The Demon" (1976), "Requiem for a Dream" (Retour à
Brooklyn, 1978), le recueil de nouvelles "Songs of the Silent Snow" (1986), "The Willow Tree" (1998).

"Last Exit to Brooklyn" (1964)
"Peu de livres ont provoqué autant de controverses que le chef-d’œuvre coup de
poing de Hubert Selby Jr. L’auteur y dresse le portrait fulgurant et halluciné de marginaux new-yorkais,
des victimes et des dépossédés qui évoluent dans un monde fait de violence, de drogue et de
sexe. L’auteur leur rend hommage en plongeant au cœur de leur détresse avec une puissance d’évocation
incroyable. Il retranscrit au plus près la façon dont leur vie se déroule, mais aussi leur style oral, presque à la façon d’une
partition musicale. On pénètre ainsi tour à tour l'esprit d'une bande de gros durs qui aiment casser du marin et du pédé, d'un travesti amoureux, Georgie, ou celui d'une prostituée aux seins hors
du commun. " (Edition Albin Michel)
La jungle urbaine de la banlieue new-yorkaise constitue le décor du livre : un bistrot louche, "Chez le Grec", des appartements plus ou moins sordides où se retrouvent petits malfrats drogués à la marijuana, à la morphine et à la benzédrine avec leurs amies, les trottoirs nocturnes où l`on dévalise les passants attardés, où l`on se bagarre avec les soldats de la base militaire toute proche, et où les filles se prostituent. La violence et la cruauté règnent partout : non seulement le sang coule dès les premières pages du livre, mais les personnages s'entredéchirent pour le seul plaisir de s`humilier : ainsi Georgette, le travesti aux touchantes aspirations culturelles, est ridiculisée par Vinnie, le voyou dont elle est amoureuse et qui la repousse avec mépris. Tralala, quant à elle, dévalise des hommes d'affaires après les avoir séduits, puis, avec sa bande, commet plusieurs vols avec effraction. Elle rejette alors le seul amour qui lui est offert, se livre à une prostitution de plus en plus maladive et finit violée dans un terrain vague par une bande de types soûls. Autre personnage tragique, Harry Black supporte mal les demandes sexuelles de sa femme, et chaque nuit il est en proie à des cauchemars atroces. A l`usine où il travaille, il a déclenché une grève en tant que dirigeant syndical. Parmi les piquets de grève, dans les affrontements avec le patronat et la police, puis dans un bar spécialisé, il découvre son homosexualité. Harry tombe amoureux d`un travesti, Regina, qui ne s`intéresse qu'à son argent. Harry finira dans le même terrain vague que Tralala, après s`être fait battre comme plâtre par ses anciens amis de "Chez le Grec"...

"Last Exit to Brooklyn" n’est pas un roman linéaire au sens traditionnel. Il s'agit d’un cycle de récits imbriqués dans un même espace urbain — un quartier ouvrier de Brooklyn dans les années 1950 — avec des personnages récurrents, parfois croisés, dans un climat de violence, d’aliénation et de déchéance sociale. Le style est brut, sans ponctuation classique, et le langage est volontairement cru. Le lien entre les parties repose davantage sur l’ambiance sociale et les thèmes (misère, sexualité réprimée, violence structurelle) que sur une intrigue suivie.
Chaque section explore une facette différente de la déshumanisation urbaine, autour de types marginaux : ouvrier sadique, transsexuelle, prostituée, gang de jeunes désœuvrés, etc. La progression donne une cartographie morale du quartier et construit une tragédie collective, où aucun personnage n’est sauvé, chacun condamné par sa condition, son genre ou sa classe.
La construction de "Last Exit to Brooklyn" repose sur une structure en éventail autour de la déchéance des classes populaires américaines. Chaque partie est un miroir brisé d’un même monde : les corps sont blessés, exploités, réduits à des fonctions sociales (sexe, travail, reproduction), les identités (de genre, sexuelles, sociales) sont piégées dans un environnement oppressant, il n’y a ni progression, ni échappatoire, seulement des variantes d’un échec inévitable. Le « dernier arrêt » est donc métaphysique autant que social....
NB.: Editions Albin Michel, 2014, pour la traduction française, mais malheureusement on notera que Selby Jr. utilise un argot très daté des bas-fonds new-yorkais des années 50, mélangé à des techniques stylistiques radicales (absence de guillemets, flux de conscience), ce qui rend beaucoup de traductions très peu lisibles ...

"Last Exit to Brooklyn" / Part I - "Another Day Another Dollar"
Mise en place d’un Brooklyn sordide, brutal, sans issue, une bande de gars – Vinnie, Harry, Tommy, Abe... tous interchangeables, anonymes, presque des fonctions sociales plus que des individus, ils parlent de rien, se battent, attendent la paye pour se saouler, violence gratuite et misogynie, les femmes sont absentes ou réduites à l’état de fantasmes sexuels. Le style fragmentaire mime leur pensée décousue, leur rage muette, leur impuissance....
"THEY sprawled along the counter and on the chairs. Another night. Another drag of a night in the Greeks, a beatup all night diner near the Brooklyn Armybase. Once in a while a doggie or seaman came in for a hamburger and played the jukebox. But they usually played some goddam hillbilly record. They tried to get the Greek to take those records off, but hed tell them no. They come in and spend money. You sit all night and buy notting. Are yakiddin me Alex? Ya could retire on the money we spend in here. Scatah. You dont pay my carfare . . .
Ils étaient vautrés tout le long du comptoir et sur les chaises. Encore une soirée. Encore une soirée chiante à tirer chez le Grec, un diner pourri ouvert toute la nuit près de la base militaire de Brooklyn. De temps en temps un biffin ou un mataf entrait bouffer un hamburger et faisait jouer le jukebox. Mais d/ ordinaire ils mettaient le disque à la gomme d/ un quelconque plouc. Ils demandaient bien au Grec de remplacer ces disques-là, mais y leur disait non. Ils viennent ici dépenser leur argent. Vous, vous traînez toute la nuit sans acheter que dalle. Tu tfousdmoi Alex ? Tu pourrais prendre ta retraite rien qu/avec le pognon qu/ on claque ici. Skata. Ça paye même pas mon trajet en bagnole…"
L'intention de Selby dans "Another Day Another Dollar" est de créer un document littéraire brutal et implacable sur les effets déshumanisants de la pauvreté, de l'exploitation et de l'ennui. C'est une plongée dans un enfer social où la violence est la seule langue parlée et où toute forme d'échappatoire – l'alcool, le sexe, la rêverie – conduit à une destruction encore plus grande. Le livre n'est pas une lecture facile, mais c'est une œuvre profondément morale qui force à regarder en face les parts les plus sombres de la condition humaine et de la société.
Selby peint l'envers cauchemardesque de l'American Dream des années 1950. Loin de la prospérité et de l'optimisme, il montre une classe ouvrière aliénée, exploitée économiquement (les grèves et la corruption des syndicats sont des thèmes sous-jacents) et détruite spirituellement. Le titre lui-même, "Another Day Another Dollar", est une expression de résignation qui résume leur condition : une vie réduite à une unité de travail et de salaire dérisoire, sans espoir d'ascension sociale.
La violence n'est pas présentée comme un acte gratuit de "mauvais garçons", mais comme le produit direct d'un système. La violence économique (chômage, pauvreté), sociale (absence de perspective) et psychologique (ennui, humiliation) engendre une violence physique qui se décharge sur les plus faibles : les femmes, les homosexuels (dans d'autres parties du livre), les marginaux. Les hommes de Selby sont à la fois les bourreaux et les victimes d'une machine sociale qui les broie.
L'écriture de Selby est un choix esthétique et éthique majeur. Absence de ponctuation traditionnelle : Peu de points, pas de guillemets pour les dialogues. Les pensées et les paroles se confondent dans un flux continu, mimant la confusion mentale des personnages et l'absence de délimitation claire entre leur intériorité et le monde extérieur. Il utilise la langue brute, vulgaire et authentique de la rue. Cela plonge le lecteur dans l'univers sans fard et refuse tout romanticisme. Les mêmes phrases, les mêmes insultes, les mêmes actions se répètent, créant un effet hypnotique et absurde qui renforce le sentiment d'enfermement et d'absence d'issue ("Last Exit").
Et le lecteur est immergé de force : Selby ne donne pas de point de vue extérieur ou moralisateur. Le lecteur est plongé dans la conscience de ces hommes, obligé de voir le monde à travers leurs yeux troubles et violents. C'est une expérience déstabilisante et volontairement provocatrice.
En faisant de ses personnages des fonctions (le bagarreur, le suiveur, le rêveur amer), Selby montre comment le capitalisme et la culture de masse (symbolisée par le jukebox et les rêves hollywoodiens) vident l'individu de son humanité. Les femmes sont réduites à des "c***" (le terme est omniprésent dans le livre), de simples objets sexuels. Les hommes eux-mêmes ne sont que des "gars", une masse indistincte. La quête d'identité, de connexion et de sens est totalement pervertie.

"Last Exit to Brooklyn" / Part II - "The Queen Is Dead"
Georgette, une femme trans, amoureuse de Vinnie, un voyou hétérosexuel et macho : malgré son affection, Vinnie ne ressent que du mépris et de la violence envers elle. Le texte plonge dans les pensées de Georgette, sans transition claire. Le lecteur est parfois perdu entre les événements "réels" et les désirs ou délires de Georgette. Ne pas chercher une linéarité mais des affects, des violences sociales qui explosent par fragments ...
"GEORGETTE was a hip queer. She (he) didnt try to disguise or conceal it with marriage and mans talk, satisfying her homosexuality with the keeping of a secret scrapbook of pictures of favorite male actors or athletes or by supervising the activities of young boys or visiting Turkish baths or mens locker rooms, leering sidely while seeking protection behind a carefully guarded guise of virility (fearing that moment at a cocktail party or in a bar when this front may start crumbling from alcohol and be completely disintegrated with an attempted kiss or groping of an attractive young man and being repelled with a punch and— rotten fairy—followed with hysteria and incoherent apologies and excuses and running from the room) but, took a pride in being a homosexual by feeling intellectually and esthetically superior to those (especially women) who werent gay (look at all the great artists who were fairies!); and with the wearing of womens panties, lipstick, eye makeup (this including occasionally gold and silver—Stardust— on the lids), long marcelled hair, manicured and polished fingernails, the wearing of womens clothes complete with padded bra, high heels and wig (one of her biggest thrills was going to BOP CITY dressed as a tall stately blond ( she was 6'4" in heels ) in the company of a negro (He was a big beautiful black bastard and when he floated in all the cats in the place jumped and the squares bugged. We were at a crazy pad before going and were blasting like crazy and were up so high that I just didnt give a shit for anyone honey, let me tell you! ) ) ; and the occasional wearing of a menstrual napkin.
She was in love with Vinnie and rarely came home while he was in jail, but stayed uptown with her girl friends, high most of the time on benzedrine and marijuana. She had come home one morning with one of her friends after a three day tea party with her makeup still on and her older brother slapped her across the face and told her that if he ever came home like that again hed kill him. She and her friend ran screaming from the house calling her brother a dirty fairy. After that she always called to see if her brother was in before going home.
Her life didnt revolve, but spun centrifugally, around stimulants, opiates, johns (who paid her to dance for them in womens panties then ripped them off her; bisexuals who told their wives they were going out with the boys and spent the night with Georgette ( she trying to imagine they were Vinnie) ), the freakish precipitate coming to the top...."
"Georgette était une folle dernière mode. Elle (il) n/ essayait pas de donner le change ni de le cacher par le mariage et un langage viril, satisfaisant secrètement son homosexualité en tenant un album de ses acteurs ou de ses athlètes préférés ou en dirigeant des activités de jeunes garçons ou en fréquentant les hammams ou les vestiaires d/ hommes, histoire de lorgner de biais tout en cherchant à se protéger derrière le rempart d/une virilité soigneusement feinte (redoutant linstant classique dans une soirée ou un bar où cette façade risquait de commencer à se désagréger comme leffet de lalcool et d/ être entièrement désintégrée par la tentative de voler un baiser ou de peloter un séduisant jeune homme et de se faire repousser d/ un coup de poing et – sale pédé – suivi d/une explosion de rage générale et d/ un flot d/ excuses incohérentes pardon pardon avant de sortir en courant) fière au contraire d’être homosexuelle se sentant intellectuellement et esthétiquement supérieure à ceux (particulièrement les femmes) qui n/étaient pas gay (qu’on pense à tous les grands artistes qui sont pédés !) ; et elle mettait des petites culottes de femmes, portait du rouge à lèvres, du mascara (cela comportant à loccasion de lor et de largent – poussière d/ étoile – sur les paupières), avait une longue chevelure ondulée, des ongles manucurés et vernis, portait des vêtements féminins jusqu/ au soutien-gorge rembourré, talons hauts et perruque (un de ses plaisirs les plus affriolants étant d/aller au BOP CITY vêtue en grande blonde majestueuse (plus d/ un mètre quatre-vingt-dix en talons) accompagnée d/ un nègre (c/ était un beau et grand noir baraqué et quand il entrait d/ une démarche élastique tous les jazzeux de la boîte en étaient baba et les caves devenaient maboules. On est allés dans une fumerie avant de venir et on a fumé comme des malades. On était tellement défoncés que j/ emmerdais la terre entière mon chou, j/ aime mieux te dire !)) ; et quand ça lui prenait mettait une serviette hygiénique.
Elle était amoureuse de Vinnie et rentra rarement chez elle quand il fit de la taule, elle restait à Manhattan avec ses copines, défoncées la plupart du temps à la benzédrine et à la marijuana. Elle était rentrée un matin avec une de ses copines après trois jours de fumette ininterrompue encore maquillée et son frère aîné lui avait flanqué une baffe en lui disant que si jamais il rentrait encore une fois dans cet état il le tuerait. Avec la copine elles s/ étaient enfuies de la maison en poussant des cris et en traitant son frère de sale pédé. Après quoi elle téléphonait toujours pour voir s/ il était là avant de rentrer.
Sa vie ne tournait pas, elle tourbillonnait comme dans une centrifugeuse, autour des stimulants, des opiacés, des michés (qui la payaient pour danser devant eux en petite culotte qu/ ils déchiraient ensuite sur elle ; des bisexuels qui racontaient à leur femme qu/ ils sortaient entre copains puis allaient passer la nuit avec Georgette (elle essayant de s/ imaginer qu’ils étaient Vinnie)), le précipité désaxé montant à la surface..."
Georgette rêve d’un amour réciproque, d' illusion romantique nourrie par le cinéma hollywoodien, en totale contradiction avec la réalité sordide de sa vie qui n'est que moqueries, brutalités, solitude. Elle organise une fête en l'honneur de Vinnie et, sous l'emprise de l'alcool et des pilules, tente une déclaration d'amour publique, sur fond de Charlie Parker, surprenant son auditoire, se suprenant elle-même : il ne s'ensuit pas une scène de violence, mais d'indifférence brutale, Vinnie se tourne vers d'autres partenaires et l'ignore totalement. Nous sommes toujours dans la tête de Georgette, des sentiments à vif et la complète dissolution de son être : psychologiquement et physiquement détruite, elle s'effondrera dans un désespoir absolu. Aucune rédemption n'est possible.
Le passage clé est la scène de la fête où tout bascule : Georgette droguée observe la dégradation de la soirée, avec le viol de Lee en point d'orgue. La difficulté majeure est de rendre "stoned out of his head" ("complètement défoncé", mais il faut garder l'image de la pierre), les onomatopées comme "HAARRR" (à conserver en majuscules), les termes techniques ("bennie", "syrette") et l'argot homophobe ("cocksucker", "fairy").Particulièrement complexe à rendre, le monologue intérieur de Georgette ("VINNie and MS") où MS signifie probablement "Miss Georgette". Sa répétition obsessionnelle doit sonner comme une litanie. Et la transition brutale quand Harry l'agresse : passer du rêve éthéré à la violence crue....
Un texte brut, violent, avec un flux de conscience typique de Selby Jr. qui mélange argot, violence sexuelle et désespoir.
"Georgette sat back and sipped her gin for many seconds. Harry got up and chirped at Georgette, stoned out of his head, and plopped down beside Lee. Georgette followed him with her eyes, still sipping gin and still fighting for control of herself. She could not fuck it up now. It wont be long. It wont be long. Vinnie and MS. Yes. She picked up the bottle of gin and refilled Malfies glass and asked him if he would let Goldie do him. Malfie closed his eyes slightly and smiled, took the glass from her hand. Got more bennie? She patted his cheek and got two more for him and went to tell Goldie that everything was arranged. O everything is just so wonderful. Vinnie and his boys are stoned out of their heads and soon she would have Vinnie. Goldie took her into the bedroom and gave her a syrette. Arent you going to take one? Not now honey. I/ll wait until after that big cocked guinea has fucked me. So Georgette shot up and waited for the first wave to pass then went back to her throne, next to Vinnie. He was yakking with Malfie and Harry—Lee and Camille joining in, Goldie just watching Malfie and occasionally laughing—and tugged Georgettes ear when she sat down. She smiled and did a rolling bump before sitting down, nodding modestly to the applause. Georgette whirled digging the scene and everybody was swinging. Even Harry and Lee were making it and the sounds came from the radio and Camille was snapping her fingers (a little too demonstratively if you ask me, but its alright because we/re (Vinnie and MS—VINNIE) swinging) and everything fell into its proper place, all words fitted; and Goldie sat beside Malfie and he grinned, aspet . . . una moment; and Camille felt real bitchy and daring and winked at Sal and he tried to speak but he couldnt stop grinding his teeth and his head just lolled back and forth, droplets of scotch dribbling down his chin, but he was so strong and handsome—O what a marvelous chin—and she giggled thinking of the letter she would write to the pinkteas back home: O honey, do you know from nothing. What a gorgeous way to lose ones virginity! Sal laughed and blurted, I gotit swingin bitch HAARRR; and Malfie emptied his glass, refilled it and followed Goldie into the bedroom and Georgette watched, floating around their heads bopping SALT PEAnuts, SALT PEAnuts—quoth the Diz evermore—Vinnie and MS—VINNie and MS—and Lee moved a few inches and Harry grabbed her by the arm and yanked her back, Where doya think ya goin, queeny, grabbing her wrist and forcing it between his legs. I gotta nice hunkka meat forya and Vinnie yelled, Is she tryin ta get fresh witya man? and they both roared and Lee started to panic, trying to free her arm, but Harry squeezed tighter and twisted until she screeched, Stop, Stop! Youre hurting me you vile fairy (wonderful, wonderful. This should teach you a lesson you evil queen. He is what you deserve. VINNie and MS—VINNie and MS—cause we/re having a party and the people are nice, and the people are nice . . . ) and Harrys eyes bugged even more and he stood up and pulled Lee off the couch, comon motherfucka. You wanna look like a broad ya gonna get fucked like one (Camille shoved her fingers in her mouth, rose halfway then fell back onto the couch and inched her way to the other end (but hes not like that (?) ) )—Hey Vinnie, come-on. Lets throw a hump intaer. Shit man, Im down. Letsgo. He grabbed her other arm and they started dragging her to the bedroom, screaming, screeching, crying, pleading and they roared and twisted her arms then Harry grabbed her by her hair, her precious golden shoulder length hair, and slapped her face. Comeon ya cocksucker. Stop theshit. Hey Maine, open the door. Malfie opened the door and grinned as they dragged Lee in, and Goldie shrieked and ran from the room, the door slamming behind her. She listened to Lee screaming and the guys slapping her and cursing as they ripped her dress off . . . then Goldie swallowed a half dozen bennies; Camille looked at Georgette, who hadnt moved ( No, No! No you fucking bitch. VINNie VINNie . . . VINNIE!!! Not with Lee. I love you Vinnie. I love you. He will see my red spangled G string. Please Vinnie. Vinnie . . .), Camille looked at Georgette then at Sal as he wobbled across the room toward her. No room in there. He opened his fly and yanked out his cock ( Its so big. And red. Be careful of your eyes. Put your arms around his ass) O???? O . . . Sal? Sal dont. Sal? Please. Ple-I got a big lob forya. Sa—he shoved it in her mouth and grabbed her long-shining-wavy-auburn-hair—Lee stopped squirming as Vinnie and Malfie held her and Harry mounted her. Vaseline. Vaseline! Please, not without vaseline. Vinnie handed her the jar, then Lee said alright then closed her eyes and cringed as Harry lunged viciously then put her arms around him and her legs around his waist. Vinnie and Malfie leaned against the wall and Harrys sweat fell on Lees face and she smiled and sucked his neck and groaned, hoping he would never come, that he would continue to lunge and lunge and lunge . . .- Thats the way Camille. Thats it HAHA OOOOO Hey, take it easy with yatongue, and Camille clutched at his belt hoping she was doing it properly; and Goldie took the syrette from her pocket, calmer now that the screaming had stopped, and though she did not approve of Camille having public sex like that she had to admit that she did not have much choice in the matter, and they did so seem to enjoy each other ( I hope Malfie wont be completely useless after this), and turned on."
Traduction fidèle (sans censure, mais lire avec précaution)
"Georgette se renversa en arrière et sirota son gin pendant de longues secondes. Harry se leva, jacassa vers Georgette, complètement défoncé, et s’affala à côté de Lee. Georgette le suivit des yeux, sirotant toujours son gin et luttant pour garder le contrôle. Elle ne pouvait pas tout foutre en l’air maintenant. Plus longtemps. Plus longtemps. Vinnie et Moi. Oui. Elle saisit la bouteille de gin, remplit le verre de Malfie et lui demanda s’il laisserait Goldie s’occuper de lui. Malfie ferma légèrement les yeux, sourit, prit le verre. « T’as plus de bennie ? » Elle lui tapota la joue, lui en donna deux autres, et alla dire à Goldie que tout était arrangé. Oh, tout est si merveilleux. Vinnie et ses gars sont défoncés à bloc et bientôt elle aurait Vinnie. Goldie l’entraîna dans la chambre et lui tendit une siringue. « T’en prends pas une ? — Pas maintenant, chérie. J’attendrai qu’ce gros bite d’italien m’ait baisée. » Georgette se shoota, attendit que la première vague passe, puis revint à son trône, près de Vinnie. Il jacassait avec Malfie et Harry—Lee et Camille se joignaient à eux, Goldie regardait juste Malfie en riant parfois—et tira l’oreille de Georgette quand elle s’assit. Elle sourit, fit un déhanché roucoulant avant de s’asseoir, saluant modestement les applaudissements. Georgette tournoyait, kiffant la scène, tout le monde swingait. Même Harry et Lee s’envoyaient en l’air, la musique venait de la radio, Camille claquait des doigts (un peu trop démonstratif à mon goût, mais c’est ok parce qu’on (Vinnie et Moi—VINNIE) swingue) et tout tombait à sa place, les mots s’emboîtaient ; Goldie s’assit près de Malfie qui ricana, « aspet… una moment » ; Camille, se sentant salope et audacieuse, fit un clin d’œil à Sal qui tenta de parler mais ne pouvait arrêter de grincer des dents, sa tête dodelinant, des gouttes de scotch dégoulinant sur son menton—mais il était si fort et beau—Oh, quel menton merveilleux—et elle gloussa en pensant à la lettre qu’elle écrirait aux coincées de chez elle : « Oh, ma chérie, tu connais que dalle. Quelle façon sublime de perdre sa virginité ! » Sal rit et brailla : « J’ai ça qui swingue, salope HAAAAAARRR » ; Malfie vida son verre, le remplit et suivit Goldie dans la chambre. Georgette regarda, planant autour de leurs têtes en scatant SALT PEAnuts, SALT PEAnuts—dixit Diz à jamais—Vinnie et Moi—VINNIE et Moi—et Lee bougea de quelques centimètres. Harry l’attrapa par le bras et la tira en arrière : « Où tu crois aller, pédale ? », empoignant son poignet et le forçant entre ses jambes. « J’ai un beau morceau pour toi. » Vinnie hurla : « Elle essaye de te draguer, mec ? » Ils rugirent tous deux. Lee paniqua, tentant de libérer son bras, mais Harry serra plus fort, tordant jusqu’à ce qu’elle hurle : « Arrêtez ! Vous me faites mal, sale folle ! » (Merveilleux, merveilleux. Ça t’apprendra, méchante queen. C’est ce que tu mérites. VINNIE et Moi—VINNIE et Moi—parce qu’on fait la fête et les gens sont gentils, les gens sont gentils…) Les yeux d’Harry exorbités, il se leva, tira Lee du canapé : « Allez, enculé. Tu veux ressembler à une meuf ? Tu vas te faire baiser comme une meuf. » (Camille enfonça ses doigts dans sa bouche, se souleva à moitié puis retomba sur le canapé, rampant vers l’autre bout (mais il est pas comme ça (?) )) — « Hé Vinnie, viens. Jetons-lui une levrette. — Merde, ouais. J’suis chaud. Allons-y. » Il lui attrapa l’autre bras. Ils la traînèrent vers la chambre, elle hurlait, criait, pleurait, suppliait. Ils rugirent, lui tordirent les bras. Harry lui saisit les cheveux—ses précieux cheveux dorés tombant sur les épaules—et la gifla : « Allez, suceuse de bites. Arrête ton cinéma. Hé Maine, ouvre la porte. » Malfie ouvrit en ricanant tandis qu’ils traînaient Lee à l’intérieur. Goldie cria et s’enfuit, la porte claquant derrière elle. Elle écouta Lee hurler, les gars la gifler, jurer en lui déchirant sa robe… Goldie avala une demi-douzaine de bennies. Camille regarda Georgette, immobile (Non, Non ! Non, salope de merde. VINNIE VINNIE… VINNIE !!! Pas avec Lee. Je t’aime Vinnie. Je t’aime. Il verra mon string pailleté rouge. S’il te plaît Vinnie. Vinnie…), Camille regarda Georgette puis Sal vacillant vers elle : « Pas de place là-dedans. » Il ouvrit sa braguette, sortit sa bite (C’est tellement gros. Et rouge. Attention à tes yeux. Mets tes bras autour de ses fesses) Oh ???? Oh… Sal ? Sal non. Sal ? S’il te plaît. Ple— « J’ai une grosse bite pour toi. » Sa—il la lui enfonça dans la bouche, agrippant ses longs-cheveux-rousse-ondulés-luisants—Lee cessa de se débattre. Vinnie et Malfie la tenaient, Harry la chevauchait. « Vaseline. Vaseline ! S’il te plaît, pas sans vaseline. » Vinnie lui tendit le pot. Lee dit « D’accord », ferma les yeux, grimpa quand Harry entra sauvagement, puis passa ses bras autour de lui, ses jambes autour de sa taille. Vinnie et Malfie s’adossèrent au mur. La sueur d’Harry tomba sur le visage de Lee. Elle sourit, suça son cou, gémit, espérant qu’il ne jouirait jamais, qu’il continuerait d’entrer, d’entrer, d’entrer…
« Comme ça, Camille. C’est ça HAHA OOOOO Hé, doucement avec ta langue. » Camille s’agrippait à sa ceinture, espérant bien faire. Goldie sortit la siringue de sa poche, calmée maintenant que les cris s’étaient tus. Même si elle désapprouvait Camille faisant l’amour en public ainsi, elle devait admettre qu’elle n’avait pas le choix—et ils semblaient tant s’apprécier (J’espère que Malfie sera pas complètement inutile après ça). Et elle se défonça..."
Cette version assume la radicalité de Selby Jr. - refusant l’euphémisation qui trahit son projet littéraire : montrer la désintégration des corps et des consciences dans l’enfer brooklynais...
Selby fait un choix audacieux : il ne parle pas de la marginalité, il parle depuis la marginalité. Il utilise son style fragmentaire et hypnotique non plus pour mimer la pensée d'un groupe, mais pour épouser la conscience fracturée d'un individu ultra-exclu. Il plonge le lecteur dans la peau d'une personne que la société de l'époque (et encore aujourd'hui dans une large mesure) rejette, méprise et ne cherche même pas à comprendre. C'est une immersion empathique forcée, et donc profondément dérangeante.
La violence ici n'est plus seulement physique (même si elle est omniprésente). Elle est psychologique et institutionnelle.
Georgette a intériorisé la haine du monde. Son monologue intérieur est plein de honte et de désir de conformité ("si seulement j'étais une vraie femme"). Les souvenirs de son frère qui la bat et la renie ajoutent une couche de traumatisme. Sa survie dépend de la prostitution, la mettant en danger constant. Selby montre que la violence des voyous comme Vinnie n'est que la partie émergée de l'iceberg ; elle est alimentée par une violence sociale bien plus large qui refuse toute place à la différence.
Tout le récit de Georgette est construit sur un fantasme : que l'amour de Vinnie la sauvera et la légitimera. Selby construit méticuleusement ce fantasme avec les rêveries de Georgette pour mieux en révéler la vacuité absolue. L'intention est de montrer que dans ce monde brutal, il n'y a pas d'issue, pas de rédemption possible par l'amour romantique. Le système de valeurs (la masculinité toxique, l'hétéronormativité) est une prison dont même les rêves ne peuvent s'échapper.
Georgette est une figure tragique au sens classique. Elle est animée par une quête (l'amour, la reconnaissance) qui est par essence impossible dans son monde, et cette quête même précipite sa chute. Selby élève ainsi son histoire au rang de tragédie, accordant une dignité littéraire à une vie que tout le monde considérerait comme sans valeur. Il ne juge pas Georgette ; il expose la mécanique implacable de sa destruction.

"Last Exit to Brooklyn" / Part III - "And Baby Makes Three"
"THE baby was christened 4 hours after the wedding. Well, whatthehell, they got married first anyway. But I/ll tellya man, it was a ball! I mean after. Her old man threw a great party..." -
La plus brève et la plus ambiguë des "nouvelles" du recueil. Elle tranche avec les deux premières par son atmosphère presque banale, mais elle est tout aussi violente, au moins psychologiquement.
Trois personnages, Suzy, une jeune femme enceinte, mariée, passive et soumise, Tommy, son mari, ouvrier, frustré, brutal, immature, et le bébé à venir.
Le quotidien d’un jeune couple, marié après une grossesse non prévue. Suzy, enceinte, est isolée, sa famille la rejette, sa belle-famille est absente, Tommy est distant. Tommy travaille, sort avec ses amis, évite le foyer, passe ses nerfs sur elle verbalement, parfois physiquement. La tension monte dans une routine d’asphyxie conjugale, repas mal cuits, silences, regards vides. Suzy tente parfois d’être aimante, de décorer la maison, d’imaginer un avenir, mais tout s’effondre. La fin restera ouverte : elle accouche (hors champ), mais on ne sait rien du devenir du couple ni du bébé.
Le titre "And Baby Makes Three" fait allusion à la formule optimiste des années 50 : mari, femme, bébé, le Bonheur. Mais ici, le bébé ne réunit pas, il sépare. Il est la cause d’un mariage forcé, sans amour ni projet, d'autant que Tommy est incapable d’aimer, de parler, de grandir. Quant à Suzy, elle vit dans l’attente, l’abandon, l’incompréhension. La pauvreté affective est plus tragique que la pauvreté matérielle ...

"Last Exit to Brooklyn" / Part IV - "Tralala"
"Tralala" est l’un des morceaux les plus célèbres et les plus choquants de Last Exit to Brooklyn. Elle dépeint la lente descente aux enfers d’une prostituée, Tralala, dans une ville sans amour ni loi. C’est un récit de déshumanisation, de vide existentiel et de viol collectif, écrit dans un style haletant et brutal.
"TRALALA was 15 the first time she was laid. There was no real passion. Just diversion. She hungout in the Greeks with the other neighborhood kids. Nothin to do. Sit and talk. Listen to the jukebox. Drink coffee. Bum cigarettes. Everything a drag. She said yes. In the park. 3 or 4 couples finding their own tree and grass. Actually she didnt say yes. She said nothing. Tony or Vinnie or whoever it was just continued. They all met later at the exit. They grinned at each other. The guys felt real sharp. The girls walked in front and talked about it. They giggled and alluded. Tralala shrugged her shoulders. Getting laid was getting laid. Why all the bullshit? She went to the park often. She always had her pick. The other girls were as willing, but played games. They liked to tease. And giggle. Tralala didn't fuckaround. Nobody likes a cockteaser. Either you put out or you dont. Thats all. And she had big tits. She was built like a woman. Not like some kid. They preferred her. And even before the first summer was over she played games. Different ones though. She didnt tease the guys. No sense in that. No money either. Some of the girls bugged her and she broke their balls. If a girl liked one of the guys or tried to get him for any reason Tralala cut in. For kicks. The girls hated her. So what. Who needs them. The guys had what she wanted. Especially when they lushed a drunk. Or pulled a job. She always got something out of it. Theyd take her to the movies. Buy cigarettes. Go to a PIZZERIA for a pie. There was no end of drunks. Everybody had money during the war. The waterfront was filled with drunken seamen. And of course the base was filled with doggies. And they were always good for a few bucks at least. Sometimes more. And Tralala always got her share. No tricks. All very simple. The guys had a ball and she got a few bucks. If there was no room to go to there was always the Wolffe Building cellar. Miles and miles of cellar. One screwed and the others played chick. Sometimes for hours. But she got what she wanted. All she had to do was putout. It was kicks too. Sometimes. If not, so what? It made no difference...."
"Tralala avait 15 ans la première fois qu’elle s/ était fait baiser. Sans passion. Seulement pour la distraction. Elle traînait chez le Grec avec les autres mômes du quartier. Rien à glander. Assise à bavarder. Écouter le jukebox. Boire du café. Taper des sèches. Tout ça chiant. Elle avait dit oui. Dans le parc. 3 ou 4 couples cherchant chacun son arbre, et de lherbe. D/ ailleurs elle avait pas dit oui. Elle avait dit que dalle. Tony ou Vinnie ou va savoir quel autre avait persévéré, voilà tout. Ils s/ étaient tous retrouvés après à la sortie. Ils s/ étaient souri. Les mecs se sentaient plus. Les nanas marchaient devant pour en parler. Avec des gloussements et des allusions. Tralala haussait les épaules. Se faire baiser c/ était se faire baiser. Pas de quoi en chier une pendule. Elle se mit à aller au parc souvent. Elle choisissait qui elle voulait, toujours. Les autres nanas demandaient pas mieux, mais elles jouaient à des petits jeux. Elles aimaient allumer. Avec des gloussements. Tralala y allait pas par quatre chemins. Personne aime les allumeuses. T/ as la marchandise ou pas. C/ est tout. Et elle avait de gros nichons. Elle était faite comme une femme. Pas comme une môme. Ils la préféraient. Et le premier été était même pas fini qu’elle s/ était mise à jouer à des jeux elle aussi. Mais pas les mêmes. Elle n/ allumait pas les garçons. Ça rimait à rien. Pas de fric non plus. Quelques-unes des nanas la faisaient chier et elle leur cassait leur coup. Quand une nana trouvait un mec à son goût ou essayait de se le faire pour quelque raison que ce soit Tralala intervenait. Pour se marrer. Les nanas la détestaient. Et puis après. Rien à cirer. C/ étaient les mecs qui l/ intéressaient. En particulier quand ils avaient dépouillé un pochetron. Ou fait un casse. Y l/ emmenaient au cinoche. Acheter des sèches. Dans une PIZZÉRIA bouffer une pizza. C/ étaient pas les pochetrons qui manquaient. Tout le monde avait du fric pendant la guerre. Les quais étaient pleins de matafs bourrés. Et bien sûr la base pleine de biffins. Et ils avaient toujours quelques billets sur eux au moins. Plus, des fois. Et Tralala avait toujours sa part. C/ étaient pas des passes. Tout était très simple. Les mecs s/ envoyaient en l’air et elle palpait quelques billets. Quand y avait pas de chambre disponible y restait toujours la cave du Wolffe Building. Des kilomètres et des kilomètres de cave. Un qui baisait et les autres qui faisaient le pet. Des fois pendant des heures. Mais elle avait ce qu/ elle voulait. On lui demandait que d/ ouvrir les cuisses. Et elle prenait son pied aussi. Des fois. Des fois pas, et alors ? Qu/ est-ce que ça changeait ?..."
Tralala est une jeune prostituée des bas-fonds de Brooklyn. Elle est belle, narcissique, vulgaire et n’éprouve aucun affect, sauf un mélange de haine et de vide : Tralala n’a jamais été aimée, ne sait pas aimer. Elle passe ses journées dans un bar miteux (le Greeks), à aguicher des marins et soldats en permission. Elle couche avec eux, les arnaque, ou les conduit à se faire tabasser par d'autres types pour les dépouiller. Elle méprise tous les hommes, se moque des filles naïves, et rit de la misère des autres. Elle semble triompher dans cet univers pourri. Puis elle rencontre ainsi Albert, un jeune militaire qui tombe sincèrement amoureux d’elle : elle le manipule, feint d’y croire, puis le pille froidement et le laisse seul, détruit. Désormais, plus personne ne veut d’elle. Elle vieillit, perd de son pouvoir. Elle est laissée de côté dans le bar, méprisée par les hommes comme par les autres prostituées.
Mais lors d’une nuit de beuverie, Tralala est emmenée dans une voiture, puis dans un terrain vague, où elle est violée par une foule d’hommes, un à un, puis en groupe, pendant des heures. Elle ne résiste pas. Elle rit, hurle, gémit, délire, incapable de sentir quoi que ce soit. Son corps est laissé à moitié nu, dans la rue. On ne sait pas si elle est morte ou simplement brisée.
"... and the 10 or 15 drunks dragged Tralala to a wrecked car in the lot on the corner of 57th street and yanked her clothes off and pushed her inside and a few guys fought to see who would be first and finally a sort of line was formed everyone yelling and laughing and someone yelled to the guys on the end to go get some beer and they left and came back with cans of beer which were passed around the daisychain and the guys from the Greeks cameover and some of the other kids from the neighborhood stood around watching and waiting and Tralala yelled and shoved her tits into the faces as they occurred before her and beers were passed around and the empties dropped or thrown and guys left the car and went back on line and had a few beers and waited their turn again and more guys came from Willies and a phone call to the Armybase brought more seamen and doggies and more beer was brought from Willies and Tralala drank beer while being laid and someone asked if anyone was keeping score and someone yelled who can count that far and Tralalas back was streaked with dirt and sweat and her ankles stung from the sweat and dirt in the scrapes from the steps and sweat and beer dripped from the faces onto hers but she kept yelling she had the biggest goddamn pair of tits in the world and someone answered ya bet ya sweet ass yado and more came 40 maybe 50 and they screwed her and went back on line and had a beer and yelled and laughed and someone yelled that the car stunk of cunt so Tralala and the seat were taken out of the car and laid in the lot and she lay there naked on the seat and their shadows hid her pimples and scabs and she drank flipping her tits with the other hand and somebody shoved the beer can against her mouth and they all laughed and Tralala cursed and spit out a piece of tooth and someone shoved it again and they laughed and yelled and the next one mounted her and her lips were split this time and the blood trickled to her chin and someone mopped her brow with a beer soaked handkerchief and another can of beer was handed to her and she drank and yelled about her tits and another tooth was chipped and the split in her lips was widened and everyone laughed and she laughed and she drank more and more and soon she passedout and they slapped her a few times and she mumbled and turned her head but they couldnt revive her so they continued to fuck her as she lay unconscious on the seat in the lot and soon they tired of the dead piece and the daisychain brokeup and they went back to Willies the Greeks and the base and the kids who were watching and waiting ..."
"... les 10 ou 15 pochetrons traînèrent Tralala jusqu/ à une épave de bagnole sur le terrain vague au coin de la 57e rue et lui arrachèrent ses fringues et la poussèrent à lintérieur et quelques types se bagarrèrent pour voir çui qui passerait le premier et pour finir ils formèrent une espèce de file d/ attente dans laquelle tout le monde gueulait et se marrait et quelqu/ un gueula aux mecs qu/ étaient les derniers d/ aller chercher de la bière et ils partirent et revinrent avec des cannettes qu/ on se passa de main en main dans la file des baiseurs et les clients de chez le Grec s/ amenèrent et quelques-uns des autres jeunes du quartier s/ assemblèrent autour pour mater et Tralala gueulait et fourrait ses nichons dans la figure de ceux qui se présentaient devant elle et les bières circulaient et on lâchait ou balançait les cannettes vides et les mecs sortaient de lépave et retournaient au bout de la file et buvaient quelques bières en attendant que leur tour revienne et d/ autres mecs encore s/ amenaient de Chez Willie et un coup de fil à la base militaire attira encore des marins et des biffins et on apporta encore de la bière de Chez Willie et Tralala buvait de la bière pendant qu/ on la baisait..."
Insoutenable. Un enfer social ordinaire. Certes, Tralala n’est pas une victime naïve : mais elle est un pur produit de la violence masculine, qui finit par la dévorer. Elle utilise son corps comme seule monnaie sociale, et finit déshumanisée, violée, détruite, abandonnée. Selby ne moralise jamais, il montre un monde sans justice ni pitié. Le récit n’a rien d’érotique. Il montre comment le corps d’une femme est traité comme une marchandise, puis comme un déchet. Le viol collectif est long, clinique, insoutenable. Selby refuse la catharsis : il force le lecteur à voir la cruauté nue, sans détour. Le style devient hallucinatoire, syncopé à mesure que Tralala perd contact avec le réel, de moins en moins de ponctuation, un insoutenable et animal délire masculin ...
Tralala est le symbole ultime de la réduction de l'être humain à une marchandise. Elle-même ne voit les hommes que comme des "dollars sur pattes". Inversement, les hommes ne la voient que comme un objet de consommation sexuelle.
Le récit montre le point final de cette logique : quand tout n'est que transaction, le corps humain devient un produit jetable. La scène du viol est décrite avec la même froideur que si on dépeignait une chaîne de montage ou la consommation d'un bien. Selby dénonce ainsi un capitalisme sauvage qui corrompt toutes les relations humaines.
La violence contre Tralala n'est pas le fait de quelques monstres, mais d'une culture entière. La misogynie est si profondément enracinée qu'elle est devenue la norme. Les hommes qui la violent ne sont pas présentés comme des exceptions ; ils sont ordinaires, lâches, et agissent en groupe pour se donner du courage. Selby montre comment la haine des femmes est un ciment social pour cette masculinité toxique et fragile, une façon de prouver sa "virilité" au groupe.
Contrairement à une vision romantique de la pauvreté, Selby ne montre aucune forme de solidarité ou de code de l'honneur parmi les démunis. C'est un monde où les plus faibles se mangent entre eux. Tralala exploite les marins, qui se vengent en la détruisant. C'est un système auto-destructeur où chacun est à la fois victime et bourreau dans une chaîne infinie de violence.
Un Style "Camera Eye" (Caméra Objective) : C'est ici que le style de Selby atteint son efficacité la plus terrifiante. Il utilise une technique quasi cinématographique ...
Contrairement à "The Queen Is Dead", on ne rentre jamais dans les pensées de Tralala ou de ses agresseurs. Le narrateur est une caméra qui enregistre froidement les faits, sans émotion, sans commentaire, sans jugement. Les dialogues sont réduits à leur plus simple expression : des insultes, des ordres, des rires gras. Ils soulignent la pauvreté du langage qui reflète une pauvreté de l'âme. Cette objectivité glaciale est bien plus insupportable qu'un pathos mélodramatique. En refusant de nous dire quoi ressentir, Selby nous force à être des témoins impuissants, nous confrontant directement à l'horreur brute de la situation. Le choc et le dégoût naissent de cette absence de médiation.

"Last Exit to Brooklyn" / Part V - "Strike"
"Strike" est à la fois la plus structurée narrativement et la plus politiquement significative des nouvelles du recueil. Le personnage central en est Harry Black, un représentant syndical par accident, respecté en apparence, mais sexuellement frustré, solitaire, et d'une hypocrisie sociale certaine. La nouvelle débute par de l'intime, sexuellement tourmenté, avant d'explorer le monde syndical ouvrier et les tensions sociales de toutes natures qui y circulent ..
Avant même de connaître Harry, Selby nous plonge successivement dans deux scènes singulières qui accaparent son esprit, le sexe de son enfant, "HARRY looked at his son as he lay on the table playing with a diaper. He covered his head with it and giggled. Harry watched him wave the diaper for a few seconds, He looked at his sons penis. He stared at it then touched it. He wondered if an 8 month old kid could feel anything different there. Maybe it felt the same no matter where you touched him. It got hard sometimes when he had to piss, but he didnt think that meant anything. His hand was still on his sons penis when he heard his wife walking into the room. He pulled his hand away. He stood back. Mary took the clean diaper from the babys hand and kissed his stomach. Harry watched her rub the babys stomach with her cheek, her neck brushing his penis occasionally. It looked as if she were going to put it in her mouth. He turned away. His stomach knotted, a slight nausea starting. He went into the living room ...", - et le désir de sa femme, qu'il subit non sans dégoût ...
Le récit qui va suivre est celui de de ce qui dit, pense et vit, Harry Black, selon les trois sphères de conscience qu'il s'est construites, sa vie domestique, étouffante auprès d'une femme qu'il méprise mais qui le sollicite à tout instant , l’intrigue syndicale et ouvrière (l’usine), au cours de laquelle il prend une importance qui lui donnera un sentiment d'invincibilité qui lui sera fatal, et sa vie proprement intime, qui va progressivement l'absorber dans les méandres d'une sexualité refoulée et vécue aux limites d'une homosexualité qu'il ne peut assumer .
Trois trajectoires, - besoin de reconnaissance syndicale, humiliation domestique et désirs interdits -, trois sphères qui alternent et se nourrissent mutuellement dans un cycle autodestructeur auquel il ne pourra échapper...
Sa vie domestique? Effroyable vision ...
"....Il détourna son regard. Son estomac se serrait, atteint d'une légère nausée. Il alla dans le living-room. Mary habilla le bébé et le mit dans son berceau. Harry l'entendit qui arrangeait le berceau. Il entendit le bébé qui tétait son biberon. Les muscles et les nerfs d'Harry se crispèrent et il frémit. Il aurait voulu pouvoir attraper ces bruits et les lui foutre dans le cul. Attraper ce bon dieu de môme et le lui refourrer dans le vagin. Il prit le programme de la télé, regarda sa montre, parcourut du doigt la colonne de chiffres deux fois, puis il alluma le poste et chercha les stations. Au bout de quelques minutes, sa femme vint dans la pièce, debout tout près de lui et elle lui frotta la nuque. Quelle émission tu regardes? J'en sais rien, dit-il en tournant la tête et en se penchant pour se dégager. Elle se dirigea vers la petite table basse, prit une cigarette du paquet qui était posé dessus et s'assit sur le canapé. Quand Harry lui enleva le bras d'autour de son cou, elle fut déçue pendant quelques secondes, puis cela passa. Elle comprenait. Harry était bizarre par moments. Il se tracassait sûrement à cause de son boulot, au sujet de La grève qui allait peut-être commencer et tout. Voilà c'était sûrement ça. Harry essayait d'ignorer la présence de sa femme, mais même en s'efforçant de fixer la télé, ou en cachant avec sa main le coin de ses yeux, il savait encore qu'elle était là.
Là! assise sur le canapé. Qui le regardait. Qui souriait. Bon dieu mais qu'est-ce qu'elle a à sourire comme ça? Elle a encore le cul en chaleur. Toujours à me casser les pieds. Si seulement il y avait quelque chose de bien à la télé bon dieu. Pourquoi est-ce qu'il y a jamais de matchs le mardi soir. Ils croient peut-être que les gens ont seulement envie de regarder les matchs le vendredi? Qu'est-ce que t'as à sourire comme ça bon dieu? Harry bâilla, tournant la tête en essayant de se cacher le visage avec ses mains - Mary ne dit rien, se contentant de sourire - essayant de se concentrer sur l'émission, quelle qu'elle soit, essayant de rester éveillé jusqu'à ce que Mary s'endorme. Si seulement elle pouvait aller se coucher cette salope. Ils étaient mariés depuis plus d'un an et on aurait pu compter les fois qu'elle s'était endormie la première. Il regarda la télé, en fumant et en l'ignorant. Il bâilla de nouveau, incapable de cacher son bâillement, il était venu trop vite. Il essaya de l'avaler au beau milieu, essayant de tousser ou de faire quelque chose, mais tout ce qu'il réussit à faire fut de laisser pendre sa bouche ouverte en émettant un grognement.
Il commence à se faire tard Harry, on devrait peut-être aller se coucher? Vas-y toi. Moi ie vais fumer une autre cigarette. Elle songea un instant à en fumer une aussi, puis elle se dit qu'il valait mieux pas. Harry se mettait en fureur quand il était comme ça, si on l'énervait. Elle se leva, lui fit une petite caresse sur la nuque en passant - Harry retira brusquement sa tête en se penchant en avant - et elle s'en alla dans la chambre. Harry savait qu'elle serait encore éveillée quand il irait se coucher. La télé était encore allumée mais il ne la regardait pas. Finalement la cigarette fut trop courte pour pouvoir encore tirer une bouffée. Il la fit tomber dans le cendrier.
Mary se mit sur le dos quand Harry entra dans la chambre. Elle ne dit rien, mais le regarda pendant qu'il se déshabillait - Harry lui tournait le dos et empilait ses vêtements sur la chaise près du lit - Mary regardait les poils au bas de sa colonne vertébrale et pensait à la saleté incrustée dans ses mains calleuses et sous ses ongles. Harry s'assit au bord du lit un instant, mais c'était inévitable : il allait falloir qu'il s'étende auprès d'elle. Il posa sa tête sur l'oreiller puis souleva ses jambes pour les poser sur le lit, Mary tenant les couvertures soulevées pour qu'il puisse se glisser dans le lit. Elle remonta les couvertures sur lui puis se tourna sur le côté face à lui. Harry se tourna sur le côté, mais en lui tournant le dos. Mary se mit à lui frotter le cou, les épaules puis le dos. Harry aurait voulu qu'elle s'endorme et lui foute la paix. ll sentit sa main qui descendait plus bas dans son dos, espérant que rien ne se passerait; espérant qu'il s'endormirait (il avait pensé qu'une fois marié il s'habituerait); il aurait voulu se retourner et la gifler et lui dire d'arrêter - bon dieu, combien de fois, il avait eu envie de lui écraser la gueule. Il essaya de penser à quelque chose, comme ça il pourrait ne plus penser à elle et à ce qu'elle était en train de faire et à ce qui était en train de se passer. Il essaya de se concentrer sur le match qu'il avait vu à la télé vendredi dernier où Pete Laughlin avait complètement écrabouillé un nègre et celui-là avait du sang plein la figure et finalement l'arbitre avait arrêté le combat au 6° round et lui Harry avait été furieux que l'arbitre l'ait arrêté... Mais il se rendait encore compte qu'elle avait la main posée sur sa cuisse. Il essaya de se rappeler la tête du patron la semaine dernière quand il était allé le voir -il avait ri jaune - ce salaud, il peut pas me foutre à la porte. Ie lui ai dit bien en face. Vice-président. Merde. Il sait bien qu'il peut pas essayer de m'avoir. J'pourrais faire fermer toute l'usine en moins de cinq minutes - la main caressante était encore là. Il n'y avait rien à faire. La salope. Pourquoi est-ce qu'elle peut pas me laisser tranquille. Pourquoi est-ce qu'elle peut pas foutre le camp quelque part avec ce bon dieu de môme. J'te lui ferais sortir les tripes par le cul à force de baiser.
Il ferma les yeux en les serrant si fort que cela lui fit mal puis soudain il roula sur Mary, en lui donnant un coup de coude sur la tête, lui écrasant la main entre ses jambes presque à lui casser le poignet en se tournant. Mary fut surprise un instant, elle entendit plus qu'elle ne le sentit son coude la frapper; elle essaya de dégager sa main; elle vit son corps å lui sur le sien; elle sentit son poids, sa main qui cherchait son sexe... puis elle se détendit et lui mit lœ bras autour du cou. Harry lui fouillait le sexe, anxieux et maladroit de rage; il aurait voulu pénétrer brutalement en elle, mais quand il essaya cela l'égratigna et lui enflamma le gland et instinctivement il s'arrêta un instant mais sa colère et sa haine l'incitèrent à pousser, à pousser jusqu'à ce qu'il soit finalement tout à fait rentré en elle - Mary tressaillit légèrement puis elle poussa un soupir - et Harry entrait et cognait tant qu'il pouvait en espérant qu'il lui ferait passer l'envie; il aurait voulu pouvoir mettre une capote passée dans des copeaux de métal ou du verre pilé et lui déchirer les tripes - Mary enroulait ses jambes autour de son corps et resserrait ses bras sur son dos, elle lui mordait le cou, roulant de gauche à droite sous l'excitation en sentant son membre qui entrait en elle encore et encore - Harry était insensible physiquement, il ne ressentait ni douleur ni plaisir, mais il remuait avec la force et le mouvement automatique d'une machine; incapable à ce moment de formuler la moindre pensée même la plus vague, ses efforts pour penser étant anéantis par sa colère et sa haine; il n'était même pas capable d'essayer de savoir pourquoi il avait envie de lui faire du mal, il ignorait complètent le plaisir qu'il donnait à sa femme; son esprit ne lui permettait même pas d'atteindre l'orgasme rapide dont il avait besoin afin de pouvoir se retirer, il ne se rendait pas compte que sa brutalité au lit était la chose qui faisait que sa femme s'accrochait à lui et plus il essayait de la repousser, de lui crever les tripes avec sa bitte, plus elle se rapprochait et s'accrochait à lui - et Mary roulait de gauche à droite défaillant presque d'excitation, jouissant une fois puis une autre, tandis qu'Harry continuait à entrer et à cogner jusqu'à ce qu'enfin le sperme jaillisse, Harry continua avec la même force et le même rythme, sans rien sentir, jusqu'à ce que son énergie s'écoule avec le sperme puis il s'arrêta brusquement, éprouvant une nausée de dégoût. Il se dégagea rapidement et s'étendit sur le côté, en lui tournant le dos, il agrippa l'oreiller des deux mains, le déchirant presque, le visage enfoui dedans, prêt à pleurer; l'estomac soulevé par la nausée; le dégoût semblait s'enrouler autour de lui comme un serpent, lentement, méthodiquement et retirer douloureusement toute vie de son corps, mais à chaque fois que cela approchait du moment où une simple petite pression mettrait fin à toutes choses : la vie, la misère, la douleur, cela cessait de le serrer, mais la pression subsistait et Harry était là, le corps seul vivant par la douleur, l'esprit malade de dégoût. Il gémit et Mary étendit la main et lui toucha l'épaule, le corps encore frémissant. Elle ferma les yeux en se détendant et bientôt elle s'endormit, sa main glissant lentement de l'épaule de Harry.
Harry ne pouvait rien faire d'autre que supporter la nausée et le dégoût gluant. Il aurait voulu fumer une cigarette mais il craignait que le moindre geste, même celui d'inspirer profondément ne lui donne des haut-le-cœur; il n'osait même pas avaler sa salive. Aussi il resta là étendu, avec un goût amer dans la bouche; on aurait dit que son estomac lui remontait à la gorge; son visage était encore enfoui dans l'oreiller; ses yeux fermés bien serrés; il se concentrait sur son estomac, essayant de chasser le poids et le goût affreux par la pensée, ou du moins, de le contrôler. Il savait après avoir lutté pendant des années, perdant à chaque fois et finissant toujours penché sur une cuvette ou un évier si encore il avait le temps d'arriver jusque-là, que c'était tout ce qu'il pouvait faire. Tout le reste était inutile. Sauf pleurer. Et il n'était plus capable de pleurer maintenant.."
(...)
Le passage qui voit progressivement son univers basculer ...
"... Harry flopped at the kitchen table and tried to ignore his wife as she served supper and asked questions about how the strike went and how long would it be . . . She put the food on the plates and sat down and started eating, still asking questions, Harry mumbling answers. He glanced at his wife from time to time and soon his body started to tighten and it continued until his body was once more one gigantic knot. He felt like rapping her across the face. He looked at her. She continued to ask questions. He dropped his fork on the plate and got up from the table. Where you going? Back to the office, I think I forget something. He rushed from the house before she could say anything and went to the bar. He went to the end of the bar and stayed there, alone, drinking, saying nothing. After an hour or so he once more started to feel better and soon became conscious of a few of the neighborhood guys standing a few feet away. Actually what attracted him to them was a high pitched feminine voice. It took a moment or two for him to realize that one of the guys standing near him was a fairy. He looked at him, trying not to be too obvious, lowering his eyes everytime somebody moved his head toward him, slowly raising them again to stare at the fairy. Harry couldnt hear everything he was saying, but he watched the delicate way in which he emphasized what he said with his hands, and the way his neck seemed to move in a hypnotic slowmotioned manner as he talked and gestured. He seemed to be telling the guys about a party, a drag ball, that had taken place last Thanksgiving at a place called Charlie Blacks. Harry continued to stare and listen, fascinated.
They stayed there for more than an hour, Harry listening and ignoring his beer. When they left he watched them leave hoping they were going across the street to the Greeks so he could follow them in a few minutes, but they got into a car and drove away. Harry continued to stare out the door after they drove away and only the sudden blaring of music from the jukebox caused him to blink his eyes and turn back to the bar. He lifted his glass automatically and finished his beer.
He stayed at the bar until about midnight, the image of the fairys face and hands still in his mind, his voice still in his ear. When he finished his last beer and left for home he was unaware of his body: partly from his preoccupation with the image and sound, partly from the beer. The fresh air clouded the image slightly, but it was still there. It was still there when he undressed and fell into bed. He lay on his side away from Mary, but soon Marys groping hand and voice forced the image to dissolve. When she first started caressing him it was still with him and excitement shocked through him. Then he became aware of her and there was nothing but her and anger, the anger keeping alive the excitement. He bolted around immediately and pounded on her trying desperately to evoke the image and sound but it was irrevocably gone for now and Mary groaned and scratched . . .
He rolled over, lay awake for a while, once more almost crying, the confusion blinding him, but he was so exhausted from all that had happened that day that he soon fell asleep.
The next morning he awoke early and left before Mary had a chance to speak to him. He went to the Greeks and had coffee and cake, glancing at the clock every now and then, but still it wasnt even 6:30 yet. He had another cup of coffee, another cake, gulping them down, still looking at the clock every few minutes feeling a need to rush, no thought from what or to where, but only a vague yet crushing pressure of time, time that seemed to wrap itself around him like a python. He dropped money on the counter and went across the street to his office. He went immediately to his desk and sat down, looking at the desk for many minutes—the serpent not loosening its grip—unable to feel the air around his body. He lit a cigarette and looked around the office. He went over to the beer keg and pumped for a while but nothing came out. Not even a hint of foam. It was empty. Theyll be here with another one soon though.
The python continued to crush him and time seemed motionless. The hands on the clock were stuck. The urgency now was not only for him to move, but for time to move too; for the men to come, to take their signs, to walk, to joke, to drink coffee and beer; for him to stamp books, to listen, to tell, to watch. They had to come soon. A cigarette only takes a certain amount of time to smoke and though this takes time it seems to take less and less with each one and you can only smoke so many, there comes a time when you have to stop, when you just cant light the next one ... at least not for a while.
He opened the rear door and looked around not really seeing anything. Nothing seemed to really exist. The objects in the office were there, they could be seen each in its place, yet still there was confusion. He knew what each object was, what it was for yet there was no real definition. He sat at his desk for a while, walked around for a while . . . sat . . . walked . . . sat . . . walked . . . looked . . . sat . . . walked . . . the only important thing was that the men get there. They had to. The day had to start. He walked . . . sat. . . smoked . . . the python still there. Were there no hands on the clock? He smoked . . . Drew a cup of coffee ... It was strong, bitter, yet it passed his mouth and throat without leaving a taste. Only a film. Dont clocks tick anymore? Is even the sun motionless. The water is boiled, poured over the coffee and it drips through and time passes . . . even if it only drips it passes . . . through. How long does it take his chair to get from the desk to the wall a few feet behind him when he pushes and the chair rolls on its little wheels? Even that takes time: time enough for a man to walk from the door to the signs, or from the urn to the door; enough time to stamp three books one right after the other: 1,2,3 . . . and yet there was not a definable thought in his mind. Only a terrifying effort to get from one side of a match box to another . . . the door opened and three men came in. Harry jumped up. The python slithered into the match box. The day had begun...."
(...)
"... Harry s’affala sur la chaise de la cuisine et tenta d’ignorer sa femme tandis qu’elle servait le dîner et posait des questions sur la grève, sa durée... Elle déposa les assiettes, s’assit, commença à manger tout en continuant ses interrogations, Harry répondant par des marmonnements. Il la regardait par intermittence ; peu à peu, son corps se crispa jusqu’à n’être plus qu’un nœud monstrueux. Il eut envie de lui balancer une claque. Elle persistait. Il laissa tomber sa fourchette et se leva. « Où vas-tu ? — Au bureau, j’ai dû oublier un truc. » Il s’enfuit avant qu’elle ne réplique et se rendit au bar. Posté au bout du comptoir, il resta seul, silencieux, à boire.
Après une heure environ, il se sentit mieux et remarqua des gars du quartier à quelques pas. Ce qui l’attira, ce fut une voix féminine aiguë. Il mit quelques secondes à comprendre que l’un d’eux était un pédé. Il l’observa en dissimulant son regard, baissant les yeux dès qu’on tournait la tête, puis les relevant lentement pour fixer ce garçon. Harry ne saisissait pas tout, mais il voyait ses gestes délicats pour ponctuer ses phrases, le mouvement hypnotique de son cou. Il semblait raconter une fête, un bal travesti, chez un certain Charlie Black, à Thanksgiving. Harry écoutait, fasciné.
Ils restèrent là plus d’une heure. Harry oublia sa bière. Quand ils partirent, il espéra les voir entrer « chez le Grec » d’en face pour les suivre, mais ils montèrent en voiture. Le brusque hurlement du juke-box le fit cligner des yeux. Il se retourna, vida son verre machinalement.
Il traîna au bar jusqu’à minuit, le visage et les mains du garçon dansant dans son esprit, sa voix résonnant à son oreille. En rentrant, il ne sentait plus son corps : hanté par l’image, engourdi par la bière. L’air frais estompa un peu le souvenir, mais il persistait. Il était encore là quand il se déshabilla et se jeta sur le lit. Il se tourna le dos à Mary, mais ses mains tâtonnantes et sa voix dissipèrent l’illusion. Quand elle le caressa, l’excitation le traversa — l’image était encore là. Puis il ne perçut plus qu’elle, et la colère entretint cette excitation. Il se retourna violemment, la martelant, tentant désespérément de faire revenir l’image, mais elle avait disparu. Mary gémit, griffa...
Il se retourna, éveillé, au bord des larmes, aveuglé par la confusion. Mais la fatigue de la journée l’engloutit dans le sommeil.
Le lendemain matin, il partit avant que Mary ne parle. Il prit un café et un gâteau « chez le Grec », jetant des coups d’œil à l’horloge : pas encore 6h30. Il engloutit un autre café, un autre gâteau. Le besoin de se presser le tenaillait, sans savoir pourquoi ni vers où. Seulement l’écrasante pression du temps, ce python qui l’étreignait. Il laissa de l’argent et traversa jusqu’à son bureau. Assis à son bureau, il fixa le vide pendant des minutes — le serpent ne relâchait pas son étreinte. L’air autour de lui était irréel. Il alluma une cigarette, inspecta la pièce. Il tenta de tirer de la bière du fût : rien. Pas même une mousse. « Ils en apporteront un autre bientôt. »
Le python continuait de l’écraser. Le temps semblait figé. Les aiguilles de l’horloge étaient bloquées. L’urgence n’était plus seulement de bouger, mais que le temps avance : que les hommes arrivent, prennent leurs pancartes, marchent, plaisantent, boivent du café ; qu’il tamponne des livres, écoute, parle, observe. « Ils doivent venir. » Une cigarette ne prend qu’un temps donné à fumer — de moins en moins à chaque fois —, mais on ne peut en allumer qu’un nombre limité. Un moment vient où il faut s’arrêter... du moins un temps.
Il ouvrit la porte arrière sans rien voir. Rien ne semblait exister. Les objets du bureau étaient là, identifiables, mais sans définition réelle. Il s’assit, marcha... s’assit... marcha... regarda... L’essentiel était que les hommes arrivent. « Il faut que la journée commence. » Il marcha... s’assit... fuma... Le python toujours là. « L’horloge a-t-elle des aiguilles ? » Il fuma... Se versa un café. Fort, amer, mais qui ne laissait aucun goût. Juste un dépôt. « Les horloges ne font plus tic-tac ? Le soleil est-il immobile ? » L’eau bout, traverse le café goutte à goutte... et le temps passe. Même goutte à goutte. « Combien de temps met cette chaise à rouler du bureau au mur quand je la pousse ? » Assez pour qu’un homme aille des pancartes à la porte, ou qu’on tamponne trois livres d’affilée : 1, 2, 3... Pourtant, aucune pensée claire ne traversait son esprit. Juste l’effort terrifiant pour traverser la longueur d’une boîte d’allumettes...
La porte s’ouvrit. Trois hommes entrèrent. Harry bondit. Le python glissa dans la boîte d’allumettes. La journée avait commencé...."
La grève stagne. Harry perd son autorité morale et politique à mesure que ses fantasmes et ses mensonges explosent au grand jour. Harry, humilié publiquement, sa double vie révélée, est jeté hors du mouvement syndical comme un pestiféré. Il se retrouve seul, mentalement brisé.
L’univers ouvrier n’est pas idéalisé, bien au contraire, Selby nous dévoile un syndicalisme figé, virilisé au maximum, la masculinité y est un incontournable et la sexualité une dérive possible pour peu qu'elle ne corresponde pas aux clichés attendus.
"... Harry lay still, sobbing. He cried then screamed a long loud AAAAAA-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA that was muffled as his face fell back into the dirt of the lot...."
Judith Butler, dans "Gender Trouble" (1990) analysera le genre comme performance imposée : Harry joue le rôle du "mec" comme une masque social, et quand il tentera de vivre autre chose (drag, sexualité queer), le système le punira sans la moindre hésitation. Le personnage de Roy Cohn (homme de pouvoir, gay refoulé) dans Tony Kushner, "Angels in America" (1991), rappelle Harry et la même logique d’auto-destruction liée à la honte et à la peur de la révélation.

"Last Exit to Brooklyn" / "Coda / Landsend"
La dernière partie de "Last Exit to Brooklyn", intitulée “Coda / Landsend”, joue un rôle à la fois stylistique, thématique et symbolique dans le roman de Hubert Selby Jr.. Ce n’est pas une "fin d’intrigue" au sens classique, mais un épilogue poétique et allégorique, qui cristallise la vision du monde que Selby a développé tout au long de l’ouvrage.
Une coda en musique est un passage conclusif qui clôt un mouvement ou une œuvre entière, souvent avec un retour de motifs antérieurs. Selby emprunte ce terme pour souligner que cette section n’est pas une suite de l’action, mais une résolution formelle, presque mystique ou méditative. Elle sert de contrepoint émotionnel et esthétique à la violence brute des chapitres précédents. Il ne s’agit plus de décrire des événements ou des personnages, mais de faire résonner le sens existentiel de tout ce qui a été vécu.
Après six chapitres d’une extrême brutalité sociale (viol, tabassage, rejet, exploitation, haine, refoulement), "Coda / Landsend", ’est le moment où l’humain, brisé par le réel, cesse de parler pour ne plus que respirer, puis s’éteindre...
La cruauté inouïe de certaines scènes de "Last Exit to Brooklyn" se retrouve dans les autres livres de Selby, ainsi dans "Retour à Brooklyn" (Requiem for a Dream, 1979), où les personnages sont de jeunes drogués, et surtout dans "La Geôle" (The Room, 1971), qui décrit les fantasmes sadiques d`un prisonnier dans sa cellule. Mais ici, la violence omniprésente qui domine cette jungle urbaine est transcendée par deux éléments : d'abord une compassion extraordinaire pour des personnages désespérés et misérables. Selby se définit lui-même comme fondamentalement puritain; le caractère volontairement obscène des passages sexuels ou des scènes de violence n`est là que pour éveiller la compassion, au sens fort de ce terme. Et l`on ne s'étonnera pas de trouver des citations de La Bible, soit en exergue des romans de Selby, soit intégrés au corps même du texte.
Par ailleurs, l'écriture de Selby, sèche et crue comme un constat ou un rapport d`autopsie, accorde aux faits une dimension qui excède leur simple portée sociale : c'est bien de tragédie qu'il s'agit, et la force de Selby consiste à évoquer cette tragédie de l'intérieur, un peu comme Faulkner dans "Sanctuaire" ou "Le Bruit et la Fureur". Selby maîtrise parfaitement l'art du dialogue et celui du monologue intérieur, ne nous épargnant aucune perversion, notant sans fausse pudeur les aberrations et autres déviances des milieux marginaux qu`il décrit, Il n`y a guère que dans "Le Démon" (The Demon, 1973), qu`il nous présente un héros parfaitement intégré, en apparence, à la bourgeoisie américaine : Harry White a une femme ravissante, il occupe une haute fonction dans la finance, mais le "démon" de la sexualité s`empare un jour de lui, dérègle sa vie et finit par le pousser au crime. ...
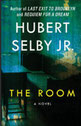
"La Geôle" (The Room, 1971)
Sans doute un chef-d'œuvre de la littérature transgressive, poussant les limites de la représentation littéraire et certainement une étude psychologique fascinante et terrifiante de l'esprit sous l'emprise de la haine et de l'enfermement....
Roman central dans l'œuvre de Selby ("Last Exit to Brooklyn", "Requiem for a Dream"), "La Geôle" plonge dans la conscience d'un homme anonyme, enfermé dans une cellule en attendant son procès pour un crime mineur (vol qualifié). Le récit, quasi dépourvu d'intrigue traditionnelle, se déroule principalement dans l'esprit du protagoniste. Submergé par la rage, l'humiliation et un désir de vengeance sadique, il imagine avec une minutie grotesque les tortures qu'il infligera à ceux qu'il juge responsables de son sort : policiers, avocat commis d'office, juge, et même sa propre famille. Ces fantasmes violents alternent avec des moments de paranoïa, de souvenirs confus et une conscience aiguë de sa dégradation physique et mentale dans l'univers carcéral.
L'absence de ponctuation conventionnelle, signature de Selby, force le lecteur à participer activement à la construction du sens, à naviguer dans le flot désordonné des pensées, reproduisant la confusion et la claustrophobie mentale du personnage. De plus, les fantasmes de violence reviennent avec des variations obsédantes, comme une litanie macabre, créant un effet hypnotique et quasi insupportable, soulignant l'obsession qui ronge le protagoniste.
"He was conscious of the dark stillness in the corridor. He knew there was nothing to be seen, yet he continued to stare thru the reflection of his face in the small window. The corridor was only 7 feet wide and the wall opposite was dimly visible. He read the signs over the dirty-linen baskets – blue shirts, blue pants, blankets, bath towels, hand towels. He was just able to read the last two by pressing against the glass and standing to one side. Again he read them from left to right, standing first in the middle then moving to the left and straining his eyes to read the last sign. Shirts, pants – he could recite them without trouble. He closed his eyes. Hand towels, blankets, bath towels … He didn’t bother checking his accuracy. He knew he was right.
Turning from the heavy, locked door he looked in the mirror over the sink. Now that his eyes were accustomed to the night light he could see his face clearly, even to the small blemish on his cheek. He leaned closer and touched the red spot with a finger tip. The beginning of a pimple. He started to squeeze it, then lowered his hands. Why bother? Itll just bruise the skin. I/ll wait until it comes to a head … if it doesnt just disappear first. Who knows, maybe it will, touching it again with a finger tip. He stopped patting the spot and stood back slightly and just stared at his face, his eyes slowly closing to a squint, his face wrinkling into a frown.
He shrugged and turned from the mirror and sat on the edge of the bunk. He knew the room was only dimly lighted compared to the daytime when all the lights in the ceiling were lit, but it seemed to be just as bright now. Of course it only seems that way. But if it seems that way then it is that way. Right? Right now its just as bright as a beach on a sunny day.
But you know it isnt. You know that it only seems to be, and it only seems to be because youve become accustomed to it. And when they turn all the lights on it will be so bright you wont be able to open your eyes all the way, then after a while it will seem like its always been that way until they turn the lights out and only the night light is on and suddenly it will seem very dark until you become accustomed to it and then it will seem bright just as it did before. Its always the same – you get used to one thing, then it changes. Get used to another, and that changes. over and over. always the same.
O well, the hell with it. Its not important anyway. Its not dark and im not tired enough to sleep. Shouldnt have taken that nap this afternoon. If i had something to read i could probably tire my eyes and fall asleep. O well, it doesnt make any difference if i sleep at night or during the day. Its all the same. The same amount of time has to be passed each day
and night. The same twenty-four hours. But the more you sleep the faster time passes. Like xmas eve when youre a kid and you cant wait until morning to see what santa claus brought. You know as soon as you fall asleep it will be morning. Thats all you have to do. Just fall asleep then wake up and jump out of bed. And there you are, under the tree tearing paper off presents. It was hard to sleep then, too. But you knew that as soon as you fell asleep it would be morning, no matter how far away it was. And you kept thinking, fall asleep and it will be morning. But it was hard to sleep. But the time did pass, and you fell asleep – eventually. And it was just as hard to fall asleep even when you knew there was no santa claus.
Il avait conscience de l'obscurité silencieuse dans le couloir. Il savait qu'il n'y avait rien à voir, pourtant il continua à fixer le reflet de son visage dans la petite vitre. Le couloir ne faisait que sept pieds de large et le mur d'en face était faiblement visible. Il lut les pancartes au-dessus des bacs à linge sale – chemises bleues, pantalons bleus, couvertures, serviettes de bain, serviettes de toilette. Il parvint tout juste à lire les deux dernières en se pressant contre la vitre et en se mettant de côté. De nouveau, il les lut de gauche à droite, se tenant d'abord au milieu puis se déplaçant vers la gauche et forçant ses yeux pour lire la dernière pancarte. Chemises, pantalons – il pouvait les réciter sans problème. Il ferma les yeux. Serviettes de toilette, couvertures, serviettes de bain… Il ne prit pas la peine de vérifier son exactitude. Il savait qu'il avait raison.
Se détournant de la lourde porte verrouillée, il regarda dans le miroir au-dessus du lavabo. Maintenant que ses yeux étaient habitués à la veilleuse, il pouvait voir son visage distinctement, jusqu'au petit défaut sur sa joue. Il se pencha plus près et toucha l'endroit rouge du bout du doigt. Le début d'un bouton. Il commença à le presser, puis baissa les mains. Pourquoi s'embêter ? Ça ne fera que marquer la peau. J'attendrai qu'il murisse… s'il ne disparaît pas avant. Qui sait, peut-être qu'il va disparaître, le touchant à nouveau du bout du doigt. Il cessa de tapoter l'endroit et se redressa légèrement, se contentant de fixer son visage, ses yeux se plissant lentement, son visage se fronçant.
Il haussa les épaules, se détourna du miroir et s'assit au bord de la couchette. Il savait que la pièce n'était que faiblement éclairée comparé à la journée où toutes les lumières du plafond étaient allumées, mais cela semblait tout aussi lumineux maintenant. Bien sûr, ça ne fait que sembler. Mais si ça semble ainsi, alors c'est ainsi. Non ? En ce moment, c'est aussi lumineux qu'une plage par une journée ensoleillée.
Mais tu sais que ce n'est pas le cas. Tu sais que ça ne fait que sembler, et ça ne fait que sembler parce que tu t'y es habitué. Et quand ils allumeront toutes les lumières, ce sera si brillant que tu ne pourras pas ouvrir les yeux grand ouverts, puis après un moment, ça semblera avoir toujours été ainsi jusqu'à ce qu'ils éteignent les lumières et que seule la veilleuse reste allumée et soudain il semblera très sombre jusqu'à ce que tu t'y habitues et alors ça semblera lumineux comme avant. C'est toujours la même chose – tu t'habitues à une chose, puis elle change. Tu t'habitues à une autre, et ça change. Encore et encore. Toujours la même chose.
Bon et bien, au diable. Ce n'est pas important de toute façon. Il ne fait pas noir et je ne suis pas assez fatigué pour dormir. Je n'aurais pas dû faire cette sieste cet après-midi. Si j'avais quelque chose à lire, je pourrais probablement fatiguer mes yeux et m'endormir. Bon et bien, ça ne change rien que je dorme la nuit ou le jour. C'est du pareil au même. La même quantité de temps doit passer chaque jour et chaque nuit. Les mêmes vingt-quatre heures. Mais plus tu dors, plus le temps passe vite. Comme le réveillon de Noël quand tu es gamin et que tu ne peux pas attendre le matin pour voir ce que le Père Noël a apporté. Tu sais qu'aussitôt que tu t'endors, ce sera le matin. C'est tout ce que tu as à faire. Juste t'endormir puis te réveiller et sauter du lit. Et te voilà, sous le sapin en train de déchirer le papier des cadeaux. C'était difficile de dormir à ce moment-là, aussi. Mais tu savais qu'aussitôt que tu t'endormais, ce serait le matin, peu importe à quelle distance il était. Et tu n'arrêtais pas de penser, endors-toi et ce sera le matin. Mais c'était difficile de dormir. Mais le temps a passé, et tu t'es endormi – finalement. Et c'était tout aussi difficile de s'endormir même quand tu savais qu'il n'y avait pas de Père Noël.

"The Demon" (1973)
La tragédie humaine d'une obsession sexuelle, mais peut-être pas que, celle d'un personnage totalement intégré, mais peut-être pas que, à une société qui cultive la réussite matérielle, son pouvoir et ses privilèges, que l'on voit entrer presque naturellement dans un jeu de séduction effréné, passer son temps libre à coucher avec des femmes mariées dans un jeu calculé qui finit par s'épuiser lui-même, tant de romans américains en exposent la même trame ....
"Ses amis l'appelaient Harry. Mais Harry n'enculait pas n'importe qui. Uniquement des femmes... des femmes mariées. Avec elles, on avait moins d'emmerdements. Quand elles étaient avec Harry, elles savaient à quoi s'en tenir. Pas question d'aller dîner ou prendre un verre. Pas question de baratin. Si c`est ce qu'elles attendaient, elles se foutaient dedans ; et si elles commençaient à lui poser des questions sur sa vie, ou à faire des allusions à une liaison possible, il se barrait vite fait. Harry refusait toute attache, toute entrave, tout embêtement. Ce qu'il voulait, c'était baiser quand il avait envie de baiser, et se tirer ensuite, avec un sourire et un geste d'adieu. Il trouvait que coucher avec une femme mariée était beaucoup plus jouissif. Pas parce qu'il baisait les femmes d'un autre, ça Harry s'en foutait, mais parce qu'il devait prendre certaines précautions pour ne pas être découvert. Il ignorait toujours ce qui pouvait se produire, et son appréhension augmentait son excitation.
Parfois, Harry White se prenait à songer aux nombreux couples dont l'union était menacée en raison de rapports sexuels médiocres ou tourmentés. Il devait bien y avoir des millions de femmes qui marchaient aux tranquillisants pour oublier leurs frustrations. Sans parler des milliers, voire des centaines de milliers, qui se trouvaient dans les hôpitaux psychiatriques après une dépression due à une vie inexistante ou peu satisfaisante. Songez donc à tous ces foyers brisés, à tous ces orphelins qui coulent une vie sans joie, tout ça faute d'orgasme.
Harry n'était pas précisément un chaud partisan du M.L.F., mais il était intimement convaincu que les femmes étaient victimes d'une injustice.
Après tout, c'est un fait reconnu et universellement accepté, la plupart des hommes donnent des coups de canif dans le contrat, comme on dit ; ils aiment bien faire la noce avec les copains et s'offrir une petite partie de cul. Et pourtant, la femme est censée rester à la maison pour s'occuper des gosses, et doit supplier son noceur de mari de lui faire l'amour de temps en temps. Et si, lasse d'attendre les étreintes sporadiques, maladroites et indigentes de son époux, elle s'avise de lui trouver, disons, un substitut, elle est vilipendée, traînée dans la boue, battue et parfois même, c'est bien triste à dire, tuée. Non, Harry n'était certes pas un militant convaincu du M.L.F., mais il était conscient de l'injustice criante de cette situation.
Alors, humblement, avec les faibles moyens dont il disposait, il faisait son possible pour la réparer, ou tout au moins, pour y remédier dans une certaine mesure. Dieu seul savait combien de vies il avait sauvées dans l'exercice de son sacerdoce. Pas seulement des vies conjugales, des vies tout court peut-être. Qui sait combien de femmes sont encore en vie et heureuses parce que Harry White, poursuivant sa vocation sans relâche, leur a épargné la folie ou la mort en crevant l'abcès de leurs anxiétés, de leurs angoisses et de leurs frustrations.
Harry travaillait dans le centre de Manhattan, et il lui fallait pratiquement deux heures pour faire l'aller-retour entre son domicile et son bureau. Pourtant, il continuait à vivre chez ses parents à Brooklyn. Bien des fois, surtout le lundi matin, quand il se sentait vaseux après un week-end particulièrement chargé, il avait songé à s'installer dans un appartement proche de son lieu de travail, d'où il pourrait se rendre à son bureau facilement en quelques minutes d'autobus ..."
Tout débute donc dans la quête du sexe opposé, maintes fois contée dans la littérature américaine, avec cette frontière parfaitement gérée entre la vie publique du petit cadre modèle et son intimité peuplée de rencontres nocturnes : sauf qu'ici, l'obsession intime envahit progressivement un monde parfaitement cloisonné, celui de la représentation et de l'ascension sociale, retards, abscences et jugement de la hiérarchie, quelque chose semble se lézardait dans le quotideien de sa vie, "quelque chose n'allait pas bien, ça il en éré sûr, mais il ne savait pas ce qui allait mal", la routine du travail, d'un côté, l'attrait de la rencontre et la consommation de femmes rencontrées au hasard, de l'autre, Louise, Helen, Olga. Puis c'est la rencontre avec Linda, un tournant dans sa vie ...
"Le temps était idéal et le Wooddale Country Club était l'endroit rêvé pour passer la journée dehors. Il y avait un golf de dix-huit trous, des jardins vallonnés, une gigantesque piscine, des pelouses tondues avec soin, entourées de bois agréables et tous les autres agréments et
commodités qu'offre un Country Club select. La plupart des invités étaient assis autour de tables au soleil ou à l'ombre des patios. Certains jouaient au tennis et Harry les regarda un moment avant de s'éloigner le long de la zone boisée. Il prenait plaisir à sa solitude, non parce que cela lui donnait le sentiment d'être plus proche des arbres qui l'entouraient, des oiseaux qui pépiaient et voletaient dans le feuillage, de la terre tachetée de vert sous ses pieds ou du soleil et du ciel bleu au-dessus de sa tête, ni parce qu'il avait peur des gens ou parce qu'il était incapable de se mêler aux autres - il n'avait pas de problèmes particuliers dans ce domaine -, mais plutôt parce qu'il savourait ce sentiment d'autosatisfaction qui l'emplissait lorsqu'il embrassait du regard l'étendue du club, sachant qu'il y avait là des gens qui se livraient à toutes sortes d'activités et pressentant que ces gens étaient conscients de son absence et se demandaient où il était.
Il s'arrêta à l'ombre des arbres et regarda la pelouse inondée de soleil qui descendait en pente douce vers les jardins vallonnés et la piscine, se laissant peu à peu envahir par un sentiment de puissance. Il ferma les yeux à demi et s'abandonna à ses visions intérieures, persuadé que la destinée allait lui apporter l'argent, les biens et le prestige qu'il désirait et savait devoir lui appartenir un jour.
Le passage de l'ombre à la lumière fut brutal, sans transition, et lorsque Harry s'avança dans les rayons presque palpables du soleil, il sentit la chaleur lui frapper le visage tout en éprouvant encore dans le dos la fraîcheur de l'ombre ; mais à peine avait-il eu le temps d'enregistrer cette sensation qu'elle avait disparu et que le soleil lui brûlait déjà le dos. Il se dirigea vers la piscine, une demi-douzaine de personnes environ étaient allongées là, nageaient ou se faisaient bronzer. En s'approchant, il remarqua une fille en bikini debout près du bassin et il s'aperçut qu'il ne pouvait en détacher les yeux. Il percevait le son des voix des autres invités et ceux qui lui parvenaient des courts de tennis à quelques centaines de mètres de là et les cris que poussaient de temps à autre ceux qui plongeaient dans un grand bruit d'éclaboussures, pourtant, il était complètement absorbé par la fille en bikini et par la façon dont ses nichons avaient l'air de vouloir s'échapper du soutien-gorge tandis que le slip semblait tenir miraculeusement accroché au bas de ses hanches, étroite bande de tissu, juste au-dessous du léger renflement de son ventre.
Il regarda fixement l'eau dégouliner jusqu'à son nombril qui lui fit penser à un trou de serrure et il cligna des yeux à cause de la luminosité et des décharges électriques de son désir. Bon Dieu, il aimerait la baiser là, tout de suite ! Elle retira son bonnet de bain et secoua la tête afin de libérer ses cheveux avant de s'allonger sur une serviette à côté du bassin. Il aurait pu jurer que sa toison pubienne était fine et peu abondante. Il s'avança de manière à lui faire de l'ombre sur le corps. Elle ouvrit les yeux et redressa légèrement la tête. - Vous me cachez le soleil. - Oh, pardon, et il s'écarta et regarda son ombre glisser lentement de son corps sur l'herbe. Il n'y a rien de pire qu'un voleur de soleil..."
C'était Linda Sorrenson. Un nouvel épisode prend corps, une normalité s'ébauche, une femme, des parents, un mariage, un enfant, une propriété, et une ascension sociale qui enfin se confirme tant l'emporte le besoin d'intégration et de reconnaissance. Pourtant, rien ne semble véritablement le satisfaire, il est une distance que notre héros ne s'explique pas, "tout cela est arrivé inopinément, et il commençait seulement à prendre conscience de ce qu'il avait fait, mais il était toujours persuadé d'avoir bien fait. Il avait le sentiment - la quasi-certitude - que cela allait combler un vide dans son existence, que c'était ce dont il avait besoin pour parvenir à une plénitude totale...". Les jours passent, un sentiment de sécurité semble l'envahir, il se laisse porter par cette vague de bien-être intérieure, puis un jour, tout commence à basculer, très progressivement, par touches successives ...
"Les souvenirs sont comme l'histoire ancienne : ils s'oublient aisément quand ils ne semblent avoir aucun rapport avec le présent, et puis, un jour, ils refont surface et reprennent un caractère d'actualité. Pour Harry, tout baigna dans l'huile pendant deux mois, jusqu'à la prochaine soirée passée en compagnie du service des relations publiques. Il téléphona à Linda et lui dit de ne pas l'attendre pour dîner; qu'il ne rentrerait pas très tard et qu'ils souperaient ensemble à son retour. Sans même avoir bu, il fut rapidement pris au piège de
l'atmosphère détendue qui régnait dans le restaurant ; le rire des hommes et des femmes assis autour de la table était communicatif, et il se retrouva bientôt en train de raconter des histoires drôles et des anecdotes, goûtant et savourant sans méfiance cet agréable dîner. En sortant du restaurant, il passa un coup de fil à Linda pour lui annoncer qu'il y avait un contretemps, que, de ce fait, il rentrerait tard, et qu'il était inutile de l'attendre. Il fut sincèrement surpris de se retrouver au lit avec cette fille. Il n`avait jamais eu l'intention d'en arriver là. Il avait suivi les autres dans la suite pour leur tenir compagnie quelques instants et s'assurer que tout se passait bien, fermement décidé à rentrer chez lui. ll n'avait pas songé un seul instant à rester seul avec l'une des filles, encore bien moins à coucher avec elle.
Mais il l'avait fait. Il avait l'impression que tout cela était arrivé contre sa volonté, comme s'il était en quelque sorte VICTIME des circonstances. La fille appréciait sa compagnie. Harry était différent des michetons qu'elle rencontrait habituellement. Il était gentil. Il lui parlait et la traitait comme si elle n'était pas différente des autres femmes, si bien que son enthousiasme était plus réel que professionnel. Et elle était en train de lui sourire et de lui caresser la poitrine quand il remarqua l'heure. Pendant le chemin du retour, il ne cessa de secouer mentalement la tête en essayant de reconstituer les événements de cette soirée.
Comment après le dîner s'était-il retrouvé dans ce lit? Qu'est-ce qui était arrivé ? Comment était-ce arrivé ? Il n'avait jamais eu l'intention de faire ça. Il n'avait même pas envie de baiser. Il était là à bavarder et à dîner tranquillement, et il allait s'assurer que tout se passait bien, et subitement, il se retrouvait dans un lit, avec cette fille, en sachant très bien qu'il venait de la baiser. Et pour la deuxième fois...
Pourquoi ? Pourquoi avait-il fait ça ? Mais au nom du ciel, que se passe-t-il ? Je n'y comprends rien. Absolument rien...."
Certes, interrogations puis remords, puis il ne cesse à nouveau de ne penser qu'aux femmes, une activité qui s'impose à nouveau dans sa vie, une vie qui, bien que compatimentée, renoue avec son obsession initiale, certes est-il marié, mais s'il s'observe dans ses attitudes, il les constate sans pouvoir, ou vouloir, les analyser. L'acquisition d'une propriété, les signes évidents d'une réussite sociale, le bonheur du foyer conjugual, retardent un moment une échéance inéluctable ...
"Un dimanche, il décida d'emmener toute la famille faire une balade en voiture. Le temps était clair et ensoleillé ; Harry Junior, installé dans son baby-relax, ne cessait pas de montrer du doigt ce qui l'entourait et de poser des questions. Harry commença à se détendre en écoutant son fils, et sa femme qui riait, et en sentant la chaleur du soleil sur son visage.
Mais il avait du mal à concentrer son esprit sur la conduite de son véhicule. Il semblait toujours légèrement surpris par la présence d'autres voitures, par les feux rouges et les piétons qui traversaient. Il finit par comprendre pourquoi : du coin de l'œil, pour que Linda ne remarquât pas son manège, il regardait constamment les femmes sur le trottoir, ou dans les autres voitures. De toutes ses forces, il essaya de se maîtriser, mais la tâche lui parut surhumaine. Ce combat incessant et les remords qu'il éprouvait finirent par lui donner la nausée. Il n'arrivait pas à comprendre ce qui n'allait pas. Pourquoi ne parvenait-il pas à garder les yeux sur la route ? Et il regardait de nouveau droit devant lui, en faisant des efforts désespérés pour ne plus détourner les yeux, jusqu'au moment où une nana traversait, le cul à moitié à l'air, et il savait qu'elle allait s'engouffrer dans le magasin d'en face, et il allait devoir accélérer s'il voulait jeter un coup d'oeil à son cul et voir si elle avait une belle paire de nichons. Affolé, il ramenait les yeux sur la chaussée, et, lorsque son cerveau hagard avait constaté que la voie était dégagée, il essayait d'entrevoir Linda du coin de l'œil pour savoir si elle avait suivi son regard et compris ce qu'il était en train de faire, et puis il ramenait les yeux sur la route (Et si j'avais heurté une autre voiture !), bonté divine, il devenait dingue, et il gardait les yeux braqués droit devant lui, et il percevait les voix de Linda et de Harry Junior, et il entendait même sa propre voix qui leur répondait, et ces deux connasses qui sortaient d'un magasin là-bas et qu'il distinguait à peine, et il ralentissait, espérant qu'elles allaient se rapprocher, mais ces deux abruties se traînaient comme des escargots, et il ne voulait pas les perdre de vue, mais il devait s'assurer que Linda ne remarquerait pas son manège maintenant qu'il avait ralenti, et il regardait de son côté en faisant semblant de s'intéresser à ce qui se passait sur le trottoir de droite pour savoir ce qu'elle faisait, et, voyant que tout allait bien, il regardait de nouveau l'autre trottoir, mais ces deux imbéciles de nanas prenaient leur temps - Bon Dieu, elles marchaient à cinq centimètres à l'heure, pas possible ! - et il allait devoir virer, et peut-être qu'alors il pourrait les voir, mais d'abord il fallait s'assurer que Linda regardait Harry Junior; il tourna à gauche, et elles étaient belles, surtout avec le vent qui plaquait leur robe sur leur mont de Vénus, et l'une d'entre elles ne portait pas de soutien-gorge, et il voyait les pointes de ses seins qui saillaient, provocantes, et ses... Une voiture surgit de nulle part, et Harry écrasa la pédale de frein, et la voiture fit une embardée, et en fait, il n'y avait pas d'obstacle, et Linda cria : que se passe-t-il ? et Harry essaya de redresser et il vit la Mercedes s'écraser contre un autre véhicule et Linda et Harry Junior roulèrent sur le plancher et il les entendit hurler, et il s'arrêta le long du trottoir... et il ferma les yeux et lutta contre les larmes qui lui brûlaient les yeux et la nausée qui lui nouait les tripes et lui remontait à la gorge..."
Le voici de nouveau livré à ce "démon" qui sommeille en lui, à cette pulsion, - primaire, peut-être, jamais expliquée, une présence qui ne cesse de prendre le contrôle de son existence, inéluctable : par vagues successives, un désir de transgression tant moral que physique s'empare de Harry White, petite délinquance insignifiante, désir sexuel d'accouplement les plus sordides, jusqu'au crime et la destruction finale, le tout mené sans le moindre état d'âme, sans jugement, à distance, au jour le jour. Certes Harry semble tourmenté par son infidélité, tente de comprendre et de contrôler ce démon intérieur qui le mène graduellement à sa perte, certes sa femme, Linda, nous renvoie l'image de cet être tout simplement humain pris au piège d'une pathologie que rien ne peut expliquer, si ce n'est tout simplement, très singulièrement un sentiment perpétuel de malheur imminent dont rien ne peut entraver la marche, le tout écrit dans une prose fragmentée, sèche et crue ... " (trad. M.Gibot, 1018)
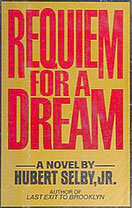
"Retour à Brooklyn" (Requiem for a Dream, 1978)
Le titre français est trompeur :"Retour à Brooklyn" évoque plutôt son premier roman, "Last Exit to Brooklyn", qui est totalement différent. "Requiem for a Dream" est une oeuvre devenue célèbre (et référence incontournable) pour sa plongée sans compromis dans l'enfer de l'addiction sous toutes ses formes, portée par le style unique et brutal de Selby, et magnifiée par une adaptation cinématographique devenue culte. C'est un requiem (une messe pour les morts) poignant pour les rêves brisés et les vies détruites par les dépendances et les illusions vendues par une société malade. Sa puissance, bien que difficile à supporter, en fait une œuvre marquante et inoubliable...
Dans un flux de conscience torrentiel et claustrophobe, immergeant le lecteur dans le chaos mental des personnages et l'urgence de leur désespoir, et dans un lange cru et direct, Selby nous fait vivre des personnages qui cherchent tous désespérément une forme de salut, de richesse, de reconnaissance ou d'amour (le "rêve").
Mais leurs voies pour y parvenir (le deal, l'art corrompu, la célébrité télévisée, l'argent facile) ou leurs mécanismes de fuite (la drogue, les pilules) les mènent inexorablement à l'autodestruction physique, mentale et sociale. Le système (médical, judiciaire, télévisuel) est ici souvent complice ou exploiteur. Malgré leurs liens, chaque personnage est finalement seul face à son addiction et sa souffrance. La communication se brise, les relations se délitent dans la méfiance et l'égoïsme induit par le manque. Et comme dans "La Geôle", Selby dépeint des institutions (hôpitaux psychiatriques, prisons, cliniques de désintoxication) et des figures d'autorité (médecins, policiers, gardiens) qui traitent les individus comme des déchets ou des numéros, accélérant leur déchéance...
Dans le Brooklyn des années 1970, la descente aux enfers parallèle de quatre personnages liés, tous détruits par leurs addictions et leurs illusions ...
- Harry Goldfarb : Jeune homme de Brooklyn, rêvant de faire fortune en "dealant" de l'héroïne avec son ami Tyrone C. Love. Son addiction à l'héroïne le consume.
- Marion Silver : Petite amie d'Harry, issue d'un milieu aisé mais déchirée. Artiste sensible, elle sombre dans l'héroïne et la cocaïne, exploitée et abandonnant ses rêves artistiques.
- Tyrone C. Love : Meilleur ami et associé d'Harry. Afro-américain, il cherche aussi à s'enrichir via la drogue pour échapper à sa condition, mais sa propre addiction et le racisme systémique le piègent.
- Sara Goldfarb : Mère veuve d'Harry, vivant seule. Son addiction n'est pas à une drogue illicite, mais à l'illusion du "Rêve Américain" véhiculé par la télévision. Obsédée par une émission de jeu télévisé (inspirée de The $64,000 Question), convaincue d'y participer, elle s'engage dans un régime amaigrissant désastreux prescrit par un médecin véreux, basé sur des amphétamines. Sa descente dans la paranoïa et la psychose médicamenteuse est centrale et tragique.
La logique de "Requiem for a Dream" repose sur une métaphore en spirale : chaque personnage descend vers un enfer spécifique, en poursuivant un rêve déformé par la société de consommation ou la misère affective ..
- Harry veut être libre, indépendant : il il devient mutilé, prisonnier.
- Marion veut créer, aimer : elle sera réduite à un objet sexuel.
- Tyrone veut sortir du ghetto : il ser est humilié par le système carcéral.
- Sara veut être aimée, exister à travers l’image qu'elle donne : elle sera lobotomisée.
Le roman alterne les points de vue des quatre personnages, juxtaposant leurs descentes parallèles. L'effet de montage crée une tension dramatique croissante et une sensation de fatalité tragique. Le lecteur est témoin de l'effondrement simultané sous tous les angles.
Chaque parcours révèle que le rêve américain est une drogue - et Selby le traite littéralement comme tel...

"Requiem for a dream" s’organise en neuf chapitres qui épousent une structure saisonnière : été, automne, hiver, suivis d’un épilogue ...
1 - Été : Le rêve commence
Harry, Marion et Tyrone vivent de petits trafics d’héroïne. Leur objectif : amasser assez d’argent pour ouvrir un magasin de design pour Marion. Ils commencent à se faire une place dans le marché local de la drogue. Sara, sa mère, passe ses journées à regarder un jeu télévisé. Un jour, elle reçoit un appel lui annonçant qu’elle pourrait passer à la télévision. Elle veut perdre du poids pour "rentrer dans sa robe rouge". Un médecin lui prescrit des amphétamines (speed) qu’elle commence à prendre de manière compulsive.
Le ton est presque euphorique (chacun nourrit un rêve, drogue, amour, réussite, reconnaissance) et le récit alterne les points de vue en courts paragraphes, ce qui crée une dynamique mentale syncopée.
2. - Été (suite) : L’illusion d'une ascension
Harry, Tyrone et Marion gagnent de l’argent grâce au trafic de drogue: et se sentent en contrôle. Marion devient plus dépendante de l’héroïne, mais reste persuadée que son projet artistique avance. Sara continue à perdre du poids, mais développe de l’anxiété, des troubles du sommeil, et devient dépendante à ses pilules. C'est le début d’auto-illusion collective : tous pensent approcher leur rêve, alors que les premières failles apparaissent.
3. - Automne : La désintégration commence
L’approvisionnement en héroïne est perturbé, les prix montent. Harry commence à perdre la sensation dans son bras, à force d’injections. Tyrone commence à revivre le traumatisme de la mort de sa mère. Marion devient de plus en plus dépendante. Son couple avec Harry se fissure. Sara, sous l’effet des amphétamines, parle seule à la télévision, croit entendre des voix. Elle augmente les doses sans que son médecin ne l’arrête.
La paranoïa s’installe. Le rêve devient anxiogène. L’automne est une saison de déni et de chute lente.
4. - Hiver : La descente
L'intrigue s’intensifie. Chacun des quatre personnages s’enfonce dans une solitude extrême. Sara connaît des hallucinations visuelles et auditives (le frigo qui bouge, la télé qui lui parle): crise psychotique, elle est internée de force en hôpital psychiatrique. Harry développe une infection au bras due aux injections répétées, mais il continue malgré la douleur et tente d’aller en Floride avec Tyrone pour trouver de la came : hospitalisé d’urgence, il sera amputé. Tyrone est arrêté, enfermé dans une prison où il est humilié et battu. Son passé revient en boucle : le souvenir de sa mère morte. Marion, ne trouvant plus d’héroïne, accepte un deal sexuel avec un dealer, devient prostituée pour acheter de la drogue, finit par participer à des orgies humiliantes.
L’hiver est la saison de la chute irrémédiable, du gel des rêves, du désespoir total.
5. - Épilogue : Le rêve est mort
L’épilogue est très bref, glacial, détaché. Chacun des personnages s’imagine encore atteindre son rêve, bien que physiquement et mentalement détruit. Sara se voit encore sur le plateau télé. Harry pense à Marion alors qu’il est amputé. Marion attend un appel de Harry, dans le silence. Tyrone se replie sur le souvenir de sa mère. Le “rêve américain” s’effondre non pas en explosion, mais en auto-hypnose finale, délire intérieur, solitude infinie...

C’est dans la section rattachée à L'Hiver que le rêve s’effondre totalement pour chacun des quatre personnages, et que le style de Hubert Selby Jr. atteint sa puissance maximale — à la fois dans la narration syncopée, l’horreur physique, et le délitement mental...
"... Sara devait aller aux courses. Depuis des jours, mais impossible de bouger. Elle n’arrivait plus à descendre et à sortir. Elle ne prenait plus le soleil. S’il y en avait. Peut-être qu’il y avait aussi des nuages dehors. Ici c’est la nuit. Peut-être même pire. La nuit, on n’a qu’à allumer et c’est plus gai. Tout est gris maintenant. Gris. Elle devait aller aux courses. Depuis des jours qu’elle devait y aller. Si seulement Ada pouvait passer. Peut-être, oui ? Peut-être qu’elle devrait l’appeler ? Ada l’accompagnerait. Elle lui demanderait pourquoi elle ne pouvait pas y aller toute seule ? Que lui répondre ? Elle ne savait pas. Rien qu’à la boutique d’en face. Oui. Rien qu’à la boutique d’en face. Mais elle n’y arrivait pas. C’était bizarre, elle le savait. Quelque chose n’allait pas. Elle le sentait. Effrayant, Comment – attention ! ! ! ! Non non non non Ahhhhhhh – comment lui expliquer ? Comment lui dire ? Comment lui dire ???? Il fallait qu’elle y aille. Plus de papier hygiénique. Plus de sucre.
Tout est parti. Elle devait y aller. Sortir. Se lever et ouvrir la porte. C’est tout. Debout et la porte. Le petit chaperon rouge. Allons-y gai – ATTENTION ! Rien. Nulle part. Elle y allait. Le réfrigérateur avait une drôle d’allure. Il était plus près. Avec une grande bouche. Plus près. Elle s’était levée. Son sac. Où ? Où ? Elle l’avait trouvé. Elle le serrait, des deux mains. Elle se dirigeait vers la porte. Le réfrigérateur bougeait. Plus près. Sans forme. Une grande bouche. Les souliers dorés de Sara claquaient sur les dalles de la cuisine. Sa robe rouge était froissée. Elle se précipita vers la porte. Le réfrigérateur était encore plus près. La télé était plus grande. L’écran était de plus en plus grand. Elle saisit la poignée. Des gens sortaient de l’appareil. La porte s’ouvrit. Sara la claqua derrière elle. Elle chancelait sur ses talons hauts. Qui claquaient sur les carreaux. La brise était un peu fraîche. Il faisait gris dehors aussi. Personne sur le trottoir. Elle descendit la rue. Elle tanguait. Elle titubait. Elle se raccrochait aux murs. Elle atteignit le coin. S’arrêta. Les voitures. Les voitures ! LES VOITURES ! ! ! ! Des voitures. Des camions. Des autobus. Les gens. Le bruit. Le mouvement. Des tourbillons. Elle avait mal au cœur. Elle s’accrocha au lampadaire. Désespérément. Elle ne pouvait plus avancer. Le feu était au vert. Elle s’accrochait. Les jointures de ses doigts toutes blanches. Le feu passait du vert au jaune. Au rouge. Au vert. Il n’arrêtait pas de tourner. Un nombre incalculable de fois. Incalculable. Les gens filaient. Certains la regardaient. Haussaient les épaules. Continuaient. Sara s’accrochait. Elle regarda de l’autre côté de la rue. Dans toutes les directions. Elle attendait le vert. Elle pouvait traverser maintenant. Elle essaya. Elle ne regardait plus. Le visage contre le poteau. Elle s’accrochait. S’accrochait. Les bruits étaient assourdissants. Des éclairs lui perçaient les paupières. Elle s’accrochait. Le métal était froid. Elle entendait les cliquetis. Elle s’accrochait… Qu’est-ce que tu as ? Ada et Rae la regardaient. Tu as peur qu’il tombe ? Sara tourna lentement la tète. Les regarda. Sara, tu n’as pas l’air dans ton assiette. Sara les regardait fixement. Ils se regardèrent un instant puis l’attrapèrent chacun par un bras et la conduisirent chez eux. Elle tremblait légèrement, ils lui donnèrent un verre de thé, elle restait là assise sans un mot en tenant son verre des deux mains, baissait le front de temps en temps pour siroter son thé, le regard fixe. Je pensais que tu n’étais qu’une grande nerveuse, mais maintenant je me demande. Ada et Rae souriaient et gloussaient et Sara avait envie de leur répondre qu’elle serait vraiment enchantée de n’être qu’une grande nerveuse. Peut-être que tu as un virus ? Pourquoi est-ce que tu ne vas pas voir ton docteur ? Il pourrait te donner un anti-quelque chose. Je n’ai rendez-vous que dans deux jours. Dans deux jours ? Qu’est qui te prend, il te faut un rendez-vous pour être malade ? C’est ça qu’il t’a dit, Attendez un peu et tombez malade dans deux jours ? Ils s’étaient mis à glousser tous les trois et Sara intérieurement s’en mordait les doigts de ne pas y avoir pensé. Elle y avait réfléchi un moment avant d’abandonner et de se contenter de les écouter glousser et de se sentir glousser avec eux et de siroter son verre de thé jusqu’à ce qu’il soit complètement vide.
La salle d’attente comme toujours était pleine de monde et Ada et Rae bavardaient pendant que Sara attendait. Son tour venu elle dit au docteur qu’elle ne se sentait pas très bien. Et quel est votre problème exactement ? Ça a l’air de marcher assez bien du côté du poids, lui dit-il en souriant. Pour le poids ça marche très bien. Mais je ne me sens pas très en forme. Les gens de la télévision arrivent et – ATTENTION ! Sara brusquement s’était retournée et avait regardé derrière elle, tout autour, sous la chaise, puis le docteur et tout autour de lui. Celui-ci avait un sourire qui lui découvrait les dents. Quelque chose qui ne va pas ? Tout me parait si drôle. Comme brouillé. Confus comme – Bon, pas de quoi s’inquiéter. Il s’était mis à écrire sur un bout de papier. Vous donnerez ça à l’infirmière et prendrez rendez-vous pour dans une semaine. À bientôt. Elle était restée seule avec ce bout de papier. Elle le regarda quelques instants puis sortit, avec beaucoup d’effort. Elle tendit le papier à la fille. Il m’a dit dans une semaine. J’ai déjà un rendez-vous pour dans deux jours. Oh parfait. Nous allons l’annuler et vous marquer pour dans une semaine. Voyons, vers les trois heures, ça vous irait ? Sara hocha la tête. Bon. Et mes pilules ? Je vais vous en redonner pour une semaine. Sara poussa un soupir de soulagement, de tout son corps. Bon. Merci. Et maintenant voyons la suite. Okay. La fille prit une fiole, une poignée de cachets en tombèrent, elle en compta vingt et un, qu’elle mit dans une autre fiole sur laquelle elle colla une étiquette. Un cachet trois fois par jour. Je l’ai indiqué sur l’étiquette. Qu’est-ce que c’est ? Oh, quelque chose qui vous calmera un peu, c’est tout. Sara regardait la fiole. Comment est-ce que vous prononcez ça ? Valium. Valleyum ? On dirait le nom d’une maladie. La fille gloussa, Dans une semaine. Et prenez-en un dès que vous serez rentrée. Sara hocha la tête et quitta le bureau. Ils retournèrent tous trois chez Ada où ils prirent une tasse de thé, avec un Danois aux prunes. Sara en prit une petite bouchée mais ne put l’avaler. Demain peut-être. Pour le moment… Elle haussa les épaules et sirota son thé. Elle restait là avec Rae et Ada, en attendant que le cachet lui fasse de l’effet, sans trop savoir ce qu’elle attendait. Mais bientôt elle se sentirait mieux, elle le sentait.
Le réfrigérateur et la télé quand elle était rentrée, étaient à leur place et se tenaient tranquilles. Elle ouvrit la télé et déposa ses pilules sur la table, près des autres, puis se jeta inopinément un coup d’œil dans la glace, en passant devant. Elle avait sa robe rouge. Toute froissée. Et déjà tachée. Elle cligna des yeux un moment et fixa son image sur le miroir. Elle se revoyait vaguement en train d’essayer sa robe, comme tous les matins, mais ne se rappelait pas l’avoir jamais gardée toute la journée. Sauf une fois, pour la bar mitzvah de son Harry. Elle secoua la tête et y réfléchit un instant, puis haussa les épaules, sourit et se changea avant de retourner à la cuisine prendre un de ses nouveaux cachets et de s’asseoir dans son fauteuil. Elle se sentait apaisée. Agréablement. Ses yeux étaient un peu lourds. Pas trop. Elle était détendue, tout simplement. Le fauteuil lui semblait plus confortable. Elle s’y enfonça. Les programmes étaient intéressants. Les gens se tenaient bien. Elle sirota un verre de thé. Sa main cherchait à tâtons sur la table, près du fauteuil, elle n’y rencontrait que le vide. Rien. Sara s’aperçut brusquement qu’elle frottait la table du bout des doigts, les contempla, ses doigts, la table, haussa les épaules, et retourna à son programme, elle ne savait trop lequel. Mais intéressant. Ils l’étaient tous. Et tout le monde restait à sa place, du bon côté de l’écran..."

"Requiem for a Dream" - Une adaptation cinématographique majeure (2000) : le film de Darren Aronofsky (avec Ellen Burstyn dans le rôle magistral de Sara) a propulsé l'œuvre vers une notoriété mondiale ...
- pour sa mise en scène révolutionnaire : Darren Aronofsky utilise des techniques visuelles innovantes : montage ultra-rapide ("hip-hop montage"), split-screens, time-lapses, et objectifs fish-eye. Ces procédés créent un sentiment d'urgence et plongent le spectateur dans la spirale des addictions.
- une bande-son iconique : la partition de Clint Mansell ("Lux Aeterna") est devenue légendaire, amplifiant l'intensité dramatique et l'angoisse.
- des performances inoubliables : Ellen Burstyn (Sara Goldfarb) livre une performance déchirante (nommée aux Oscars). Jared Leto (Harry), Jennifer Connelly (Marion) et Marlon Wayans (Tyrone) incarnent la désillusion avec une brutalité réaliste.
- le film expose la destruction des rêves par les dépendances (drogue, télévision, relations toxiques) avec une honnêteté sans compromis. Son message anti-drogue viscéral en fait un outil pédagogique choc.
- une utilisation de couleurs symboliques (rouge pour l'héroïne, froid pour la solitude) et une photographie granuleuse qui accentue la déchéance.
Le film est une transposition fidèle dans l'esprit (et la brutalité) du livre, utilisant des techniques visuelles et sonores innovantes pour reproduire l'expérience des addictions et le style de Selby : jusqu'à amplifier la portée de son oeuvre, la rendant accessible à un public plus large tout en conservant sa puissance destructrice....
