- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Svevo - Pirandello
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki
- 1930-1940
- 1930s
- Fitzgerald
- Hemingway
- Faulkner
- Koch
- Céline
- Bernanos
- Jouve
- DosPassos
- Kojève
- Miller-Nin
- Grosz - Dix
- Green
- Ortega y Gasset
- Wittgenstein
- Russell - Carnap
- Artaud
- Jaspers
- Sapir - Piaget
- Guillén
- Garcia Lorca
- Hammett
- A.Christie
- Heidegger
- Icaza
- Huxley
- Hubble
- Caldwell
- Steinbeck
- Waugh
- Blixen
- Rhys
- J.Roth - Doderer
- Aub
- Malraux-StExupéry
- DBarnes-NWest
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bataille
- Char-Michaux
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Bloch
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Lewin - Mayo - Maslow
- Montherlant
- Buzzati - Pavese
- Vittorini
- Fallada
- Malaparte
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Welty
- Boulgakov
- Tamiki - Yôkô
- Weil
- Gadda
- Broch
- Steeman
- Jouhandeau
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Ellison
- Bergman
- Baldwin
- Fromm
- Bradbury - A.C.Clarke
- Tennessee Williams
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Carpentier
- Mishima
- Salinger - Styron
- Pasternak
- Asturias
- O'Connor
- Hoffer
- Matute - MartinGaite
- 1960-1970
- 1960s
- Abe
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- U.Johnson - C.Wolf
- Heller - Toole
- Naipaul
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Onetti - Sábato
- Capote
- Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- McCarthy - Minsky
- Sillitoe
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- Lenz
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Dolls
- Ellis
- Cortázar
- Warhol
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- HarperLee
- Fuentes
- 1970-1980
- 1970s
- Habermas
- Handke
- GarciaMarquez
- Deleuze
- Derrida
- Beck
- Satir
- Kundera
- Hrabal
- Didion
- Guinzbourg
- Lovelock
- Vietnam
- H.S.Thompson - Bukowski
- Pynchon
- E.T.Hall
- Bateson - Watzlawick
- Carver
- Irving
- Milgram
- VargasLlosa
- Puig - Donoso
- Lasch-Sennett
- Crozier - Touraine
- Friedan-Greer
- Jacob-Monod
- Dawkins
- Beattie - Phillips
- Gaddis
- Rawls
- Zinoviev
- H.Searles
- Ballard
- Jong
- Kôno
- Calvino
- Ballester-Delibes
- ASchmidt
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact
- 1960s
- Abe
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- U.Johnson - C.Wolf
- Heller - Toole
- Naipaul
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Onetti - Sábato
- Capote
- Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- McCarthy - Minsky
- Sillitoe
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- Lenz
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Dolls
- Ellis
- Cortázar
- Warhol
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- HarperLee
- Fuentes

Vladimir Jankélévitch (1903-1985), "Valeur et signification de la mauvaise conscience" (1933), ": L'Ironie" (1936), "Philosophie première, introduction à une philosophie du presque" (1954), "Le Je-ne-sais-quoi et le presque-rien" (1957), "Le Pur et l'Impur" (1960), "L'Aventure, l'Ennui, le Sérieux" (1963), "La Mauvaise Conscience" (1966), "La Mort" (1966), "Traité des vertus, réed. complète, t. 1 : Le sérieux de l'intention" (1968), "Traité des vertus, réed. complète, t. 2 : Les Vertus et l'Amour" (1970), "L'Irréversible et la nostalgie" (1974), "Quelque part dans l'inachevé" (1978), "Le Je-ne-sais-quoi et le presque rien", nouv. éd. remaniée (1980), .. - ...
Last update : 11/11/2016
Vladimir Jankélévitch, musicien et philosophe, aborde par petites touches des thèmes habituellement délaissés par la philosophie : l'ennui, le mensonge, le sérieux. Mais aussi tout ce qui est passager, éphémère, instable, ce qu'il appelle "l'apparition disparaissante", la "disparition apparaissante, qui apparaît en disparaissant". Avec la même finesse d'approche, son attention s'est portée sur l'analyse existentielle (la Mauvaise Conscience, 1933 ; Traité des vertus, 1949 ; la Mort, 1966 ; le Je-ne-sais-quoi et le Presque-rien, 3 volumes, 1981) et sur les aspects les plus fugitifs de la musique . Il s'est aussi en effet "intéressé" à la musique (Fauré, Debussy, Ravel), pianiste lui-même qui rappelle que "ce qu'on ne peut exprimer autrement, on l'exprime par la musique" : "elle est temporelle, fondante, évasive, elle ne démontre ni n'expose.."
Vladimir Jankélévitchest connu bien au-delà des cercles spécialisés de philosophie, notamment pour son engagement moral pendant et après la Seconde Guerre mondiale, et pour ses réflexions sur la musique. Ses livres (comme "Le Je-ne-sais-quoi et le presque-rien", "La Mort", "L'Irréversible et la Nostalgie") sont des classiques régulièrement réédités et étudiés. Dans le monde anglophone et international, sa notoriété est plus restreinte, il a été moins traduit et moins étudié que ses contemporains comme Sartre, Merleau-Ponty ou Levinas. Cependant, depuis une quinzaine d'années, ses œuvres majeures sont progressivement traduites en anglais et en d'autres langues, et les études académiques sur sa pensée se multiplient.
Sa philosophie du "presque-rien" et de l'instant fugitif est un antidote précieux à l'accélération numérique. Dans un monde saturé de sons et d'images, sa philosophie de la musique, qui insiste sur l'émotion immédiate, l'ineffable et la présence pure de l'œuvre, nous apprend à écouter et à ressentir en profondeur, au-delà du simple divertissement ...
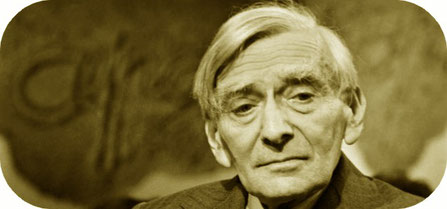
Vladimir Jankélévitch (1903-1985)
Vladimir Jankélévitch, dont les parents russes ont immigré en France suite aux campagnes anti-juives, a obtenu son agrégation de philosophie en 1926. De 1927 à 1932, il enseigne à l'Institut français de Prague et termine sa thèse de doctorat sur Schelling. Il débute sa carrière universitaire à Toulouse, puis à Lille, perd sous l'Occupation, en même temps que sa nationalité française, son poste d'enseignant. En 1951, il se voit enfin offrir à la Sorbonne la chaire de philosophie morale, qu'il occupera jusqu'en 1979. Jankélévitch s'oppose à un Sartre ou à un Merleau-Ponty, à propos desquels il ne livrera aucun jugement quant à leurs oeuvres, mais par le détour de la notion d' "engagement" : "un philosophe, c'est d'abord quelqu'un qui fait comme il dit. C'est quelqu'un qui s'engage, mais réellement. Pas en paroles, pas dans des discours, comme l'ont fait tant de philosophes après la guerre, mais qui par son action quotidienne peut quand même courir certains périls, n'est-ce-pas? Parce que c'est périlleux de s'engager. Or, depuis quelques décennies, les occasions de l'engagement ont été fréquentes et grandes dans nos existences. D'abord, un philosophe de ma génération qui n'a pas pris part à la guerre, qui n'a pas pris part à la Résistance, qui n'a pas joué un rôle pendant ces années, peut toujours parler d'engagement. ... dire un "philosophe engagé" quand ce philosophe engagé a, par exemple, consacré la guerre à faire sa thèse de doctorat, sous l'occupation..."

Vladimir Jankélévitch, "L'ironie ou la bonne conscience", Paris, Alcan, 1936
"Qu'est-ce que l'ironie ? Quelles en sont les formes ? Quels en sont les pièges aussi ? Autant de délicates questions auxquelles l'auteur répond, non sans
ironie lui-même, avec l'aide d'une infinité d'exemples qui montrent son immense culture, musicale aussi bien que philosophique. Sommairement, qu'est-ce que l'ironie, sinon la conscience, mais une
bonne conscience joyeuse - ce en quoi elle se distingue de l'hypocrisie ? Pas d'humour sans amour, ni d'ironie sans joie. L'ironie, en somme, sauve ce qui peut être sauvé. Elle est mortelle aux
illusions ; partout elle tisse les toiles d'araignée où se prendront les pédants, les vaniteux et les grotesques. « Ironie, vraie liberté ! », s'écrie Proudhon au fond de sa cellule de
Sainte-Pélagie. L'ironie remet tout en question ; par ses interrogations indiscrètes elle ruine toute définition, dérange à tout moment la pontifiante pédanterie prête à s'installer dans une
déduction satisfaite. Grâce à l'ironie, la pensée respire plus légèrement quand elle s'est reconnue, dansante et grinçante, dans le miroir de la réflexion." (Editions Flammarion)
Rééditée en 1950, L'ironie s`est enrichie d'un sous-titre : l'ironie ou la bonne conscience. Pour Vladimir Jankelevilch, en effet, "l'ironie est la conscience" et elle ne va pas sans l'amour et la joie ...
"L'ironie, en somme, sauve ce qui peut être sauvé. La sagesse commence au point précis où le cynisme de l'analyse ne nous gâte plus le plaisir ingénu de la synthèse. Il faut que la sentimentalité a purifiée par la moquerie, résiste à la moquerie, d'abord parce qu'il y a dans celle-là une région centrale que celle-ci ne peut atteindre, ensuite parce que notre simplicité fondamentale, un instant décontenancée, retombe toujours sur ses pattes et, de plus belle, recommence à aimer et à croire.
Au fond, nous ne demandons qu'à redevenir puérils.
Il est presque sans exemple que d'être bien renseigné ait jamais dégouté un amant de son amour, que de savoir à quoi s'en tenir sur les humbles origines de l'art ait jamais contrarié vraiment le plaisir esthétique. L'extrême lucidité ne décourage pas si facilement l'extrême naïveté. L'ironie, d'une part, est mortelle aux illusions; partout elle tisse les toiles d'araignées où se prendront les pédants, les vaniteux et les grotesques. "Ironie, vraie liberté!" s'écrie Proudhon au fond de sa cellule de Sainte-Pélagie C'est donc bien vrai que l'ironie est la mobilité même de la conscience, l'esprit révoquant sans cesse ses propres créatures pour garder son entrain et rester maître des codes, des cultures et des formes cérémonielles ; elle nous présente le miroir concave où nous rougissons de nous voir déformés, grimaçants, elle nous apprend à ne pas nous adorer nous-mêmes et fait que notre imagination conserve tous ses droits sur ses progénitures indociles. Quiconque est sourd à son chuchotement se condamne au dogmatisme stationnaire et à l'engourdissement béat.
Pourtant l'ironie n'est pas hostile non plus à l'esprit d'amour et de simplicité.
Il faut être lucide, mais il faut être direct, et faire simplement les choses simples. Comme il y a une misère moderne, misère paradoxale, misère ironique, qui vient de la surproduction, ainsi il y a neurasthénie de l`âme qui a pour cause, non pas l'excessive pauvreté, mais la trop grande richesse; non pas la pluie, mais le stupide beau temps : c'est là le vrai "malheur d'avoir trop d'esprit"..
(...)
L'humour est plus preste et plus agile que l'amour, mais l'amour est encore plus fort que l'humour. Schopenhauer nous montre la volonté poussée sans relâche du désir à l'ennui, et nous, par une dialectique toute contraire, nous verrions plutôt le désir renaître infatigablement du dégoût. C'est un miracle perpétuellement renouvelé, et aussi profond que le retour annuel d'Osiris. A tout moment l'instinct sexuel germe dans les profondeurs de la sensualité, et le sérieux de l'amour renaît des mille sarcasmes qui le criblent; tous les ans il y a un mois de mai et une nouvelle jeunesse dans la terre et dans les arbres...
Comment tant d'hivers répétés n'ont-ils pas dégoûté la nature de faire des fleurs? Mais non, le printemps est aussi têtu que l'hiver, et chaque fois, dans son inlassable patience, la nature réveille les bêtes et les plantes comme si elle n'avait rien appris (...)
Notre naïveté, elle aussi, a la vie prodigieusement dure. Rien n'y fait, ni la moquerie, ni l'échec, ni les longs hivers de la méfiance; l'amour est, comme le premier soleil d'avril, follement oublieux, et rien n'est plus émouvant que cette générosité inépuisable d'une passion qui, chaque fois déçue, retrouve chaque fois la fraîcheur de son enfance. Ce sont les jeux de l'amour et de l'ironie. L'ironie et l'amour tournent en rond sans relâche, l'un pourchassant l'autre, selon le cycle des morts et des renaissances. Cet amour qui ne cesse de se renouveler, cet absolu qui est relatif ne représentent-ils pas tout ce que les hommes, hélas ! peuvent savoir de l'éternité? Tel est justement l'Éros du Banquet sur qui la prêtresse Diotime, l'étrangère de Mantinée, nous dit les plus grandes choses peut-être, les plus profondes, les plus touchantes qu'un homme ait jamais dites. Eros est fils d'Indigence et d'Expédient, c'est-à-dire qu'il est aussi pauvre de vraies satisfactions que riche de convoitises; de son père il tient l'ingéniosité fertile, l'infatigable curiosité et les dons magiques, car Amour est philosophe, et, par surcroît, un peu sorcier (...), toujours en train d'ourdir quelque ruse. De sa mère il tient l'infini dénuement : "rude, malpropre, va-nu-pieds, sans gîte, couchant toujours par terre et sur la dure", il dort à la belle étoile, sur le pas des portes ou dans les chemins. Est-il mortel ou immortel ?
Dans la même journée on le voit naître, mourir et revivre. Toujours déçu, toujours ardent, à la fois beau et laid, très jeune et très vieux, toujours suranné et toujours inouï, Eros est une créature synthétique ; il sait ce qu'il ne sait pas et ne sait pas ce qu'il sait. Eros, comme Socrate, est un démon, un intermédiaire : il descend sur la terre pour apporter aux hommes les faveurs des dieux, et remonte vers le ciel en apportant aux dieux les prières et les offrandes des hommes.
L'ironie, comme Eros, est une créature démonique. Ironie amoureuse, ironie sérieuse, toujours moyenne entre la tragédie et la légèreté! Presque rien n'est aussi grave que nous le craignons, ni aussi futile que nous l'espérons. Les masques qui déambulent follement sur le corso, dans le carnaval de Hoffmann, ont appris la bonne nouvelle : la pensée a détruit la "contemplation", mais la conscience de soi, en lui proposant sa propre image, la rend à sa vraie patrie ; et la pensée respire plus légèrement quand elle s'est reconnue, dansante et grimaçante dans le miroir de la réflexion. Cela veut dire d'abord que l'humour n'est pas sans l'amour, ni l'ironie sans la joie, et ensuite que la lucidité ne manquera pas à ceux qui auront aimé de tout leur cœur...."

Vladimir Jankélévitch, "Le Je-ne-sais-quoi et le Presque-rien", 1957
Le Je-ne-sais-quoi et le presque rien, nouvelle édition remaniée; tome I: La Manière et l'Occasion; tome II: La méconnaissance. Le Malentendu; tome III: La
Volonté de vouloir, Paris, Le Seuil, 1980
"Le "je-ne-sais-quoi" n'est pas un nouveau concept que j'aurais inventé, et qui s'ajouterait à la liste déjà longue des concepts qui meublent l'histoire de
la philosophie" : mais "il faut bien donner un nom à ce qui n'a pas de nom, à ce qui est impalpable", à ce qui n'est pas un objet de savoir, ni matière à science. Nous sommes habitués
aux sentiments ambivalents, contradictoires, on a certes un langage pour expliquer notre malaise, notre timidité, les sentiments parfois compliqués que nous éprouvons, mais que l'entendement ne
parvient pas à expliciter. Vladimir Jankélévitch ajoutera, à propos de ce "je-ne-sais-quoi", qu'il est "l'inapaisable soif d'une âme tendue vers les choses inexistantes", un état
plaisant, vital, qui peut "faire battre le coeur plus fort et plus vite", qui nous fait sourire ou nous rend joyeux : le "je-ne-sais-quoi" rend séduisante, sans que je sache exactement pourquoi,
la moindre mesure de Chopin, par exemple, et je pourrais analyser en profondeur toute l'harmonique sur laquelle elle repose, je n'en saurai pas plus, l'essentiel m'échappera..
L'intention fondamentale de Jankélévitch est de cartographier l'indicible. Son projet est un acte de résistance philosophique contre deux tendances qu'il rejette ...
- Le rationalisme excessif : l'idée que tout peut et doit être expliqué, conceptualisé et réduit à des catégories claires et distinctes. Pour lui, cette approche rate l'essentiel de l'expérience humaine : sa part de mystère, de charme, de grâce et d'évidence immédiate.
- Le positivisme scientifique : la croyance que seul ce qui est mesurable, quantifiable et observable existe véritablement. Jankélévitch veut au contraire donner un statut philosophique de premier ordre aux phénomènes les plus ténus, les plus subjectifs et les plus fuyants.
Son but n'est pas de "définir" le je-ne-sais-quoi (ce qui serait une contradiction absolue), mais de cerner par l'approche indirecte ce qui se dérobe. Il utilise la philosophie non comme un scalpel pour disséquer, mais comme une loupe pour observer les vibrations de l'être. C'est une entreprise phénoménologique (description de ce qui apparaît à la conscience) et métaphysique (réflexion sur les principes premiers de la réalité).
Le choix de ce sujet n'est pas arbitraire ; il est au centre de toute sa pensée et répond à plusieurs impératifs :
- Fidélité à l'expérience vécue : Nous faisons tous l'expérience du je-ne-sais-quoi (le charme d'une personne, la grâce d'un moment, la beauté indéfinissable d'une mélodie). La philosophie, pour Jankélévitch, doit rendre compte de cette expérience première et non la nier parce qu'elle est difficile à penser.
- Une question philosophique fondamentale : Le je-ne-sais-quoi pose la question de l'émergence. Comment quelque chose (une émotion intense, une décision, une œuvre d'art) peut-il surgir de presque rien ? C'est lié aux problèmes de la liberté, de la création et de la vie elle-même.
- Un pont entre ses domaines de prédilection : Ce concept est le lieu où se rencontrent naturellement ses trois grands champs d'expertise : la morale (l'acte gratuit, la générosité spontanée), la métaphysique (le mystère de l'instant et du commencement) et l'esthétique (le charme ineffable de la musique).
Pourquoi Trois Tomes ?
La division en trois tomes n'est pas un artifice éditorial, mais la structure nécessaire de son investigation. Chaque tome aborde le problème sous un angle différent, correspondant à une modalité distincte de l'existence du je-ne-sais-quoi. L'intention de Jankélévitch était de combler un vide philosophique en nous apprenant à penser l'impensable et à parler de l'ineffable.
Le choix des trois tomes est systématique et progressif :
- Phénoménologie (Tome 1 : Comment ça apparaît ?)
- Herméneutique (Tome 2 : Comment ça se communique - ou pas ?)
- Métaphysique (Tome 3 : D'où est-ce que ça vient ?)
Cette structure lui permet d'approcher son objet par cercles concentriques, usant d'une méthode qui épouse la nature même de son sujet : non pas une démonstration linéaire et rigide, mais une série de variations, d'exemples et de méditations qui, ensemble, finissent par dessiner les contours de ce qui ne se laisse pas capturer.
"Le Je-ne-sais-quoi
Il y a quelque chose qui est pour ainsi dire la mauvaise conscience de la bonne conscience rationaliste et le scrupule ultime des esprits forts ; quelque chose qui proteste et « remurmure » en nous contre le succès des entreprises réductionnistes. Ce quelque chose est comparable, sinon aux reproches intérieurs de la raison devant l’évidence bafouée, du moins aux remords du for intime, c’est-à-dire au malaise d’une conscience insatisfaite devant une vérité incomplète.
Il y a quelque chose d’inévident et d’indémontrable à quoi tient le côté inexhaustible, atmosphérique des totalités spirituelles, quelque chose dont l’invisible présence nous comble, dont l’absence inexplicable nous laisse curieusement inquiets, quelque chose qui n’existe pas et qui est pourtant la chose la plus importante entre toutes les choses importantes, la seule qui vaille la peine d’être dite et la seule justement qu’on ne puisse dire ! Comment expliquer l’ironie passablement dérisoire de ce paradoxe : que le plus important, en toutes choses, soit précisément ce qui n’existe pas ou dont l’existence, à tout le moins, est le plus douteuse, amphibolique et controversable ? Quel malin génie empêche que la vérité des vérités soit jamais prouvée sans équivoque ?
Autant demander pourquoi c’est justement le mal qui est tentant, le plaisir nuisible qui nous attire, le devant-être qui nous répugne ! Ce n’est pas ici le lieu de nous interroger sur l’ataxie constitutionnelle qui fait de la donnée trompeuse une évidence obvie et inambiguë, de l’unique chose essentielle un absconditum et un mystère, qui nous soustrait celui-ci en nous amusant avec celle-là… La nostalgie de quelque chose d’autre, le sentiment qu’il y a autre chose, le pathos d’incomplétude enfin animent une espèce de philosophie négative qui a toujours été en marge et parfois au centre de la philosophie exotérique.
Platon, qui sait, quand il dit les choses indicibles, abandonner le discours dialectique pour le récit mystériologique, Platon parle dans le Banquet d’un « quelque chose d’autre » dont les âmes des amants sont éprises, qu’elles ne peuvent exprimer, qu’elles devinent seulement et suggèrent en énigmes : ἄλλο τι βουλομένη ἑϰατέρου ἡ ψυχὴ δήλη ἐστὶν ὄ οὐ δύναται εἰπεῖν, άλλὰ μαντεύεται ὂ βούλεται ϰαὶ αἰνίττεται1. Il est vrai que ce quelque chose d’autre est l’unité de la nature primitive, laquelle est chose assignable et, en somme, dicible : mais le fait qu’il est l’objet d’une réminiscence prénatale et d’un vœu métempirique plus grands que tout désir sensible oblige Aristophane à l’exposer mythiquement et à lui donner un caractère inexplicable autant qu’inépuisable. Sans ce mystérieux et surnaturel Allo ti, l’aporie d’amour telle que la décrit le Phèdre serait-elle aussi évasive ?
Ayant énuméré à la manière d’Aristote les caractères de la beauté poétique, le P. Rapin, que cite Henri Bremond, ajoute : « Il y a encore dans la poésie de certaines choses ineffables et qu’on ne peut expliquer. Ces choses en sont comme les mystères. » Voilà un encore qui n’est pas un post-scriptum ordinaire ! L’« Encore » poétique des jésuites Rapin et Ducerceau, comme le quelque chose d’autre érotique du discours d’Aristophane, est une allusion à l’infini et une ouverture sur l’indicible ; ce « résidu » de mystère est la seule chose qui vaille la peine, la seule qu’il importerait de connaître, et qui, comme exprès, demeure inconnaissable. Le secret, comme il en est de la mort, est décidément bien gardé, l’ignorance humaine est décidément bien combinée ! Beaucoup de noms ont pu être donnés à cet innommé innommable, beaucoup de définitions proposées pour ce « quelque chose d’autre » qui n’est précisément pas comme les autres parce que en général il n’est ni une chose ni quelque chose."
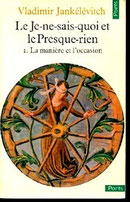
"Le Je-ne-sais-quoi et le presque rien, tome I: La Manière et l'Occasion"
Concept central : La manifestation du je-ne-sais-quoi dans le monde.
Le "je-ne-sais-quoi" et le "presque-rien" sont deux expressions pour cerner une même réalité insaisissable : ce qui fait le charme, l'âme, la grâce d'un être, d'une œuvre d'art ou d'un moment, sans pouvoir être réduit à une qualité objective ou mesurable. C'est un phénomène qui se ressent intensément mais se dérobe à l'analyse rationnelle.
Le tome I, La Manière et l'Occasion, explore comment ce charme opère dans la temporalité...
- La Manière : Jankélévitch explore ici le "comment" des choses. Ce n'est pas ce qui est fait, mais la façon dont c'est fait. La manière, c'est le style, l'allure, la grâce dans l'exécution. C'est ce qui distingue un technicien parfait d'un artiste génial. Il l'oppose à la "méthode", qui est froide et reproductible.
- L'Occasion : C'est l'étude du kairos grec (le moment opportun, propice). Le je-ne-sais-quoi n'apparaît pas n'importe quand ; il surgit dans un instant fugitif et favorable, un "presque-rien" temporel. Il analyse la ponctualité, le retard, la précipitation, l'à-propos. L'occasion, c'est le creuset temporel où le charme opère.
Ce tome décrit le je-ne-sais-quoi dans l'espace (la manière) et dans le temps (l'occasion).
Chapitre I - Le charme du Temps
"1. Apparence et Manière
Il y a bien des façons d’escamoter le mystère : on peut, soit intervertir purement et simplement l’ordre d’importance de l’essence et de l’accident, soit faire de l’inconnaissable une simple exténuation quantitative du connaissable. La réhabilitation de l’accident caractérise une certaine philosophie modale qui se désintéresse de l’être pour considérer les seules manières d’être de cet être : le philosophe réintègre la caverne des ombres et des reflets hors de laquelle il avait fait évader les captifs. Qualités primaires, qualités secondes, elles ont toutes même promotion et même consistance pour un impressionnisme philosophique qui réduit la substance à ses modes. Cette interversion diamétrale du platonisme, sensible déjà dans l’éthique cicéronienne du Decorum, a pris une forme particulièrement piquante chez Balthasar Gracián : la quatorzième maxime de l’Oracle manuel résume à cet égard un chapitre du Discreto qui oppose la Circonstance à la Substance et la Manière à la Chose. Gracián appelle la manière le Comment et indique par là qu’il la conçoit sous une forme qualitative et dans son rapport avec l’agrément sensible.
Toutefois, il ne faut pas s’exagérer le caractère révolutionnaire d’une inversion qui, succédant à la conversion platonicienne et néo-platonicienne, c’est-à-dire renversant du Contre au Pour le renversement du Pour au Contre, semble réhabiliter le jeu frivole des apparences et des nuances et ce ballet des ombres vaines dont le nom platonicien était Skiagraphia. Chrétien et surnaturaliste, Gracián ne manque pas une occasion de préciser que la vérité seule importe, et il oppose volontiers l’« homme substantiel » à l’« homme d’ostentation ». Il dit qu’il faut préférer le solide de la substance au vide de l’ostentation, la vraie royauté à la vanité, le réel au luxe des cérémonies. Le livre du Discret, qui raconte l’apologue du Paon, l’oiseau d’ostentation, explique théologiquement comment ce primat du substantialisme s’accorde avec une réhabilitation relative des modalités3 : le Créateur a conféré à ses créatures le Paraître en même temps que l’Être, et ceci par surcroît : car, comme l’artifice est une seconde nature qui double et corse la première, ainsi la manière d’être est un second être ou un supplément d’être, une petite majoration ontique dont le Créateur a gratifié l’être, pour qu’en plus de l’Esse nu l’être ait aussi la splendeur multicolore du plumage et la gloire et le lustre.
Sans ostentation, dit Gracián, toute perfection serait dans un état violent. En disant que l’apparence est sacramentaire, mais non point sacrée, nous aurons peut-être exprimé l’amphibolie de sa nature : si en effet sa négativité consiste à paraître sans être, sa vertu positive est d’apparaître ; si elle est moindre être par opposition à l’essence concentrée et invisible de l’être, elle est pourtant la glorieuse et visible auréole de cet invisible ; détendu, diffus et raréfié, comme tout ce qui semble, le second être est ipso facto l’irradiation d’un être surnaturel. Quelque chose de la substance resplendissante, mais obscure, est passé dans l’apparence resplendie ! Le petit être du Paraître rayonne du grand être de l’Essence, et par conséquent il est la splendeur de la Ténèbre. La dialectique ascendante de la République et du Banquet remontait des ombres à la lumière du soleil et du soleil visible à la lumière suprasensible du Bien ou de la beauté sans forme, pour ensuite rétablir l’ordre hiérarchique normal de la procession : Gracián commence, en théologien, par l’ordre a priori de la théophanie, mais c’est pour mieux séjourner ensuite dans le monde des mille reflets et des fantasmes.
Aussi le soleil est-il moins une allégorie de l’invisible qu’une lumière ostentative illuminant le théâtre du monde : le soleil fait la roue comme un paon, scintille comme le diamant, s’épanouit comme la rose ; sa fonction est la montre, c’est-à-dire qu’il sert à exhiber ou « faire voir », et non pas à soustraire ni à mener ailleurs par métaphore. C’est l’extérieur, remarque le Discret lui-même, qui nous fait connaître l’intérieur — non pas tant parce que le dehors est anagogique, mais parce que l’écorce seule est connue immédiatement et premièrement. L’apparence est donc à la fois ce qui est premier par rapport à nous seuls (πρότερον πρὀς ἡμᾶς) et ce qui amorce la démarche a posteriori ; et pourtant l’être, sans le paraître, ne serait que ce qu’il est, à savoir Esse nudum, terne substance et réalité méconnaissable. Le paraître donne à l’être l’éclat, mais ce n’est pas lui qui fait être l’être ; le paraître ne rend pas juste la justice, ni raisonnable la raison, ni vraie la vérité, il fait seulement qu’elles en aient l’air et la réputation, et que tout le monde les reconnaisse pour telles. Par exemple la manière adoucit l’aigreur de la vérité, mais elle ne fait pas du vrai le faux ni du faux le vrai : le « Comment », dit Gracián, sucre la vérité, c’est-à-dire la rend enchanteresse et attrayante, mais il n’en altère pas la substance.
Pareillement la manière efface les rides de la vieillesse, mais elle ne rajeunit pas le vieillard ; elle le fait paraître plus jeune, ce qui est agréable et peut même être utile : elle ne fait pas littéralement du vieux un jeune, elle ne peut rien contre la triste vérité de la vieillesse, rien contre l’irréversibilité du temps. La spécialité de la manière, c’est la « semblance », et si le faux-semblant est plus que le faux, la vraisemblance à son tour est bien moins que le vrai. L’être est pratiquement ce qu’il semble…, pratiquement et approximativement ; mais, en ultime vérité, l’être est ce qu’il est, et la lourde tautologie, ou plutôt la « tautousie » qui est l’identité vécue se referme comme un destin sur l’être débarrassé de ses fards. Et tout de même : l’homme a pratiquement l’âge qu’il paraît, pratiquement et par manière de dire, c’est-à-dire à la ville et à la cour dans les petites affaires quotidiennes ; mais, dans les grandes choses sérieuses, par rapport à l’état de ses artères, devant la maladie et devant la mort, l’homme a l’âge qu’il a. Le Comment des instituts de beauté concerne la demi-vérité des miroirs, celle que le sixième livre de la République considérait comme un reflet ou un lustre, φάντασμα. Le sage qui cherche à imiter le Modèle des modèles se soucie-t-il de paraître plus jeune ? « Ce qui ne se voit pas est comme s’il n’était pas. » Comme si ! Gracián aurait pu dire : ce qui ne se voit pas n’existe pas ; or il écrit : l’invisible est autant dire inexistant. La splendeur ne pose pas la valeur, mais elle la met en valeur ! La réputation ou renommée, qui est un savoir réfracté dans l’opinion d’autrui, ne crée pas le savoir, mais elle double le savoir d’un savoir second qui dore et fait resplendir le premier…
Platon n’avait cure de flatter et de plaire — car c’est tout le platonisme qui vomit les parfums et les sirops du bas agrément, qui dresse la science sérieuse contre la complaisance, et l’austère vérité contre la stupide et frivole câlinerie : le gracianisme, lui, réhabilite ces routines discréditées de la Flatterie (ϰολαϰεία)5 : commôtique, rhétorique, sophistique — où le Gorgias n’avait voulu reconnaître que les fourriers honteux de l’hédonisme ; Alcibiade, qui est façade sans intériorité, se trouve réhabilité. Sur le chemin de velours du stratagème s’organise toute une technique de la plaisance, une académie de flatterie. Dans l’art de persuader tel que le mysticisme de Pascal le réhabilitera, il entre une bonne part de dérision cynique : c’est la corruption de la créature qui nous oblige à tenir compte de la zone passionnelle, conjecturale et courtisane de l’existence. Gracián s’engage plus profondément que Pascal dans le jeu intramondain : comme Cicéron tourné vers le renom, la célébration louangeuse et l’applaudissement, comme le Prince machiavélique et comme le courtisan de Balthazar Castiglione, le « Plausible » de Gracián est le personnage parfaitement adapté au régime de l’apparence, de la doxa et de la poudre aux yeux. Paroles de soie ! s’écrie cet homme modernissime...."
Ce chapitre est une méditation sur le charme spécifique qui émane de la durée, de la temporalité étirée, et particulièrement du passé. Jankélévitch oppose ici le "charme" à la "grâce". La grâce serait instantanée, divine, atemporelle (comme un trait d'esprit ou un sourire). Le charme, lui, est intrinsèquement lié au temps ; il est mélancolique, nostalgique et possède une épaisseur temporelle.
Sa thèse est que le passé, précisément parce qu'il est révolu et inaccessible, exerce un charme puissant. Ce charme n'est pas dans l'événement lui-même, mais dans la distance qui nous en sépare, dans le voile de l'oubli et de la mémoire sélective qui l'embellit.
Concepts Clés ...
- Le Charme du Passé : Le passé est charmant car il est irrévocable. On ne peut plus rien y changer, ce qui le rend à la fois tragique et précieux. Son charme est fait de "déjà-vécu" et de "jamais-plus". C'est le charme des ruines, des vieilles photos, des souvenirs d'enfance.
- La Métaphore Musicale : Jankélévitch, musicologue, utilise abondamment la musique pour illustrer son propos. Le charme du temps est celui de la mélodie, qui a besoin de la durée pour se déployer, par opposition à l'accord qui est un instant harmonique. La mélodie charme parce qu'elle se souvient de ses notes passées et anticipe les futures, créant une tension et une résolution continues.
- Le Presque-Rien : Dans ce contexte, le "presque-rien" est l'accumulation infinitesimale d'instants, de petits riens qui, tissés ensemble par la durée, forment la trame charmante du souvenir. C'est la patine du temps sur un objet, l'imperceptible changement qui fait la valeur de l'ancien.
- Critique de la Nostalgie : Jankélévitch ne célèbre pas naïvement la nostalgie. Il en montre le mécanisme et presque la duperie. Le charme est une illusion rétrospective ; nous charmons le passé en le regardant depuis le présent. Le "je-ne-sais-quoi" réside dans cet acte même de projection et de valorisation.
La profondeur de l'analyse est remarquable. Jankélévitch parvient à mettre des mots sur une sensation universelle et pourtant indicible. Son style est poétique et précis, à la fois philosophique et littéraire.
Mais le texte est exigeant. Il procède par associations d'idées, digressions et répétitions incantatoires plus que par une argumentation linéaire. Le lecteur doit accepter de se laisser porter par la prose pour en saisir la subtilité plutôt que d'y chercher une démonstration rigide.
Chapitre II - Le charme de l’Instant et l’Occasion
"1. L’Occasion, ou la « bonne Heure »
Jusqu’ici on a surtout considéré le je-ne-sais-quoi diffus, celui qui est inhérent à la continuation de l’intervalle ; mais on a dû également préciser que notre rencontre avec ce je-ne-sais-quoi advenait dans l’espace infinitésimal d’une étincelle. Le charme diffluent émane de la fluide continuité du devenir : c’est le charme de l’intervalle ; mais le charme de l’intervalle opère dans l’instant ; le charme, qu’il soit intervalle ou manière temporelle, s’appréhende comme une phosphorescence de l’instant et comme une apparition naissante-mourante. Or il arrive aussi que le charme soit lui-même instant : l’entrevision de ce charme est alors une captation de l’instant dans l’instant, mieux encore — elle est un instant qui appréhende l’instant ; c’est la minute enchantée où le regard croise le regard, où s’effile pour notre entrevision le je-ne-sais-quoi le plus fin, le plus ponctuel et le plus fugitif.
Dans la continuation des apparitions disparaissantes l’intuition guette en effet des fractures privilégiées qui constituent des événements privilégiés. Balthasar Gracián s’exprime ainsi : « Il faut traverser la vaste carrière du temps pour arriver au centre de l’occasion. » Et de fait les maximes 55 et 56 de l’Homme de cour se répondent : celle-là consacrée au « temporisement » qui mûrit les résolutions et à la patience d’attendre qui ralentit toute précipitation, celle-ci consacrée à la « promptitude » et aux expédients de l’« Impromptu ». C’est qu’il y a chez Gracián deux sagesses et deux prudences, l’une toute en lenteur et retenue, dont il emprunte les traits à Tacite, l’autre toute en vivacité et diligence. Parlant de la première, il écrit : « La béquille du Temps fait plus de besogne que la massue de fer d’Hercule. Dieu même, quand il nous punit, ne se sert pas du bâton, mais de la saison. » Le temps est la dimension du délai intelligent et du sursis dilatoire : la temporisation sera donc toute la grammaire des princes. Le φρόνιμος est un être de précaution, de discrétion et de circonspection qui a dépassé le stade des impromptus et de la spinalité réflexe : l’ajournement ou mora est sa vraie dignité. Les choses, dit Machiavel, procèdent gradatim, et le temps, qui dévoile la causation, est le « père de toute vérité ». Quiconque escamote l’opération temporelle et bouscule l’adagio du devenir et du loisir, n’enfantera jamais que des avortons.
Pourtant si le politique est l’ouvrier des chefs-d’œuvre tardifs, le héros est parfois le virtuose des œuvres hâtives. Céder au temps, tempori cedere3, peut en effet signifier deux choses : ou bien accepter, par sagesse, le laps incompressible de l’évolution et du mûrissement ; ou bien s’adapter aux circonstances et aux bizarreries imprévisibles de la conjoncture. Et le mot Saison, à son tour, il désigne tantôt la période, qui est intervalle, tantôt l’occasion, qui est un moment. Le Plausible entreprend dans le temps, mais il se règle sur les divers temps successifs de ce temps. Aussi Gracián précise-t-il que le sage vit dans l’éternel, mais dépend du siècle ; que tout est relatif à la mode du jour, sauf la vertu qui est « en tout temps ».
Et voici enfin où apparaît avec évidence le lien de τρόπος et de ϰαιρός, le passage du trope à l’occasion : il faut épier le temps le plus favorable du lustre le plus éclatant, car c’est la saison qui donne son point de perfection à la renommée. Ainsi s’expriment la maxime sur l’« Homme d’ostentation » et le traité sur le Politique don Ferdinand5. — Historiquement la réhabilitation des fluxions imperceptibles du devenir va de pair avec l’importance croissante des manières les plus superficielles de l’être : et comme il y a un « maniérisme » qui intervertit la hiérarchie traditionnelle de la substance et des modalités, ainsi il y a un « occasionnalisme » qui limite la préséance des causes et consacre la promotion des accidents les plus insignifiants et des facteurs les plus négligeables. En réalité, la cause reste bien la cause, et l’occasion n’occasionnerait même pas si elle ne présupposait la cause éminente qui la rend occasionnelle ; l’occasion n’opère que parce que la situation est rendue instable, explosive, virtuellement féconde en effets potentiels grâce à la préexistence latente de la cause.
A cet égard, il y a un indicible et un impalpable qu’on appelle tantôt Volonté, tantôt Liberté, tantôt Pouvoir ou Faire-être, et qui est pour nous la seule cause absolument prévenante, la cause profondissime, car elle détient seule, par opposition aux causes subalternes, la vraie préséance étiologique. Mais cette cause insondable, si elle est nécessaire, n’est pas toujours suffisante, c’est-à-dire effectivement efficiente et positivement déterminante : elle est comme un pouvoir trop large dont l’être ne sait que faire et qui donne un peu le vertige ; l’être, par exemple, est cause-de-soi, mais ce pouvoir de réalisation indéterminé se dissoudrait dans le vide si aucune matière ne lui était offerte : la cause indéterminée a donc besoin, à son tour, des causes occasionnelles qui la limiteront et, la limitant, donneront au pouvoir-être la possibilité effective de s’exercer. Ce que l’occasion offre ainsi à la cause en peine, à la cause pneumatique et désincarnée, ce sont les deux coordonnées de la date et du lieu : une double localisation est en effet la condition de toute existence historique complète comme de tout repérage précis.
Pourtant, si la cause non fécondée par l’occasion est nécessaire sans être suffisante, l’occasion toute seule n’est ni suffisante ni même nécessaire : séparées de la volonté inspiratrice, qui non seulement représente la condition sine qua non, mais détient la vraie paternité étiologique, les réponses aux questions Ubi et Quando ne sont que des précisions catégorielles, hypothétiques et fictives. Quoi qu’il en soit, la cause a besoin, pour causer quelque chose, des occasions postées sur son chemin, c’est-à-dire des facteurs chargés d’occasionner la causation. L’occasionnement est le type de la causalité par ricochet et de l’étiologie induite : car comme l’acte poétique consiste dans une certaine mutualité de corrélation et dans le va-et-vient qui s’établit entre la création et la contre-expression, entre le rayonnement du sens et le contrecoup des signes, ainsi l’occasion est l’origine d’une onde de retour qui reflue sur la causalité efférente et descendante ; dans cette relation bilatérale, à la fois « poétique » et « pathique », la cause devient secondairement effet tandis que l’effet devient cause subalterne.
L’énergie spirituelle se développe dans le temps pur, qui est le mode d’être du faire-être et la manière qu’a le non-être d’être ou l’être de n’être rien : car telle est la dimension du devenir ; mais les occasions activent et libèrent cette énergie dans une durée concrète..."
Si le premier chapitre traitait de la durée, le second se concentre sur son opposé complémentaire : l'instant. Jankélévitch explore ici le charme de ce qui est éphémère, fugace, de l'occasion (la kairos des Grecs) qu'il faut saisir au vol. Le charme n'est plus dans la nostalgie, mais dans l'urgence du présent. Sa thèse est que le "je-ne-sais-quoi" se manifeste souvent dans un instant privilégié, une occasion unique qui, si elle n'est pas saisie, est perdue à jamais. Ce charme est celui de la spontanéité, de la rencontre fortuite, de l'improvisation.
Concepts Clés ...
- L'Instant (vs. le Moment) : Jankélévitch distingue l'instant (ponctuel, fulgurant) du moment (une petite durée, un laps de temps). Le charme opère dans l'instant, dans l'étincelle.
- L'Occasion (Kairos) : C'est le concept central. L'occasion est la "bonne occasion", le moment propice, le carrefour où le destin bascule. Elle n'est pas chronologique (chronos) mais qualitative. Son charme réside dans son ambiguïté : elle est à la fois offerte (elle se présente) et à prendre (elle exige une action). Elle est fragile et périssable.
- Le "Presque-Rien" de l'Occasion : Ici, le "presque-rien" est le détail infinitésimal qui fait basculer une situation : un regard, un silence, un mot prononcé ou tu au bon moment. C'est la petite différence qui change tout, le point de bascule imperceptible.
- La Rencontre et l'À-propos : Le charme de la rencontre amoureuse ou amicale est un paradigme de l'occasion. Cela "clique" ou cela ne clique pas, sans que l'on puisse toujours expliquer pourquoi. L'à-propos (la manière parfaitement adaptée à l'instant) est la vertu qui permet de saisir l'occasion et de générer du charme.
Les deux chapitres forment une dialectique ...
- Chapitre I : Le Charme de la Durée (Passé/Nostalgie). C'est un charme rétrospectif, contemplatif, mélancolique.
- Chapitre II : Le Charme de l'Instant (Présent/Occasion). C'est un charme prospectif, actif, héroïque (il faut oser saisir l'occasion).
Le "je-ne-sais-quoi" est donc ce phénomène qui se joue dans l'interstice entre ces deux temps : dans la mémoire qui transforme la durée en charme (Ch. I) et dans la décision qui saisit la chance de l'instant (Ch. II).
La conceptualisation de l'occasion est brillante et extrêmement fertile, applicable à l'esthétique, à l'éthique et à la vie quotidienne. Jankélévitch rend palpable l'urgence de vivre.
Comme souvent chez Jankélévitch, les frontières entre les concepts (instant, occasion, à-propos, charme) sont floues et délibérément poreuses. Le lecteur cherchant des définitions strictes sera frustré. Il faut voir cela comme une pensée en mouvement, qui mime la fluidité de son objet d'étude.

"Le Je-ne-sais-quoi et le presque rien, tome II: La méconnaissance. Le Malentendu"
« On ne comprend jamais tout à fait un être, pas plus qu'une musique... » - Concept central : L'incommunication et le malentendu comme destin probable du je-ne-sais-quoi.
- La Méconnaissance : Le je-ne-sais-quoi est par nature fragile et insaisissable. Il est donc très facile de le rater, de ne pas le percevoir, ou de l'interpréter de travers. Jankélévitch explore les pathologies de la communication : l'indifférence, l'inattention, l'incompréhension.
- Le Malentendu : Paradoxalement, ce malentendu n'est pas toujours négatif. Il peut être créateur. Une œuvre d'art, par exemple, peut être interprétée de mille façons différentes, et cette polysémie fait partie de sa richesse. Le malentendu est le risque et peut-être la chance de toute communication authentique, qui n'est jamais une simple transmission d'information.
Ce tome est une philosophie de l'altérité et de la rencontre. Il montre que l'ineffable qui nous attire chez l'autre est aussi ce qui nous sépare et rend la communication parfaite impossible, forgeant ainsi la richesse des relations humaines.
PREMIÈRE PARTIE - LA MÉCONNAISSANCE
CHAPITRE I - Le Je-ne-sais-quoi Le Je-ne-sais-quand Méconnaissance de la manière - CHAPITRE II - Ambiguïté de l’apparence - CHAPITRE III - La temporalité - CHAPITRE IV - Les méconnaissables - CHAPITRE V - La reconnaissance
"La méconnaissance est génératrice de malentendus. Elle n’est certes pas la seule cause des fausses situations qui bloquent les rapports humains. La méconnaissance est une connaissance à laquelle, apparemment, il ne manque rien… ou presque-rien ! Après avoir cherché à saisir cet insaisissable « presque-rien », ce je-ne-sais-quoi, il nous faut maintenant décrire la connaissance paradoxalement complète et incomplète (les deux ensemble) à laquelle le presque-rien fait défaut. Recherche négative en quelque sorte ! Qu’on ne s’étonne donc pas si cette recherche nous arrête assez longuement. Il y a plus à dire sur les variétés innombrables de la mauvaise connaissance et de la mauvaise entente que sur la fine pointe aiguë de la liberté ou sur le je-ne-sais-quoi. Du je-ne-sais-quoi en lui-même, par définition, je ne sais rien et je n’ai rien à dire. Parler de la méconnaissance et de ses innombrables « manières » de tomber à côté quand on a visé l’inatteignable je-ne-sais-quoi, n’est-ce pas le lot de toute philosophie « apophatique » ? Le problème de la méconnaissance concerne le mystère impalpable de la personne, de l’œuvre ou du message : la méconnaissance est une façon particulièrement irritante, controversable et aporétique de manquer celui-là en croyant connaître ceux-ci.
1. Docte ignorance. Mécompréhension, malentendu
La méconnaissance se distingue à la fois de l’inconnaissance qui est ignorance pure et simple et de l’inconnaissance qui est « docte ignorance ». De la première — l’ignorance tout court — elle se différencie au premier coup d’œil : l’ignorance plate n’est pas plus méconnaissance que le savoir pédant n’est une vraie connaissance… Car l’ignorance négative est nescience vide et n’a ni profondeur ni signification d’aucune sorte ; sa platitude exclut toute allusion à un mystère, quel qu’il soit ; elle est l’ignorance ignorante, l’ignorance-un-point-c’est-tout ! Vous ne savez pas ? Allez à l’école, pour combler vos lacunes. L’ignorance banale, nescienta vulgaris, nescience inexcusable (sinon impardonnable) de la chose connaissable, en un mot l’amathie, άμαθὶα ou ἇρνοια, ignorant ce qu’elle ferait mieux d’apprendre, pose un simple problème didactique. — La docte ignorance, gnose nesciente, à la fois excusable et pardonnable est au contraire l’inconnaissance de l’inconnaissable ; elle est, sinon une véritable intuition, du moins une espèce d’innocence gnostique : telle est cette gnose dont nous parle la Théologie mystique du Pseudo-Denys (l’Aréopagite), et qui traverse la nuée ténébreuse de l’inconnaissance (γνόφος τῆς άγνωσίας) pour accéder à la lumière ; dans le même sens le traité des Noms divins de Denys l’Aréopagite nous dit que l’inconnaissance est le chemin vers la connaissance1. Elle est en fait au-delà de l’alternative connaissance-ignorance.
Qu’en est-il maintenant de la méconnaissance ? La méconnaissance aussi est, à sa manière, une science nesciente, mais la contradiction en ce cas est le symétrique inversé de la contradiction qui fait tout le paradoxe d’une « docte ignorance » : l’une et l’autre, méconnaissance et docte ignorance, savent et en même temps ne savent pas, savent sans savoir, savent tout et ne savent rien, mais elles sont orientées en sens inverse l’une de l’autre : la docte ignorance sait, croyant ignorer, et le méconnaissant, au contraire, croit savoir alors qu’il ne sait pas ; la méconnaissance ne sait pas ce qu’elle sait ; et la docte ignorance, elle, sait ce qu’elle ne sait pas, un peu comme l’innocente de Pelléas et Mélisande… Si l’ignorance vulgaire est inexcusable et la docte ignorance excusable, la méconnaissance est à la fois excusable et inexcusable : elle est excusable car elle est, après tout, bien loin de ne rien savoir… Elle sait, au contraire, beaucoup de choses, et elle n’en sait même que trop ! et elle n’en est que plus perfide ! Elle s’oppose, la présomptueuse, non seulement à la connaissance droite, parce qu’elle la fausse, mais à la docte ignorance de l’Aréopagite et de Nicolas de Cues ; et ceci du tout au tout ! Plutôt qu’une docte ignorance, c’est une ignorance doctorale, une ignorance érudite, pédantesque et prétentieuse : de la science elle n’a en effet que les prétentions ; et elle est, face à la docte ignorance, comme les faux docteurs en face de Socrate qui les confond et dénonce leur imposture : car ils savent sans comprendre et méconnaissent l’essentiel ; et la docte ignorance, au contraire, elle, sait qu’elle ne sait rien, et c’est même, dans son humilité extrême, la seule chose qu’elle croie savoir ; le dénuement est la seule richesse (et encore !) dont elle se reconnaisse la possession. Modestie socratique ou sainte agnosie dionysienne, la docte ignorance croit ingénument ne pas savoir ce qu’en fait elle sait déjà ou déjà entrevoit..."
La méconnaissance n'est pas l'ignorance (ne pas savoir) mais le fait de se tromper sur ce que l'on croit savoir. C'est une connaissance illusoire, un savoir qui est en réalité un non-savoir déguisé. Jankélévitch y analyse les mécanismes par lesquels nous manquons l'essence de l'autre, de l'œuvre d'art ou d'une situation, croyant pourtant la comprendre.
Sa thèse est que la méconnaissance est structurelle dans la relation au je-ne-sais-quoi. Comme celui-ci est par nature fuyant et insaisissable, il se prête naturellement aux projections, aux interprétations erronées et aux illusions. Nous croyons saisir un charme alors que nous ne saisissons que l'idée que nous nous en faisons.
Concepts Clés ...
- Le Faux-Témoignage de la Conscience : Notre propre esprit est le premier source de méconnaissance. Nous interprétons les signes à travers le prisme de nos désirs, nos préjugés, nos attentes. La conscience est un "mauvais guide" qui nous fait prendre nos constructions mentales pour la réalité.
- La Méconnaissance en Amour : C'est le paradigme principal. L'amour est le domaine par excellence du je-ne-sais-quoi (on aime "je ne sais quoi" chez l'autre). Mais c'est aussi le terrain de jeu de la méconnaissance la plus radicale : l'idolâtrie (où l'on prend l'être aimé pour un dieu) et la mystification (où l'on se leurre sur ses qualités réelles). L'amour-propre et le désir déforment notre perception de l'autre.
- L'Indirect et l'Insaisissable : Le je-ne-sais-quoi ne se donne jamais directement. Il faut l'interpréter. Cette nécessité de l'interprétation ouvre la porte à toutes les erreurs. Nous méprenons les signes indirects, les pudeurs, les silences, les sous-entendus.
- Le "Presque-Rien" de la Méprise : Ici, le "presque-rien" est le détail infinitésimal qui fait basculer la compréhension vers l'incompréhension : une intonation mal interprétée, un geste ambigu, un lapsus. C'est le grain de sable dans l'engrenage de la communication.
Jankélévitch offre une phénoménologie brillante de l'erreur. Il ne la condamne pas moralement mais en décortique les mécanismes avec une profonde compassion. Il montre que la méconnaissance n'est pas un accident, mais une tentation permanente de l'esprit humain face à la complexité du réel. C'est une analyse profondément moderne, qui anticipe les questions sur la construction de la réalité et les biais cognitifs.
DEUXIÈME PARTIE - LE MALENTENDU
CHAPITRE I - Variétés du malentendu - CHAPITRE II - L’ordre du malentendu Et comment les malentendus se dissolvent
"Le presque-rien n’est rien, ou à peu près, mais on s’expose à des mécomptes si on n’en tient pas compte. Le malentendu est la revanche de la philosophie et de la morale, sciences inexistantes, inutiles qui ont pour objet les choses les plus invisibles et les plus controversables. Le divin de l’être est ce qu’on peut méconnaître impunément. Les esprits forts du matérialisme physico-chimique, prenant le réel au mot, font comme si cet élément inexistant de l’existence n’existait, en fait, d’aucune manière : les éclatantes réussites mécaniques justifient ce positivisme, la faillite morale et la détresse morale prouvent l’indémontrable lacune d’une vision à la fois complète et incomplète. Nous disions : il manque quelque chose et il ne manque rien, il manque quelque chose qui n’est rien, il manque… on ne sait quoi, quelque chose d’inassignable qu’on ne peut dire et qui, comme le charme ou la conviction du cœur, n’a presque pas de nom.
Cette dissymétrie d’une fausse vérité qui a raison et tort, tort d’avoir raison et raison d’avoir tort et qui reflète si bien notre condition moyenne, est le principe du malentendu. Ainsi la réalité plutôt méconnue que mal connue, et plutôt mécomprise que méconnue, se venge par le malentendu. Si, comme nous aurons à le montrer, le Temps est l’élément différentiel par excellence, l’élément inexistant par définition qui fait de la conscience une « chose » pas comme les autres, si, en d’autres termes, le Temps est précisément le rien qui est tout, il faudra conclure d’abord que la philosophie est la méditation du temps, c’est-à-dire que la science inexistante raisonne à l’aide de pensées bâtardes, son objet étant l’être qui n’est pas (presque pas !) ou le non-être qui est ; ensuite il faudra avouer que la solution du malentendu repose sur la réhabilitation de la temporalité ; la philosophie, faisant honneur à l’inexprimable du devenir, aiderait les sourds à bien s’entendre : car l’entente veut une ouïe mentale extra-fine et une subtilité auriculaire hors du commun…
Une déroutante amphibolie démonétise paradoxalement la dichotomie du vrai et du faux : nous appelions Je-ne-sais-quoi, d’un nom anonyme, l’équivoque qui suspend ainsi le principe de contradiction. Le malentendu est la méconnaissance d’un impalpable, impondérable, indémontrable je-ne-sais-quoi qu’on peut négliger sans contrevenir aux lois écrites… Dans ce domaine des lois non écrites où la nuance de l’interprétation est tout, où seule importe l’appréciation morale, le malentendu est la méprise bien fondée, l’erreur pneumatique qui punit la surdité pneumatique. Appelons-le la mésaudition. Le Je-ne-sais-quoi est ce mésentendu atmosphérique lui-même, cet inassignable principe de l’erreur-en-esprit ! L’oreille de l’âme est ici seule responsable, puisque la nuance qualitative importe seule. Un esprit n’est donc pas encore situé quand on dit de lui qu’il est ou dans le vrai ou dans le faux ; notre complication mentale, les mille et une nuances de la susceptibilité, de la coquetterie et de l’ambivalence pudique défient l’alternative polaire de l’erreur et de la vérité. On peut, n’est-ce pas ? avoir tort tout en ayant raison… En fait, les deux partenaires du malentendu ont tous deux raison à la fois : celui qui a compris de travers a, en un autre sens, ou du moins en apparence, fort bien compris ; il a, tout en se trompant, compris ce qui était à comprendre ! Deux consciences passionnées, deux personnes entrent en rapports, deux partenaires qui croient se comprendre et pourtant n’attribuent pas le même poids, la même sonorité, la même nuance au même mot : et voilà de l’un à l’autre les fils inextricables du mensonge, de l’amour-propre et de la vanité qui commencent à se brouiller : le même devient un autre et le contraire son propre contraire ; les mots n’ont plus de sens, ni le principe d’identité, et la tête la plus froide, grisée par ce vent de folie, par ce génie de la confusion ne sait plus elle-même ce qu’elle pense. De là la difficulté d’obtenir un témoignage clair et univoque sur quoi que ce soit. L’évidence a cessé d’être incontestable, et notre conviction elle-même subit non seulement l’empreinte de notre désir, mais celle de la croyance qu’il nous plaît de suggérer aux autres, ou que les autres nous attribuent.
1. La force du Désir
Le malentendu, comme en son genre la « Gaffe », appartient à l’espèce de ces erreurs bien fondées qui deviennent possibles par le commerce scabreux des consciences ; il n’est pas simple confusion, mais faux calcul caractéristique, faux sens révélateur, intéressé et passionnel. Qu’est-ce qui détermine, en fait et subjectivement, l’orientation spécifique de la fausse croyance ? On ne peut le comprendre qu’en adoptant la perspective psychologique de l’auditeur ou du lecteur. Au dogmatisme de l’affirmation répondent la naïveté de la créance ou la gaucherie de la méfiance, l’une et l’autre manifestant dans tous les cas la force thétique et réifiante du désir. Ai-je bien entendu ? Et puis-je en croire mes oreilles ? L’absurdité déconcertante des malentendus, l’impossibilité où l’on se trouve de les prévenir jamais complètement, malgré les précautions les plus minutieuses, s’expliquent par cette fausse magie de nos souhaits ; nous disons fausse, car bien entendu il n’y a pas de miracle, et notre désir de la chose ne fait pas qu’elle soit, mais seulement qu’on le croie ; et voilà toute la méprise. On croit ce qu’on désire et l’on entend ce qu’on croit. Renouvier a profondément parlé1 de ce vertige passionnel et imaginatif à la faveur duquel on glisse sans volonté, sans réflexion, de l’hypothèse au jugement de réalité ; la conscience passe furtivement du possible à l’acte, non pas pour tricher, comme la mauvaise foi dans les sophismes, mais parce qu’elle est dupe elle-même de son désir : les hallucinés, les demi-charlatans que nous sommes aident ainsi au mouvement attendu, pensant le suivre ; constatent les miracles ; vérifient les prophéties. Tout prodige, toute imposture ou absurdité, recrute ainsi des témoins sincères prêts à déposer en sa faveur.
On n’empêchera jamais l’homme fasciné de prendre ses vœux pour la réalité, de bondir en imagination par-dessus l’abîme ontologique qui sépare le notionnel et l’existence, le possible et l’événement ; la baguette des fées, les étoiles filantes ou, à leur défaut, les songes romanesques et toutes les chimères de la nuit servent ainsi de rallonge au possible : ils complètent la médiocre, la prosaïque réalité, ils jettent au-dessus du temps la passerelle des mensonges merveilleux. Mieux encore, notre prière, à un certain degré d’intensité ou d’incandescence, doit s’exaucer elle-même et par sa seule ferveur ; c’est une conviction chevillée au cœur des hommes que le futur ne pourra se refuser indéfiniment à une espérance sincère et passionnée, qu’à force de désirer quelque chose vertigineusement, cette chose sera : soit que notre malheur présent nous donne des droits sur le bonheur, soit que notre contrition décide la Providence à nous faire grâce ou à nous prendre en pitié, soit même que nos vœux aient la force de métamorphoser un monstre en princesse.
Hélas ! ce ne sont là que les formes de notre impuissance. La médecine peut guérir toutes les maladies, mais elle ne peut rien contre la mort qui est la maladie des maladies ; les techniques augmentent infiniment la vitesse de nos déplacements, mais elles ne nihilisent pas la distance, laquelle est incompressible et pas davantage la durée ; elles ne nous confèrent ni le don d’immortalité ni le don d’omniprésence ni le don d’omnipotence qui sont des dons « surnaturels ». La malédiction du temps n’est jamais conjurée, sinon dans les rêves ; la limite de l’instantanéité n’est jamais atteinte. Don Quichotte ne représente-t-il pas au seuil des temps modernes ce désenchantement d’une conscience grisée par les romans de chevalerie et qui se retrouve soudain dans un monde prosaïque, dans un monde sans fées ? Ce monde est le monde galiléen des actions mécaniques et des lois de la pesanteur…"
Si la méconnaissance est un phénomène individuel (je me trompe moi-même), le malentendu est son versant interpersonnel et social. C'est un échec de la communication où les messages sont émis mais ne se rencontrent pas, où les consciences restent parallèles sans se connecter.
La thèse de Jankélévitch est que le malentendu n'est pas l'absence de communication, mais une communication qui réussit trop bien dans sa propre logique et rate pourtant sa cible. Chacun comprend parfaitement… mais dans son propre système de référence, sans rencontrer celui de l'autre. C'est le drame de l'incommunicabilité.
Concepts Clés ...
- Le Quiproquo et la Tragédie : Jankélévitch explore le malentendu comme source de comédie (le quiproquo) mais aussi et surtout de tragédie. Le malentendu n'est pas drôle ; il est souvent douloureux et destructeur. Il est au cœur des conflits humains, des ruptures, des guerres même.
- L'Intersubjectivité Ratée : Le malentendu révèle la difficulté ontologique de la rencontre des consciences. Nous sommes condamnés à communiquer par des signes équivoques (les mots, les gestes) qui ne transporteront jamais exactement notre intention. Il y a une solitude fondamentale dans l'être humain.
- Le Silence et le Non-Dit : Le malentendu le plus profond ne naît pas de ce qui est dit, mais de ce qui n'est pas dit. Les silences, les sous-entendus, les non-dits sont le terreau fertile des incompréhensions. Le "presque-rien" ici est l'absence de parole au bon moment.
- L'Irréparable : C'est un concept central chez Jankélévitch. Certains malentendus, une fois installés, deviennent irréparables. L'explication elle-même arrive trop tard ou est encore un nouveau malentendu. La confiance est brisée et ne peut se reconstruire.
On le voit, la progression est logique et tragique ...
- La Méconnaissance (Partie I) : Je me trompe sur toi. C'est une erreur active de ma part.
- Le Malentendu (Partie II) : Nous nous trompons mutuellement. C'est un échec relationnel et dialectique. C'est la méconnaissance devenue dialogue de sourds.
Le malentendu est la socialisation de la méconnaissance. Il est le résultat inévitable du fait que deux subjectivités, chacune sujette à la méconnaissance, tentent de communiquer.
C'est dans cette partie que Jankélévitch touche à sa dimension la plus profonde et la plus sombre. Sa analyse du malentendu est d'une lucidité désarmante sur la condition humaine. Il n'offre pas de solution miracle, mais constate une fragilité essentielle du lien social. La force de son analyse est de montrer que le malentendu n'est pas un accident de parcours, mais une possibilité permanente et structurelle de toute relation.
Le tome II est peut-être le plus poignant et le plus profond des trois. Il complète parfaitement le premier en montrant l'envers du décor : si le je-ne-sais-quoi réussi produit le charme et la grâce, le je-ne-sais-quoi manqué produit la méconnaissance et le malentendu.
Le génie de ce tome réside dans son regard sans illusion mais non cynique sur les relations humaines. Jankélévitch ne se moque pas de nos erreurs ; il en fait le matériau d'une réflexion éthique sur la difficulté de rencontrer l'autre. C'est une philosophie de la fragilité ...
La difficulté, comme toujours, est stylistique. La pensée procède par spirales, répétitions variations et illuminations soudaines. Il faut accepter de se perdre parfois dans les méandres de sa prose pour en saisir les fulgurances.
En définitive, ce tome est une méditation essentielle sur les limites de la connaissance et de la communication. Il nous apprend que la plus grande prudence éthique consiste à savoir que l'on peut toujours se méprendre sur l'autre et que le dialogue est un équilibre perpétuellement à reconquérir contre la tentation du malentendu. C'est un plaidoyer pour l'humilité dans nos jugements et pour l'attention aux "presque-riens" qui peuvent tantôt créer le lien, tantôt le briser.
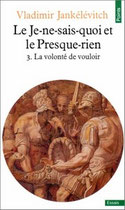
"Le Je-ne-sais-quoi et le presque rien, tome III: La Volonté de vouloir"
« Le presque-rien de la volonté, c'est le fiat de la décision. » - Concept central : L'origine du je-ne-sais-quoi, son point de naissance dans la conscience et l'action.
- Ce tome est le plus métaphysique. Jankélévitch s'attaque au mystère du commencement : comment une décision, un acte libre, une intention jaillissent-ils en nous ?
- La "Volonté de vouloir" : Il distingue le "vouloir" concret (je veux ceci ou cela) de la "volonté de vouloir", qui est la capacité pure à initier, à commencer, à être l'origine d'une action. Avant tout choix raisonné, il y a un élan premier, un "presque-rien" volitif qui met la machine en marche.
C'est l'application du je-ne-sais-quoi à la liberté humaine et à la création. L'acte libre naît d'un fond obscur et indéterminé, tout comme l'œuvre d'art naît d'une inspiration qui précède la raison.
Ce tome remonte à la source même du phénomène. Il montre comment le "presque-rien" est le point de bascule à partir duquel le quelque chose (une action, une œuvre, une vie) advient au monde.
CHAPITRE I - La Liberté et l’équivoque
De toutes les formes du Presque-rien, il n’en est pas de plus méconnaissable, de plus propice au malentendu que la liberté, et il n’en est donc pas de plus déroutante, sinon pour l’esprit de finesse et d’entre-vision, du moins pour l’esprit de géométrie ; sinon pour Anima, du moins pour Animus. Schelling, au début de ses Recherches philosophiques sur l’essence de la liberté, prend assez à la légère l’objection d’après laquelle la liberté, étant asystématique par essence, ne se pourrait saisir, comme dit Platon, que par raisonnement bâtard : mais si l’amphibolie est toute la nature de la liberté, l’objection ne tourne-t-elle pas en argument ? Sa paradoxologie, qui lui est commune avec le mouvement et la vie, cesse de la réfuter quand elle est professée en elle-même. La liberté vérifie en effet, non pas l’évidence univoque de Descartes, mais plutôt l’évidence équivoque de Pascal, celle qui est évidence simultanée des contraires. Une assertion simple sur la liberté n’est jamais qu’un moment dans la dialectique oscillante qui alternativement nous renvoie du Contre au Pour, puis du Pour au Contre : en sorte que tout le monde a successivement raison dans ce jeu de bascule infini. N’est-ce pas ce jeu de bascule lui-même qui est la liberté ?
1. Le renversement du Contre au Pour
Le Contre. La liberté ne se prouve pas plus que la vie ; et comme tout ce qui est observé ou conclu plaide pour le mécanisme et pour la théorie physico-chimique, ainsi tout le positif de nos actes volontaires démontre le déterminisme.
« C’est toujours le déterminisme qui paraît avoir raison1. » Aussi y a-t-il quelque machiavélisme dans le zèle compromettant et indiscret des indéterministes ; Bergson a déjoué avec une intrépide et inégalable clairvoyance le sophisme apodictique qui prétend prouver la liberté comme une certaine propriété assignable de l’acte parce qu’il s’attend ainsi à ne pas la trouver et parce que c’est en somme le but recherché. Plutôt le déterminisme qu’une liberté si mal défendue ! Démontrer l’indémontrable, n’est-ce pas le réfuter ? A tout moment je me découvre serf et déterminé, comme en chaque point le mouvement se résout en stations et le bon mouvement en petits calculs d’intérêt…
Si la liberté est un effet d’ensemble, le détail des motifs et mobiles, lui, donnera toujours raison aux Zénon d’Élée de la défiance rationnelle et aux La Rochefoucauld du soupçon ; aux immobilistes et aux misanthropes. Libre en gros, de haut et de loin, l’acte gratuit s’avère déterminé quand on y regarde de plus près, ou mesquinement égoïste en chacun de ses moments. Personne n’agit, dit Leibniz, « sans rime ni raison », et l’absence de raison est encore une raison, le plaisir d’agir sans raison étant lui-même une raison d’agir ; ou, comme le dit encore Leibniz dans une lettre publiée par Gaston Grua : nous voulons ce que nous trouvons bon d’après notre goût, fût-ce par caprice ou esprit de contrariété, fût-ce pour prouver notre liberté. Le Gorgias et le Ménon exprimaient ce truisme dans le style et l’humeur de l’optimisme en disant que vouloir, c’est par définition même vouloir le bien ; que le bien est par définition chose voulue et que la volonté, captive d’une fatalité de bienveillance, est constamment aimantée par la causalité finale du Meilleur.
L’homme heureux n’est heureux qu’en gros et de loin, et à la seule condition d’effleurer, de glisser et de ne jamais insister : il devient soucieux dès qu’il approfondit son bonheur ; et, tout de même, celui qui croit choisir « sans raison » découvre des motifs de sa préférence pour peu qu’il l’analyse ; liberté et optimisme, ils sont tous deux effet de masse et d’approximation ; en somme, la lucidité analytique et la minutieuse précision sont toujours du côté du déterminisme, la liberté n’étant jamais qu’un vœu, une protestation sentimentale, une illusion de notre incorrigible chimérisme.
Cette disparité se vérifierait aussi dans l’ordre des jugements de valeur ; l’aveugle colère et l’indignation passionnée traitent l’intention comme indivise, donc comme responsable ; mais la minutie, elle, est généralement déterministe ; l’indéterminisme peut paraître simpliste auprès d’une étiologie qui tient compte des antécédents, tenants et aboutissants et de toute la motivation complexe d’un acte ; nuançant l’axiologie sommaire et sévère à laquelle le libre arbitre donne lieu, le déterminisme multiplie les motifs d’indulgence : les manières du Comment et les degrés du Combien rendent plus floue l’imputation, estompent la bifurcation vertigineuse du Bien et du Mal et nous soulagent d’une responsabilité dont ils distribuent la charge entre les motifs.
Et c’est peu de dire que l’esprit de finesse déterministe multiplie jusque dans l’infinitésimal les circonstances atténuantes : car c’est le déterminisme en général qui est « circonstanciel ». Les modalités circonstancielles sont toujours atténuantes, et elles émoussent le tranchant du dualisme manichéen ; mais l’intention, qui est liberté et quoddité, est toujours aggravante ! Ainsi tout ce qui est pensable et assignable dans la liberté est déterminé, tout… hormis ce fiat impalpable, hormis ce je-ne-sais-quoi au nom duquel la folle volonté nie les déterminismes ; ce je-ne-sais-quoi atmosphérique est le contraire d’une chose, et il n’y a précisément rien à en dire. Et ce n’est sans doute pas un hasard si le même mot « détermination », tout en excluant l’arbitraire de l’indifférence, désigne des existences dotées de marques caractérisables et entièrement particularisées dans leur forme.
Le Pour. Cependant l’évidence no 2 — l’évidence non évidente — proteste contre l’évidence no 1 et fait entendre ces « reproches intérieurs » qui sont comme la mauvaise conscience du déterminisme : car celle-ci a peut-être tort d’avoir trop raison comme celle-là a raison d’avoir tort. Si le déterminisme est le scrupule de l’indéterminisme, la liberté à son tour est le remords du déterminisme ; tout comme l’évidence de la vitalité est le remords du mécanicisme. Dans les deux cas il y a une évidence négligée. Et voici d’abord le point de vue du sujet agissant : je fais ce que je fais, quoi que je fasse ; ainsi l’exige le principe d’identité. Mais je pourrais faire autrement ! Et la preuve en est que le spectateur témoin ne peut jamais prévoir mon choix avec certitude, il peut seulement l’anticiper en tâtonnant, à force d’approximations statistiques, grâce aux données disponibles de la caractérologie et de la sociologie, et toujours dans l’ordre du probable.
Comment se fait-il qu’un acte déterminé ou explicable après coup soit toujours imprévisible avant le fait ? Pourquoi, s’agissant de l’homme et de l’histoire, la détermination ne se révèle-t-elle jamais quand on en aurait besoin ? Car, il faut en prendre son parti, ce sont surtout les prophéties rétrospectives3 qui réussissent… Et, de même que la vie prend un sens par la rétroaction posthume de la mort, c’est-à-dire quand il est trop tard, de même que l’événement historique, si immotivé soit-il en apparence, trouve sa loi après coup, de même, quand l’éventualité sera devenue événement, une étiologie raisonnable s’offrira à en établir la nécessité ; je ne sais pas encore, mais je devine que je vais avoir su.
Dans cette antinomie tient toute l’ambiguïté du libre arbitre : il n’est jamais prouvé après coup que les choses auraient pu tourner autrement ; mais il est également impossible de prouver qu’elles ne pouvaient pas être autrement : sinon, pourquoi ne les avait-on pas prévues ? De la même manière je ne puis jamais prouver rétrospectivement que, si je suis guéri, c’est grâce à ce remède, que je n’aurais pas guéri sans lui… Le sophisme de Diodore Kronos, c’est d’appliquer au futur soi-disant nécessaire le principe d’identité et du tiers exclu : les choses, quoi qu’il arrive, ne pouvaient être qu’ainsi, c’est-à-dire telles qu’elles ont été ; quoi qu’il arrive, c’est ce qui devait advenir qui sera advenu ; quoi qu’il arrive, c’est, par définition même, le motif le plus fort4 qui aura prévalu. Certes, tout prouve le destin, et le pour et le contre, et l’argument et l’objection…
Le nécessitaire, ayant toujours raison d’avance, gagne à tous les coups. Mais le dilemme qu’on a substitué à l’alternative n’est-il pas un grossier sophisme ? L’argos logos, qui réussit par la seule élimination du temps, n’est-il pas un truisme vulgaire ? Les Mégariques sont les spécialistes des vaticinations a posteriori, et ces vaticinations sont si verbales que Leibniz lui-même s’arrangeait pour combiner la prédestination avec l’activisme : la monade, quoi qu’elle entreprenne, accomplit sa définition, mais ceci n’est d’aucune conséquence pour la volonté, qui continue de franchir ou de ne pas franchir ses Rubicons sans tenir particulièrement compte de l’inclusion préétablie des attributs dans les sujets. L’accomplissement de la vocation est tout entier donné dans la définition, sans aléa ni incertitude.
Telles sont donc les deux optiques contradictoires et indépendantes dont le sporadisme fait toute l’équivoque de notre liberté. Le déterminisme se vérifie dans le détail, par analyse, comme il se vérifie après coup, par rétrospection ; la liberté s’exhale de l’ensemble, et elle détient aussi le secret imprévisible, le secret impénétrable du futur. Après coup et comme Avoir-pu-faire-autrement, la liberté n’est qu’un vain regret et une improuvable illusion ; avant le fait et comme Pouvoir-faire-l’un-ou-l’autre, l’imprévisibilité est une irréfutable, irréfragable évidence ; et elle défie toute anticipation, et elle se rit de nos pronostics. La liberté au passé est aussi inconsistante que le charme d’Hier, lequel était imperceptible hier, c’est-à-dire sur le moment, quand cet « hier » était un Aujourd’hui, et apparaît dès que l’aujourd’hui d’hier est devenu l’hier d’aujourd’hui. J’aurais pu, j’aurais dû… Ici, « autrement » ne traduit que la vaine impuissance du regret. Après coup et dans la rétrospectivité posthume de l’acte, la liberté est aussi décevante, aussi évanouissante qu’un charme...."
Ce chapitre est une méditation sur le caractère fondamentalement équivoque et indécidable de la liberté humaine. Jankélévitch s'attaque ici au problème philosophique classique du libre arbitre, non pas pour le résoudre de manière théorique, mais pour en décrire l'expérience vécue, qui est une expérience de doute, de trouble et d'ambiguïté.
Sa thèse est que la liberté n'est pas un fait objectif que l'on peut constater, mais un postulat pratique et une angoisse. Nous ne pouvons jamais avoir la certitude rétrospective que nous avons été libres dans un choix passé ; nous ne pouvons que le croire et en assumer la responsabilité. La liberté est un "je-ne-sais-quoi" métaphysique qui se dérobe à la preuve.
Concepts Clés ...
- L'Équivoque Radicale : Personne, pas même le sujet lui-même, ne peut trancher avec une certitude absolue s'il a agi librement ou par une suite de causes (passions, déterminismes inconscients, influences). Cette indécidabilité n'est pas un défaut de la liberté mais son mode d'être même.
- La Liberté comme Scandale : La liberté est un "scandale pour la raison" car elle introduit une rupture, une discontinuité absolue dans l'enchaînement causal du monde. Elle est un commencement absolu, un "presque-rien" qui fait basculer le cours des événements.
- Le Remords et la Preuve Négative : Jankélévitch trouve dans le remords l'indice le plus fort de la liberté. Le fait même de se sentir coupable, de regretter un acte en croyant qu'on aurait pu faire autrement, est la "preuve par l'absurde" de la liberté. Si nous étions totalement déterminés, le remords n'aurait aucun sens.
- L'Option et l'Hésitation : Il décrit le moment qui précède le choix comme un temps d'hésitation vertigineuse, où toutes les possibilités sont ouvertes. Ce moment est celui du "vouloir vouloir", où la volonté se prend elle-même pour objet avant de se jeter dans l'action.
Jankélévitch se distingue des traitements classiques du libre arbitre (philosophiques ou scientifiques) en déplaçant la question de "Sommes-nous libres ?" (question de fait) à "Que signifie pour nous l'expérience déroutante de nous sentir libres et responsables ?" (question de sens). Il décrit avec une finesse psychologique remarquable le trouble existentiel qui accompagne tout choix important.
CHAPITRE II - Le Vouloir en son fin fond
1. Le pouvoir de vouloir. Vouloir, c’est pouvoir.
« Commencer est un grand mot », écrit Jules Lequier. Il suffisait peut-être de dire que la liberté elle-même en elle-même et quant à elle-même, libertas ipsa, que l’ipséité de la liberté enfin, coïncide avec ce pouvoir du commencement. La liberté n’est inconsistante que dans la continuation, quand tout est joué, décidé, révolu, quand il est trop tard, donc après coup. Immense et décevante comme l’avenir dont ce commencement est la promesse, quand on envisage en elle le pouvoir du Pas-encore, elle apparaît éblouissante et insaisissable comme le présent quand on vise en elle ce point instantané de l’initiative qui est en somme un presque-rien.
La liberté est en effet le point évanouissant où pouvoir et vouloir, le temps d’une étincelle, coïncident. Quelle description fixera jamais ce scintillement du vouloir, cette apparition disparaissante de la scintilla voluntatis ? Quelle dialectique atteindrait ce branle très secret par quoi tout commence ? Vouloir est la seule chose au monde qui dépende de moi plénièrement, absolument, exclusivement, la seule chose qui soit, comme eût dit Épictète, radicalement ἐφ’ ἡμῖν ; vouloir est, dans tous les cas, à mon entière discrétion et disposition.
En d’autres termes : l’exercice de la volonté est la seule opération qui, si elle implique une possibilité préalable, ne suppose aucune potentialité, aucun pouvoir distinct du vouloir lui-même ; toute activité finie présuppose en effet une disposition passive ou une capacité active qui en conditionnent l’exercice : or nulle puissance expresse ne double ni ne précède le vouloir, puisque le vouloir est lui-même cette puissance… Entendons-nous : dans la mesure où la volition est un événement qui peut advenir ou ne pas advenir en fait, il y a bien une faculté de vouloir et cette faculté s’actualise quand on en use, reste virtuelle quand on s’abstient ; en ce sens très général le pouvoir exprime une simple possibilité logique de volonté ou nolonté : l’homme est un être volontaire capable de ne pas vouloir, ou plutôt c’est un être volontaire qui n’est pas toujours voulant. Quid faciemus ? Quel contenu donner à ce pouvoir vide ?
Ce que nous voulons dire, c’est que le « pouvoir » de vouloir ne suppose ni essais ni apprentissage, qu’il est d’emblée parfait chez tous, que son actualisation enfin est immédiate, instantanée et assurée du succès. Vouloir c’est, sans gradus ad Parnassum, pouvoir les deux (utrumque), et par exemple pouvoir le bien ou le mal, le oui et le non, et donc être impardonnable de ne pas vouloir. L’homme peut faire s’il veut, à condition de le pouvoir, et notamment d’avoir appris ; l’homme peut vouloir s’il veut, c’est-à-dire peut vouloir dans tous les cas, inconditionnellement et sans effort exprès, à condition seulement de le vouloir… car en dernière instance cela ne dépend que de son bon vouloir.
On dirait volontiers (n’est-il pas, pour cette raison, le divin en l’homme ?) que le vouloir implique, comme Dieu, l’essence et l’existence confondues, car il est à la fois, au même moment et du même coup, possibilité de poser et position effective, position, non pas de quelque chose, mais de soi comme voulant quelque chose d’autre. Qui prétend n’avoir pas la « force » de vouloir, celui-là ne veut pas : cette mauvaise raison n’est qu’un prétexte et un sophisme pour déguiser en faiblesse le cercle vicieux de sa mauvaise volonté. Vouloir, n’étant pas conditionné par un quelconque Posse, n’a pas de conditions de possibilité, et c’est déjà méconnaître l’absolutisme de la volonté que d’en faire une faculté de vouloir au même titre que toute faculté relative et empirique. Et, partant, la volonté n’est pas une puissance qui serait acquise ou apprise par apprentissage scalaire, qu’on pourrait donc avoir ou ne pas avoir, avoir plus ou moins et en partie, et, l’ayant, employer ou ne pas employer : car tel est le cas des talents que tout le monde ne possède pas et que leurs possesseurs mêmes peuvent acquérir par morceaux ; qui sont le privilège d’une élite, et dans cette élite même un privilège gradué.
A cet esthétisme un peu aristocratique du pouvoir-faire, par lequel les hommes s’inégalisent et se différencient, opposons l’éthisme œcuménique du vouloir. C’est peu de dire que le pouvoir de vouloir est, comme le bon sens, la chose du monde la mieux partagée : il est l’universellement humain par excellence ! Aussi les hommes, ces demi-dieux du vouloir, sont-ils rigoureusement égaux en leur demi-divinité.
Et c’est peu de dire que le pouvoir métempirique de vouloir n’est pas fractionnable : il est, à l’opposé de toute aptitude spécialisée, de toute virtuosité technique, d’emblée parfait chez tous les hommes ; il est toujours tout ce qu’il peut être. Velle non discitur. Le pouvoir de faire est à la fois difficile et facile, difficile parce qu’il résulte du labeur patient et de la gymnastique des habitudes, facile en ce que le progrès lui-même repose sur la conservation des modifications nerveuses et musculaires ; vice versa, le « pouvoir » de vouloir est à la fois facile et difficile : facile en ceci que, parfait de naissance, il rend inutile tout perfectionnement laborieux, et difficile parce que, excluant la capitalisation de l’acquis et l’épargne biologique, il suppose un recommencement continué à partir de zéro et une tension toujours vigilante du vouloir.
Plus simplement encore : quand une volonté veut, il est superflu a fortiori, inutilement analytique et absurdement tautologique de préciser qu’elle peut vouloir, étant donné que pour pouvoir vouloir il suffit par définition de le vouloir. Vouloir, c’est pouvoir — non point à la lettre et en cet absurde sens qu’il suffirait de vouloir pour pouvoir ce qu’on veut, comme les magiciens, et pour accomplir le saut ontologique : car le fiat n’a rien de commun avec la thaumaturgie des vœux et dépend au contraire des lois prosaïques du déterminisme… Vouloir, ce n’est pas pouvoir les choses qu’on veut, entendez : les choses, valeurs, objets que l’on veut ; ni faire miraculeusement et comme par enchantement que le complément direct matériel de ce vouloir devienne réel, ni réaliser physiquement le voulu. Non ! vouloir ce n’est pas pouvoir les choses qu’on veut, mais c’est, ipso facto, pouvoir vouloir.
Cet acte de foi de l’assurance volontariste, pris au sens des sorciers, aurait un peu l’air d’un défi et d’une paradoxologie provocante : car il est bien évident que, pour toutes les activités empiriques autres que le vouloir nu, l’acquisition laborieuse d’un pouvoir par habitude, étude, gymnastique ou exercice, conditionne le passage du vouloir-faire au faire. « Je veux, je peux » est encore moins une déduction que le Cogito : cette juxtaposition sans ergo développe une espèce d’identité instantanée. Vouloir c’est pouvoir vouloir, et pour pouvoir vouloir il n’est que de vouloir : le vouloir nous renvoie au vouloir du vouloir, et nous sommes ainsi ramenés au vouloir pur et simple qui est l’alpha et l’oméga, qui est le premier mot et le dernier mot de tout. Le vouloir, comme l’amour, commence par lui-même : initiative prévenante, il commence par lui-même et revient à lui-même ; il aboutit à son propre commencement ! Il tourne donc dans un cercle… qui n’a rien de vicieux, qui est au contraire sain et bien portant ! La dialectique du pouvoir-vouloir se réduit-elle à des lapalissades ?
Du moins peut-elle servir à mieux dégager la différence entre l’intimité du vouloir, qui est le for intérieur du pouvoir, et l’extériorité du pouvoir, qui est le for relativement intérieur du possible. De même que le possible, c’est-à-dire la sphère des choses qui « peuvent être pues » (le mot possibile ne désigne-t-il pas, par un dédoublement paradoxal, ce qu’on peut pouvoir ?), a toujours quelque chose de passif, de même le pouvoir, capacité active ou virtualité passive, a toujours quelque chose de négatif : la possibilité des possibles « pus » est au passif ce qu’est à l’actif la potentialité du pouvoir qui les peut ; mais possibilité et potentialité, possibles ou pouvoir, ce n’est jamais que verso ou recto d’une même puissance négative.
Sans quelque chose d’autre, qui est la seule raison positive et suffisante du faire, le pouvoir peut fort bien rester éternellement inemployé et son détenteur mourir sans l’avoir jamais exercé, comme il arrive quand on sait une langue qu’on ne veut pas parler ou dont on n’a jamais eu l’occasion de se servir : je pourrais, si je voulais ; mais si je ne veux pas, j’aurai beau pouvoir, je ne ferai jamais, et mon pouvoir restera peut-être en puissance et en friche toute ma vie...."
Si le premier chapitre posait le décor de l'équivoque de la liberté, ce second chapitre plonge au cœur même de la volonté pour en saisir le mécanisme le plus intime. Jankélévitch cherche à isoler l'instant pur où la volonté bascule du "vouloir-vouloir" au "vouloir-faire", c'est-à-dire l'instant de la décision.
Sa thèse est que le fond ultime de la volonté est un acte gratuit, un déclic inexplicable qui est le "presque-rien" par excellence. Cet acte n'est pas motivé par une raison ou un désir extérieur ; il est l'auto-affirmation pure de la volonté, un surgissement spontané qui est la source de toute action.
Concepts Clés ...
- L'Acte Gratuit : Concept central emprunté à la littérature (Gide) mais dont Jankélévitch fait un concept philosophique. C'est un acte sans motif, sans but utilitaire, presque absurde. Il est la manifestation la plus pure de la liberté car il ne répond à rien d'autre qu'à elle-même. C'est le "je-ne-sais-quoi" de la volonté à l'état brut.
- Le Fiat : C'est le moment du "Que cela soit !", l'ordre intérieur que la volonté se donne à elle-même. Le fiat est l'instant de la création ex nihilo, le passage du possible au réel. C'est un saut, une rupture.
- L'Initiative : Le vouloir est initiative, commencement. Jankélévitch le décrit comme une "ponctuation" dans le flux du temps. Il introduit une novation absolue dans le monde.
- Le "Presque-Rien" du Déclenchement : Ici, le "presque-rien" n'est pas un charme ou un malentendu, mais l'impulsion initiale, infinitésimale, qui met en mouvement la machine du vouloir. C'est le point d'application de la liberté sur le monde, un point sans dimension mais d'une puissance infinie.
La progression est à la fois chronologique et conceptuelle ...
- Chapitre I : La Liberté et l'équivoque décrit le contexte et le problème de la liberté (son indécidabilité).
- Chapitre II : Le Vouloir en son fin fond décrit l'acte même de la liberté dans son instant de surgissement, avant même qu'il ne s'extériorise et ne devienne, rétrospectivement, équivoque.
Le Chapitre II est une réponse au Chapitre I : on ne peut pas prouver la liberté, mais on peut en faire l'expérience intime dans l'acte de décider, dans le fiat du vouloir.
C'est le sommet métaphysique de l'œuvre. Jankélévitch parvient à parler de l'ineffable acte de la volonté avec une grande puissance d'évocation. Sa description est concrète et existentielle, évitant l'écueil de l'abstraction pure.
Mais le concept d' "acte gratuit" est extrêmement contestable. Peut-on vraiment agir sans aucun motif, même inconscient ? Jankélévitch est parfaitement conscient de cette objection et assume ce paradoxe. Pour lui, chercher un motif, c'est déjà nier la liberté pure. C'est une position radicale qui peut sembler intenable d'un point de vue psychologique ou scientifique, mais elle est cohérente avec son projet de décrire l'expérience vécue de la liberté comme commencement absolu.
Les deux premiers chapitres du Tome III représentent le cœur métaphysique de toute l'œuvre. Jankélévitch y accomplit son projet : fonder une philosophie du "presque-rien" non plus sur des phénomènes périphériques, mais au centre même de la subjectivité humaine, dans l'acte de vouloir.
Le génie de ces chapitres réside dans leur capacité à transformer une question métaphysique abstraite (le libre arbitre) en une expérience palpable, angoissante et concrète. Jankélévitch ne théorise pas sur la liberté ; il nous place devant elle, dans son équivoque radicale et dans le vertige de son instantation.
La difficulté est maximale, car le sujet lui-même est par nature fuyant. Le style de Jankélévitch, fait de circonvolutions, de répétitions et d'approximations successives, est parfaitement adapté à son objet : il mime le processus de la volonté qui hésite, tourne autour de son objet avant de se jeter.
En définitive, ces chapitres sont un plaidoyer passionné pour la liberté comme mystère constitutif de l'humain. Ils nous invitent moins à résoudre le problème de la liberté qu'à en assumer l'énigme et la responsabilité. Le "je-ne-sais-quoi" n'est plus seulement ce qui nous charme ou nous divise, il est le nom de notre pouvoir le plus fondamental et le plus insaisissable : celui de commencer quelque chose de nouveau dans le monde.
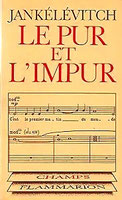
"Le Pur, et l'impur", Paris, Flammarion, 1960
Un livre capital dans l'œuvre de Vladimir Jankélévitch, souvent considéré comme le pivot entre sa période « métaphysique » et sa période « morale » plus engagée. Il ne s'agit pas d'un simple traité de morale, mais d'une plongée phénoménologique dans les complexités de la vie morale, qui prolonge et radicalise les enquêtes du Je-ne-sais-quoi.
Après la Shoah : Jankélévitch a écrit ce livre dans le sillage de la Seconde Guerre mondiale et de la découverte de la Shoah. Cette expérience historique catastrophique plane sur l'ouvrage. Il ne s'agit plus seulement de décrire des nuances psychologiques ou métaphysiques, mais de penser le Mal dans ce qu'il a de plus absolu et systématique.
Il se situe après les grands cycles du "Je-ne-sais-quoi" (explorant l'ontologie) et de "Traité des vertus" (explorant la morale), et avant ses livres les plus engagés et pamphlétaires contre l'oubli du mal nazi (L'Imprescriptible, Pardonner ?). Il est le lieu où sa métaphysique rencontre l'éthique de la manière la plus aiguë.
La Thèse Centrale : Une Morale de l'Intention et de la Rigueur
Jankélévitch oppose deux manières d'envisager la moralité ...
- Le Pur : Ce n'est pas la pureté au sens naïf ou innocent. C'est la rigueur morale intransigeante, la bonne volonté inconditionnelle, l'intention pure (au sens kantien) qui agit par devoir et non par intérêt. Le pur est exigeant, angélique parfois, et il reconnaît la radicalité du Mal. Il dit « non » de manière claire et sans compromission au mal (il deviendra le « non » absolu au pardon pour les crimes nazis).
- L'Impur : Ce n'est pas le mal pur et simple. C'est bien plus subtil et insidieux. L'impur est la confusion, le compromis, la dilution, la mauvaise foi. C'est le bien qui se mélange à de mauvaises motivations (l'aumône par vanité), le pardon qui est en réalité un oubli complice, la tolérance qui devient lâcheté. L'impur est le règne de l'équivoque, du « en-même-temps » (aimable et calculateur), qui corrompt la moralité de l'intérieur.
Le vrai combat moral ne se situe pas entre le Bien et le Mal, mais entre le Pur et l'Impur, entre la décision ferme et l'ambiguïté complice...
Lien avec le « Je-ne-sais-quoi » et le « Presque-rien » ...
Une application morale des concepts : Jankélévitch applique ici sa grille de lecture du « presque-rien » au domaine moral. Le mal radical (le Pur négatif) et le bien authentique (le Pur positif) ne résident pas toujours dans des actes spectaculaires, mais dans des intentions infinitésimales, des nuances de la volonté, des « presque-riens » qui inclinent une action vers la bonne foi ou la mauvaise foi.
L'impur est un « je-ne-sais-quoi » de la mauvaise conscience : C'est ce quelque chose d'indéfinissable qui gâte une action par ailleurs bonne. Comme le charme, il est insaisissable mais terriblement efficace pour corrompre la pureté de l'intention.
Ce livre est le laboratoire où Jankélévitch forge sa position morale absolutiste qui caractérisera ses écrits ultérieurs. On y trouve les prémisses de son refus catégorique du pardon pour les crimes contre l'humanité : face à la pureté du Mal absolu (la Shoah), seule une pureté morale intransigeante (le refus) est possible. Tout compromis est impur.
Avant même Sartre, mais dans un style très différent, Jankélévitch fait une anatomie minutieuse de la mauvaise foi, de l'autopersuasion et de la complaisance envers soi-même. C'est une contribution majeure à la philosophie morale du XXe siècle.
Tout son travail sur l'ambiguïté (dans le Je-ne-sais-quoi) trouve ici sa conclusion éthique. Si l'équivoque peut être charmante en art, elle devient mortelle en morale. Le Pur et l'Impur est une charge contre la confusion des valeurs.
Le livre est un chef-d'œuvre du style Jankélévitchien : une écriture allusive, musicale, qui procède par variations et oppositions, mime la pensée en train de se faire et de se nuancer elle-même pour cerner son objet insaisissable. Son importance réside dans le fait qu'il incarne le moment où la subtilité métaphysique de Jankélévitch entre en collision frontale avec l'horreur historique, et en sort transformée en une éthique de la rigueur et de l'intransigeance. Il montre que derrière le philosophe des nuances se cache un moraliste d'une exigence absolue, pour qui certaines choses – comme le mal – ne doivent souffrir aucune nuance.
Il répond à cette question : comment philosopher sur le « presque-rien » après avoir été confronté au « tout » du Mal ? La réponse est : en traquant le « presque-rien » de l'impureté morale qui permet au Mal de renaître...

Vladimir Jankélévitch, "L'Aventure, l'Ennui et le Sérieux", Paris, Aubier-Montaigne, 1963
Les trois thèmes abordés par Jankélévitch dans cet ouvrage sont inhabituels en philosophie, rappelle-t-on dans la préface, ce sont plutôt des thèmes évoqués en littérature, et pourtant ils renvoient bien à la toute la singularité de la démarche philosophique de l'auteur : ici, il aborde la dimension temporelle de l'action, aborde le sujet de "l'ennui", si étranger à la pensée d'un Bergson tout à sa conception créatrice de la durée, de "l'aventure", non loin d'un Simmel qui en établit une première analyse, mais ici considérée comme une disposition à être dans le temps, enfin du "sérieux" qui s'impose lorsqu'on termine sa réflexion pour définir l'existence dans son rapport au présent. C'est l'une des première synthèse de la pensée de Jankélévitch, où l’on a coutume de distinguer les deux critères essentiels qui fondent l’unité de son œuvre, la dignité philosophique donnée à des objets jugés mineurs, et la volonté radicale de mettre en lumière la dimension temporelle de l’action....
"L'Aventure, l'Ennui et le Sérieux sont trois manières dissemblables de considérer le temps. Ce qui est vécu, et passionnément espéré dans l'aventure, c'est le surgissement de l'avenir. L'ennui, par contre, est vécu plutôt au présent : certes l'ennui se réduit souvent à la crainte de s'ennuyer, et cette appréhension, qui fait tout notre ennui, est incontestablement braquée vers le futur ; néanmoins le temps privilégié de l'ennui est bien ce présent de l'expectative qu'un avenir trop éloigné, trop impatiemment attendu a vidé par avance de toute sa valeur : dans cette maladie l'avenir déprécie rétroactivement l'heure présente, alors qu'il devrait l'éclairer de sa lumière. Quant au sérieux, il est une certaine façon raisonnable et générale non pas de vivre le temps, mais de l'envisager dans son ensemble, de prendre en considération la plus longue durée possible. C'est assez dire que si l'aventure se place surtout au point de vue de l'instant, l'ennui et le sérieux considèrent le devenir surtout comme intervalle : c'est le commencement qui est aventureux, mais c'est la continuation qui est, selon les cas, sérieuse ou ennuyeuse. Il s'ensuit naturellement que l'aventure n'est jamais "sérieuse" et qu'elle est a fortiori recherchée comme un antidote de l'ennui. Dans le désert informe, dans l'éternité boursouflée de l'ennui, l'aventure circonscrit ses oasis enchantées et ses jardins clos; mais elle oppose aussi à la durée totale du sérieux le principe de l'instant. Redevenir sérieux, n'est-ce pas quitter pour la prose amorphe de la vie quotidienne ces épisodes intenses, ces condensations de durée qui forment le laps de temps aventureux?"
"...L'AVENTURE MORTELLE - L'aventureux, disions-nous, est dedans-dehors, mais quelquefois plus dedans que dehors, quelquefois plus dehors que dedans, et quelquefois l'un autant que l'autre inextricablement. Dans le premier style d'aventure, l'homme est plus dedans que dehors, c'est-à-dire que l'aventure comprend à la fois le jeu et le sérieux, mais le sérieux prévaut ici sur le jeu et l'immanence sur la transcendance; en sorte qu'elle vire facilement en tragédie : le glissement se produit quand disparaît le grain de sel de l'élément ludique qui assaisonne et futilise toute aventure ; alors l'aventure tend à se confondre avec la vie elle-même ; alors les vicissitudes et péripéties dramatiques de l'aventure ont envahi toute l'existence. En même temps que l'homme est engagé dans l'aventure, et ceci avec l'âme tout entière, il doit donc en être relativement dégagé. L'aventureux est à la fois engagé, comme on dit si souvent aujourd'hui, et désengagé, mais de telle manière que l'engagement l'emporte dans une grande mesure sur le dégagement et le détachement. Cette amphibolie peut être formulée en termes temporels. Selon la chronologie en effet, l'aventure est vécue comme une continuation par celui qui est dedans, et pendant, et en expérimente sur le moment toutes les vicissitudes. L'aventure dépend de moi dans son commencement, mais sa continuation ne dépend pas toujours de moi, et sa terminaison encore moins. Ou vice versa : je suis plus dedans que dehors, mais j'ai commencé par me mettre librement dedans. Un homme décide un beau jour d'escalader l'Himalaya. Il n'est pas obligé de se donner cette peine. Il est obligé de payer ses impôts, de faire son service militaire, d'exercer un métier, car ces choses-là sont "sérieuses" ; mais pour ce qui est d'escalader l'Everest, non, personne ne l'y oblige. Le commencement de l'aventure est donc un décret autocratique de notre liberté, et il est en cela, comme tout acte arbitraire et gratuit, de nature un peu esthétique. Mais voici que l'homme dégagé s'engage à fond. L'amateur qui a quitté volontairement sa famille et ses occupations se trouve pris, sur les pentes de l'Everest, dans une tourmente de neige. À partir de ce moment il regrette sans doute d'être parti, mais il est trop tard pour regretter et revenir sur ses pas : à partir de ce moment, il se bat pour son tout-ou-rien, il se bat pour sa peau. Ce qui est en jeu désormais c'est sa destinée et son existence même ; c'est, comme on dit, une question de vie ou de mort. L'aventure, alors, est sur le point de cesser d'être une aventure pour devenir une tragédie : à plus forte raison si l'alpiniste meurt de froid sur le glacier ou tombe dans une crevasse, si l'aventure finit tragiquement ; il arrive qu'on la commence par force et qu'on la continue par jeu, mais le plus souvent c'est l'inverse : on la commence pour jouer, mais on ne sait ni quand ni comment elle peut finir, ni jusqu'où elle peut aller. Elle commence frivole, elle continue sérieuse, et elle se termine tragique ; son déclenchement est libre et volontaire, mais sa continuation et surtout sa conclusion se perdent dans les brumes menaçantes, dans l'inquiétante ambiguïté de l'avenir. L' aventurier a brûlé ses vaisseaux, les vaisseaux du retour et de la résipiscence. En ce point commence la tragédie! Par rapport à l'entreprise saugrenue et baroque nommée aventure, l'homme est un peu dans la situation de l'apprenti sorcier. Ce demi-sorcier sait le mot qui déclenche les forces magiques, mais il ne sait pas le mot qui les refrénerait : l'apprenti ne sait donc que la moitié du mot. Seul le maître sorcier connaît les deux mots, le mot qui déclenche et le mot qui arrête. Si l'homme savait les deux mots de l'aventure, il serait non point un demi-magicien, un apprenti, et pour tout dire un aventurier, mais un magicien complet, ou mieux, il serait comme Dieu. Il n'y a que Dieu qui soit maître à la fois de déclencher et de stopper à volonté, qui sache à la fois le mot du commencement et le mot de la fin, qui soit à la lettre omnipotent : l'homme en cela n'est qu'un demi-dieu, comme sa liberté n'est qu'une demi-liberté, comme sa puissance est non pas toute-puissance, mais moitié de puissance; le "fiat" initial est seul entre nos mains, et seulement pour l'amorçage d'une entreprise qui se déroule ensuite toute seule. Par rapport à l'irréversibilité du temps, nos pouvoirs sont des pouvoirs boiteux, tronqués, unilatéraux, et c'est sans doute cette dissymétrie qui explique la prépondérance du sérieux. Comment s'étonner qu'une telle dissymétrie nous inspire des sentiments ambivalents ?
Parlant d'une aventure où le sérieux l'emporte sur le jeu, nous n'avons pas encore dit le mot essentiel qui en indique l'objet et qui explique pourquoi notre destinée entière y est tragiquement engagée. Ce mot, c'est le mot de mort. Ce mot innommé, et même inavouable, donne à l'aventure son apparence immotivée. Sans doute l'homme est-il hors de la mort par la conscience qu'il en prend; mais comme cette conscience n'empêche nullement l'être pensant de mourir en fait, l'être pensant-mortel est avant tout au-dedans de la mort. Car c'est la mort, en fin de compte, qui est le sérieux en tout aléa, le tragique en tout sérieux, et l'enjeu implicite de toute aventure. Une aventure, quelle qu'elle soit, même une petite aventure pour rire, n'est aventureuse que dans la mesure où elle renferme une dose de mort possible, dose souvent infinitésimale, dose homéopathique si l'on veut et généralement à peine perceptible... C'est tout de même cette petite et parfois lointaine possibilité qui donne son sel à l'aventure et la rend aventureuse. Plus généralement : la douleur, le malheur, la maladie, le danger sont à cet égard logés à la même enseigne. Un danger n'est dangereux que dans la mesure où il est un danger de mort. Le risque mortel peut ne représenter qu'une chance sur mille, - non pas une chance sur vingt, comme dans cette "roulette du suicide" qui fut naguère le passe-temps des officiers russes, mais une sur mille; c'est pourtant l'appréhension de cette toute petite chance, c'est ce minuscule souci qui rend périlleux le péril et passionnante l'aventure..."

Vladimir Jankélévitch, "La Mort", 1966
"Pourquoi la mort de quelqu'un est-elle toujours une sorte de scandale? Pourquoi cet événement si normal éveille-t-il chez ceux qui en sont les témoins
autant de curiosité et d'horreur? Depuis qu'il y a des hommes, et qui meurent, comment le mortel n'est-il pas habitué à ce phénomène naturel et pourtant toujours accidentel? Pourquoi est-il
étonné chaque fois qu'un vivant disparaît, comme si cela arrivait chaque fois pour la première fois? Telles sont les questions que pose ce livre sur la mort. Dans chacun de ses ouvrages, Vladimir
Jankélévitch a essayé de saisir le cas limite, l'expérience aiguë : à son point de tangence avec ces frontières, l'homme se situe à la pointe de l'humain, là où le mystère, l'ineffable, le
"je-ne-sais-quoi", ouvrent le passage de l'être au néant, ou de l'être à l'absolument-autre. Il s'attache ici à analyser un évènement considéré dans sa banalité et dans son étrangeté à la fois,
dans son anomalie normale, son tragique familier, bref, dans sa contradiction. "Si la mort n'est pensable ni avant, ni pendant, ni après, écrit Jankélévitch, quand pourrons-nous la penser?"
(Editions Flammarion)
"Si la mort à partir de la vie est proprement impensable, c'est peut-être qu”en général elle n'est pas faite pour qu'on y pense ? Mais comme on ne peut pas ne penser à rien, le mieux est sans doute de penser à autre chose. Visiblement l'être, quant à lui, ne nous est pas donné pour méditer sur le non-être... où il n'y a, au demeurant, rien à penser; visiblement cette "pensée" totale, cette "pensée" infinie est une pensée irritante et malsaine qui déprécie pernicieusement tous les intérêts de l'empírie, toutes les valeurs relatives de la continuation, toutes les tâches constructives de notre "bas"-monde. Sans doute la pensée de cet événement surnaturel est-elle une pensée contre-nature ; sans doute la fascination du néant est-elle une complication un peu morbide... Bergson avait déjà remarqué ce caractère destructif de l'intelligence. ll faut croire que le problème en général n'était pas fait pour être posé, ni a fortiori résolu, puisqu'il est insoluble. L'indiscret qui creuse l'être pour y trouver je ne sais quelle dimension de profondeur va, semble-t-il, contre l'intention de la nature, qui est de nous soustraire notre fin en nous empêchant d'y penser, en la rendant insensible et invisible. Le secret est soigneusement gardé, hermétiquement scellé, profondément enterré, et il est probablement sage de ne pas chercher à connaître cet inconnaissable. Tout se passe comme si la nature elle-même nous détournait d`une connaissance éminemment contraire aux desseins de la vie, de l'espèce et de la société, ainsi qu'aux nécessités de l'action. Effectivement, quelque chose nous empêche de prendre conscience des battements du cœur et des rythmes de la respiration... Ne dirait-on pas de même qu'une sorte de finalité protectrice empêche l'homme de penser à sa propre mort ? Dans cette finalité, Pascal ne voulait voir qu'un divertissement, c'est-à-dire une frivolité coupable et une fuite assez lâche devant notre tragédie intérieure : le divertissement détourne vers les choses extérieures le moi soucieux ou en puissance de souci ; pour ne pas voir l'abîme, pour échapper au vertige et à l'ennui, à l'angoisse et au désespoir, l'homme se voile la face et se distrait avec les futilités mondaines, avec les passe-temps tumultuaires qui emplissent l'intervalle; de gaieté de cœur, il s'étourdit dans les agitations artificielles et superficielles. En fait, il s`empêche lui-même de penser à ce qui n'est que trop évident : son vide, son lamentable néant, la fin inévitable qui nous guette. Max Scheler, à l'inverse, parle d'une insouciance métaphysique, comme si c'était le souci qui détournait notre curiosité vers la vaine profondeur... Dans L'Amour sorcier de Manuel de Falla, le baiser de Carmelo, qui symbolise l`évidence de l'amour vivant, exorcise le spectre du passé : car le gitan jaloux, c'est le souci dévorant qui nous empêche de vivre ; délivrée de son revenant, de son cher tyran, de son idée fixe, Candelas conjure à jamais les sortilèges de mort et de réminiscence.
Mais si par hasard l'insouciance métaphysique était une simple incurie biologique ? Car c'est plutôt la futile incurie qui veille à écarter de nous le profond souci, le souci métaphysique de l`origine radicale et de la terminaison définitive. L'insouciance guérit Candelas de son obsession ; mais le souci et la bonne mémoire, à leur tour, hantent la trompeuse sinécure. Hélas ! le souci philosophique, comme un remords secret, ravive sans cesse le problème dont l`incurie biologique nous détourne ; l'insouciance expulse le souci, mais le souci trouble la bienheureuse incurie. Bienvenue soit la providentielle sinécure qui nous protège du souci de la mort ! Bienvenue la frivolité qui nous aide à vivre ! Mais malheur aussi à l'insouciant qui dédaigne la profondeur mortelle ! Malheur à l'inavouable sinécure qui dissimule la vérité ! Les philosophes n`ont pas toujours péché par excès d`insouciance. Une sorte de substantialisme naïvement réaliste les incline à rechercher la mort dans les profondeurs de la vie, de la même manière, par exemple, que les artistes macabres du Moyen Age imaginaient le squelette derrière l'apparence charnelle, et le faciès grimaçant de la mort derrière le visage radieux de la vie, et le rictus sardonique du trépassé derrière le sourire de la jeunesse. La mort est-elle tapie à l'intérieur de la vie comme ce crâne hideux au dedans du visage dont il est l'ossature ? En tout cas, ce crâne caché est notre souci. Ce crâne est en quelque sorte l'idée fixe de la radioscopie macabre. Qui sait ? « Melancholia ›› est peut-être le nom que Dürer donnait à ce souci inavouable. L`opposition est diamétrale entre le souci de Dürer et l'insouciance de Raphaël : Raphaël est entièrement tourné vers l`enfant, vers la nativité, vers l'espérance et les promesses du futur, vers la positivité radieuse de la couleur et de la lumière ; ni angoisse ni arrière-pensée dans ce monde de la printanière sinécure : aucune méfiance ne contracte le sourire des madones, aucune inquiétude ne ternit l'éclat des chairs, aucun souci ne voile la sérénité de l'innocence ; l'angoisse du déclin n'empoisonne pas le bienheureux épanouissement de la vie. L'artiste macabre au contraire, l'artiste des civilisations nécrophiles dédouble de la positivité visible une négativité supra-sensible qu'à son tour il rend visible et manifeste. Le Macabre est précisément l'intrusion dérisoire de la fin métempirique en pleine continuation d'intervalle. La peinture philosophique n'est-elle pas à cet égard la révélation de notre obsession, l'épiphanie d'une sollicitude qui n'a pas de réalité plastique ou charnelle et qui trouble notre confiante ingénuité quand elle affleure à la surface de l'apparence ? Le souci macabre fait remonter au jour les ténèbres enfouies au fond de la lumière. La joyeuse bigarrure de la vie et des apparences multicolores et multiformes n'est qu'une suite de variations sur un seul thème monotone : le sinistre thème de la mort ; le noir est la toile de fond de cette diversité polychrome, l'amorphisme est le fondement de cette pluralité polymorphe. Huizinga, dans "le Déclin du Moyen Age", cite une sentence d'Odon de Cluny fort caractéristique de l'imaginaire double vue des Macabres: "La beauté du corps est tout entière dans la peau. En effet, si les hommes voyaient ce qui est sous la peau, doués comme les lynx de Béotie d'intérieure pénétration visuelle, la seule vue des femmes leur serait nauséabonde." La jeune fille et la mort ! La beauté des femmes, c`est-à-dire la positivité de l'être en ce qu'elle a de plus vital, surveillée et déjà obscurcie par l`ombre du néant... voilà des thèmes familiers à la nécromanie masochiste d'un Baldung Grien. La Sérénade des chants et danses de la mort, dont Moussorgski emprunta les paroles au comte Arsène Golenichtchev-Koutouzov,
a donné à ce rapprochement blasphématoire une intensité bouleversante. Non seulement le visage délabré des vieillards, comme il est naturel, noirs parle de la mort, mais aussi la fraîcheur des jeunes filles, comme il est paradoxal et scandaleux. Le vieillard en parle directement et la jeune fille obliquement. Parce que la beauté est la présence par excellence et le comble de la perfection morphologique, il arrivera au pessimisme de nourrir contre ce chef-d'œuvre une rancune particulièrement acharnée, une haine particulièrement sacrilège...."

Comment penser philosophiquement la mort, penser le paradoxe de la mort ("la pensée de Jankélévitch est toujours une pensée du paradoxal") : dans la mort, l'existant perd son sens mais le prend aussi....
"Les généralisations cosmologiques, d'une part, la réflexion rationnelle, d'autre part, tendent soit à bagatelliser, soit à conceptualiser la mort, à en réduire l'importance métaphysique, à faire de la tragédie absolue un phénomène relatif, de l'anéantissement total une disparition partitive. du mystère un problème, du scandale une loi ; qu'elle escamote la cessation métempirique dans une continuation empirique ou dans une éternité idéale, c'est de part et d'autre, la conscience philosophique qui se veut consolatrice : tantôt en naturalisant la surnaturalité de la mort, tantôt en rationalisant son irrationalité. Mais l'évidence de la tragédie proteste a son tour contre la banalisation du phénomène ; l'ipséité de la personne disparue demeure irremplaçable, comme la disparition même de cette personne demeure incompensable : et d'autre part la nihilisation dérisoire de l`être pensant ferait encore question. même si la pensée survit à l'être qui pense. En somme. il y a deux évidences contradictoires qui paradoxalement sont évidentes toutes les deux à la fois. et nonobstant se tournent le dos. Le caractère déconcertant et même vertigineux de la mort, si profondément analysé par P. L. Landsberg, tient lui-même à cette contradiction : d'une part, un mystère qui a des dimensions métempiriques, c'est-à-dire infinies, ou mieux pas de dimensions du tout et d`autre part un événement familier qui advient dans l'empirie et s'accomplit parfois sous nos yeux. Il y a certes des phénomènes naturels régis par des lois (encore que leur « quoddité ›› ou origine radicale soit, en définitive, toujours inexplicable), des phénomènes à l'échelle de l'empirie et toujours en relation avec d'autres phénomènes. Et il y a, d'autre part, des vérités métempiriques à priori, indépendantes de toute réalisation hic et nunc, des vérités qui n' "arrivent" jamais, mais ont pour conséquence certains phénomènes particuliers. Et entre les deux. il y a ce fait insolite et banal, ce monstre empirico-métempirique qu`on appelle la mort : d'un côté, la mort est un fait divers journalistique que le chroniqueur relate, un incident que le médecin légiste constate, un phénomène universel que le biologiste analyse : capable de survenir à tout moment et n'importe où, la mort est repérable selon des coordonnées de temps et de lieu : ce sont ces déterminations circonstancielles, l'une temporelle et l'autre spatiale, que le juge d`instruction cherche à établir lorsqu'il enquête sur le ubi-quando du "décès". Mais en même temps, ce fait divers ne ressemble à aucun des autres faits divers de l'empirie : ce fait divers est démesuré et incommensurable aux autres phénomènes naturels. Un mystère qui est un événement effectif, quelque chose de métempirique qui advient familièrement en cours d'empirie, voilà sans doute tous les symptômes du miracle... avec pourtant cette double réserve : la thaumaturgie létale n'est pas une révélation positive, ni même une métamorphose bénéfique, mais elle est disparition et négation : contrairement aux apparitions féeriques, elle n'est pas un gain. mais une perte : la mort est un vide qui se creuse brusquement en pleine continuation d'être ; l`existant, rendu soudain invisible comme par l'effet d'une prodigieuse occultation. s'abîme en un clin d`œil dans la trappe du non-être. Et, d'autre part, ce "miracle" n'est pas une interruption rarissime de l'ordre naturel, une déclinaison exceptionnelle dans le cours des existences ; non : ce "miracle" est en même temps la loi universelle de toute vie, ce miracle est le destin œcuménique des créatures; à sa manière, qui est miraculeuse, la féerie de la mort est une féerie toute naturelle ; la mort est littéralement "extra ordinem" parce qu'en effet elle est d'un tout autre ordre que les intérêts de l'empirie et les menues affaires de l'intervalle : et pourtant rien n'est davantage dans l'ordre des choses! La mort est par excellence l'ordre extraordinaire...."
"La Mort" (1966) de Vladimir Jankélévitch est un ouvrage absolument singulier dans le paysage philosophique traitant de la thanatologie. Sa différence radicale par rapport aux autres penseurs (comme Épicure, Heidegger, Sartre ou même les contemporains comme Lévinas) tient à sa méthode, son objet et son ton...
Contrairement à la plupart des philosophes, Jankélévitch refuse catégoriquement de parler de la mort comme d'un « événement » ou d'un « état » dont on pourrait dire quelque chose...
- Contre la métaphysique (Platon, Hegel) : Il écarte toute spéculation sur l'âme immortelle, la vie après la mort ou la dialectique de l'être et du néant. Pour lui, ces questions sont vaines car la mort est l'absolument autre, l'impensable. Il ne s'agit pas d'un « néant » que l'on pourrait opposer à l'« être » ; c'est une altérité radicale.
- Contre Heidegger : C'est la différence la plus frappante. Heidegger fait de la mort le fondement de l'être-pour-la-mort (Sein-zum-Tode), la possibilité la plus propre de l'Dasein qui lui permet de vivre authentiquement. Pour Jankélévitch, c'est une dramatisation injustifiée. La mort n'est pas une « possibilité » ; c'est précisément l'impossibilité de toute possibilité. Elle n'est pas le sens de la vie, elle est son non-sens absolu, son interruption scandaleuse. Il reproche à Heidegger d'avoir « apprivoisé » la mort en en faisant un concept ontologique.
Jankélévitch va déplacer l'objet d'étude. Ce n'est pas la mort en soi (dont on ne peut rien dire), mais l'idée de la mort et son retentissement sur la vie. Il fait une phénoménologie de l'avant et de l'après (pour les survivants), mais jamais de l'après pour le mort. Jankélévitch applique ici ses concepts clés. La mort n'est pas un processus, mais un passage instantané, un « presque-rien » temporel d'une puissance infinie...
- Le « Je-ne-sais-quoi » du passage : Le moment précis de la mort est insaisissable. On ne peut pas le localiser. C'est un instant infinitésimal qui sépare la présence de l'absence, le quelque chose du rien. C'est le mystère par excellence.
- La Mort comme « Presque-Rien » ontologique : Ce n'est pas un grand spectacle. C'est souvent un petit rien : un souffle qui ne revient pas, un cœur qui s'arrête. Ce « presque-rien » a le pouvoir d'anéantir un monde entier (la subjectivité d'une personne). Cette dialectique entre la petitesse de l'événement physique et l'immensité de ses conséquences métaphysiques est au cœur de sa réflexion.
Jankélévitch est le seul à analyser la mort avec cette grille de lecture du passage infinitésimal, de l'instant fulgurant et décisif qui échappe à toute prise...
Le Point de Vue des Survivants : Le Chagrin et l'Irréversible ...
Une grande partie du livre est consacrée non au mort, mais à ceux qui restent. Jankélévitch explore philosophiquement le deuil, le chagrin, la mémoire et le sentiment d'irréversibilité.
- L'Irréparable : La mort est l'irréparable absolu. Aucun acte, aucun regret, aucun pardon ne peut revenir en arrière. Cette dimension de « trop tard » est cruciale chez Jankélévitch et le distingue des penseurs pour qui la mort peut être « assumée » ou « intégrée ».
- L'Ambiguïté du Deuil : Il décrit avec une finesse psychologique rare le comportement des survivants : le sentiment de culpabilité (« aurais-je pu faire plus ? »), la difficulté de partager une douleur qui est par essence solitaire, et la trahison involontaire de l'oubli qui finit par s'installer.
Jankélévitch donne une dignité philosophique à l'expérience vécue et affective de la perte, là où d'autres se concentrent sur la mort comme structure de l'être.
Le style de Jankélévitch est immédiatement reconnaissable et participe pleinement de son propos. Sa prose est rythmée, faite de répétitions, de variations et d'antithèses, comme une partition qui tenterait de cerner musicalement l'indicible. Contrairement au ton froid et technique de Heidegger ou au détachement stoïcien d'un Épicure (« La mort n'est rien pour nous »), Jankélévitch assume pleinement l'angoisse, le scandale et le mystère que représente la mort. Sa philosophie n'est pas une consolation ; elle est la reconnaissance d'une blessure ontologique. Il use d'un langage poétique et métaphorique pour tourner autour du sujet, pour en suggérer l'horreur et la fascination sans jamais le violer par un concept.
Jankélévitch réinjecte ainsi dans la philosophie de la mort une émotion et une profondeur lyrique qui avaient été souvent évacuées au profit d'une rigueur conceptuelle sèche ...
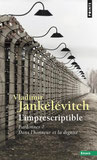
Vladimir Jankélévitch, "L'Imprescriptible - Pardonner ? Dans l'honneur et la
dignité"
« Le pardon est mort dans les camps de la mort. »
Qui a bien pu écrire une telle phrase ? Un philosophe, un Juif, un Français, un moraliste ? Oui, mais surtout un survivant, un survivant mystérieusement
sommé de protester sans relâche contre l’indifférence. Sous le titre L’Imprescriptible se trouvent en effet réunis deux textes : Pardonner ? et Dans l’honneur et la dignité, parus respectivement
en 1971 et 1948, qui tentent de maintenir « jusqu’à la fin du monde » le deuil de toutes les victimes du nazisme, déportés ou résistants.
Jankélévitch, philosophe de l’occasion, n’a jamais cru bon d’attendre « l’occasion » d’exprimer sa colère et sa pitié. C’était toujours pour lui le moment
de rappeler que la mémoire de l’horreur constitue une obligation morale.
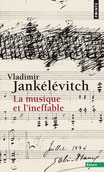
Vladimir Jankélévitch, "La Musique et l'Ineffable" , 1961
"Qu'est-ce que la musique ? se demande Gabriel Fauré à la recherche du "point intraduisible", de la très irréelle chimère qui nous élève "au-dessus de ce qui est...". C'est l'époque où Fauré ébauche le second mouvement de son premier Quintette, et il ne sait pas ce qu'est la musique, ni même si elle est quelque chose ! "Qu'est-ce que la musique ?", s'interroge en philosophe Vladimir Jankélévitch, s'appuyant sur les oeuvres musicales elles-mêmes et choisies dans son répertoire favori, celui du XIXe et du XXe siècles russes et français. « Il y a dans la musique une double complication, génératrice de problèmes métaphysiques et de problèmes moraux, et bien faite pour entretenir notre perplexité. Car la musique est à la fois expressive et inexpressive, sérieuse et frivole, profonde et superficielle ; elle a un sens et n’a pas de sens. La musique est-elle un divertissement sans portée ? ou bien est-elle un langage chiffré et comme le hiéroglyphe d’un mystère ? Ou peut-être les deux ensemble ? Mais cette équivoque essentielle a aussi un aspect moral : il y a un contraste déroutant, une ironique et scandaleuse disproportion entre la puissance incantatoire de la musique et l’inévidence foncière du beau musical.»
Comme le langage, l'art des sons possède une rhétorique de la litote, de l'allusion, de l'humour, de l'évocation voilée et de la description sommaire, et un privilège inestimable qui est d'atteindre à l'inexprimable. Qu'est-ce que cet inexprimable dont nous parle la musique, non pas l'indicible mais l'ineffable, c'est-à-dire ce dont il y a à dire infiniment, comme Dieu ou l'amour. "La musique est inexpressive en ceci qu'elle implique d'innombrables possibilités d'interprétation, entre lesquelles elle nous laisse choisir. " Elle exprime la souveraineté du "faire" au détriment du "dire", et ne signifie pas, comme la poésie, autre chose que ce qu'elle est....

Vladimir Jankélévitch, "Quelque part dans l'inachevé",
en collaboration avec Béatrice Berlowitz, Paris, Gallimard, 1978
Béatrice Berlowitz tente ici d'entrouvrir la pensée de Vladimir Jankélévitch,une pensée habitée constamment par l'impalpable, la nostalgie, "la quête du mot
introuvable, le désespoir devant l'idée perdue, la hantise de l'inertie qui toujours menace les moments de vie vraiment vivante.."
"Si la philosophie est essentiellement controversable, toujours précaire et contestée, sans cesse remise en question, c'est sans doute à cause de la nature particulièrement floue, évasive et fuyante de ces objets qui n'en sont pas. Objets diffus et diffluents entre tous! Il y a quelque chose de nocturne dans l' "objet" philosophique. Le temps et le philosophe sont frères en malheur! En avouant le caractère insoluble de son problème infini, la philosophie se rend elle-même plus vulnérable... La philosophie ne fait pas des "progrès", à la différence des techniques, et notamment des techniques qui se rapportent aux instruments, véhicules et vecteurs de la mobilité humaine. Chaque année paraît un nouvel indicateur des chemins de fer, annonçant les nouveautés de la saison : des améliorations sensationnelles, des vitesses plus grandes, des relations plus nombreuses, des horaires plus tendus; la technique se prête à un perfectionnement infini, nous promet un progrès sans limites. Mais la philosophie, elle, ne nous fait pas de promesses, et d'ailleurs même si elle en faisait, elle ne les tiendrait pas; il faut donc qu'elle justifie chaque fois ses titres à l'existence. Assurément, si l'on se place sur le terrain des finalités utilitaires, la philosophie ne sert à rien... Mais ne serait-ce pas là paradoxalement sa raison d'être? Si par hasard vivre dangereusement était depuis toujours sa vocation? sa périlleuse et gratuite vocation? Une fois de plus paraphrasons Pascal. Qu'on ne reproche pas à la philosophie la nature insaisissable de son problème puisque justement elle en fait profession. L'histoire de la philosophie n'a cessé de nous offrir ce double spectacle : le spectacle d'une discipline à la recherche de son problème, le spectacle d'une discipline divisée d'avec elle-même. Sur le second point : l'acuité des contradictions qui opposent les différents courants philosophiques a fourni des armes aux misologues de toutes provenances. ..La philosophie a passé son temps à se mettre elle-même en question, c'est là le plus fondamental et le plus clair de ses problèmes : elle n'a pas plus tôt commencé à philosopher qu'elle se demande si elle existe vraiment, pourquoi elle existe et à quoi bon. Car elle n'est pas sûre d'exister! Et elle passe son temps à se tâter, à se définir! Toute la philosophie est déjà là, dans cet étonnement d'exister..."

"...toujours dans vos mots de philosophe coule une respiration musicienne.." : "La réflexion, le travail philosophique nourrissent la prose de
l'existence, la toute-la-journée de tous les jours; mais il arrive un moment où le philosophe doit retourner à la musique, comme le poète, à bout de paroles prosaïques, retourne au poème. Il
arrivait à Jean Wahl, dans les congrès, de terminer une communication en tirant de sa poche un poème qu'il avait composé en écoutant les autres conférenciers.. A la limite la musique, acte
"primaire", est la négation de ces actes secondaires qu'on appelle écriture, lecture, diction: à la limite il y a le mouvement merveilleusement simple et même rude qui consiste à ne pas répondre
et, pour toute réponse, à s'asseoir au piano sans un mot et à jouer : voilà la Barcarolle de Chopin: le pianiste la refait, ou mieux la fait, la recrée devant vous. Par cette réponse qui n'en est
pas une, le pianiste a choisi de se taire et de faire. N'est-ce pas la meilleure façon de vous parler de Chopin? Pendant longtemps j'ai aimé la musique en toute innocence, comme une chose toute
naturelle. J'écrivais un livre de philosophie, puis un livre sur Fauré ou sur Liszt : j'allais ainsi, nativement, de l'un à l'autre, sans jamais me demander quel lien pouvait exister entre une
thèse de doctorat sur Schelling et la dévotion à Janáček. Si j'ai cessé d'être innocent et si j'ai fini par problématiser la philosophie de la musique, c'est à force de m'entendre demander, dans
un monde tellement peu musical, pourquoi je consacrais des livres à des musiciens. En effet, pourquoi? Et surtout pour qui, mon Dieu? et à quoi bon? Ecrire un livre sur Debussy quand on est
professeur de philosophie, et sans en être prié le moins du monde... : je n'avais pas remarqué à quel point cette chose-là est bizarre et même inconvenante. Quel rapport y a-t-il entre Bergson et
Bartók? Bartók n'est pas un auteur du programme.. J"ai donc fini par me poser la question! Mais cette question, seuls la posent ceux qui ne vivent pas pour la musique ou qui la futilisent et en
parlent comme d'un violon d'Ingres...
..La musique témoigne du fait que l'essentiel en toutes choses est je ne sais quoi d'insaisissable et d'ineffable; elle renforce en nous la conviction
que voici : la chose la plus importante du monde est justement celle qu'on ne peut dire. Auprès de cette chose-là rien ne vaut la peine. Quand j'abandonne la musique pour la philosophie, il me
semble revenir d'un voyage au pays de l'irrationnel, moins convaincu que jamais de la solidité des mots. Mais quand je laisse la table de travail pour m'asseoir à nouveau devant l'instrument,
avais-je vraiment quitté ce dernier? Une fois au piano, je m'interromps parfois afin de noter une idée que je ne veux pas laisser se perdre et qui ne concerne pas nécessairement la musique. Et
puis de nouveau l'écriture, le travail aride, l"effort ingrat pour tenir un discours rigoureux et en tout point cohérent. Mais même au cours de cette mise en ordre maniaque des idées rétives, une
imperceptible allégresse, je ne sais quelle griserie légère issues du piano continuent à m'éclairer..."
