- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Svevo - Pirandello
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki
- 1930-1940
- 1930s
- Fitzgerald
- Hemingway
- Faulkner
- Koch
- Céline
- Bernanos
- Jouve
- DosPassos
- Kojève
- Miller-Nin
- Grosz - Dix
- Green
- Ortega y Gasset
- Wittgenstein
- Russell - Carnap
- Artaud
- Jaspers
- Sapir - Piaget
- Guillén
- Garcia Lorca
- Hammett
- A.Christie
- Heidegger
- Icaza
- Huxley
- Hubble
- Caldwell
- Steinbeck
- Waugh
- Blixen
- Rhys
- J.Roth - Doderer
- Aub
- Malraux-StExupéry
- DBarnes-NWest
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bataille
- Char-Michaux
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Bloch
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Lewin - Mayo - Maslow
- Montherlant
- Buzzati - Pavese
- Vittorini
- Fallada
- Malaparte
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Welty
- Boulgakov
- Tamiki - Yôkô
- Weil
- Gadda
- Broch
- Steeman
- Jouhandeau
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Ellison
- Bergman
- Baldwin
- Fromm
- Bradbury - A.C.Clarke
- Tennessee Williams
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Carpentier
- Mishima
- Salinger - Styron
- Pasternak
- Asturias
- O'Connor
- Hoffer
- Matute - MartinGaite
- 1960-1970
- 1960s
- Abe
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- U.Johnson - C.Wolf
- Heller - Toole
- Naipaul
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Onetti - Sábato
- Capote
- Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- McCarthy - Minsky
- Sillitoe
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- Lenz
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Dolls
- Ellis
- Cortázar
- Warhol
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- HarperLee
- Fuentes
- 1970-1980
- 1970s
- Habermas
- Handke
- GarciaMarquez
- Deleuze
- Derrida
- Beck
- Satir
- Kundera
- Hrabal
- Didion
- Guinzbourg
- Lovelock
- Vietnam
- H.S.Thompson - Bukowski
- Pynchon
- E.T.Hall
- Bateson - Watzlawick
- Carver
- Irving
- Milgram
- VargasLlosa
- Puig - Donoso
- Lasch-Sennett
- Crozier - Touraine
- Friedan-Greer
- Jacob-Monod
- Dawkins
- Beattie - Phillips
- Gaddis
- Rawls
- Zinoviev
- H.Searles
- Ballard
- Jong
- Kôno
- Calvino
- Ballester-Delibes
- ASchmidt
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact
- 1960s
- Abe
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- U.Johnson - C.Wolf
- Heller - Toole
- Naipaul
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Onetti - Sábato
- Capote
- Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- McCarthy - Minsky
- Sillitoe
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- Lenz
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Dolls
- Ellis
- Cortázar
- Warhol
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- HarperLee
- Fuentes

Caraïbe anglophone - C.L.R.James (1901-1988), "Miny Alley" (1936) - V.S. Naipaul (1932-2018), "A House for Mr Biswas" (1961), "The Mimic Men" (1967), "In a Free State" (1971), "A Bend in the River" (1979), "The Enigma of Arrival" (1987) - Derek Walcott (1930-2017), "Omeros" (1990) - Wilson Harris (1921-2018), "Guyana Quartet" (1962-1963) - ....
Lastupdate: 31/12/2016
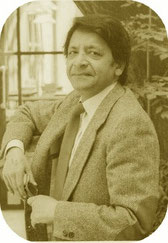
Avant lui, les petites îles des Caraïbes, les communautés indiennes déracinées et les sociétés post-coloniales en crise n'étaient pas considérées comme des sujets "nobles" pour la grande littérature. Naipaul a placé ces mondes au centre de son œuvre avec une précision et une acuité sans précédent...
"The world is what it is ; men who are nothing, who allow themselves to become nothing, have no place in it" (Le monde est ce qu'il est ; les hommes qui ne sont rien, et qui se laissent devenir rien, n'y ont pas leur place) - Le journaliste et activiste politique de la Trinidad, CLR. James (1901-1989) écrivit avec "Miny Alley" (1936) l'un des premiers romans des Caraïbes, mais d'autres auteurs se confrontèrent bientôt au problème particulier de leur identité antillaise. Le commentateur et romancier particulièrement caustique, également de la Trinidad, VS. Naipaul (né en 1932), devint célèbre avec des œuvres comme "A House for Mr Biswas", puis en vint à élargir ses horizons pour aborder les sociétés post-coloniales en Afrique, en Asie, et dans les Caraïbes. Auteur de plus d’une trentaine de livres de fiction et de non-fiction, il obtint le prix Booker en 1971, et le prix Nobel, en 2001...
Avant de s’établir en Angleterre, Naipaul a grandi à Trinidad dans une communauté d’immigrants indiens et sa représentation des peuples colonisés a souvent été sévèrement jugée par les critiques, la jugeant mal inspirée, raciste et sexiste, c'est-à-dire reflet de nombre de préjugés eurocentriques. D'autres l'ont lu comme un autodépravé et autocritique, s'étant engagé à décrire sa propre implication dans ce qu’il voyait comme le malaise du monde postcolonial.
Au fond, ne reflétant que les immenses et profondes contradictions inhérentes au monde post-colonial qu’il a observé avec tant de précision. Le jeune Naipaul, à l'époque de la décolonisation, a éprouvé « l'intuition d'un monde en mouvement, d'un monde perturbé», d'un monde (colonial) produit d'un dérèglement dont il n'a pu saisir les origines et les conséquences lorsqu'il l'a rencontré pour la première fois en lui-même. Et bien qu'il ne l'ait pas réalisé à l'époque, il finira par être convaincu, semble-t-il, que sa tâche d'écrivain est de découvrir une forme adéquate aux « mondes que je contenais en moi, aux mondes dans lesquels je vivais » (the worlds I contained within myself, the worlds I lived in). Son Nobel de littérature ne récompense-t-il pas une oeuvre "qui nous pousse à voir la présence de l’histoire refoulée"...
Trinité-et-Tobago est un État insulaire situé dans la région des Caraïbes, au large de la côte nord-est de l'Amérique du Sud (à seulement 11 kilomètres de la côte du Venezuela), une colonie britannique qui devint une nation indépendante au sein du Commonwealth britannique le 31 août 1962 et une république en 1976 ...
Il est au final singulier de voir combien C.L.R. James, V.S. Naipaul, Derek Walcott et Wilson Harris, entre autres (Jean Rhys, Sam Selvon, Kamau Brathwaite), sont parvenus à donner aux Caraïbes, tant marquées par le colonialisme, l’esclavage, et une grande diversité culturelle entre Asie et Afrique, un rang d’espace littéraire mondial et de réflexions sur ces questions profondes que sont l’identité, l’histoire, et la condition humaine ....
Même lorsqu'on le rejette, on ne peut ignorer la puissance de son oeuvre. V.S. Naipaul force le lecteur à confronter des vérités inconfortables, ce qui est une des fonctions les plus vitales et les plus durables de la grande littérature. Son héritage est donc à la fois artistique (une prose sublime), intellectuel (une analyse pénétrante) et polémique (un corpus qui divise et qui dérange).
"Une maison pour Monsieur Biswas" (1961) reste son chef-d'œuvre absolu, un classique de la littérature mondiale. C'est le roman universel de la quête de dignité et d'identité à travers la possession d'un foyer. Des livres comme "Crépuscule sur l'Islam" ou "À la courbe du fleuve" (sur l'Afrique post-coloniale) sont des essais/romans indispensables pour comprendre les soubresauts du monde contemporain.
Dans un monde globalisé où les questions de migration et d'identité multiple sont centrales, l'œuvre de Naipaul reste une référence pour explorer la psyché de celui qui est entre plusieurs mondes ...

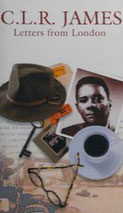
C.L.R. James (1901-1988)
"Minty Alley" (1936), "The Black Jacobins"(1938), "Beyond a Boundary" (1963)
Cyril Lionel Robert James James est né dans une famille de la classe moyenne à Trinité (Tunapuna), alors colonie britannique, a fréquenté le Royal College, la meilleure école du pays, où il est devenu joueur de cricket et athlète passionné. Après avoir travaillé comme enseignant, il s'installe à Port of Spain, la capitale de Trinité, commence à écrire , publie trois nouvelles, "La Divina Pastora" (1927), "Triumph" et "Turner’s Prosperity" (tous deux dans le magazine Trinidad, 1929), et s'intéresse rapidement à l'histoire coloniale et au rôle des Noirs dans les luttes révolutionnaires mondiales. En 1932, il quitte la Trinité pour la Grande-Bretagne, s’installe dans le Lancashire avec son ami, le grand joueur de cricket et futur homme politique trinidadien Learie Constantine. Correspondant du Manchester Guardian pour la rubrique sur le cricket, il s'implique de plus en plus dans la politique marxiste, de tendance trotskiste, publie "World Revolution", 1917-1936. "The Rise and Fall of the Communist International" (1937), qui retient l'intérêt de Trotski et de George Orwell. Pendant cette même période, C. L. R. James commence à militer, notamment à l'intérieur de l'International Service Bureau, en faveur des peuples colonisés. Il signe une pièce sur la révolution haïtienne qui éclata dans les années 1790, intitulée "Toussaint L'Ouverture" et représentée à Londres en 1936. Deux ans plus tard, il publie "The Black Jacobins"; largement applaudie par la critique, cette étude marxiste d'un mouvement mené par des esclaves lui vaudra une renommée internationale. Il a par ailleurs fréquenté les cercles littéraires anglais et a rencontré Edith Sitwell, à Bloomsbury, poétesse et essayiste ("The English Eccentrics", 1933).
En 1938, il gagne les États-Unis. Il fut trotskyste pendant de nombreuses années, visitant Trotsky chez lui au Mexique et rencontra également Frida Kahlo et Diego Rivera. James a vécu aux États-Unis de 1938 à 1953, avant de rejeter le trotskysme en 1951. Il a été emprisonné à Ellis Island en 1953 pour avoir laiss expiré son visa, puis a quitté le pays avant d’être expulsé. Il est retourné volontairement en Grande-Bretagne en 1953 puis à Trinidad pour les célébrations de la nouvelle Fédération des Antilles en 1958, où il a édité le journal pro-indépendance du Mouvement national populaire, le Nation. En Grande-Bretagne, il a vécu à Hampstead et à Willesden, puis à Brixton, où il est mort en 1989. Son autre ouvrage très célèbre est "Beyond a Boundary" (1963), où il évoque l'importance du cricket dans la mentalité britannique et dans l'histoire des Caraïbes, et un livre sur Kwame Nkrumah, le premier dirigeant du Ghana après l’indépendance, qu’il avait connu comme étudiant ("Nkrumah and the Ghana Revolution", 1977).
James n’a jamais écrit qu’un seul roman, "Minty Alley" (1936), le premier roman d’un écrivain noir des Caraïbes à être publié en Angleterre (la comédie de Samuel Selvon, "The Lonely Londoners", qui traite des Noirs des Caraïbes nouvellement arrivés à Londres, date de 1956). Il ne faisait pas encore partie de cette vague des écrivains de l’ère Windrush comme Wilson Harris, George Lamming, Edgar Mittelholzer, V. S. Naipaul, Andrew Salkey et Samuel Selvon, qui purent bénéficier du mouvement d'ampleur de migration des Caraïbes vers la Grande-Bretagne. On a oublié qu'entre 1948 et 1971, environ 500.000 personnes ont émigré vers la Grande-Bretagne en provenance des pays du Commonwealth, des milliers d’hommes et de femmes des Caraïbes qui se sont battus pour la Grande-Bretagne pendant la Deuxième Guerre mondiale (environ 10000 soldats des Caraïbes britanniques ont combattu pour l’armée britannique, et 6000 autres dans la Royal Air Force). La plupart sont retournés aux Caraïbes à la fin de la guerre : la génération des Windrush a eu une incidence culturelle importante sur la société britannique d’aujourd’hui.
James était dans les années 1930 un solitaire ...
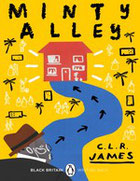
"Minty Alley" (1936)
Ecrit en 1928 et se déroulant à Port of Spain, la capitale de Trinidad, "Minty Alley" est un roman colonial, plus que post-colonial, écrit trente-trois ans avant que Trinidad n’obtienne son indépendance en 1962. Mais les structures impériales britanniques qui ont gouverné ce pays ne sont pas au centre du roman : cette chronique de la vie quotidienne dans une maison de pension à Trinité est centrée sur la communauté des Caraïbes, un microcosme en relation avec lui-même. Ils ne sont pas des étrangers dans un environnement hostile qui lutte pour être accepté, même si beaucoup d’entre eux ont l’ambition d'émigrer, mais sont parmi les leurs et mènent une vie ordinaire au sein d’un réseau compliqué de relations divertissantes. On anticipe ici sur les bases du roman le plus célèbre de Naipaul, "A House for Mr Biswas" (1961). Pour le lecteur contemporain, on plonge dans une société qui date de près d’un siècle, ce qui nous montre que si les circonstances sont différentes, nos passions essentielles, nos préoccupations et nos ambitions restent les mêmes.
"Haynes concluded his calculations and decided that he could not continue to live in the whole house. He would occupy two rooms and let the rest as soon as he could; but leave the house, that he would not do." Haynes, est un jeune homme de la classe moyenne éduquée de Trinité, perd à la mort de sa mère, toute stabilité financière et doit emménager dans une maison de pension située à Minty Alley, un quartier modeste de Port of Spain. Ce déménagement va marquer une rupture avec son ancien mode de vie confortable et le plonger dans une réalité sociale inconnue. Haynes, un solitaire dont toute l'existence était jusque-là tracée par sa mère, se mue en observateur attentif des locataires de la pension : un microcosme social issu des classes populaires, tenu par Miss Atwell, une femme énergique et pragmatique qui jongle avec les problèmes financiers et les tensions sociales entre ses locataires. On y rencontre Benoit, un homme charismatique mais manipulateur, souvent impliqué dans des disputes; Maisie, une jeune femme ambitieuse, qui rêve d’une vie meilleure; Ella, femme douce mais vulnérable, souvent en conflit avec les autres locataires. Haynes observe, non sans fascination, les interactions entre les locataires, marquées par des rivalités, des alliances, et des drames personnels. Et malgré les disputes qui éclatent fréquemment, la maison reste un espace de solidarité dans l’adversité. Les intrigues amoureuses jouent un rôle central dans les conflits. Haynes va être est progressivement entraîné dans la vie de la pension, devenir un confident pour certains locataires et se retrouve impliqué dans leurs conflits, mais surtout découvre des dimensions de l’humanité qu’il ignorait auparavant : celles des réalités sociales de Trinité et du rôle à tenir dans une société coloniale marquée par les inégalités.
Le chapitre qui décrit l’arrivée de Haynes, qui vient d’un milieu aisé, dans la maison de pension tenue par Miss Atwell, est souvent considéré comme emblématique. Il établit le cadre du roman tout en introduisant les thèmes centraux et les personnages clés. Son arrivée dans cette maison marque le début de son immersion dans un monde qui lui est étranger : et les dialogues du roman vont nous révéler de nouveaux modes de relations humaines et de nouvelles formes de société enracinées dans les désirs et les aspirations des classes les plus populaires d'une société coloniale des Caraïbes, loin, très loin du vide des Antilles instruites. "Minty Alley" a ouvert la voie à d'autres écrivains caribéens, comme Derek Walcott et V.S. Naipaul ...
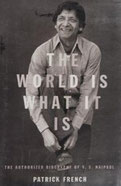
V.S. Naipaul (1932-2018)
Né en 1932 à Trinidad, alors colonie britannique (ses ancêtres étaient des paysans du nord de l’Inde qui avaient été emportés à la fin du XIXe siècle pour travailler comme ouvriers sous contrat dans les plantations de sucre de Trinidad), V.S. Naipaul (Sir Vidiadhar Surajprasad Naipaul), écrivain d'origine indo-trinidadienne et lauréat du Prix Nobel de littérature en 2001, écrivit exclusivement en anglais. Bien que ses œuvres reflètent ses racines indiennes et son héritage culturel caribéen, il choisit l'anglais comme langue d'expression littéraire, tout en intégrant des éléments culturels et linguistiques issus de l’hindi et les dialectes indiens (cf. ses dialogues et descriptions de la communauté indo-trinidadienne dans des œuvres comme "A House for Mr. Biswas", mais aussi le créole trinidadien, l’ourdou et l’hindoustani). Personnalité controversée, beaucoup ne l'ont abordé qu'en distinguant l’individu, jugé désagréable, et l’écrivain, accompli. L'homme aux opinions tranchées et au franc-parler, pour son regard distant et parfois condescendant sur les cultures qu’il décrivait, ses observations sur l’Inde ("India: A Wounded Civilization", 1977), et l’islam politique ("Among the Believers", 1981, "Beyond Belief", 1998), trop alignées sur les valeurs occidentales, ses commentaires sur les femmes écrivaines, notamment Jane Austen, - et les femmes en général-. On peut citer l'écrivain indien Amitav Ghosh à ce sujet ; "[Naipaul’s] views and opinions I almost always disagreed with: some because they were founded on truths that were too painful to acknowledge; some because they were misanthropic or objectionable; and some because they came uncomfortably close to being racist…. Yet he was writing of matters that no one else thought worth noticing; he had found words to excavate new dimensions of experience.".
L'auteur est donc fermement apprécié pour son style précis et dépouillé, son pessimisme profond envers les sociétés post-coloniales, - qu'il décrit souvent comme stagnantes ou dysfonctionnelles -, et son extrême acuité qui sait d'emblée déceler toutes les contradictions humaines, les failles culturelles ou les tensions sociales. "A House for Mr Biswas "(1961), inspiré de la vie de son père, conte l'histoire de Mohun Biswas, un homme luttant pour trouver une maison et une identité dans une société coloniale chargée d'ambiguïtés. "The Mimic Men" (1967) pourfend les élites post-coloniales et leur tentative d’imiter les anciens colonisateurs. "A Bend in the River" (1979) est un roman sombre sur l’Afrique post-coloniale, marqué par la corruption et la violence...
"The World Is What It Is" est citée comme la biographie autorisée de V. S. Naipaul, écrite par Patrick French (2008) et dont le titre reprend la célèbre phrase d’ouverture du livre de Naipaul, "A Bend in the River".
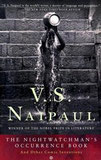
"The Mystic Masseur" (1957)
Ce premier roman de l'écrivain trinidadien V. S. Naipaul met en scène un personnage issu du
peuple dans le contexte politique de l'indépendance des Caraïbes, alors que les divisions de races et de classes semblent faire place à un nouvel esprit nationaliste. Sur un mode volontiers humorístique, l`histoire de l'instituteur Pandít Ganesh est contée, accumulant les
coïncidences, tandis que le héros ne manque pas d'insister sur sa prédestination. Cet ancien
mauvais élève -ne doit de pouvoir quitter un métier d`enseignant dont il s'acquitte mal qu`au décès providentiel de son père, qui lui laisse des actions pétrolières.
Stupide et entêté dans son désir d'écrire. il compose un opuscule sur la religion hindoue. qu'il ne parvient pas à placer. ll devient alors "masseur mystique" et, mêlant la charlatanerie à l'apparat (il se drape dans d`imposants costumes traditionnels), il parvient à établir sa réputation après avoir débarrassé un jeune Noir d'un sentiment obsessionnel de culpabilité. La fortune lui sourit et il se trouve élu, comme représentant de l'opposition, à l'assemblée législative lors du premier scrutin universel de la nation indépendante.
Son opportunisme l'incite bientôt à devenir un pilier du gouvernement en place : décoré par la Grande-Bretagne., il se trouve envoyé en tournées à l`étranger pour défendre sa politique coloniale. Ses manières jadis frustes s`européanisent et, dans un parfait mimétisme, il devient un "Britannique à la peau noire" sans souffrir des complexes analysés par Frantz Fanon. Pour parachever sa métamorphose, il change de nom et devient G. Ramsay Muir, Esq.. chevalier de l`ordre de l'empire Britannique.
Trop caricatural pour être vraisemblable, le cheminement de Ganesh vers le succès en ce monde attire l`attention sur l'artificialité de la passation des pouvoirs lors des indépendances formelles et les conséquences à long terme de la colonisation culturelle dans l'esprit des anciens sujets de l'Empire. Naipaul montre aussi comment l'effondrement de la culture indienne traditionnelle ne donne lieu qu'à un comportement mimétique, au mépris des valeurs individualistes positives de l`Occident lui-même. La moralité n'a plus cours face à l'opportunisme, la liberté devient dérision quand l`ancien opprimé l'utilise à des fins égoïstes au détriment du bien commun.
Ce récit, qui aurait pu être désespérément moralisateur, demeure léger, le ton badin. Naipaul s'essaie à peindre, sans trop prendre parti, une situation sociale complexe tout en s`abstenant de condamner totalement son personnage dans le style des romanciers anglais de la fin du XIXe siècle ...
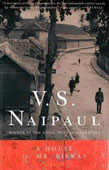
"A House for Mr Biswas" (1961)
Issu d'une famille indienne ayant immigré à Trinidad, dans les Antilles, au XIXe siècle, Vidiadhar Suraiprasad Naipaul obtient une renommée internationale avec ce roman qui restitue le contexte dans lequel il a grandi. Le personnage principal, Mohun Biswas, doit lutter pour construire sa propre maison, pour subvenir aux besoins des siens, et pour échapper à une belle-mère envahissante. Confronté aux injustices du colonialisme et au déracinement, il est également tiraillé par des tensions entre l'individu et la famille.
Les Tulsis, une famille influente et étendue, décident de déménager à Shorthills, une propriété spacieuse mais délabrée en dehors de la ville. Mr. Biswas, qui s'est toujours senti marginalisé dans le monde des Tulsis, voit ce déménagement comme une opportunité de se rapprocher de l'indépendance qu'il désire ardemment. Cependant, à son arrivée, il découvre que Shorthills est un lieu isolé, mal entretenu, et difficile à gérer. Shorthills va devenir un microcosme de la famille Tulsis, avec ses alliances et ses querelles. Les tensions entre Mr. Biswas et les autres membres de la famille, particulièrement avec Seth (le patriarche autoritaire), s'exacerbent dans cet environnement confiné. Mr. Biswas, incapable de s’intégrer pleinement, se sent de plus en plus frustré par la dépendance de sa famille envers les Tulsis. Mais cette maison, symbole de grandeur initialement promise, va rapidement se détériorer, reflet de l’échec collectif de la famille à s’adapter à son nouvel environnement, absurdité des ambitions collectives des Tulsis et nécessité pour Mr. Biswas de trouver sa propre voie...
"DESPITE THE solidity of their establishment the Tulsis had never considered themselves settled in Arwacas or even Trinidad. It was no more than a stage in the journey that had begun when Pundit Tulsi left India. Only the death of Pundit Tulsi had prevented them from going back to India; and ever since they had talked, though less often than the old men who gathered in the arcade every evening, of moving on, to India, Demerara, Surinam. Mr Biswas didn’t take such talk seriously. The old men would never see India again. And he could not imagine the Tulsis anywhere else except at Arwacas. Separate from their house, and lands, they would be separate from the labourers, tenants and friends who respected them for their piety and the memory of Pundit Tulsi; their Hindu status would be worthless and, as had happened during their descent on the house in Port of Spain, they would be only exotic..."
"The Shorthills Adventure" est sans doute l'un des chapitres les plus emblématiques du roman, celui dans lequel Mr. Biswas, sa femme Shama, et leurs enfants déménagent dans une grande maison à Shorthills, une propriété appartenant à la famille Tulsis...
Ce roman reste le chef-d'œuvre de l'écrivain trinidadien V. S. Naipaul. Très autobiographique, en dépit du recul ironique avec lequel il traite de la carrière d'un Indien désargenté mais né dans la caste enviée des brahmanes, il évoque l'adolescence de l`auteur, certains membres de sa famille, dont son père. Seepersad Naipaul, lui-même écrivain, issu d`une famille pauvre d'immigrants hindous, et parlant l'hindi. L'imagination revendique pourtant ses droits dans cette épopée du Nouveau Monde qui retrace les difficultés, les triomphes et les déconvenues d'un fils du peuple en route vers le succès et l'acculturation.
"TEN WEEKS before he died, Mr Mohun Biswas, a journalist of Sikkim Street, St James, Port of Spain, was sacked. He had been ill for some time. In less than a year he had spent more than nine weeks at the Colonial Hospital and convalesced at home for even longer. When the doctor advised him to take a complete rest the Trinidad Sentinel had no choice. It gave Mr Biswas three months’ notice and continued, up to the time of his death, to supply him every morning with a free copy of the paper.
Mr Biswas was forty-six, and had four children. He had no money. His wife Shama had no money. On the house in Sikkim Street Mr Biswas owed, and had been owing for four years, three thousand dollars. The interest on this, at eight per cent, came to twenty dollars a month; the ground rent was ten dollars. Two children were at school. The two older children, on whom Mr Biswas might have depended, were both abroad on scholarships.
It gave Mr Biswas some satisfaction that in the circumstances Shama did not run straight off to her mother to beg for help. Ten years before that would have been her first thought. Now she tried to comfort Mr Biswas, and devised plans on her own.."
"Dix semaines avant sa mort, Mr Mohun Biswas, un journaliste de Sikkim Street, Saint- James, Port of Spain, fut congédié. Il avait été malade pendant quelque temps. En moins d’un an, il avait passé plus de neuf semaines au Colonial Hospital, et sa convalescence chez lui s’était prolongée plus longtemps encore. Lorsque le médecin lui conseilla de prendre un repos complet, la Trinidad Sentinel n’eut pas le choix. Elle donna à Mr Biswas un préavis de trois mois et continua jusqu’à son dernier jour à lui faire chaque matin le service du journal.
Mr Biswas avait quarante-six ans et quatre enfants. Il n’avait point d’argent. Sa femme Shama non plus. Sur la maison de Sikkim Street, Mr Biswas devait, depuis quatre années déjà, trois mille dollars. L’intérêt de cette somme à huit pour cent représentait vingt dollars par mois. Les deux aînés de ses enfants, sur qui Mr Biswas aurait pu compter pour le soutenir, étaient tous deux à l’étranger, comme boursiers.
Mr Biswas éprouva quelque satisfaction à constater qu’en l'occurrence Shama ne courut pas tout droit chez sa mère pour quêter du secours. Dix ans plus tôt, c’eût été sa première pensée. À présent, elle essaya de réconforter Mr Biswas, et médita des projets de son cru..."
Le PROLOGUE nous montre le héros au sommet de sa carrière et à la fin de sa vie : il possède sa propre maison mais va mourir d`une maladie du cœur. Le retour en arrière qui décrit les étapes de son ascension sociale met surtout en lumière les humilíations subies et le caractère dérisoire de sa réussite. Propriétaire, il est enfin respecté par son épouse, Shama, née dans le riche clan commerçant des Tulsi, dont Biswas a trop longtemps dû supporter la promiscuité et le mépris. Son humour l'aide à se venger de leur comportement hautain qui l'exclut, mais il tend surtout à compenser son inférioríté par une conduite d'évasion.
Son monde favori n'est ni la ville grouillante ni les campagnes arriérées, quoique splendides, de son île, mais c`est l`univers fabuleux de la littérature britannique, pleine d'exotisme et de merveilleux pour qui la voit depuis les tropiques. Ses classiques suscitent son émulation maladroite d'écolier et, plus tard, sa carrière de journaliste infatigable et de pamphlétaire contenu.
Un roman qui parle d'écriture prise souvent au pied de la lettre puisque Biswas débute comme peintre d'enseignes, mais aussi d`accomplissement de soi au sein d`un univers indifférent. Ce milieu à la fois fruste et avide semble incapable de comprendre une âme délicate d'artiste; au mieux, ses élites demeurent de médiocres copies de cercles culturels métropolitains.
A côté de ce thème récurrent de la vocation artistique contrariée, Naipaul sait peindre en réaliste et en satiriste la quotidienneté pleine d'humour, de vitalité, d'invention, de réactions inattendues, d`une existence en commun au sein de la demeure imposante de Hanuman House. Les personnages, dont aucun n'est secondaire même si certains restent épisodiques, sont hauts en couleur; la métaphore animale sert volontiers à caractériser les humains, tout comme le symbole de la maison sous-tend et structure la quête d'un chez soi, et d`un quant à soi. L'individualisme s`oppose à la communauté forcée, les valeurs européennes du succès à une solidarité qui semble de mise mais qui est illusoire. (Trad. Gallimard, 1964)

"A House for Mr Biswas" - PREMIÈRE PARTIE
Cette première partie ne se contente pas de raconter l'enfance et les premières expériences professionnelles de Mr Biswas ; elle construit méthodiquement les fondations de son complexe d'infériorité, de son aliénation et de son désir viscéral d'autonomie, symbolisé par la quête d'une maison...
"Mr Biswas ne put jamais dire au juste, par la suite, où s’élevait la hutte de son père et à quel endroit Dhari et les autres avaient creusé le sol. Il ne sut jamais si quelqu'un avait découvert le pécule de Raghu. Ce ne devait pas être grand-chose, étant donné les gains modiques de Raghu. Mais la terre livrait bel et bien des trésors, car ceci se passait à la Trinité du Sud et le terrain que Bipti avait vendu si bon marché à Dhari se trouva contenir un riche gisement de pétrole. Et quand Mr Biswas, travaillant à un article pour l’hebdomadaire du Sunday Sentinel — intitulé LE RÊVE DE RALEIGH RÉALISÉ, avec en épigraphe : « Mais l’or est noir. Seule la terre est jaune, seule la brousse est noire ».… — quand Mr Biswas, disons-nous, chercha l’emplacement où il avait vécu ses premières années, il ne vit qu’un va-et-vient, un va-et-vient de camions-citernes à pétrole et des pompes rébarbatives à perte de vue, entourées de panneaux indicateurs : Défense de fumer. La maison de ses grands-parents avait également disparu et les huttes de torchis une fois abattues ne laissent point de trace. Son cordon ombilical enterré cette nuit de mauvais augure et son sixième doigt enfoui dans le sol peu après, n'étaient que poussière, l’étang asséché, et toute la région marécageuse transformée à présent en une cité-jardin, de bungalows en bois blanc à toits rouges, de citernes sur hauts pilotis et de parcs soignés. Endiguée, déviée dans un réservoir, la rivière où jadis il guettait les poissons, et des pelouses rectilignes, des rues et des routes carrossables recouvraicnt son lit sinueux, irrégulier. Rien au monde ne portait plus témoignage de la naissance et des premières années de Mr Biswas ..."
Avant les Tulsi : La malédiction originelle
Le livre s'ouvre sur la naissance de Mohun Biswas à Trinidad. Dès le départ, sa vie est marquée par le malheur et la superstition. Il naît à minuit, un signe de malchance, et un astrologue prédit qu'il sera un "fléau pour ses parents et sa famille" et qu'il "mangera la substance de [ses] propres père et mère". Cette prophétie pèse sur toute son enfance. Son père, Raghu, un ouvrier agricole noyé dans les dettes, meurt tragiquement par noyade alors qu'il tentait de sauver l'un de ses fils. Cet événement plonge la famille dans la misère et disperse ses membres. Mohun, intelligent, est pris en pitié par un pandit qui lui apprend à lire et écrire, puis est brièvement envoyé à l'école. Mais il est rapidement retiré pour devenir apprenti chez un pandit brutal et hypocrite, avant de fuir.
Destin et Fatalité : Naipaul plante le décor d'un monde hindou traditionnel où la superstition et le destin dictent les vies. La prophétie est le moteur psychologique de toute l'existence de Biswas. Il se bat constamment contre ce destin écrit, cherchant à prouver qu'il peut être plus qu'un "fléau".
La mort du père et la dispersion de la famille signent la fin de toute structure stable. Biswas n'a littéralement pas de maison, pas de foyer fixe. Il est un déraciné dès son plus jeune âge, ballotté par le malheur et les décisions des autres.
Son seul refuge est l'école, où il excelle brièvement. C'est là que naît son aspiration à une vie meilleure, à la dignité que confère l'éducation. La brutalité de son apprentissage renforce son désir de fuir toute forme d'exploitation et d'asservissement.
"..Les Tulsi avaient, parmi les Hindous, la réputation d’une famille pieuse, conservatrice, nantie de terres. D’autres communautés qui ne savaient rien des Tulsi avaient entendu parler du pandit Tulsi, fondateur de la famille. Victime d’un des premiers accidents d’auto, il faisait l’objet d’une chanson irrévérencieuse extrêmement populaire, aussi n’était-il, pour beaucoup d'étrangers, qu’une créature fictive. Parmi les Hindous circulaient d’autres rumeurs sur le pandit Tulsi, les unes romanesques, les autres bouffonnes. La fortune qu’il avait réalisée à Trinidad n’était pas le fruit de son travail, et l’on se demandait pour quel motif mystérieux il avait émigré comme «ouvrier ». Un ou deux émigrants issus de clans criminels étaient venus pour échapper à la justice. Un ou deux autres pour se soustraire aux conséquences de leur participation à la mutinerie. Le pandit Tulsi n’appartenait à aucune de ces catégories. Sa famille prospérait toujours aux Indes — des lettres arrivaient régulièrement, et l’on savait qu’il était d’un niveau social supérieur à celui des Indiens émigrés à Trinidad, qui presque tous, comme Raghu ou Ajodha, avaient perdu tout contact avec leur parentèle et n’auraient su en quelle province la chercher. La déférence qui entourait le pandit Tulsi dans son district natal l’avait suivi à Trinidad et, après sa mort, restait attachée à sa famille. De cette famille, on ne savait, au fond, pas grand-chose; les gens du dehors n'étaient admis à Hanuman House qu’à l’occasion de certains offices religieux.
Mr Biswas se rendit à Hanuman House pour peindre des réclames destinées au Bazar Tulsi, après une entrevue avec un homme grand, moustachu, autoritaire, dénommé Seth, beaufrère de Mrs Tulsi..."
Les Tulsi : La perte de l'identité
Jeune homme, Biswas devient peintre d'enseignes. C'est lors d'une commande pour les Tulsi qu'il rencontre la famille qui va dominer le reste de sa vie. Les Tulsi sont une riche famille propriétaire terrien d'origine indienne, dirigée par la matriarque Mme Tulsi ("la Veuve"). Leur propriété, Hanuman House, est un microcosme clos, presque féodal, où règnent les rites, les commérages et l'autorité de la famille. Biswas, maladroit et arrogant, est intrigué par Shama, une des filles Tulsi. Après un quiproquo romantique (il lui écrit une lettre qui est interceptée et lue à toute la famille), il est contraint de l'épouser pour sauver les apparences.
L'Assimilation par le Clan : L'entrée dans la famille Tulsi est le tournant de sa vie. Hanuman House n'est pas un foyer, c'est une institution. Biswas n'épouse pas seulement Shama ; il est absorbé par le clan. Il perd son nom, son identité et son autonomie pour devenir "le mari de Shama", un rouage négligeable dans la grande machine Tulsi.
Satire Sociale : Naipaul use d'un humour féroce et ironique pour décrire l'absurdité des conventions sociales. Le mariage n'est pas une affaire de sentiment mais de bienséance. La lettre de Biswas, maladroite et prétentieuse, est un chef-d'œuvre de comique cringe, mais elle révèle aussi sa profonde solitude et son désir de connexion.
Le Conflit : Biswas se rebelle immédiatement contre l'autorité des Tulsi, en particulier contre les deux fils tyranniques, Seth et Shekhar. Son orgueil et son sentiment d'infériorité le poussent à des actes de défi puérils mais symboliques (comme briser un vase précieux), qui ne font qu'empirer sa situation et le rendre ridicule aux yeux du clan.
"... The Chase était une longue agglomération de huttes de torchis disséminées au cœur de la région de cannes à sucre. Ses habitants travaillaient aux plantations et aux routes. Le monde au-delà semblait lointain et l’on n’y était relié que par les charrettes et les bicyclettes des villageois, les camions et fourgons des grossistes et parfois les cars sans horaire établi ni itinéraire fixe.
Pour Mr Biswas, ce fut comme un retour au village de ses premières années, sauf qu’à présent, les ténèbres environnantes et le mystère avaient disparu. Il savait ce qui existait au-delà des champs de canne à sucre, et où aboutissaient les routes. Elles allaient à des villages tout pareils à The Chase; elles allaient à des villes croulantes où peut-être, ses enseignes décoraient une boutique ou un café.
La boutique de Mr Biswas se composait d’une pièce longue et étroite, au toit de tôle zinguée, rouillée. Le plancher de béton, à peine plus haut que le sol, usé par le frottement, présentait des aspérités caillouteuses, incrustées de crasse. ..."
The Chase & Green Vale : L'échec de l'émancipation
Pour se débarrasser de lui, les Tulsi envoient Biswas et sa jeune famille (Shama et leurs deux premiers enfants) gérer une petite épicerie/bureau de tabac dans un village éloigné appelé The Chase. L'entreprise est un échec cuisant. Biswas, piètre commerçant, se fait voler et accumule les dettes. Il sombre dans la dépression et la maladie. Après la mort tragique de sa fille nourrisson, il fait une dépression nerveuse et est rapatrié à Hanuman House, humilié.
Plus tard, les Tulsi lui offrent une nouvelle "chance" : devenir surveillant d'une de leurs fermes à Green Vale. Voulant croire à son indépendance, il accepte. Là-bas, dans un geste désespéré d'autonomie, il contracte un prêt colossal pour construire sa propre maison. La construction, menée par un charpentier incompétent, est un désastre. La maison est fragile, mal conçue, et s'effondre littéralement lors d'une tempête, ensevelissant sous les dettes les espoirs de Biswas.
La Quête Tragi-comique de la Maison : La séquence de Green Vale est le cœur symbolique de cette première partie. La maison qu'il bâtit n'est pas un foyer, c'est un acte de défiance. Elle est construite avec l'argent des Tulsi (via le prêt qu'ils garantissent), sur une terre qui ne lui appartient pas. Sa construction désastreuse et son effondrement sont la métaphore parfaite de sa vie : une ambition noble mais malavisée, construite sur des bases fragiles et vouée à l'échec à cause du manque de moyens et de compétences.
Cycle de Dépendance et d'Échec : Chaque tentative de Biswas de s'émanciper des Tulsi se solde par un échec plus cuisant qui le rend encore plus dépendant d'eux. Ils sont son seul filet de sécurité, aussi étouffant soit-il. Naipaul montre la terrible ironie du colonialisme et du système féodal : l'oppressé est contraint de dépendre de l'oppresseur pour sa survie.
La Maladie et la Dépression : L'état mental et physique de Biswas se dégrade au fil des échecs. Sa dépression à The Chase et sa "maladie" récurrente sont des manifestations psychosomatiques de son impuissance et de son aliénation. Son corps refuse la vie qu'on lui impose.
"... lorsque Seth dit : « Maï et Owad rentrent cette fin de semaine » (entendant par là que la chambre bleue devait être préparée à l’intention d'Owad), alors seulement Mr Biswas songea à agir. Il répugnait à émigrer dans une autre partie de la maison, il répugnait à affronter Mrs Tulsi et le dieu. La petite valise de carton brun, acquise par troc contre une grande quantité de paquets de cigarettes Anchor et décorée, sur les deux côtés, de son monogramme, suffisait à contenir les effets qu’il comptait emporter. Il se rappela le sarcasme de Shama :
« Quand tu es venu chez nous, tu n’avais pas plus de vêtements que ce qu’on peut pendre à un clou. » Il continuait à avoir peu de vêtements, tous chiffonnés et sales. Il décida de laisser le casque de liège. Il l’avait toujours trouvé ridicule et d’ailleurs ce couvre-chef appartenait au baraquement. Il pourrait un Jour faire chercher ses livres. Mais il emballa ses brosses de peintre.
Elles avaient survécu à tous ses déplacements; la cire molle sur les poils d’une ou deux d’entre elles avait durci, craqué, pour s’effriter en poudre.
Il voulait partir de bon matin, pour disposer de plus de temps avant la tombée de la nuit. Ses vêtements froissés lui semblèrent trop larges lorsqu’il les mit; son pantalon pendait; il avait maigri.
Il se rappela le matin où sa serviette-éponge lui était tombée du corps, en face des douze chambres du baraquement. Quand Savi lui apporta son cacao, des biscuits et du beurre, il lui dit : « Je m’en vais.» - Elle ne parut ni surprise ni déçue, et ne demanda pas où il allait.
Il s’en allait dans le vaste monde, pour éprouver si ce monde aurait le pouvoir de l’effrayer. Le passé n’était qu’un simulacre, une série d’incidents décevants. La vie réelle et sa douceur particulière l’attendaient. Il repartait à pied d'œuvre. ..."
Un départ : L'exil comme seule issue
Accablé par la dette de la maison effondrée et rongé par l'humiliation, Biswas est de nouveau contraint de retourner se réfugier à Hanuman House, la matrice qu'il déteste mais qui reste son seul abri.
La Défaite Apparente : La fin de cette première partie est un constat d'échec total. Biswas a tout tenté pour gagner son indépendance et a échoué à chaque fois. Il retourne chez les Tulsi en position de faiblesse, un parasite comme la prophétie l'avait prédit.
La Graine de la Révolte : Pourtant, cet échec nourrit en lui une haine et une amertume qui vont devenir son carburant. Chaque humiliation subie renforce sa détermination (même passive) à un jour posséder sa propre maison. Le départ de Green Vale n'est pas une fin, mais la fin d'un chapitre d'apprentissage douloureux ..
"C'était la saison de la moisson. Dans les champs de canne à sucre, déjà en partie fauchés, les moissonneurs et les chargeurs étaient à l’œuvre, enfoncés jusqu'aux genoux dans la bagasse. Le long des sentiers entre les champs boueux, des buffles gris noirs tiraient nonchalamment des charrettes aux grands chargements de canne à sucre ébouriffée. Bientôt le pays changea et lair fut moins poisseux. La canne à sucre céda la place aux rizières, la couleur vaseuse de leur eau diluée dans le pur reflet du ciel bleu; les arbres se firent plus nombreux et, au lieu des huttes de boue séchée, il y eut des maisons de bois, petites et vieilles, mais achevées, peintes et pourvues de jalousies, avec du bois ajouré, souvent cassé, le long des auvents, au-dessus des portes, des fenêtres, et autour des vérandas enfoncées dans les fougères. La plaine s’abaissa derrière eux, les montagnes se rapprochèrent; mais la maison de poupée resta toujours aussi petite et quand le car tourna dans la Grand-Route principale de l’Est, Mr Biswas la perdit de vue ..".

"A House for Mr Biswas" - DEUXIÈME PARTIE
Un lent et laborieux cheminement vers une forme d'autonomie ...
Le nouveau régime : L'illusion de l'indépendance
De retour à Hanuman House après le désastre de Green Vale, Biswas vit dans une dépendance humiliante. Le monde des Tulsi change : la vieille Mme Tulsi s'affaiblit, l'autorité est de plus en plus détenue par Seth, et les fils aînés partent étudier à l'étranger. Pour occuper Biswas et le sortir de son apathie, on lui trouve un emploi de conducteur de bus pour le compte de la famille. C'est un nouvel échec : il est renvoyé après un accident. Finalement, grâce à une connaissance des Tulsi, il décroche un poste de journaliste au Sentinel de Port-d'Espagne.
La Mutation des Tulsi : Naipaul montre l'évolution de la micro-société Tulsi. La vieille génération s'efface, la nouvelle s'occidentalise (études à l'étranger) sans pourtant renoncer à ses privilèges féodaux. Le "nouveau régime" est tout aussi étouffant, simplement plus moderne.
Le journalisme est la première véritable opportunité pour Biswas. Ce n'est pas un don des Tulsi, mais une chance qu'il doit saisir par son propre talent (limité) pour l'écriture. Pour la première fois, il a un métier qui lui confère une identité sociale en dehors du clan : Monsieur Biswas, le journaliste. C'est une lueur d'espoir et le début d'une émancipation financière et psychologique.
"Si solide que fût leur établissement, les Tulsi ne s’étaient jamais crus fixés à Arwacas ou même à Trinidad. Ce n’était qu’une étape du voyage commencé lorsque le pandit Tulsi avait quitté l'Inde. Seule la mort du pandit Tulsi les avait empêchés de regagner leur patrie d’origine, et depuis lors, ils avaient toujours parlé — encore que moins souvent que les vieillards réunis tous les soirs dans le passage — de partir pour l'Inde, Demerara, Surinam. Mr Biswas ne prenait pas ces propos au sérieux. Les vieilles gens ne reverraient jamais l’Inde. Et il ne pouvait s’imaginer les Tulsi ailleurs qu’à Arwacas. Séparés de leur maison et de leurs terres, ils seraient séparés des ouvriers agricoles et des amis qui les respectaient pour leur piété et en mémoire du pandit Tulsi; leur état civil hindou perdrait toute valeur et, comme il était advenu pendant leur séjour dans la maison de Port of Spain, ils seraient simplement exotiques.
Mais, lorsque Shama se précipita à Arwacas pour faire part des propos blasphématoires de Seth, elle trouva Hanuman House en l’air. Les Tulsi avaient décidé d’émigrer. On abandonnerait la maison de briques et chacun ne parlait que du nouveau domaine de Shorthills, au nord-est de Port of Spain, parmi les montagnes de la Northern Range.
La Grand-Rue était animée et brillante comme toujours à la saison de Noël, bien qu’en raison de la guerre il y eût pénurie d'objets importés, dans les magasins. Au Bazar Tulsi, point d'articles de Noël hormis les antiques poupées noires, ni décorations à part les panneaux publicitaires fanés, écaillés, de Mr Biswas. Plusieurs rayons étaient vides. Tout ce qui pourrait servir à Shorthills avait été emballé.
Et les nouvelles données par Shama sentaient le rance. Le différend entre Seth et le reste de la famille avait déjà tourné à la guerre ouverte. Avec sa femme et ses enfants, il avait quitté Hanuman House et habitait une rue écartée, non loin de là. Ils ne s’associaient pas au transfèrement à Shorthills. Les causes de la querelle restaient obscures, chaque camp accusant l’autre d’ingratitude et de trahison, et Seth invectivant Shekhar en particulier.
Mrs Tulsi et Shekhar s’abstenaient de toute déclaration. En outre, Shekhar se montrait rarement à Arwacas et c’étaient ses sœurs qui entretenaient la querelle. Elles avaient interdit à leurs enfants de parler aux enfants de Seth; Seth avait interdit à ses enfants de parler aux enfants Tulsi. Seule Padma, la femme de Seth, était bien accueillie à Hanuman House, en tant que sœur de Mrs Tulsi; on ne pouvait lui faire grief de son mariage et son âge lui donnait droit au respect. Depuis la brouille, elle avait fait une seule visite clandestine à Hanuman House. Les sœurs considéraient son loyalisme comme un hommage à la justesse de leur cause; le fait qu’elle eût dû venir en cachette attestait la brutalité de Seth.
Vint la saison de la moisson et les champs de canne à sucre, privés d’un surveillant général, furent à la merci de ceux qui cherchaient noise aux Tulsi. Deux incendies avaient déjà été déclenchés et le bruit courait que Seth fomentait de nouveaux troubles, en revendiquant pour siennes des propriétés Tulsi. Les maris de certaines sœurs avaient reçu des menaces. Pourtant on parlait moins de Seth que du nouveau domaine. Shama entendait sans cesse énumérer ses gloires. Les jardins de la maison domaniale comprenaient un terrain de cricket et une piscine; des orangers, des palmiers gri-gri aux fûts blancs élancés, aux baies rouges et aux feuilles vert foncé bordaient Pallée carrossière. La terre elle-même tenait du miracle. Les samans avaient des lianes si fortes et souples que l’on pouvait se balancer dessus. Toute la journée, les plants d’immortelles égrenaient leurs fleurs rouges et jaunes en forme d’oiseau, au travers desquelles on pouvait siffler, comme un oiseau. Les cacaoyers poussaient à l'ombre des immortelles, le café à l’ombre du cacao, et les fèves de tonka recouvraient les collines. Arbres fruitiers, manguiers, orangers, avocatiers foisonnaient au point de sembler sauvages. Et il y avait des muscadiers ainsi que des cèdres, du pour, et le bois-canot si léger mais si élastique et résistant qu’il fournit de meilleurs battes de cricket que le saule. Les sœurs parlaient des collines, des sources d’eau douce, des cascades cachées, avec toute l’excitation de personnes qui n’ont connu que la plaine brûlante, découverte, les arpents plats de Ja canne à sucre et les boueuses rizières. Même si l’on ne savait pas tirer parti de la terre aussi bien qu’elles, et si l’on ne faisait rien, la vie pouvait être riche à Shorthills. Il fut question d’exploitation laitière; il fut question de cultiver le pamplemousse. Surtout, il fut question d’élever des moutons et l’on agita le projet idyllique de donner en propre un mouton à chaque enfant, ce qui serait — présenté sous cet angle — le point de départ d’une fortune fabuleuse. Et il y avait des chevaux dans le domaine. Les enfants apprendraient à monter. Bien que par la suite on ne s’expliquât jamais avec clarté la soudaineté de cette grande décision, ni pourquoi le dernier effort collectif des Tulsi s’était concentré sur ce déracinement, Shama partit pour Port of Spain, pleine d’enthousiasme. Elle voulait s'intégrer de nouveau à la famille, prendre sa part de l’aventure..."
L'aventure de Shorthills : Le dernier asservissement
Les Tulsi, en pleine décadence, décident de vendre Hanuman House et d'acheter une immense propriété délabrée à Shorthills. Toute la famille déménage et est contrainte de participer à un projet fou : transformer la propriété en ferme viable. Biswas et sa famille sont embarqués dans cette aventure. Il est forcé de participer aux travaux exténuants et absurdes (comme abattre des arbres immenses à la hache), tout en faisant la navette avec son travail à Port-d'Espagne. Cette période est l'une des plus éprouvantes physiquement et moralement.
Shorthills représente l'apogée de l'exploitation de Biswas par les Tulsi. On exige de lui un travail physique pour lequel il est totalement inadapté, au mépris de son emploi de col blanc qui devrait pourtant le valoriser. C'est la négation de son identité naissante de journaliste.
Satire du Projet Post-Colonial : Le projet de Shorthills est une métaphore grotesque des rêves de développement post-coloniaux : ambitieux, mal planifiés, basés sur une vision romantique et erronée de la terre, et finalement voués à l'échec. Naipaul ridiculise cette entreprise qui épuise tout le monde pour aucun résultat.
Parmi les liseurs et les bûcheurs : La fracture définitive
Cette section consacre la fracture intellectuelle et sociale entre Biswas et les Tulsi. Son travail de journaliste, son accès à la culture (les "liseurs") le distinguent des autres membres de la famille, perçus comme des "bûcheurs" (travailleurs manuels) même s'ils ne le sont plus vraiment. Il se sent supérieur mais est toujours logé et nourri par eux, ce qui crée un conflit intérieur permanent. Les tensions avec la famille, surtout avec Owad, le fils préféré de Mme Tulsi revenu d'Angleterre avec des idées méprisantes, deviennent insupportables.
L'Identité par la Culture : Biswas trouve enfin une forme d'émancipation non pas économique, mais culturelle. La lecture et l'écriture sont ses armes. Elles lui permettent de se construire un monde intérieur inaccessible aux Tulsi et de se définir en opposition à eux.
Le Complexe Colonial : Le personnage d'Owad est crucial. Revenu d'Angleterre, il méprise tout ce qui est local et indigène, y compris Biswas. Naipaul montre ici les effets pervers du colonialisme : l'admiration des colonisés pour le colonisateur et le mépris de soi qui en découle. Biswas hait Owad mais envie secrètement son assurance et son éducation anglaise.
"... C'était en ce temps-là, pour les hommes, la mode de paraître aux réunions sportives, en tenant dans une main un étui de fer-blanc rond qui contenait cinquante cigarettes anglaises, et une simple boîte d’allumettes, l’index pressé sur la boîte d’allumettes qui sommait l’étui. Mr Biswas possédait les allumettes; Il dépensa l’allocation de subsistance d’une demi-journée pour acheter les cigarettes. Afin de ne pas déranger la ligne de son veston, il se rendit à bicyclette à l’Oval, l’étui à la main.
Tandis qu’il avançait dans Tragarete Road, il perçut de faibles applaudissements dispersés. C’était juste avant l’heure du déjeuner — trop tôt pour les foules. C’eût été préférable d’arriver après le thé. Néanmoins, il fit le tour des tribunes de l’Oval, appuya sa bicyclette contre la clôture de tôle ondulée écaillée, l’enchaîna, ôta les pinces de son pantalon au pli impeccable qu’il rabattit, le défripa, redressa la veste correctement sur ses épaules. Il n’y avait pas de file d’attente. Il paya son billet un dollar et, son étui à cigarettes et sa boîte d’allumettes à la main, monta les marches de la tribune, dont un quart seulement était occupé.
La plupart des gens étaient assis sur le devant. Il repéra un siège vide, au milieu d’une des rares rangées garnies. « Pardon », dit-il, et il se mit en devoir d’avancer lentement; les gens se levaient devant lui, les gens se levaient dans les rangées de derrière, les gens se rasseyaient dans son sillage, et il continuait à répéter « Pardon », très affable, inconscient du dérangement. Enfin il gagna son siège, l’épousseta avec son mouchoir, et se pencha légèrement ..."
Le vide & La Révolution : La libération
"Le Vide" décrit une période de dépression profonde de Biswas, liée à la fatigue, au dégoût de sa vie et à un sentiment d'impasse totale. "La Révolution" est le point de rupture. Après une altercation violente et définitive avec Owad, Biswas quitte Shorthills pour de bon. Il s'installe dans une chambre meublée à Port-d'Espagne avec ses deux plus jeunes enfants, laissant Shama et les aînés chez les Tulsi. Pour la première fois, il vit seul, indépendant, et assume pleinement son rôle de père.
La Décision Salvatrice : Ce départ n'est pas un échec, mais une révolution personnelle. C'est un acte courageux de rupture définitive avec le système Tulsi. Il préfère la pauvreté et la solitude dans une chambre sordide à la sécurité humiliante du clan.
La Paternité : Dans cette nouvelle vie, sa relation avec ses enfants, en particulier sa fille Anand, devient centrale. Il transmet ses aspirations et sa soif de culture, espérant pour eux un avenir meilleur qu'il n'a eu.
"... Le lundi soir, Mr Biswas prit sa décision finale. Le jeudi, la maison l’attendait. Tard dans l’après-midi du jeudi, ils se rendirent à Sikkim Street dans la Prefect. Le soleil tapait dur sur la maison et laissait des bandes éblouissantes sur l’escalier à découvert. Seule la cuisine échappait à ses rayons; partout ailleurs, malgré les treillis et les fenêtres ouvertes, l’atmosphère était asphyxiante, une concentration de chaleur et de lumière qui blessa leurs yeux et les fit suer.
Sans rideaux, vide à part le lot de fauteuils morris, avec le parquet brûlant qui ne reluisait plus, le soleil qui n’éclairait que des souillures, des éraflures et des traces de pas poussiéreux, la maison semblait plus petite que les enfants ne se la rappelaient, et privée de l’ambiance douillette qu’ils avaient remarquée le soir, sous les lumières voilées, avec les épais rideaux qui excluaient le reste du monde. À présent, dépourvues de rideaux, les grandes cloisons treillissées ne défendaient plus la maison contre la lueur verte de l’arbre à pain d’à côté, l’épaisse vigne vierge, couleur de cœur saignant qui se vrillait sur la clôture vermoulue, le voisinage des taudis en ruines, les bruits de la rue ..."
La maison : La victoire paradoxale
Enfin stable dans son travail, Biswas rêve toujours de sa maison. Il repère une annonce pour une maison à vendre à Sikkim Street. La maison est petite, mal construite, biscornue, et située dans un quartier peu prestigieux. Elle est loin du rêve. De plus, l'agent immobilier est véreux, le prix est exorbitant et les dettes seront écrasantes. Poussé par la peur de voir Shama et les enfants lui échapper et retourner définitivement chez les Tulsi, il signe, s'endettant pour les 30 années à venir.
Un Symbole Ambigu : La maison de Sikkim Street est l'antithèse de la maison rêvée. C'est le symbole de toutes les contradictions de la quête de Biswas :
- Elle représente son indépendance (il en est le propriétaire légal).
- Elle est le fruit de son travail et de sa persévérance.
- Mais elle est aussi laide, chère et défectueuse (les portes coincent, les murs fissurent).
- Elle est acquise par crainte (de perdre sa famille) plus que par enthousiasme.
- Elle le rend esclave d'une hypothèque pour le reste de sa vie.
C'est une victoire profondément ambivalente. Biswas a gagné son combat contre le destin et les Tulsi, mais au prix d'un asservissement à un autre maître : la dette. Naipaul conclut sur cette note profondément ironique et humaine. La maison n'apporte pas le bonheur magique, mais elle offre quelque chose de plus précieux : la dignité d'être chez soi. La fin du livre, où Biswas meurt dans "sa" maison, entouré des siens, est triste mais apaisée. Il a gagné ..
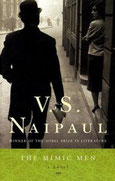
"The Mimic Men" (1967, Les Hommes de paille)
Un roman jugé comme l'une des oeuvres de V.S. Napaul les plus riches après "Une maison pour M. Biswas". Il reprend une situation déjà évoquée et dénoncée, sur un ton plus léger, dans "Le Masseur mystique", mais cette fois c'est une carrière individuelle, caractérisée par le mimétisme qui pousse l'ancien colonisé à imiter ses maîtres de naguère, et devient le symbole du comportement décevant de toute une génération : celle qui a bénéficié de la chance historique de vivre l'avènement de son pays à l'indépendance politique et de mettre la main sur quelques fragments du pouvoir abandonné par la métropole.
Le héros est un Indien de haute caste, Ralph Kripal Singh, qui manque moins d'éducation que de volonté, moins d'initiative que de but cohérent, de persévérance que d`honnêteté. Il évoque ses souvenirs d`enfance, ses études en Angleterre, son retour au pays après l'indépendance et son exil définitif. Singh, de manière significative, n'a pas réussi à s'insérer dans le contexte pluri-ethnique de son île, sa nouvelle nation. Il se perçoit sous les traits d`un étranger et se considère comme une sorte d`exilé dans un pays du Tiers-Monde, loin de la chère Angleterre de Shakespeare et de Dickens, des hivers enneigés et des jonquilles, qu'il a découverte dans ses lectures...
S'évadant dans un monde fantastique où il cherche sa gratification de manière infantile, le citoyen du Tiers-Monde court au désastre. Tandis que les membres de la classe moyenne se réfugient dans les signes matérialistes de leur statut économique et dans un rituel social imitant celui des cercles coloniaux, le peuple s'évade grâce à l`opium de la religion, ou bien substitue à la lutte des classes les clivages des races et des groupes ethniques dans un particularisme exacerbé par la quête de boucs émissaires.
Le récit est fait par le protagoniste lui-même, sous forme d'évocation de ses souvenirs, et s`il se trouve soumis à une critique, celle-ci reste implicite. Mais la narration n'est pas linéaire et un va-et-vient plein d'hésitations semble seul commander l'ordre de ces fragments, de ces bribes décousues de vie qui refont surface. Le contraste semble un principe unificateur plus que la continuité logique, soulignant ainsi le manque de plan de cette existence et l`exil vis-à-vis de soi-même qui mutile à jamais ce "réfugié" loin de ses racines. Naipaul met en scène le caractère doux-amer de l'existence de l'ancíen colonisé dans le "Londres des Noirs" et le perpétuel déplacement de ceux qui croient, à tort, s`y trouver un jour acceptés. (Trad. Bourgois, 1991).
"The Mimicry of Power" (Chapitre 5) - "The sanctions my mother had invoked on the docks were not important. We were a haphazard, disordered and mixed society in which there could be nothing like damaging exclusion; and before the end of that first fortnight we had found ourselves attached to theneutral, fluid group which was to remain ours for the next five or six years. The men were professional, young, mainly Indian, with a couple of local whites and coloured; they had all studied abroad and married abroad; on Isabella they were linked less by their background and professional standing than by their expatriate and fantastically cosmopolitan wives or girl friends. Americans, singly and in pairs, were an added element. It was a group to whom the island was a setting; its activities and interests were no more than they seemed.
There were no complicating loyalties or depths; for everyone the past had been cut away. In that fortnight we got to know as much about the group as there was to know; all that followed was repetition and ageing. But at the beginning we were dazzled. We had come to the island expecting the meanness and constriction of island life; we were dazzled, as by the sunlight itself, by the freedom which everyone who welcomed us proclaimed by his behaviour. The clothes! So light, so fresh, so prodigally changed! We were dazzled to be among the rich, to be considered of their number; and to get, from this, the conviction that in such a setting a com parable wealth would soon be ours as well. Austerity and prudence were forgotten. In that fortnight we spent! We gave as much as we received. We consumed quantities of champagne and caviar. It was part of the simplicity of our group; we loved champagne and caviar for the sake of the words alone..."
Retour de Ralph Singh, le narrateur et protagoniste, sur sa brève carrière politique sur l’île fictive d’Isabella, une ancienne colonie britannique : issu de la classe aisée d'Isabella, il s'est engagé en politique dans l'espoir de transformer son île natale t se voyait alors comme un acteur du progrès et de la modernité. Mais rapidement confronté à la réalité d’une société coloniale marquée par le népotisme, la division raciale, et l'absence d’une véritable souveraineté, Singh réalise que son engagement politique n’est qu’un exercice de "mimétisme". Les dirigeants locaux, y compris lui-même, imitent les structures de pouvoir des anciens colonisateurs sans en comprendre pleinement la signification. Le chapitre incarne le concept central du roman : le mimétisme des structures coloniales par les élites post-coloniales. Singh et ses collègues imitent les institutions britanniques sans véritable compréhension ni contrôle, ce qui conduit à un parfait simulacre de pouvoir. Ces sociétés, ne sont devenues indépendantes qu'en théorie, et restent piégées dans des systèmes imposés par leurs anciens maîtres...

Naipaul décrit une communauté d'expatriés et de professionnels déracinés, formant une micro-société sans racines profondes ni hiérarchie établie (« haphazard, disordered and mixed » / « improvisée, désordonnée et mélangée »). C'est une conséquence directe du colonialisme et de la mondialisation...
Le groupe vit à la surface des choses. L'île n'est qu'un « décor », leurs intérêts sont superficiels (« no more than they seemed ») et leur lien est artificiel, basé sur le statut et le cosmopolitisme de façade de leurs femmes. Leur vie est une performance.
Le cosmopolitisme comme valeur et artifice : Ils se définissent par leur « cosmopolitisme », mais celui-ci se réduit à des signes extérieurs de richesse et de culture : champagne, caviar, préférences spécifiques pour certaines marques. Naipaul pointe l'ironie avec une froide précision : « we loved champagne and caviar for the sake of the words alone » (« nous aimions le champagne et le caviar rien que pour le son des mots eux-mêmes »).
Le contraste avec le passé : Le narrateur oppose violemment cette nouvelle vie « éblouissante » à la grisaille et à l'« angoisse » de son passé londonien, décrit avec une accumulation de détails sordides et étouffants (« mean rooms », « shut door », « tarnished ceiling »...). Cette libération est d'autant plus intense qu'elle contraste avec une période de privation.
Un observateur froid et ironique qui se moque gentiment de sa propre naïveté (« we were dazzled ») et surtout de la vulgarité et de la prétention du groupe, incarnée par le personnage de Sandra, « issue si sincèrement de sa vulgarité » (« Sprung so sincerely from her commonness »). Il admire et méprise cette liberté factice en même temps ....
" ... The sanctions my mother had invoked on the docks were not important. We were a haphazard, disordered and mixed society in which there could be nothing like damaging exclusion; and before the end of that first fortnight we had found ourselves attached to the neutral, fluid group which was to remain ours for the next five or six years. The men were professional, young, mainly Indian, with a couple of local whites and coloured; they had all studied abroad and married abroad; on Isabella they were linked less by their background and professional standing than by their expatriate and fantastically cosmopolitan wives or girl friends. Americans, singly and in pairs, were an added element. It was a group to whom the island was a setting; its activities and interests were no more than they seemed. There were no complicating loyalties or depths; for everyone the past had been cut away. In that fortnight we got to know as much about the group as there was to know; all that followed was repetition and ageing. But at the beginning we were dazzled. We had come to the island expecting the meanness and constriction of island life; we were dazzled, as by the sunlight
"« Les sanctions que ma mère avait invoquées sur les docks n'avaient aucune importance. Nous formions une société improvisée, désordonnée et mélangée, où il ne pouvait rien exister de tel qu'une exclusion dommageable ; et avant la fin de ces deux premières semaines, nous nous étions retrouvés attachés au groupe neutre et fluide qui allait rester le nôtre pour les cinq ou six années à venir. Les hommes étaient des professionnels, jeunes, principalement indiens, avec quelques blancs et métis locaux ; ils avaient tous étudié à l'étranger et s'étaient mariés à l'étranger ; sur l'île d'Isabella, ils étaient liés moins par leur origine et leur statut professionnel que par leurs épouses ou petites amies expatriées et fantastiquement cosmopolites. Les Américaines, seules ou en couple, étaient un élément supplémentaire. C'était un groupe pour qui l'île n'était qu'un décor ; ses activités et ses centres d'intérêt n'étaient rien de plus que ce qu'ils paraissaient être. Il n'y avait ni loyautés complexes ni profondeurs ; pour chacun, le passé avait été tranché. En quinze jours, nous avions appris tout ce qu'il y avait à savoir sur le groupe ; tout ce qui suivit ne fut que répétition et vieillissement. Mais au début, nous étions éblouis.
itself, by the freedom which everyone who welcomed us proclaimed by his behaviour. The clothes! So light, so fresh, so prodigally changed! We were dazzled to be among the rich, to be considered of their number; and to get, from this, the conviction that in such a setting a com parable wealth would soon be ours as well. Austerity and prudence were forgotten. In that fortnight we spent! We gave as much as we received. We consumed quantities of champagne and caviar. It was part of the simplicity of our group; we loved champagne and caviar for the sake of the words alone. And after the anguish of London, after the mean rooms, the shut door, the tight window, the tarnished ceiling, the over-used curtains, after the rigged shilling-in-the-slot gas and electric meters, the dreary journeys through terraces of brick, the life reduced to insipidity, I felt revived. And even before the fortnight was out Sandra could be heard disdaining demisec and expressing a preference for Mercier above all others. The splendid girl! Sprung so sincerely from her commonness!
It was our happiest fortnight; she was at her most avid and most appreciative. We celebrated our unexpected freedom; we celebrated the island and our knowledge, already growing ambiguous, of the world beyond; we celebrated our cosmopolitanism, which had more meaning here than it ever had in the halls of the British Council..."
Nous étions arrivés sur l'île en anticipant la mesquinerie et l'étroitesse de la vie insulaire ; nous étions éblouis, comme par la lumière du soleil elle-même, par la liberté que tous ceux qui nous accueillirent proclamèrent par leur comportement. Les vêtements ! Si légers, si frais, changés avec une telle prodigalité ! Nous étions éblouis d'être parmi les riches, d'être considérés comme des leurs ; et d'en tirer la conviction que dans un tel cadre, une richesse comparable serait bientôt aussi la nôtre. Austérité et prudence furent oubliées. En ces deux semaines, nous avons dépensé ! Nous avons donné autant que nous avons reçu. Nous avons consommé des quantités de champagne et de caviar. C'était partie intégrante de la simplicité de notre groupe ; nous aimions le champagne et le caviar rien que pour le son des mots eux-mêmes. Et après l'angoisse de Londres, après les pièces sordides, la porte close, la fenêtre hermétique, le plafond terni, les rideaux usés jusqu'à la corde, après les compteurs à gaz et à électricité trafiqués pour avaler les shillings, les mornes trajets à travers des rangées de maisons de brique, la vie réduite à l'insipidité, je me sentis revivre. Et avant même que les deux semaines ne soient écoulées, on pouvait entendre Sandra dédaigner le demisec et exprimer sa préférence pour le Mercier above all others. La splendide fille ! Issue si sincèrement de sa vulgarité !
Ce furent nos deux semaines les plus heureuses ; elle était à son plus avide et son plus reconnaissant. Nous célébrions notre liberté inattendue ; nous célébrions l'île et notre connaissance, déjà grandissante et ambiguë, du monde au-delà ; nous célébrions notre cosmopolitisme, qui avait plus de sens ici qu'il n'en avait jamais eu dans les halls du British Council....»
Celebration; and within it a great placidity. Once, longing for the world, I had wished to say goodbye to the island for good. Now, at a picnic on the hot sand of a beach reticulated with succulent-looking green vines on which grew purple flowers, or at a barbecue around an illuminated swimming-pool, it was possible without fear or longing or the feeling of being denied the world to draw out from one of our group her adolescent secret of cycle rides along a dirt road to the red hills outside her town, in a state west of the Mississippi, to see the sun set; to get from another a picture, in grey and white, of snow and Germans in Prague; and from yet another an English Midland landscape at dusk, a walk among moon daisies on the bank of a stream, an endless summer walk beside water, into a night scene, with swans; these, on the island, becoming pictures of a world now totally comprehended, of which I had ceased to feel I could form part and from which we had all managed to withdraw. I loved to contemplate this fragmented world that we had put together again; and I did so with the feeling of my own imminent extinction. I belonged to a small community which in this part of the world was doomed. We were an intermediate race, the genes passive, capable of disappearing in two generations into any of the three races of men, with perhaps only a shape of eye or flexibility of slender wrist to speak of our intrusion.
« Célébration ; et en son sein, une grande placidité. Autrefois, aspirant au monde, j'avais souhaité dire adieu à l'île pour de bon. Maintenant, lors d'un pique-nique sur le sable chaud d'une plage réticulée de vignes succulentes et vertes portant des fleurs violettes, ou lors d'un barbecue autour d'une piscine illuminée, il était possible, sans crainte ni nostalgie ni ce sentiment d'être privé du monde, de tirer de l'une de notre groupe son secret d'adolescente : des balades à vélo le long d'une route de terre vers les collines rouges à l'extérieur de sa ville, dans un état à l'ouest du Mississippi, pour voir le soleil se coucher ; d'obtenir d'une autre une image, en gris et blanc, de neige et d'Allemands à Prague ; et d'une autre encore un paysage des Midlands anglais au crépuscule, une marche parmi des marguerites sur la rive d'un ruisseau, une marche estivale interminable le long de l'eau, s'enfonçant dans une scène nocturne, avec des cygnes ; ces souvenirs, sur l'île, devenant des images d'un monde désormais totalement compris, dont j'avais cessé de sentir que je pouvais faire partie et dont nous avions tous réussi à nous retirer. J'aimais contempler ce monde fragmenté que nous avions reconstitué ; et je le faisais avec le sentiment de ma propre extinction imminente. J'appartenais à une petite communauté qui, dans cette partie du monde, était condamnée. Nous étions une race intermédiaire, aux gènes passifs, capables de disparaître en deux générations dans l'une des trois races humaines, avec peut-être seulement une forme d'œil ou une flexibilité de poignet mince pour témoigner de notre intrusion. »
Le « monde » n'est plus un lieu à conquérir, mais un musée de souvenirs que l'on partage. Les expériences des autres (le Mississippi, Prague, les Midlands anglais) sont réduites à de simples « images » esthétiques, des tableaux (« pictures ») que l'on contemple. Ils sont « totalement compris » précisément parce qu'ils sont mis à distance, transformés en art. Le groupe a « réussi à se retirer » de ce monde, il en est devenu un observateur et non plus un acteur anxieux.
Naipaul utilise la métaphore brillante du « monde fragmenté que nous avions reconstitué ». La communauté d'expatriés et de déracinés a créé son propre microcosme en rassemblant les morceaux épars de leurs passés et cultures divers. Cette nouvelle entité, bien que factice, offre un sentiment d'appartenance.
Le Sentiment d'Extinction : C'est le cœur tragique du passage. Cette placidité et cette célébration sont teintées par la conscience aiguë de leur propre disparition prochaine. Le narrateur contemple cette beauté avec le sentiment de son « extinction imminente ». Cela n'est pas seulement personnel, mais communautaire.
La « Race Intermédiaire » : Une communauté condamnée : Naipaul livre ici une réflexion anthropologique et profondément pessimiste sur l'identité post-coloniale. Sa communauté (sans doute les descendants d'indiens immigrés dans les Caraïbes) est décrite comme :
- « Intermédiaire » : Elle ne appartient ni au monde indien, ni au monde européen, ni au monde africain.
- « Aux gènes passifs » : Son identité n'est pas forte ou assertive ; elle est vouée à être absorbée, diluée.
- « Capable de disparaître en deux générations » : Son existence est éphémère, un simple moment de transition dans l'histoire.
Seules des traces infimes (« une forme d'œil », « une flexibilité de poignet ») témoigneront de leur brève existence...
"My mother’s sanctions were a pretence, no doubt; but they were also an act of piety towards the past, towards ancient unknown wanderings in another continent. It was a piety I shared. But what release to be the last of one’s line! Consider this as an underlying mood, occasionally coming to the surface in an alcoholic haze when, the music from bands or record-players grown distant, I considered our group as though for the first time, and Sandra and myself within it. It was a mood never examined beyond this point, never revealed. It was the mood of my placidity, the mood of my new life of activity. Within me, with that very placidity, with that departure from London and that total acceptance of a new, ready-made way of life, I felt that I had changed. I recognized that the change was involuntary, so that at last my ‘character’ became not what others took it to be butsomething personal and ordained. This placidity, at the heart of celebration, I felt to be my strength; I visualized it as existing within a walled, impregnable field. I lived neutrally; activity was real, but it was all on the surface; I felt I would never allow myself to be damaged again.
« Les sanctions de ma mère étaient une feinte, sans doute ; mais elles étaient aussi un acte de piété envers le passé, envers d'anciennes errances inconnues sur un autre continent. C'était une piété que je partageais. Mais quelle libération que d'être le dernier de sa lignée ! Considérez ceci comme une humeur sous-jacente, remontant occasionnellement à la surface dans un brouillard alcoolisé lorsque, la musique des groupes ou des électrophones devenue lointaine, je considérais notre groupe comme pour la première fois, et Sandra et moi-même en son sein. C'était une humeur jamais examinée au-delà de ce point, jamais révélée. C'était l'humeur de ma placidité, l'humeur de ma nouvelle vie d'activité. En moi, avec cette même placidité, avec ce départ de Londres et cette acceptation totale d'un nouveau mode de vie tout fait, je sentais que j'avais changé. Je reconnaissais que le changement était involontaire, de sorte qu'enfin mon "caractère" devint non pas ce que les autres croyaient qu'il était, mais quelque chose de personnel et d'ordonné. Cette placidité, au cœur de la célébration, je la sentais être ma force ; je la visualisais comme existant à l'intérieur d'un champ clos, imprenable. Je vivais de manière neutre ; l'activité était réelle, mais tout était à la surface ; je sentais que je ne me laisserais plus jamais blesser. »
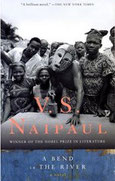
"A Bend of the River" (A la courbe du fleuve, 1979)
"In a Free State" " (1971), "A Bend of the River" et "The Enigma of Arrival" (1987), avec leur ton sombre et grave, une sagesse mélancolique, trois romans parmi les plus réussis de V.S. Naipaul, et de ces trois, "A Bend in the River" est peut-être le meilleur...
"À la courbe du fleuve" a pour base factuelle un article de Naipaul sur le président zaïrois Mobutu "Un nouveau roi pour le Congo" (1975), de même que la trame de son roman "Guerilleros" reposait sur son article sur "Les Tueries à Trinidad".
Le narrateur, que des générations de résidence ont peu à peu africanisé, est un musulman d'origine indienne. Salim nourrit peu d'illusions, mais un certain fatalisme qui s'accompagne chez lui d'une véritable admiration pour l'homme fort, ce qui lui permet de retracer sans la condamner l'ascension du Grand Homme, "the Big Man" président de cet Etat sans nom (le Zaïre, à noter une scène étonnante où le président – clairement une version de Mobutu – parle à la radio), qui va forger son propre mythe très "Afrique noire" avec l'aide d'un historien blanc dont la femme entretient une liaison passionnée avec Salim...
Celui-ci quitte la côte Est et refuse la prison d'un mariage bourgeois pour s'aventurer à l'intérieur du continent, ce véritable "cœur des ténèbres" conradien qu'est d'abord pour lui la boucle du fleuve où il a acquis sans l'avoir vue une vieille boutique. Les Européens sont pour la plupart déjà tous partis et il se retrouve donc en territoire inconnu et dangereux. Parmi ses clients, une femme des tribus qui visite son magasin et vend des amulettes et des potions; un vieux prêtre belge collectionneur de masques et de sculptures africaines; des entrepreneurs en plein essor, dont un compatriote indien qui ouvre un fast-food en ville sous l'enseigne de Bigburger; mais aussi la marchande Zabeth et son fils Ferdinand : il devient le protégé de Salim, l'envoie à l'école et observera sa transformation d'un moins que rien en un gouverneur et administrateur politiquement engagé...
Dans un contexte si hautement politisé et qui appelle la critique, la présence du fleuve Congo, véritable personnage, transforme pourtant ce qui débute comme un pamphlet virulent contre les échecs du Tiers-Monde en un projet devenu esthétique.
Dans ce qu'on nomme doctement l'intertextualité d'un subtil dialogue avec Conrad, des questions essentielles viennent à être posées : reconnaissance des normes de la civilisation et de leur écroulement, définition de la "sauvagerie". Les gens de la forêt massacrent le père Huismans, un Européen, et plantent sa tête au bout d'un piquet.
Cette vision des choses selon laquelle l`Afrique révèle la sauvagerie tapie dans l'être humain n`a pas manqué de passer pour complice du néo-colonialisme.
Certes, Naipaul dénonce le Grand Homme et il hésite à présenter en Ferdinand un nouveau héros pour l'Afrique, mais en laissant le Grand Homme à l'arrière-plan, il parvient à ne pas remettre en question la légitimité de ses principes libérateurs et révolutionnaires. Le statut de réfugié de Salim permet aussi d'explorer le thème de l'exil. En outre, l'opposition entre le village et la brousse, devenue quasi archétypique, structure le roman : une lutte continuelle se déroule entre l'invasion destructrice de la végétation, le retour de la forêt vierge (domaine des rebelles) et les réalisations précaires de la modernité.
L'intrigue du roman exploite de même la notion de temps, temps de la durée lente contre temps fragmenté du "développement" , comme si l'Afrique possédait sa propre temporalité, naturelle et lente, et que les lndépendances ont suscité un tourbillon de destructions et de reconstructions qui coupe le continent actuel de sa mémoire, de l`Histoire ancestrale. Si Naipaul refuse de glorifier les nations décolonisées, la critique caustique de leurs faiblesses et des excès sanglants de leurs dirigeants se veut positive (Trad. Albin Michel, 1982).
Dans un chapitre emblématique, "The Domain" (Chapitre 3, selon l'édition), Salim, le narrateur, un marchand d'origine indienne s’installe dans une ville sans nom au bord d’un grand fleuve africain pour échapper à la stagnation économique de sa région d'origine. "The Domain", centre culturel et éducatif, une création de l’État post-colonial, est présenté comme un centre de modernité et de progrès, censé représenter l’avenir de l’Afrique indépendante. Il est dirigé par Raymond, un intellectuel européen respecté, et sa femme, Yvette. Salim commence à fréquenter cet espace, attiré par son apparence cosmopolite et ses promesses de renouveau. Raymond, historien et conseiller du "Grand Homme" (le président dictatorial du pays), incarne l’élite intellectuelle qui justifie les politiques autoritaires sous couvert d’idéalisme. Il est à la fois admiré et méprisé par les locaux, et son rôle soulève des questions sur la légitimité des élites dans le contexte post-colonial. Salim est fasciné mais également sceptique quant aux idées de Raymond, qui semblent déconnectées de la réalité africaine. Il développe une relation ambivalente avec Yvette, la femme de Raymond, une liaison, marquée par des tensions sexuelles et émotionnelles, alors que Salim ne sait comment trouver sa place dans un monde en transition. D'autant que "The Domain", tant vanté comme un symbole de progrès, devient un projet qui se fragilise sous la dépendance du pouvoir capricieux du "Grand Homme". Salim ne peut qu'observer la corruption, l’instabilité, et la désintégration sous-jacente à cette façade de modernité...
"If you look at a column of ants on the march you will see that there are some who are stragglers or have lost their way. The column has no time for them; it goes on. Sometimes the stragglers die. But even this has no effect on the column. There is a little disturbance around the corpse, which is eventually carried off—and then it appears so light. And all the time the great busyness continues, and that apparent sociability, that rite of meeting and greeting which ants travelling in opposite directions, to and from their nest, perform without fail.
So it was after the death of Father Huismans. In the old days his death would have caused anger, and people would have wanted to go out to look for his killers. But now we who remained—outsiders, but neither settlers nor visitors, just people with nowhere better to go— put our heads down and got on with our business.
The only message of his death was that we had to be careful ourselves and remember where we were. And oddly enough, by acting as we did, by putting our heads down and getting on with our work, we helped to bring about what he had prophesied for our town. He had said that our town would suffer setbacks but that they would be temporary. After each setback, the civilization of Europe would become a little more secure at the bend in the river; the town would always start up again, and would grow a little more each time. In the peace that we now had, the town wasn’t only re-established; it grew. And the rebellion and Father Huismans’s death receded fast.
We didn’t have Father Huismans’s big views. Some of us had our own clear ideas about Africans and their future. But it occurred to me that we did really share his faith in the future. Unless we believed that change was coming to our part of Africa, we couldn’t have done our business. There would have been no point. And—in spite of appearances—we also had the attitude to ourselves that he had to himself. He saw himself as part of a great historical process; he would have seen his own death as unimportant, hardly a disturbance. We felt like that too, but from a different angle.
« Si vous observez une colonne de fourmis en marche, vous verrez qu'il y en a certaines qui traînent en arrière ou qui ont perdu leur chemin. La colonne n'a pas de temps à leur accorder ; elle continue d'avancer. Parfois, les traînantes meurent. Mais même cela n'a aucun effet sur la colonne. Il se produit une petite perturbation autour du cadavre, qui finit par être emporté — et alors il paraît si léger. Et pendant tout ce temps, la grande activité continue, et cette apparente sociabilité, ce rite de rencontre et de salutation que les fourmis se déplaçant dans des directions opposées, vers et depuis leur nid, accomplissent sans faute.
Il en fut de même après la mort du Père Huismans. Autrefois, sa mort aurait provoqué la colère, et les gens auraient voulu partir à la recherche de ses meurtriers. Mais maintenant, nous qui étions restés — des étrangers, mais ni des colons ni des visiteurs, juste des gens qui n'avaient nulle part où aller d'autre — nous avons baissé la tête et nous nous sommes occupés de nos affaires.
Le seul message de sa mort était que nous devions nous-mêmes faire attention et nous souvenir de l'endroit où nous étions. Et chose étrange, en agissant comme nous l'avons fait, en baissant la tête et en nous occupant de notre travail, nous avons contribué à réaliser ce qu'il avait prophétisé pour notre ville. Il avait dit que notre ville souffrirait des revers mais qu'ils seraient temporaires. Après chaque revers, la civilisation de l'Europe deviendrait un peu plus sûre à la courbe du fleuve ; la ville redémarrerait toujours, et grandirait un peu plus à chaque fois. Dans la paix que nous connaissions alors, la ville ne fut pas seulement rétablie ; elle s'agrandit. Et la rébellion et la mort du Père Huismans s'estompèrent rapidement.
Nous n'avions pas la grande vision du Père Huismans. Certains d'entre nous avaient nos propres idées claires sur les Africains et leur avenir. Mais il m'est venu à l'esprit que nous partagions réellement sa foi en l'avenir. À moins de croire que le changement arrivait dans notre partie de l'Afrique, nous n'aurions pas pu faire nos affaires. Cela n'aurait eu aucun sens. Et — en dépit des apparences — nous avions aussi la même attitude envers nous-mêmes qu'il avait envers lui-même. Il se voyait comme faisant partie d'un grand processus historique ; il aurait considéré sa propre mort comme sans importance, à peine une perturbation. Nous nous sentions comme ça aussi, mais sous un angle différent. »
We were simple men with civilizations but without other homes.
Whenever we were allowed to, we did the complicated things we had to do, like the ants. We had the occasional comfort of reward, but in good times or bad we lived with the knowledge that we were expendable, that our labour might at any moment go to waste, that we ourselves might be smashed up; and that others would replace us. To us that was the painful part, that others would come at the better time. But we were like the ants; we kept on.
People in our position move rapidly from depression to optimism and back down again. Now we were in a period of boom. We felt the new ruling intelligence—and energy—from the capital; there was a lot of copper money around; and these two things—order and money— were enough to give us confidence. A little of that went a long way with us. It released our energy; and energy, rather than quickness or great capital, was what we possessed.
All kinds of projects were started. Various government departments came to life again; and the town at last became a place that could be made to work. We already had the steamer service; now the airfield was recommissioned and extended, to take the jets from the capital (and to fly in soldiers). The cités filled up, and new ones were built, though nothing that was done could cope with the movement of people from the villages; we never lost the squatters and campers in our central streets and squares. But there were buses now, and many more taxis. We even began to get a new telephone system. It was far too elaborate for our needs, but it was what the Big Man in the capital wanted for us.
The growth of the population could be gauged by the growth of the rubbish heaps in the cités. They didn’t burn their rubbish in oil drums, as we did; they just threw it out on the broken streets—that sifted, ashy African rubbish. Those mounds of rubbish, though constantly flattened by rain, grew month by month into increasingly solid little hills, and the hills literally became as high as the box-like concrete houses of the cités.
Nobody wanted to move that rubbish. But the taxis stank of disinfectant; the officials of our health department were fierce about taxis. And for this reason. In the colonial days public vehicles had by law to be disinfected once a year by the health department ..."
« Nous étions des hommes simples, dotés de civilisations mais sans autres foyers.
Chaque fois qu'on nous en laissait la possibilité, nous faisions les choses complexes que nous avions à faire, comme les fourmis. Nous avions le réconfort occasionnel de la récompense, mais par les bons comme par les mauvais temps, nous vivions avec la conscience que nous étions jetables, que notre labeur pourrait à tout moment être réduit à néant, que nous-mêmes pourrions être détruits ; et que d'autres nous remplaceraient. Pour nous, c'était cela la partie douloureuse, que d'autres viendraient en des temps meilleurs. Mais nous étions comme les fourmis ; nous persistions.
Les gens dans notre situation passent rapidement de la dépression à l'optimisme et redescendent tout aussi vite. Nous étions alors dans une période de boom. Nous sentions la nouvelle intelligence — et énergie — dirigeante venue de la capitale ; il y avait beaucoup d'argent [provenant du cuivre] qui circulait ; et ces deux choses — l'ordre et l'argent — suffisaient à nous donner confiance. Un peu de cela nous allait très loin. Cela libérait notre énergie ; et l'énergie, plutôt que la rapidité ou un grand capital, était ce que nous possédions.
Toutes sortes de projets furent lancés. Divers ministères gouvernementaux reprirent vie ; et la ville devint enfin un endroit que l'on pouvait faire fonctionner. Nous avions déjà le service de bateaux à vapeur ; maintenant, l'aérodrome fut remis en service et agrandi, pour accueillir les jets de la capitale (et pour y amener des soldats). Les cités se remplirent, et de nouvelles furent construites, bien que rien de ce qui était fait ne puisse faire face au mouvement des gens quittant les villages ; nous n'avons jamais perdu les squatteurs et les campeurs dans nos rues et nos places centrales. Mais il y avait des bus maintenant, et beaucoup plus de taxis. Nous avons même commencé à obtenir un nouveau système téléphonique. Il était bien trop élaboré pour nos besoins, mais c'était ce que le Grand Homme de la capitale voulait pour nous.
La croissance de la population pouvait se mesurer à la croissance des tas d'ordures dans les cités. Les gens ne brûlaient pas leurs déchets dans des fûts d'huile, comme nous le faisions ; ils les jetaient simplement sur les rues défoncées — ces déchets africains cendrés et tamisés. Ces monticules d'ordures, bien que constamment aplatis par la pluie, grossirent mois après mois pour devenir des collinettes de plus en plus solides, et les collines devinrent littéralement aussi hautes que les maisons de béton cubiques des cités.
Personne ne voulait déplacer ces ordures. Mais les taxis puaient le désinfectant ; les officiels de notre ministère de la Santé étaient intraitables envers les taxis. Et pour cette raison. À l'époque coloniale, les véhicules publics devaient par loi être désinfectés une fois par an par le service de santé... »
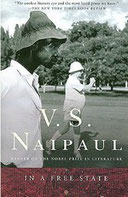
"In a Free State" (1971)
Prologue, from a Journal: The Tramp at Piraeus - ONE OUT OF MANY - TELL ME WHO TO KILL - IN A FREE STATE - Epilogue, from a Journal: The Circus at Luxo - .
De la signification et des limites de la liberté. Un recueil de deux nouvelles et un court roman (encadrés par un prologue et un épilogue en forme de journal intime) qui a remporté le Booker Prize en 1971 et ainsi consolidé la réputation de Naipaul comme un écrivain majeur. Un titre ironique, un pays africain fictif qui symbolise de nombreuses nations post-coloniales en proie à des luttes internes après l’indépendance : Naipaul critique ici la fragilité des structures politiques héritées du colonialisme. D'un côté, un président militaire et un roi rival, issus de groupes ethniques différents, affrontement pour le pouvoir et exacerbation des tensions ethniques et sociales. De l'autre, des expatriés représentant l’héritage ambigu du colonialisme et la difficulté pour les anciens colonisateurs de se réconcilier avec une réalité post-coloniale...
Dans "One Out of Many", Santosh, le narrateur et protagoniste, est un domestique travaillant pour un fonctionnaire indien dans son pays d’origine : une vie simple et sans ambition, se contentant de suivre les routines de son maître. Lorsque son maître est nommé à un poste diplomatique à Washington, D.C., Santosh décide de le suivre, séduit par l'idée d'une vie meilleure dans une ville qu’il imagine pleine de richesses et de possibilités. Mais le choc culturel est immense : il va devenir au fil du récit un étranger dans tous les sens du terme, étranger à son pays d’origine, étranger dans son nouveau pays, et étranger à lui-même...
"Tell Me Who to Kill" est raconté par un homme caribéen dont le nom n’est pas mentionné, mais qui partage une relation fusionnelle avec son jeune frère, Dayo. Celui-ci émigrera vers l'Angleterre et s'y intègrera sans le moindre problème, ce que ne parvient à faire le narrateur qui s'éloignera définitivement de son frère : sacrifice et trahison...
Dans les deux cas, la liberté ne semble possible qu'avec la perte des repères qui conféraient tant signification et sécurité au pays natal ...
Au début de "In Free State", il s’agit simplement d’un voyage en voiture à travers l’Afrique. Deux Anglais, Bobby, fonctionnaire avec un penchant pour les garçons africains, et Linda, - femme d’un fonctionnaire britannique, cynique et désabusée, exprimant un mépris à peine voilé pour l’Afrique et ses habitants -, retournent dans leur enclave après un séjour dans la capitale. Mais entre les deux, un pays dont la misère et les tensions ethniques suggèrent l’Ouganda d’Idi Amin. Tout au long de leur trajet, ils traversent des paysages africains magnifiques mais aussi des villages détruits, des checkpoints militaires, et une violence latente. Leur statut d’étrangers blancs les rend à la fois vulnérables et arrogants. Ils se sentent détachés des conflits locaux mais ne peuvent échapper à leurs implications. À un moment donné, leur voiture sera arrêtée à un poste de contrôle militaire, où ils sont confrontés à des soldats armés : une scène marquée par une tension palpable, reflétant l'instabilité et la menace constante. Toute la vieille assurance coloniale s'est effritée. Et bien qu’ils parviennent à continuer leur voyage, cet incident renforce leur sentiment de vulnérabilité et d'impuissance dans un pays qu’ils n'ont aucune chance de comprendre ...
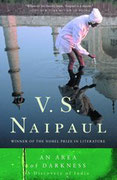
"An Area of Darkness" (1964)
Ecrit sous la forme d’un journal de voyage et basé sur le premier qu'il fit en Inde, le pays de ses ancêtres, dans les années 1960, ce livre est aussi une réflexion personnelle et une critique socioculturelle : on y retrouve toutes les tensions entre l’héritage indien de Naipaul, ses attentes, et la réalité qu’il découvre sur place. Sa plongée dans les réalités sociales et culturelles de la terre des ancêtres, - indépendante depuis peu (1947) -, villages, villes, temples, et marchés mêle fascination et dégoût. Un des chapitres emblématiques est "The Ceremony of the Train". Il est ici frappé par l’état des wagons, les foules chaotiques, et l’intensité de la vie publique qui se déroule dans cet espace clos. Le train devient un véritable microcosme de l’Inde, bruyant, surpeuplé, et lieu d'une scène récurrente : les passagers qui se préparent à effectuer leurs ablutions matinales. Un choc face à cette démonstration publique d’intimité devant laquelle il se sent à la fois étranger et lié à cette réalité, une partie de son héritage qu’il ne comprend pas totalement. Une scène qui permet également d'illustrer les inégalités et les réalités économiques qui contraignent les gens à vivre leur vie quotidienne dans des espaces publics : un symptôme, pour Naipaul, des difficultés profondes de la société indienne. Beaucoup en Inde ont perçu cette œuvre comme une caricature injuste du pays, alimentée par les préjugés de l'auteur ...
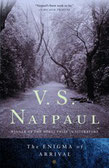
"The Enigma of Arrival" (1987)
Un roman semi-autobiographique souvent interprété comme une réflexion de Naipaul sur lui-même. Le narrateur, un écrivain d’origine caribéenne, s’installe dans un cottage situé sur un domaine rural près de Salisbury, en Angleterre : une vallée du Wiltshire, au coeur du "Wessex" de Thomas Hardy. Toute l'imagination anglaise. Il décrit son voyage et son installation dans un qui invite à la quiétude et à l'inspiration. Dès le départ, le narrateur établit un parallèle entre son arrivée et une peinture de Giorgio de Chirico intitulée "The Enigma of Arrival", qui symbolise l’idée d’un moment de transformation et d’adaptation. Le narrateur observe et décrit minutieusement les paysages de la campagne anglaise, les saisons, et les habitants du domaine rural, des descriptions, empreintes de poésie et d'émerveillement. Mais il note également les signes de déclin de cette campagne, des bâtiments en ruine, des traditions en voie de disparition, et des habitants vieillissants. Il va développer des relations discrètes avec les personnes vivant autour de lui, notamment Jack, un vieil homme qui s’occupe du jardin, et Mr. Phillips, le propriétaire du domaine, des relations qui permettent d'introduire des réflexions sur son propre parcours, de ses racines caribéennes à sa carrière d’écrivain : et notamment l’impact du colonialisme sur sa propre identité, se sentant à la fois lié et si distant de la culture britannique.
Le chapitre "Jack's Garden" est souvent considéré comme le plus emblématique de "The Enigma of Arrival", la métaphore est évidente, métaphore de la vie, de la beauté éphémère et de la lutte contre une dégradation inévitable qui emporte jusqu'aux créations les plus soigneusement conçues. La mort de Jack, le jardinier, va marquer un tournant dans le récit, plus qu'un rappel de sa propre mortalité, ce qui l’amène à réévaluer sa place dans le monde et son rôle d’écrivain...
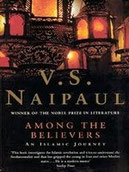
Naipaul a toujours refusé l'angélisme et le romantisme révolutionnaire. Il a osé décrire la corruption, le chaos, les échecs et les fantasmes identitaires des nations nouvellement indépendantes (en Afrique, dans les Caraïbes, en Asie). Cette franchise lui a valu beaucoup d'inimitiés, on l'a accusé de mépris et de servir le discours occidental.
Un regard sans concession et provocateur qui se prolonge dans des ouvrages tels que "Among the Believers: An Islamic Journey" (1981) et sa suite "Beyond Belief: Islamic Excursions Among the Converted Peoples" (1998) : V.S. Naipaul adopte ainsi une vision critique et souvent controversée de l'islam.
Dans "Among the Believers : An Islamic Journey" (1981), il nous donne sa vision, à travers des observations et nombre d'entretiens, de l'impact de l'islamisme et de la montée du fondamentalisme dans quatre pays musulmans non arabes. Il arrive ainsi en Iran peu après la Révolution islamique de 1979 et observe les bouleversements sociaux, politiques et religieux causés par l'établissement d'une théocratie sous l'ayatollah Khomeini. Il discute avec des Iraniens de différents milieux, enregistrant tout à la fois l'euphorie révolutionnaire et les désillusions naissantes. Le Pakistan qu'il aborde est celui du régime militaire du général Zia-ul-Haq, où la loi islamique (charia) était mise en œuvre de manière stricte. Naipaul interroge des intellectuels, des ouvriers, et des religieux, et note que l'islamisation est utilisée pour renforcer un État militaire tout en marginalisant les minorités et les femmes. En Malaisie, Naipaul tente de comprendre comment l'islam joue un rôle dans la construction de l'identité nationale du pays, à distance d'une forte minorité chinoise : il note les efforts du gouvernement pour promouvoir une forme d'islam modéré et moderne. Enfin, l'Indonésie permet à Naipaul d'explorer le lien complexe entre religion et politique dans le pays à la plus grande population musulmane au monde : il y observe la coexistence des pratiques religieuses locales avec l'islam orthodoxe importé.
En conclusion ses critiques sont particulièrement fortes :
- Naipaul considère que l'islam, en particulier dans les sociétés converties (comme celles de l'Iran, du Pakistan, de l'Indonésie ou de la Malaisie), tend à effacer les identités culturelles préexistantes : il critique ce qu'il appelle une "perte d’identité", où les traditions locales et les histoires nationales sont souvent rejetées au profit d’une culture islamique uniformisée.
- Il critique la politisation de l'islam, la manière dont l'islam est utilisé comme un outil politique dans les pays qu'il visite : il y voit la religion souvent instrumentalisée pour renforcer le pouvoir des élites ou justifier des régimes autoritaires.
- Il exprime un scepticisme quant à la compatibilité de l'islam, tel qu'il est pratiqué dans certains pays, avec les exigences de la modernité : et refus d'examiner de manière critique l'histoire et la pratique de l'islam.
- Enfin, Naipaul souligne que la montée du fondamentalisme islamique dans les années 1970 et 1980 est souvent liée à une quête identitaire dans des sociétés en crise : les tensions post-coloniales, les échecs économiques, et les inégalités sociales poussent des population à chercher refuge dans une vision idéalisée de l'islam. Un recours au fondamentalisme qu'il juge comme une réaction simpliste et dangereuse quant aux innombrables défis complexes que pose modernité. D'autant qu'il perçoit souvent l'individu dans ce contexte comme écrasé par une identité collective imposée.
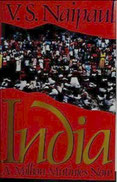
"India: A Million Mutinies Now", V.S. Naipaul (1990)
Un titre qui reflète l’idée que l’Inde est traversée par d’innombrables révoltes, grandes et petites, contre les structures traditionnelles, des "mutineries" qui ne sont pas nécessairement violentes, mais qui témoignent d’un profond besoin de changement. Des révoltes qui proviennent, de plus, de groupes et d’individus autrefois marginalisés, qui réclament leur place dans une société en transition. Naipaul retourne ainsi en Inde après une absence de plusieurs années et, contrairement à ses précédents ouvrages sur le pays, où il avait exprimé une vision sombre et désenchantée, il aborde ici l’Inde avec une ouverture accrue et une curiosité pour les transformations qui s’y opèrent. Il reconnaît ici une société en évolution, capable de surmonter ses contradictions. Une grande partie du livre est constituée de récits individuels, basés sur des entretiens avec des personnes de tous horizons, des militants politiques et religieux, des femmes, des entrepreneurs et artistes, des Dalits qui luttent pour leurs droits et leur dignité dans une société encore marquée par des hiérarchies rigides, des villes comme Bombay (Mumbai), Calcutta (Kolkata), et Madras (Chennai) ...
Naipaul a révolutionné l'écriture du voyage et du reportage. Dans des livres comme "L'Inde. Un million de révoltes" ou "Crépuscule sur l'Islam", il mêle observation méticuleuse, analyse historique et récits personnels pour créer une forme narrative hybride, à la fois profondément subjective et rigoureusement documentée. Il ne se contente pas de décrire les paysages ; il dissèque l'âme des nations....
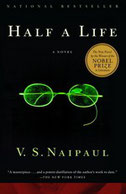
"Half a Life" (V.S. Naipaul, 2001)
Dans un récit qui emprunte le visage de Willie Chandran, un homme d’origine indienne, et qui se déplace avec une rapidité onirique de l’Inde à l’Angleterre et à l’Afrique, le lauréat du prix Nobel V. S. Naipaul a produit, peut-être, son meilleur roman à ce jour.
Le protagoniste, Willie Somerset Chandran, est né dans une famille de caste mixte en Inde. Son prénom est inspiré de Somerset Maugham, un écrivain britannique que son père admirait.
Le père de Willie, un brahmane, s'est marié à une femme d’une caste inférieure en guise de protestation contre le système des castes et les attentes sociales. Cependant, ce mariage devient une source de frustration pour les deux parents, et Willie hérite de ce ressentiment, qui se transforme, en grandissant, en véritable mépris et honte de l'héritage reçu.
Willie quitte l’Inde pour étudier à Londres. Là, il espère se réinventer et échapper à son passé. Cependant, il reste profondément marqué par son sentiment d’infériorité et son incapacité à s’intégrer pleinement dans la société britannique. À Londres, il commence à écrire des nouvelles semi-autobiographiques, influencées par sa propre histoire et son identité fragmentée. Ces récits lui permettent de trouver un semblant de reconnaissance, mais ils ne comblent pas son vide intérieur.
C'est alors l'Afrique. "The Arrival in Africa" (Deuxième partie) est sans doute la partie la emblématique de "Half a Life". Willie rencontre Ana, une femme d’origine portugaise et africaine, qui est impressionnée par ses écrits : elle vit en Afrique, où sa famille possède une plantation. Séduit et attiré par l’idée d’une nouvelle vie, Willie la suit donc en Afrique. Cependant, dès son arrivée, il se rend compte qu’il est encore plus étranger dans ce nouvel environnement. En complète dépendance vis-à-vis d’Ana, il ne travaille pas et passe ses journées à observer ce qui se passe autour de lui, ainsi la plantation autour de laquelle se tissent les relations entre les colons, les Africains locaux, et les métisses comme Ana, tout l'héritage complexe du colonialisme. Et Willie ne parvient ni à se lier aux travailleurs locaux ni à s’intégrer dans la communauté des expatriés ..
Willie aura ainsi passé ainsi une grande partie de sa vie à fuir, sa famille, son pays, ses relations, et finalement lui-même, tout en étant partagé entre plusieurs mondes, son héritage indien, la culture occidentale, et la réalité post-coloniale africaine. Si sa quête de liberté lui paraît essentielle, elle reste insaisissable ...
Après 18 ans passés en Afrique, Willie décide de quitter Ana et la plantation. Il quitte l'Afrique comme il a quitté l'Asie. Et il réalise qu’il a été incapable jusque-là de s’engager pleinement dans quoi que ce soit : son mariage, son travail, ou son identité. Débute une sorte de quête personnelle pour trouver un sens à sa vie, bien que l’issue reste très ambiguë...
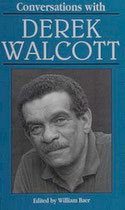
Derek Walcott (1930-2017)
Omeros (1990), Dream on Monkey Mountain (1970), In a Green Night (1962)
Derek Walcott est né à Sainte-Lucie, une petite île des Caraïbes, dans une famille créole. Son père, Warwick Walcott, était peintre et poète, mais il est décédé lorsque Derek avait un an. Sa mère, Alix, était enseignante et a encouragé son intérêt pour la littérature. Walcott a étudié à l’Université des Indes occidentales (UWI) à Kingston, en Jamaïque, où il s'est spécialisé en littérature anglaise. Dès l’âge de 14 ans, il avait publié son premier recueil de poèmes, 25 Poems (1948), grâce à un prêt de sa mère. Il s’est également investi dans le théâtre, fondant le Little Carib Theatre à Trinidad et le Trinidad Theatre Workshop en 1959. Sa réputation va grandir avec des recueils comme "In a Green Night: Poems 1948–1960" (1962) et "The Gulf" (1969), les paysages et l'histoire des Caraïbes, la quête identitaire dans un monde post-colonial.
En 1990, il publie "Omeros", une épopée moderne qui sera largement acclamée, qui lui assurera une place parmi les grands écrivains du XXe siècle. Walcott a enseigné dans plusieurs universités prestigieuses, notamment à l’Université de Boston, où il a influencé de nombreux jeunes écrivains.
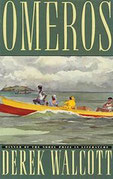
"Omeros" (1990)
Derek Walcott fut célébré pour sa capacité à transformer les paysages, les histoires et les cultures des Caraïbes en œuvres poétiques et théâtrales d’une portée universelle. C'est avec un héritage marqué par sa quête de réconciliation entre les héritages culturels multiples, qu'il s'est imposé comme une voix puissante et intemporelle dans la littérature post-coloniale.
'Omeros" est une épopée moderne inspirée d’Homère, transposée dans les Caraïbes (plus précisément sur l'île natale de l'auteur, Sainte-Lucie), mêlant histoires locales et mythes universels. Achille est ici un pêcheur descendant d’esclaves, qui représente l’homme enraciné dans les traditions et la nature. Hector, un autre pêcheur, rival d’Achille, qui aspire à une vie moderne et meilleure, mais au prix de sa rupture avec la tradition (il abandonnera la pêche pour devenir chauffeur de taxi). Helen, une jeune femme d’une beauté exceptionnelle qui travaille comme servante et provoque la rivalité entre Achille et Hector : elle symbolise à la fois une femme réelle et une métaphore des Caraïbes, désirées et disputées. Enfin, le narrateur, un alter ego de Walcott, qui voyage entre Sainte-Lucie, l’Europe et l’Amérique du Nord, réfléchissant sur son propre passé, la colonisation, et son rôle d’écrivain.
"Omeros" n’a pas une intrigue linéaire traditionnelle, mais tisse plusieurs récits entrelacés, alternant entre les Caraïbes, l’Europe, et l’Afrique. L’épopée est divisée en sept livres, chacun composé de plusieurs chapitres en vers libres. Les récits alternent entre différents personnages et lieux, mêlant mythologie et réalités historiques.
Achille et Hector se disputent pour l’amour d’Helen. Leur rivalité culmine dans un combat où Achille tue Hector. C'est un combat dépourvu de l’héroïsme épique de l’Antiquité mais ancré dans une réalité plus banale, empreinte de frustration et de désespoir. Après le meurtre, Achille entreprend un voyage introspectif en Afrique, à la recherche de ses racines ancestrales. Il découvre l’histoire de ses ancêtres esclaves et approfondit ainsi son lien avec la diaspora africaine. La mer joue un rôle central dans l’épopée, symbolisant à la fois la connexion historique entre les continents (l’esclavage transatlantique) et l’immuabilité face aux bouleversements humains.

Wilson Harris (1921-2018), "Guyana Quartet" (1962-1963)
Wilson Harris est né dans une famille créole d'origine africaine, européenne, et amérindienne. Cette diversité culturelle a profondément influencé son écriture. Il a étudié à Georgetown, la capitale de la Guyane britannique, où il s'est formé comme géomètre, une expérience menée sur les vastes territoires de la Guyane qui lui a fourni une connaissance intime de la forêt amazonienne et des paysages de son pays natal. En 1959, Harris s'installe à Londres, où il vit jusqu'à sa mort.
Bien qu'il ait quitté la Guyane, ses écrits restent profondément enracinés dans les paysages, l'histoire et les mythologies de son pays. Il a publié une vingtaine de romans, ainsi que des essais critiques et une trentaine de pièces ("Dream on Monkey Mountain", 1967), "Ti-Jean and His Brothers", 1958). Son style distinctif, souvent qualifié de mystique et expérimental, repousse les limites des genres littéraires traditionnels : ses œuvres intègrent des éléments de mythologie indigène, africaine, et occidentale, créant un univers riche et multidimensionnel. De même la forêt, les rivières, et les montagnes de la Guyane jouent un rôle central dans ses romans, souvent décrits comme des entités vivantes et spirituelles.
"Palace of the Peacock" (1960), son premier roman est aussi le plus emblématique de son œuvre : il raconte le voyage d’un groupe d’hommes à travers une rivière de la Guyane, une quête mystique marquée par des visions et des expériences transcendantales. Un roman qui inaugure son "Guyana Quartet", une série de quatre livres explorant les paysages et les mythes de la Guyane : "Palace of the Peacock", "The Far Journey of Oudin" (1961), "The Whole Armour" (1962), et "The Secret Ladder" (1963).
"A horseman appeared on the road coming at a breakneck stride. A shot rang out suddenly, near and yet far as if the wind had been stretched and torn and had started coiling and running in an instant. The horseman stiffened with a devil’s smile, and the horse reared, grinning fiendishly and snapping at the reins. The horseman gave a bow to heaven like a hanging man to his executioner, and rolled from his saddle on to the ground.
The shot had pulled me up and stifled my own heart in heaven. I started walking suddenly and approached the man on the ground. His hair lay on his forehead. Someone was watching us from the trees and bushes that clustered the side of the road. Watching me as I bent down and looked at the man whose open eyes stared at the sky through his long hanging hair. The sun blinded and ruled my living sight but the dead man’s eye remained open and obstinate and clear.
I dreamt I awoke with one dead seeing eye and one living closed eye. I put my dreaming feet on the ground in a room that oppressed me as though I stood in an operating theatre, or a maternity ward, or I felt suddenly, the glaring cell of a prisoner who had been sentenced to die. I arose with a violent giddiness and leaned on a huge rocking-chair. I remembered the first time I had entered this bare curious room; the house stood high and alone in the flat brooding countryside. I had felt the wind rocking me with the oldest uncertainty and desire in the world, the desire to govern or be governed, rule or be ruled for ever.
Someone rapped on the door of my cell and room. I started on seeing the dream-horseman, tall and spare and hardlooking as ever. “Good morning,” he growled slapping a dead leg and limb. I greeted him as one greeting one’s gaoler and ruler. And we looked through the window of the room together as though through his dead seeing material eye, rather than through my living closed spiritual eye, upon the primitive road and the savannahs dotted with sentinel trees and slowly moving animals.
His name was Donne, and it had always possessed a cruel glory for me. His wild exploits had governed my imagination from childhood. In the end he had been expelled from school.
He left me a year later to join a team of ranchers near the Brazil frontier and border country. I learnt then to fend for myself and he soon turned into a ghost, a million dreaming miles away from the sea-coast where we had lived.
“The woman still sleeping,” Donne growled, rapping on the ground hard with his leg again to rouse me from my inner contemplation and slumber.
“What woman?” I dreamed, roused to a half-waking sense of pleasure mingled with foreboding.
“Damnation,” Donne said in a fury, surveying a dozen cages in the yard, all open. The chickens spied us and they came half-running, half-flying, pecking still at each other piteously and murderously.
“Mariella,” Donne shouted. Then in a still more insistent angry voice – “Mariella.”
I followed his eyes and realized he was addressing a little shack partly hidden in a clump of trees.
Someone was emerging from the shack and out of the trees. She was barefoot and she bent forward to feed the chickens. I saw the back of her knees and the fine beautiful grain of her flesh. Donne looked at her as at a larger and equally senseless creature whom he governed and ruled like a fowl.
"Un cavalier apparut sur la route, arrivant à une allure vertigineuse. Un coup de feu retentit soudain, à la fois proche et lointain, comme si le vent avait été étiré et déchiré, se mettant à s'enrouler et à courir en un instant. Le cavalier se raidit avec un sourire diabolique, et le cheval se cabra, grimaçant sinistrement et mordillant les rênes. Le cavalier s'inclina vers le ciel comme un pendu devant son bourreau, et roula de sa selle sur le sol.
Le coup de feu m'avait arrêté net et avait étouffé mon propre cœur, le projetant au ciel. Je me mis soudain à marcher et m'approchai de l'homme à terre. Ses cheveux tombaient sur son front. Quelqu'un nous observait depuis les arbres et les buissons qui bordaient le côté de la route. Il m'observait alors que je me penchais et regardais l'homme dont les yeux ouverts fixaient le ciel à travers ses longs cheveux pendants. Le soleil aveuglait et gouvernait ma vue de vivant, mais l'œil du mort demeurait ouvert, obstiné et clair.
Je rêvai que je me réveillais avec un œil mort voyant et un œil vivant fermé. Je posai mes pieds rêveurs sur le sol d'une pièce qui m'oppressait comme si je me tenais dans une salle d'opération, ou une maternité, ou je sentis soudain, la cellule crue d'un prisonnier condamné à mort. Je me levai avec une violente sensation de vertige et m'appuyai sur un immense rocking-chair. Je me souvins de la première fois où j'étais entré dans cette pièce nue et curieuse ; la maison se dressait, haute et solitaire, dans la campagne plate et recueillie. J'avais senti le vent me bercer avec la plus ancienne incertitude et le plus ancien désir du monde, le désir de gouverner ou d'être gouverné, de diriger ou d'être dirigé pour toujours.
Quelqu'un frappa à la porte de ma cellule et de ma chambre. Je tressaillis en apercevant le cavalier de mon rêve, grand, mince et d'apparence aussi dure que jamais. « Bonjour, » grogna-t-il en tapant sur sa jambe, un membre mort. Je le saluai comme on salue son geôlier et son maître. Et nous regardâmes ensemble par la fenêtre de la chambre, comme si c'était à travers son œil matériel, mort et voyant, plutôt qu'à travers mon œil vivant, fermé et spirituel, la route primitive et les savanes parsemées d'arbres sentinelles et d'animaux se déplaçant lentement.
Il s'appelait Donne, et ce nom avait toujours eu pour moi une gloire cruelle. Ses exploits extravagants avaient gouverné mon imagination depuis l'enfance. Il avait finalement été renvoyé de l'école.
Il me quitta un an plus tard pour rejoindre une équipe d'éleveurs près de la frontière brésilienne et de la région frontalière. J'appris alors à me débrouiller seul et il se transforma bien vite en fantôme, à un million de miles rêveurs de la côte où nous avions vécu.
« La femme dort encore, » grogna Donne, frappant à nouveau le sol avec sa jambe pour me sortir de ma contemplation intérieure et de ma torpeur.
« Quelle femme ? » rêvai-je, éveillé à moitié, un sentiment de plaisir mêlé à un pressentiment.
« Bon sang, » dit Donne furieux, examinant une douzaine de cages dans la cour, toutes ouvertes. Les poules nous aperçurent et vinrent à notre rencontre, mi-courant, mi-volant, se picorant encore les unes les autres avec une pitié meurtrière.
« Mariella, » hurla Donne. Puis d'une voix plus insistante et plus colérique encore – « Mariella. »
Je suivis son regard et réalisai qu'il s'adressait à une petite baraque à moitié cachée dans un bouquet d'arbres.
Quelqu'un émergeait de la baraque et sortait des arbres. Elle était pieds nus et se pencha pour nourrir les poules. Je vis le creux de ses genoux et le grain fin et beau de sa peau. Donne la regardait comme une créature plus grande mais tout aussi insensée qu'il gouvernait et dirigeait comme une volaille..."
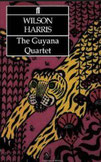
"Palace of the Peacock" (1960, Le Palais du paon)
Donne, planteur si tyrannique qu'il ne trouve personne pour travailler sous ses ordres, décide de remonter le fleuve pour engager de force des Amérindiens dispersés dans la grande forêt de l`intérieur. L`équipage comprend des représentants de chacun des groupes ethniques qui composent la Guyane. Dans ce mícrocosme se rejouent allégoriquement les haines et les divisions entretenues par l'Histoire. Les hommes découvrent bientôt qu`un autre équipage, portant les mêmes noms a péri dans les rapides. Leur réapparition provoque la consternation dans les populations environnantes. Le voyage apparaît de plus en plus comme une quête au-delà de la mort.
L`intérêt de cette œuvre réside autant dans le traitement du sujet que dans l`intrigue ; le voyage à la fois dantesque et conradien au cœur des ténèbres est empreint de connotations alchímiques et bibliques. Mariella. la muse amérindienne que Donne entraîne de force avec lui, est à la fois Marie et Béatrice. Les membres de l`expédition découvrent que l'Eldorado tant vanté par les conquistadores se trouve en eux-mêmes pour peu qu`ils acceptent de se départir de leur perception matérialiste pour acquérir un regard visionnaire. La tyrannie fait place à la compassion, l`ambition individuelle à la découverte de réseaux subtils de communauté. Le temps linéaire s'efface devant les révélations de la synchronicité. La création privilégie les développements métaphoriques, les enchaînements de paradoxes, le lecteur abandonne la logique réaliste et plonge dans un univers tourbillonnant de miroirs, de sons, de couleurs.(Trad. Belfond, 1993)
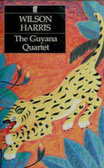
"The secret Ladder" (1963, L'échelle secrète)
Dans ce livre aux fortes connotations autobiographiques, Fenwick et ses hommes effectuent des mesures hydrologiques dans la brousse guyanaise. Rapidement leur entreprise se heurte à l'hostilité de Poséidon, vieux chef d'une communauté d'Africains, descendants des "marrons" réfugiés dans la forêt pour fuir l'esclavage. Fenwick, qui représente la science matérialíste et le "progrès" et ignore l'attachement presque métaphysique des Noirs à cette maigre terre gagnée de haute lutte, est soupçonné de préparer l'expropriation des gens de Poséidon. Progressivement, Fenwick se trouve impliqué dans une confrontation qui bouleverse sa perception du monde. Refusant la manière forte préconisée par son adjoint Jordonne, il cherche à établir une communication véritable avec les rebelles.
Ce roman allégorique, tenu pour le plus abordable de l'auteur, rejoue les drames de la conquête et ouvre sur des perspectives visionnaires. La limpidité apparente ne doit pas faire oublier le travail grâce auquel Wilson Harris creuse la langue, dynamise la perception métaphorique qui ouvre sur des perspectives pratiquement infinies. (Trad. Belfond, 1981).
