- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Svevo - Pirandello
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki
- 1930-1940
- 1930s
- Fitzgerald
- Hemingway
- Faulkner
- Koch
- Céline
- Bernanos
- Jouve
- DosPassos
- Kojève
- Miller-Nin
- Grosz - Dix
- Green
- Ortega y Gasset
- Wittgenstein
- Russell - Carnap
- Artaud
- Jaspers
- Sapir - Piaget
- Guillén
- Garcia Lorca
- Hammett
- A.Christie
- Heidegger
- Icaza
- Huxley
- Hubble
- Caldwell
- Steinbeck
- Waugh
- Blixen
- Rhys
- J.Roth - Doderer
- Aub
- Malraux-StExupéry
- DBarnes-NWest
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bataille
- Char-Michaux
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Bloch
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Lewin - Mayo - Maslow
- Montherlant
- Buzzati - Pavese
- Vittorini
- Fallada
- Malaparte
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Welty
- Boulgakov
- Tamiki - Yôkô
- Weil
- Gadda
- Broch
- Steeman
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Ellison
- Bergman
- Baldwin
- Fromm
- Bradbury - A.C.Clarke
- Tennessee Williams
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Carpentier
- Mishima
- Salinger - Styron
- Pasternak
- Asturias
- O'Connor
- Hoffer
- Matute - MartinGaite
- 1960-1970
- 1960s
- Abe
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- U.Johnson - C.Wolf
- Heller - Toole
- Naipaul
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Onetti - Sábato
- Capote
- Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- McCarthy - Minsky
- Sillitoe
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- Lenz
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Dolls
- Ellis
- Cortázar
- Warhol
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- HarperLee
- Fuentes
- 1970-1980
- 1970s
- Habermas
- Handke
- GarciaMarquez
- Deleuze
- Derrida
- Beck
- Satir
- Kundera
- Hrabal
- Didion
- Guinzbourg
- Lovelock
- Vietnam
- H.S.Thompson - Bukowski
- Pynchon
- E.T.Hall
- Bateson - Watzlawick
- Carver
- Irving
- Milgram
- VargasLlosa
- Puig - Donoso
- Lasch-Sennett
- Crozier - Touraine
- Friedan-Greer
- Jacob-Monod
- Dawkins
- Beattie - Phillips
- Gaddis
- Rawls
- Zinoviev
- H.Searles
- Ballard
- Jong
- Kôno
- Calvino
- Ballester-Delibes
- ASchmidt
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact
- 1960s
- Abe
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- U.Johnson - C.Wolf
- Heller - Toole
- Naipaul
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Onetti - Sábato
- Capote
- Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- McCarthy - Minsky
- Sillitoe
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- Lenz
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Dolls
- Ellis
- Cortázar
- Warhol
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- HarperLee
- Fuentes

Boom latinoamericano - Ernesto Sábato (1911-2011, Arg.), "El Túnel" (1948), "Sobre héroes y tumbas" (1961) - Juan Carlos Onetti (1909-1994, Urug.), ""Los adioses" (1954), "El astillero" (1961, Le Chantier), "Juntacadáveres" (1964, Ramasse-Vioques) - ...
Last update: 03/11/2017
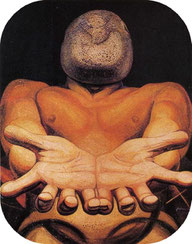
Les années 1960 voient pour la première fois la publication et la diffusion dans le monde entier d'un grand nombre d'oeuvres hispaniques d'Amérique du Sud : tous ces auteurs n’appartiennent pas à la même génération ni n’empruntent les mêmes styles ou inspirations, mais tous, intégrés et identifiés sous une même dénomination, le fameux "boom latinoamericano", envahissent la scène culturelle, les ateliers de traduction nord-américains et européens, et déferlent sur un public espagnol alors sevré de littérature. La littérature hispano-sudaméricaine semble soudainement se libérer de toute entrave, repositionnée par la révolution cubaine de 1959, portée par le modernisme européen, libérée par le "realismo mágico" de ses grandes figures qui débrident l'imagination et cette substance irrationnelle qui peuple la moindre parcelle d'un continent labouré par la rationalité occidentale. Sont ainsi successivement publiés "La muerte de Artemio Cruz" (1962), du mexicain Carlos Fuentes, "La ciudad y los perros" (1962) et "La casa verde" (1965), du péruvien Mario Vargas Llosa, "El astillero" (1961), de l'uruguayen Juan Carlos Onetti, "Paradiso" (1966), du cubain José Lezama Lima, "Rayuela" (1963), de l'argentin Julio Cortázar, "Sobre héroes y tumbas" (1961), de l'argentin Ernesto Sábato, "Cien años de soledad" (1967), du colombien Gabriel García Márquez, "El siglo de las luces" (1962), du cubain Alejo Carpentier... Tous ces écrivains vivent ou ont vécu en Europe, chassés souvent par les dictatures militaires, au moment où les milieux universitaires européens et nord-américains s'ouvrent à l'Amérique latine. Tous sont unis par les mêmes affinités "politiques" et bénéficient d'un environnement promotionnel d'autant plus important que la production romanesque espagnole ne parvient encore à trouver les termes de sa singularité...
David Alfaro Siqueiros - Nuestra imagen actual (1947, Museo de Arte Moderno, México)
L'Urugayen Juan Carlos Onetti et l'Argentin Ernesto Sábato peuvent être approchés en référence au Río de la Plata (la région englobant Buenos Aires en Argentine et Montevideo en Uruguay) : n'a-t-on pas dit que le Río de la Plata du XXe siècle est un creuset unique qui a façonné une sensibilité particulière ...
- un Cosmopolitisme "mélancolique" (Buenos Aires et Montevideo sont des ports, des villes d'immigrants européens (Italiens, Espagnols) tournés vers l'Europe, mais qui se perçoivent comme étant à la "périphérie" du monde occidental), Cette position crée une nostalgie sans objet (on rêve d'une Europe idéalisée qu'on ne connaît pas vraiment) et un sentiment de déracinement.
- et contrairement à l'optimisme du "rêve américain", la région du Río de la Plata a connu une série de désillusions : la crise économique de 1929, la montée des populismes et, surtout, les dictatures militaires brutales des années 70-80. Cette histoire a engendré un climat de désespoir politique et existentiel.
- Ce n'est pas une géographie de jungles ou de montagnes, mais un paysage horizontal, fait de vastes plaines (la pampa), d'un fleuve immense et boueux (le Río de la Plata), de brouillard et de banlieues tristes. Ce paysage se traduit en une atmosphère littéraire d'ennui, d'enfermement et de mélancolie.
Enfin, tous deux affronteront les dictatures militaires dans leurs pays respectifs (l'Uruguay pour Onetti, l'Argentine pour Sábato), mais leur engagement a pris des formes radicalement différentes, reflétant leur personnalité et leur œuvre ...

Ernesto Sábato (1911-2011)
Natif de Rojas, province de Buenos Aires, marqué, a-t-on dit par l'amour possessif d'une mère, Ernesto Sábato incarne la conscience tourmentée de
l'Argentine tout au long de ce XXe siècle et pense un temps pouvoir se réfugier dans la clarté des sciences exactes. Il est passé par le Parti communiste en 1930, qu'il quitte en 1934, épouse
Matilde Kusminsky Richter qui soutiendra cette âme pessimiste et torturée en toutes occasions. Docteur en physique en 1937, il est à Buenos Aires en 1940, et commence à écrire, hanté par les
rapports de la science, qu'il abandonne définitivement peu après - "Uno y el Universo" (1945) critique le rôle déshumanisant de la science et de la technique -, à l'éthique et à Dieu. C'est
avec "El tunel", en 1948, qu'il acquiert une notoriété internationale (Albert Camus le fera traduire en français par Gallimard) : un romancier, disait-il, à la différence d'un fou, peut aller
jusqu'à la folie et en revenir, ici Juan Pablo Castel est un héros torturé qui ne pourra se soustraire à son désir d'absolu et à cet exorcisme de la solitude que peut être l'amour, Castel
met fin à ses amours tumultueuses en tuant Maria, la femme qu'il aime. Sábato poursuit alors ses interrogations r sur la situation métaphysique de l'homme en ce monde et l'apport défaillant de la
civilisation occidentale, - "Hombres y engranajes" (1951), "Heteroxia" (1953), puis explore le passé historique de l'Argentine ("Romance de la muerte de Juan Lavalle"; "Abbadon, el exterminador",
1974), jusqu'à l'épisode ambigu et surprenant de la rencontre de de ces deux si prestigieux écrivains argentins que sont Ernesto Sabato et Jorge Luis Borges avec le dictateur et général Videla en
mai 1976...

"El Túnel" (Le Tunnel, 1948)
Bref et intense roman publié en 1948, fruit de la "littérature existentielle" (literatura existencial) et salué dès parution comme un chef-d`œuvre par Albert Camus, Graham Greene et Thomas Mann. "LE TUNNEL" (El túnel), de l'écrívain argentin Ernesto Sábato, conte l'histoire d'un crime passionnel à travers laquelle l'auteur exprime toutes ses idées à propos de l`angoisse, de l`aliénatíon et de la folie de l`homme contemporain.
Le peintre Juan Pablo Castel raconte comment il a tué par jalousie sa maîtresse María lribarne. Castel s`était épris de María en voyant cette inconnue arrêter longuement les yeux sur un détail du tableau (une Maternité) qu`il exposait au Salon de printemps de Buenos Aires en 1946. Ce détail était une petite fenêtre par laquelle on apercevait une plage solitaire et une femme en train de regarder la mer. ll avait pour lui une immense importance car il suggérait une "solitude anxieuse et absolue", la sienne. Croyant être compris par la visiteuse, Castel, après son départ et pendant des jours, se met à rêver, à imaginer qu`ils se retrouvent, dialoguent sur son art, s'accordent ou s`affrontent. Amoureux, il ne peint plus que pour elle. Quand il la rencontre effectivement, quelques mois plus tard, dans une rue de Buenos Aires, après l`avoir désespérément cherchée, le contact a lieu, assez proche des rêves de Castel, et María accepte bientôt de devenir sa maîtresse. Oui, María est une jeune femme fascinante et mystérieuse, à la fois attentive et lointaine, mais les relations qui s'établissent sont difficiles et orageuses. Sans cesse María semble fuir, elle conserve des silences inexplicables qui ont des allures de secrets, et la jalousie s`empare de Juan Pablo, notamment lorsqu`il découvre qu`elle est mariée à un aveugle, Allende. lncapable de dominer la confusion de ses sentiments adverses, il va s`enfoncer dans le "tunnel" de cette jalousie, renforcée à partir de l`instant où il soupçonne María d'être aussi la maîtresse d'un des cousins de son mari, I'architecte Hunter. Et le crime met fin à cette liaison toute d`amour fou, de haine et de démons : Juan Pablo assassine María à coups de couteau. (Trad. Gallimard. 1956; Le Seuil. 1978).
"I bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne; supongo que el proceso está en el recuerdo de todos y que no se necesitan mayores explicaciones sobre mi persona. Aunque ni el diablo sabe qué es lo que ha de recordar la gente, ni por qué. En realidad, siempre he pensado que no hay memoria colectiva, lo que quizá sea una forma de defensa de la especie humana...."
"Il suffira de dire que je suis Juan Pablo Castel, le peintre qui a tué Maria Iribame ; je suppose que le procès est resté dans toutes les mémoires et qu’il n’est pas nécessaire d’en dire plus sur ma personne. Pourtant, du diable si on sait ce que les gens vont se rappeler, et pourquoi ! En réalité, j’ai toujours pensé qu’il n’existe pas de mémoire collective, ce qui pourrait être pour la race humaine une manière de se défendre. Le fameux « bon vieux temps » ne signifie pas qu’il y aurait eu dans le passé moins de malheurs, mais qu’heureusement on s’empresse de les oublier. Bien sûr, cette expression n’a pas une valeur universelle : moi, par exemple, je suis porté à me rappeler de préférence le mal qui s’est fait, au point que je pourrais presque parler d’un « triste vieux temps », si ce n’était que le présent me parait aussi horrible que le passé ; je me rappelle tant de calamités, tant de visages cyniques et cruels, tant de méfaits que la mémoire est pour moi comme une lumière tremblante éclairant un sordide musée de la honte. Que de fois ne suis-je pas resté accablé, des heures durant, dans un coin obscur de mon atelier, après avoir lu tel ou tel fait divers !
Mais, à vrai dire, ce n’est pas là que la race humaine se montre sous son jour le plus honteux ; jusqu’à un certain point, les criminels sont des gens plus propres, plus inoffensifs que les autres ; et je ne dis pas cela parce que j’ai moi-même tué un être humain : c’est chez moi une honnête et profonde conviction. Un individu est malfaisant ? Eh bien ! on le liquide et puis c’est tout. Voilà ce que j’appelle une bonne action. Pensez combien il est plus néfaste pour la société que cet individu continue à distiller son venin et qu’au lieu de l’éliminer on veuille contrer son action en recourant aux lettres anonymes, aux calomnies et autres bassesses de ce genre. Quant à moi, je dois avouer qu’à l’heure actuelle, je regrette de n’avoir pas mieux profité du temps où j’étais libre pour liquider six ou sept types de ma connaissance.
Que le monde soit horrible, c’est une. vérité qui se passe de démonstration. En tout cas, il suffirait d’un fait pour le prouver ; dans un camp de concentration, un ex-pianiste se plaignait de la faim ; alors on l’a forcé à manger un rat, mais vivant. Mais ce n’est pas de cela que je veux parler maintenant ; je reviendrai plus tard, si j’en ai l’occasion, sur cette histoire de rat.
Comme je le disais, je m’appelle Juan Pablo Castel.
On pourra se demander ce qui me pousse à écrire l’histoire de mon crime (je ne sais pas si j’ai déjà dit que je vais raconter mon crime) et, surtout, à chercher un éditeur. Je connais assez l’âme humaine pour prévoir qu’on pensera à la vanité. On peut penser ce qu’on
voudra : cela m’est indifférent ; il y a longtemps que l’opinion et la justice des hommes me laissent froid. Supposons donc que je publie cette histoire par vanité.
En fin de compte, je suis fait de chair, d’os, de cheveux et d’ongles, comme tout autre homme, et il me paraîtrait bien injuste qu’on exige de moi, de moi précisément, des qualités particulières ; il arrive qu’on se croie un surhomme, jusqu’au jour où l’on s’aperçoit que,
comme les autres, on est mesquin, répugnant et faux.
Je ne parle pas de la vanité : je crois que nul n’est dépourvu de ce remarquable moteur du Progrès humain. Ils me font rire, ces bons messieurs qui vous sortent la modestie d’Einstein ou de personnages du même style ; réponse : il est facile d’être modeste quand on est célèbre ; je veux dire d’avoir l’air modeste. Même quand on imagine que toute trace de vanité a disparu, on en découvre tout à coup, sous la forme la plus subtile : la vanité de la modestie. On tombe sans arrêt sur ce genre d'individus. Même un homme réel ou symbolique comme le Christ a prononcé des paroles suggérées par la vanité ou du moins par l’orgueil. Que dire de Léon Bloy qui, pour se défendre d’être orgueilleux, arguait qu’il avait passé sa vie au service d’individus qui ne lui arrivaient pas à la cheville ? La vanité se rencontre là où l’on s’y attend le moins : aux côtés de la bonté, de l’abnégation, de la générosité. Quand j’étais petit et que je me désespérais à l’idée que ma mère devait mourir un jour (avec les années, on arrive à comprendre que la mort est non seulement supportable, mais même réconfortante), je n’imaginais pas qu’elle pût avoir des défauts. Maintenant qu’elle n’est plus, je dois dire qu’elle a été aussi bonne que peut parvenir à l’être un spécimen du genre humain. Mais, dans ses dernières années, alors que j’étais devenu un homme, je me rappelle comment, au début, je souffrais de découvrir dans ses meilleures actions une très subtile dose de vanité ou d’orgueil. Il m’est arrivé à moi-même quelque chose de beaucoup plus significatif quand on l’a opérée du cancer. Pour être près d’elle à temps, j’avais dû voyager deux jours entiers sans dormir. Quand j’arrivai à son chevet, elle réussit à mettre sur son visage cadavérique un léger sourire plein de tendresse, et elle murmura quelques mots pour me plaindre (elle me plaignait de ma fatigue !). Et moi, obscurément, j’ai senti en moi-même l’orgueil vaniteux d’être accouru aussi vite. J’avoue ce secret pour qu’on voie à quel point je ne me crois pas meilleur que les autres.
Pourtant, je ne raconte pas cette histoire par vanité.
Peut-être serais-je prêt à admettre qu’il y a là un peu d’orgueil et d’ostentation. Mais pourquoi cette manie de vouloir trouver une explication à tous les actes de la vie ? Quand j’ai commencé ce récit, j’étais fermement décidé à ne donner aucune espèce d’explication.
J’avais envie de raconter l’histoire de mon crime, un point c’est tout : celui à qui cela ne plairait pas n’aurait qu’à refermer le livre. Quoique j’en doute, parce que justement ces gens qui veulent toujours des explications sont les plus curieux et je pense qu’aucun d’eux ne voudra manquer l’occasion de lire jusqu’au bout l’histoire d’un crime.
Je pourrais garder pour moi les raisons qui m’ont poussé à écrire cette confession ; mais comme je n’ai pas intérêt à passer pour un excentrique, je dirai la vérité, qui de toute façon est assez simple : j’ai pensé que ces pages pourraient être lues par beaucoup de gens, puisque maintenant je suis célèbre ; et bien que je ne me fasse pas beaucoup d’illusions sur l’humanité en général ni sur les lecteurs de ces pages en particulier, je suis poussé par le faible espoir que quelqu’un parviendra à me comprendre, quand ce ne serait qu’une SEULE personne...."
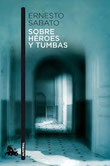
"Alejandra - Sobre héroes y tumbas" (1961, Héros et tombes)
Esta es la segunda novela de Ernesto Sabato, que profundiza la senda iniciada por El tunel. Una obra, considerada uno de los mejores libros del siglo, que indaga en las zonas mas oscuras del espiritu. Elément d'un tryptique qui comprend "Le Tunnel" et "L'Ange des ténèbres", considéré comme l’un des meilleurs romans argentins du XXème siècle, ce récit intimiste s'enracine dans une troublante Buenos Aires de six millions d'habitants et entend rendre toute la complexité d'un monde en crise en s'organisant autour du personnage d'Alejandra Vidal Olmos, une jeune femme étrange, épileptique, à la fois ange et démon, qui vit entourée d'un vieillard qui conserve dans un carton la tête du commandant Acevedo, d'une vieille Indienne plus ou moins sourde, et de l'oncle Bebe, un fou qui se promène constamment avec sa clarinette. Surgit un jeune homme, Martin, qui découvre l'amour avec Alejandra, mais surtout une expérience sans fin de cette sorte de folie qui se joue d'elle ("La Formación de Martín").
Dans une seconde partie ("La decadencia de los Vidal Olmos"), surgit Fernando Vidal Olmos, le père d'Alejandra, qui nous offre l'un des chapitres les plus connus de cette oeuvre, "Informe sobre ciegos" (le "Rapport sur les aveugles") : Fernando est en effet persuadé que les aveugles sont au cœur d'une société secrète qui serait à l'origine de tous les complots, et élabore ainsi une théorie qui va le mener au bord de la folie. L'histoire de Martín et d'Alejandra resurgit à nouveau pour se clôturer en tragédie : Alejandra tue son père et périt dans l'incendie de leur maison. Reste Martín abandonné à son chagrin et une fresque sociale de l'Argentine de Perón qui semble sombrer à jamais et que symbolise cette fameuse équipée qu'accomplissent des fidèles du général Lavalle, s'acharnant au péril de leur vie à transporter vers le nord du pays son cadavre pourrissant afin de lui épargner les outrages de l'ennemi...
"Abaddon el exterminador" (L’Ange des ténèbres, 1974) se présente comme une suite et met en scène l’auteur lui-même, pathétique dans ses interrogations et ses contradictions...
"Un sábado de mayo de 1953, dos años antes de los acontecimientos de Barracas, un muchacho alto y encorvado caminaba por uno de los senderos del parque Lezama.
Se sentó en un banco, cerca de la estatua de Ceres, y permaneció sin hacer nada, abandonado a sus pensamientos. “Como un bote a la deriva en un gran lago aparentemente tranquilo pero agitado por corrientes profundas”, pensó Bruno, cuando, después de la muerte de Alejandra, Martín le contó, confusa y fragmentariamente, algunos de los episodios vinculados a aquella relación. Y no sólo lo pensaba sino que lo comprendía ¡y de qué manera!, ya que aquel Martín de diecisiete años le recordaba a su propio antepasado, al remoto Bruno que a veces vislumbraba a través de un territorio neblinoso de treinta años; territorio enriquecido y devastado por el amor, la desilusión y la muerte.
Melancólicamente lo imaginaba en aquel viejo parque, con la luz crepuscular demorándose sobre las modestas estatuas, sobre los pensativos leones de bronce, sobre los senderos cubiertos de hojas blandamente muertas. A esa hora en que comienzan a oírse los pequeños murmullos, en que los grandes ruidos se van retirando, como se apagan las conversaciones demasiado fuertes en la habitación de un moribundo; y entonces, el rumor de la fuente, los pasos de un hombre que se aleja, el gorjeo de los pájaros que no terminan de acomodarse en sus nidos, el lejano grito de un niño, comienzan a notarse con extraña gravedad. Un misterioso acontecimiento se produce en esos momentos: anochece. Y todo es diferente: los árboles, los bancos, los jubilados que encienden alguna fogata con hojas secas, la sirena de un barco en la Dársena Sur, el distante eco de la ciudad. Esa hora en que todo entra en una existencia más profunda y enigmática. Y también más temible, para los seres solitarios que a esa hora permanecen callados y pensativos en los bancos de las plazas y parques de Buenos Aires.
"Un samedi de mai 1953, deux ans avant les événements de Barracas, un garçon grand et courbé marchait sur l’un des sentiers du parc Lezama. Il s’assit sur un banc, près de la statue de Cérès, et resta sans rien faire, abandonné à ses pensées. "Comme un bateau à la dérive dans un grand lac apparemment calme mais agité par des courants profonds", pensa Bruno quand, après la mort d’Alexandra, Martin lui raconta, confusément et fragmentairement, certains des épisodes liés à cette relation. Et non seulement je le pensais, mais je le comprenais, et comment ! car ce Martin de dix-sept ans lui rappelait son propre ancêtre, le lointain Bruno qui entrevoyait parfois à travers un territoire brumeux de trente ans; territoire enrichi et dévasté par l’amour, la désillusion et la mort.
Mélancoliquement, je l’imaginais dans ce vieux parc, la lumière crépusculaire s’arrêtant sur les modestes statues, sur les pensifs lions de bronze, sur les sentiers couverts de feuilles tendrement mortes. A cette heure où les petits murmures commencent à se faire entendre, où les grands bruits se retirent, comme s’éteignent les conversations trop fortes dans la chambre d’un mourant; et alors, la rumeur de la fontaine, les pas d’un homme qui s’éloigne, le gazouillis des oiseaux qui ne finissent pas de s’installer dans leurs nids, le cri lointain d’un enfant, commencent à se remarquer avec une étrange gravité. Un événement mystérieux se produit à ces moments-là : le crépuscule. Et tout est différent : les arbres, les bancs, les retraités qui allument un feu avec des feuilles sèches, la sirène d’un bateau dans la Darse Sud, l’écho lointain de la ville. Cette heure où tout entre dans une existence plus profonde et plus énigmatique. Et encore plus redoutable, pour les êtres solitaires qui à cette heure-là restent silencieux et pensifs sur les bancs des places et parcs de Buenos Aires.
(...)
Les "Sobre héroes y tumbas" sont ceux de la famille Olmos, pionniers excentriques qui ont participé au XIXe siècle à la création de l'Argentine et dont le destin s'entrecroise avec celui de leurs descendants non moins étranges. Le thème du roman a bien l'allure dramatique d`un fait divers. A Buenos Aires, le 24 juin 1955, un père de famille, Femando Olmos, a été assassiné au revolver par sa fille Alejandra, qui a ensuite mis le feu à la chambre du crime avant de se suicider en se laissant carboniser. Le mobile, apprend-on, aura été les relations incestueuses du père avec sa fille et le sentiment de culpabilité qu`elles ont entraîné chez celle-ci.
Tous les personnages du livre, qu'ils appartiennent au présent ou au passé, vivent une "solitude métaphysique" morbide, dans l'ombre sinistre d'une capitale oppressante et maléfique comme une ville de cauchemar. Ainsi le lien entre l'hier et l'aujourd'hui est-il assuré par une tante d`Alejandra, morte très âgée en 1932, et qui a gardé durant toute son existence, auprès d`elle, comme témoignage d'une tragédie de sa jeunesse, la tête tranchée de son père. Le narrateur, Bruno, a lui-même vécu un horrible amour frustré avec la mère d'Alejandra. Il écoute un étudiant pauvre et naïf, Martin Carrillo, lui raconter comment il s'est épris d'Alejandra après l'avoir rencontrée dans un parc, et comment celle-ci, démon tentateur ou fascinante sorcière, l'a envoûté au point de le contraindre à la rechercher même après sa mort.
Au centre de cette quête figure, avec Alejandra, le véritable protagoniste du roman, Femando Olmos, qui incarne l'homme en "crise" d'une société paranoïaque et décadente, monstrueux acteur libérant ses instincts et concrétisant ses fantasmes dans un monde sans croyances religieuses, morales ou politiques.
Dans une longue confession qu'il écrit peu avant de mourir et qu'il intitule "Rapport sur les aveugles" (Informe sobre ciegos), Fernando Olmos nous entraîne dans les cloaques d'un Buenos Aires où s'abritent des forces obscures aux pouvoirs extraordinaires. Là où il a une interminable et hallucinante union avec une "femme aveugle", une secte d'aveugles prépare et exerce hargneusement sur ses victimes des vengeances terrifiantes. Avec une très grande force suggestíve, cette descente aux enfers éclaire plus cruellement et douloureusement encore que les autres pages le mal de vivre d'une capitale argentine déchirée par la violence, hantée par les dictatures militaires, livrée aux conflits sociaux nés d'un accroissement bariolé et chaotique, et emprisonnant chacun dans la solitude et une introversion débouchant le plus souvent sur le désespoir et même la folie. (Trad. Le Seuil, 1967)
(Informe sobre ciegos)
¿Cuándo empezó esto que ahora va a terminar con mi asesinato? Esta feroz lucidez que ahora tengo es como un faro y puedo aprovechar un intensísimo haz hacia vastas regiones de mi memoria: veo caras, ratas en un granero, calles de Buenos Aires o Argel, prostitutas y marineros; muevo el haz y veo cosas más lejanas: una fuente en la estancia, una bochornosa siesta, pájaros y ojos que pincho con un clavo. Tal vez ahí, pero quién sabe: puede ser mucho más atrás, en épocas que ahora no recuerdo, en períodos remotísimos de mi primera infancia. No sé. ¿Qué importa, además?
Recuerdo perfectamente, en cambio, los comienzos de mi investigación sistemática (la otra, la inconsciente, acaso la más profunda, ¿cómo puedo saberlo?). Fue un día de verano del año 1947, al pasar frente a la Plaza Mayo, por la calle San Martín, en la vereda de la Municipalidad. Yo venía abstraído, cuando de pronto oí una campanilla, una campanilla como de alguien que quisiera despertarme de un sueño milenario. Yo caminaba, mientras oía la campanilla que intentaba penetrar en los estratos más profundos de mi conciencia: la oía pero no la escuchaba. Hasta que de pronto aquel sonido tenue pero penetrante y obsesivo pareció tocar alguna zona sensible de mi yo, algunos de esos lugares en que la piel del yo es finísima y de sensibilidad anormal: y desperté sobresaltado, como ante un peligro repentino y perverso, como si en la oscuridad hubiese tocado con mis manos la piel helada de un reptil.
Delante de mí, enigmática y dura, observándome con toda su cara, vi a la ciega que allí vende baratijas. Había cesado de tocar su campanilla; como si sólo la hubiese movido para mí, para despertarme de mi insensato sueño, para advertir que mi existencia anterior había terminado como una estúpida etapa preparatoria, y que ahora debía enfrentarme con la realidad. Inmóvil, con su rostro abstracto dirigido hacia raí, y yo paralizado como por una aparición infernal pero frígida, quedamos así durante esos instantes que no forman parte del tiempo sino que dan acceso a la eternidad. Y luego, cuando mi conciencia volvió a entrar en el torrente del tiempo, salí huyendo.
De ese modo empezó la etapa final de mi existencia. Comprendí a partir de aquel día que no era posible dejar transcurrir un solo instante más y que debía iniciar ya mismo la exploración de aquel universo tenebroso.
Quand a commencé ce qui va se terminer par mon assassinat ? Cette lucidité féroce que j'ai maintenant est comme un phare et je peux harnacher un faisceau très intense vers de vastes régions de ma mémoire : je vois des visages, des rats dans une grange, des rues de Buenos Aires ou d'Alger, des prostituées et des marins ; je déplace le faisceau et je vois des choses plus lointaines : une fontaine dans l'estancia, une sieste étouffante, des oiseaux et des yeux que je pique avec un ongle. Peut-être là, mais qui sait : c'est peut-être beaucoup plus loin, à des époques dont je ne me souviens plus, dans les périodes les plus reculées de ma petite enfance, je ne sais pas. Je ne sais pas, qu'est-ce que ça peut faire ?
Je me souviens parfaitement, cependant, des débuts de ma recherche systématique (l'autre, l'inconsciente, peut-être la plus profonde, comment le saurais-je). C'était un jour d'été 1947, je passais devant la Plaza Mayo, dans la rue San Martín, sur le trottoir de l'Hôtel de Ville. Je marchais, abstrait, quand soudain j'ai entendu une petite cloche, une petite cloche comme quelqu'un qui voulait me réveiller d'un rêve millénaire. Je marchais, tandis que j'entendais la cloche essayer de pénétrer dans les strates les plus profondes de ma conscience : je l'entendais mais je ne l'entendais pas. Jusqu'à ce que, soudain, ce son faible mais pénétrant et obsédant semble toucher une zone sensible de mon moi, un de ces endroits où la peau du moi est très fine et anormalement sensible : et je me suis réveillé en sursaut, comme face à un danger soudain et pervers, comme si, dans l'obscurité, j'avais touché de mes mains la peau glacée d'un reptile.
Devant moi, énigmatique et dure, m'observant de tout son visage, je vis la femme aveugle qui vend des bibelots là-bas. Elle avait cessé de sonner sa cloche ; comme si elle ne l'avait fait que pour moi, pour me réveiller de mon rêve insensé, pour m'avertir que mon existence passée était terminée comme une stupide étape préparatoire, et que je devais maintenant affronter la réalité. Immobiles, son visage abstrait tourné vers la rambarde, et moi paralysé comme par une apparition infernale mais glaciale, nous restâmes ainsi pendant ces instants qui ne font pas partie du temps mais donnent accès à l'éternité. Puis, lorsque ma conscience a réintégré le courant du temps, je me suis enfui.
Ainsi commença la dernière étape de mon existence. À partir de ce jour, j'ai compris que je ne pouvais pas laisser passer un autre instant et que je devais commencer à explorer cet univers sombre dès maintenant.
Pasaron varios meses, hasta que en un día de aquel otoño se produjo el segundo encuentro decisivo. Yo estaba en plena investigación, pero mi trabajo estaba retrasado por una inexplicable abulia, que ahora pienso era seguramente una forma falaz del pavor a lo desconocido.
Vigilaba y estudiaba los ciegos, sin embargo. Me había preocupado siempre y en varias ocasiones tuve discusiones sobre su origen, jerarquía, manera de vivir y condición zoológica. Apenas comenzaba por aquel entonces a esbozar mi hipótesis de la piel fría y ya había sido insultado por carta y de viva voz por miembros de las sociedades vinculadas con el mundo de los ciegos. Y con esa eficacia, rapidez y misteriosa información que siempre tienen las logias y sectas secretas; esas logias y sectas que están invisiblemente difundidas entre los hombres y que, sin que uno lo sepa y ni siquiera llegue a sospecharlo, nos vigilan permanentemente, nos persiguen, deciden nuestro destino, nuestro fracaso y hasta nuestra muerte. Cosa que en grado sumo pasa con la secta de los ciegos, que, para mayor desgracia de los inadvertidos tienen a su servicio hombres y mujeres normales: en parte engañados por la Organización; en parte, como consecuencia de una propaganda sensiblera y demagógica; y, en fin, en buena medida, por temor a los castigos físicos y metafísicos que se murmura reciben los que se atreven a indagar en sus secretos. Castigos que, dicho sea de paso, tuve por aquel entonces la impresión de haber recibido ya parcialmente y la convicción de que los seguiría recibiendo, en forma cada vez más espantosa y sutil; lo que, sin duda a causa de mi orgullo, no tuvo otro resultado que acentuar mi indignación y mi propósito de llevar mis investigaciones hasta las últimas instancias.
Plusieurs mois se sont écoulés, jusqu'à ce qu'un jour d'automne, la deuxième rencontre décisive ait lieu. J'étais en pleine recherche, mais mon travail était ralenti par une aboulie inexplicable, dont je pense aujourd'hui qu'elle était sûrement une forme fallacieuse de la peur de l'inconnu.
Cependant, j'ai observé et étudié les aveugles. Je m'en suis toujours préoccupé et j'ai eu à plusieurs reprises des discussions sur leur origine, leur hiérarchie, leur mode de vie et leur statut zoologique. A cette époque, j'avais à peine ébauché mon hypothèse de la peau froide et j'avais déjà été insulté par lettre et par le bouche à oreille par des membres des sociétés liées au monde des aveugles. Et avec cette efficacité, cette rapidité et cette information mystérieuse que possèdent toujours les loges et les sectes secrètes, ces loges et ces sectes invisiblement répandues parmi les hommes et qui, sans que nous le sachions ni même le soupçonnions, nous observent constamment, nous persécutent, décident de notre sort, de notre échec et même de notre mort. C'est ce qui se passe en grande partie avec la secte des aveugles qui, pour le plus grand malheur des inconscients, a à son service des hommes et des femmes normaux : en partie trompés par l'Organisation, en partie par suite d'une propagande sentimentale et démagogique, et enfin, en grande partie, par crainte des châtiments physiques et métaphysiques que l'on dit infliger à ceux qui osent sonder leurs secrets. Des châtiments que j'avais d'ailleurs à l'époque l'impression d'avoir déjà partiellement reçus, et la conviction que je continuerais à les recevoir, sous une forme de plus en plus redoutable et subtile ; ce qui, sans doute à cause de mon orgueil, n'a eu d'autre résultat que d'accentuer mon indignation et ma détermination à mener mes investigations jusqu'aux derniers retranchements.
Si fuera un poco más necio podría acaso jactarme de haber confirmado con esas investigaciones la hipótesis que desde muchacho imaginé sobre el mundo de los ciegos, ya que fueron las pesadillas y alucinaciones de mi infancia las que me trajeron la primera revelación. Luego, a medida que fui creciendo, fue acentuándose mi prevención contra esos usurpadores, especie de chantajistas morales que, cosa natural, abundan en los subterráneos, por esa condición que los emparentó con los animales de sangre fría y piel resbaladiza que habitan en cuevas, cavernas, sótanos, viejos pasadizos, caños de desagües, alcantarillas, pozos ciegos, grietas profundas, minas abandonadas con silenciosas filtraciones de agua; y algunos, los más poderosos, en enormes cuevas subterráneas, a veces a centenares de metros de profundidad, como se puede deducir de informes equívocos y reticentes de espeleólogos y buscadores de tesoros, lo suficiente claros, sin embargo, para quienes conocen las amenazas que pesan sobre los que intentan violar el gran secreto.
Si j'étais un peu plus fou, je pourrais peut-être me vanter d'avoir confirmé par ces recherches l'hypothèse que j'avais imaginée dès mon enfance sur le monde des aveugles, puisque ce sont les cauchemars et les hallucinations de mon enfance qui m'en ont apporté la première révélation. Puis, en grandissant, je me suis de plus en plus méfié de ces usurpateurs, sortes de maîtres chanteurs moraux qui, naturellement, pullulent dans les souterrains, en raison de cette condition qui les apparente aux animaux à sang froid et à peau glissante qui habitent les grottes, les cavernes, les caves, les vieux passages, les tuyaux d'évacuation, les égouts, les fosses septiques, les crevasses profondes, les mines abandonnées avec des infiltrations d'eau silencieuses ; et d'autres, les plus puissants, dans d'immenses grottes souterraines, parfois à des centaines de mètres de profondeur, comme on peut le déduire des rapports équivoques et réticents des spéléologues et des chasseurs de trésors, suffisamment clairs cependant pour ceux qui connaissent les menaces qui pèsent sur ceux qui tentent de violer le grand secret.
(..)
Jeune physicien prometteur, il a travaillé sur le rayonnement atomique au Laboratoire Curie à Paris, en proie à une crise existentielle profonde, Ernesto Sábato a tourné le dos à une carrière scientifique brillante pour se consacrer à la littérature et à la peinture. Ce renoncement radical incarne le conflit entre la raison scientifique et les interrogations métaphysiques de l'âme humaine, un thème central dans son œuvre.
Sa trilogie romanesque, bien que concise, a profondément marqué la littérature :
- "El túnel" (1948) : Un court roman existentialiste qui explore la solitude, la jalousie et la folie. Il est devenu un classique pour son intensité psychologique et sa structure narrative impeccable.
- "Sobre héroes y tumbas" (1961) : Son œuvre maîtresse. Ce roman est souvent considéré comme le "roman total" de l'Argentine. Il mêle l'histoire d'amour tragique, le reportage social sur Buenos Aires, l'histoire nationale (à travers l'évocation du dictateur Rosas) et la descente aux enfers psychologique (notamment dans la section célèbre et cauchemardesque "Informe sobre ciegos"). Il capture l'essence de l'âme argentine, ses mythes, ses traumatismes et son malaise existentiel.
- "Abaddón el exterminador" (1974) : Un roman expérimental, autobiographique et apocalyptique qui brouille les frontières entre fiction et réalité.
La Conscience Morale de la Nation : le Rapport Sábato ...
C'est son rôle le plus important et le plus respecté en Argentine. Après la chute de la dictature militaire (1976-1983), le président Raúl Alfonsín l'a nommé président de la CONADEP (Commission nationale sur la disparition des personnes). Le travail de la CONADEP a conduit à la publication du rapport "Nunca Más" (Plus Jamais Ça) en 1984. Sábato a personnellement remis le rapport à Alfonsín lors d'une cérémonie télévisée très émouvante. Un rapport qui a documenté de manière irréfutable les horreurs de la Terreur d'État, les tortures et les disparitions de milliers de personnes. Il a été fondateur pour la mémoire collective argentine et pour le processus de justice et de réconciliation nationale. Sábato est devenu la voix de la vérité et de la dignité face à la barbarie.
Le Rapport "Nunca Más" est devenu un modèle et un symbole international pour les commissions vérité et réconciliation à travers le monde. Le rôle de Sábato a montré comment un intellectuel pouvait mettre sa notoriété et son intégrité au service de la justice et de la défense des droits humains, devenant ainsi une référence morale globale.
Et tout au long de sa vie, Sábato a été un essayiste prolifique. Dans des ouvrages comme "Hombres y engranajes" (Hommes et rouages), il a critiqué la société technocratique moderne qui déshumanise l'individu. Il s'est constamment interrogé sur le rôle de l'art, de la science et de l'éthique dans le monde contemporain.
Ses romans, particulièrement "El túnel" et "Sobre héroes y tumbas", ont été traduits dans de nombreuses langues et sont étudiés dans les universités du monde entier. Il est reconnu comme l'une des figures majeures de la littérature latino-américaine du "Boom" (aux côtés de García Márquez, Vargas Llosa, Cortázar), même si son œuvre est plus introspective et psychologique que celle de ses contemporains magico-réalistes...

Juan Carlos Onetti (1909-1994)
Natif de Montivedeo, l'existence d'Onetti, à l'instar de son oeuvre, est fait d'errances, de rencontres, de séparations, nourrie d'auteurs comme Dash
Hammett, Knut Hamsum, William Faulkner, hanté par le retour des mêmes impasses, quelles soient de l'ordre de son existence ou de celui de ses créations fictionnelles. Il enchaîne alors de
puissantes oeuvres qui vont marquées la littérature urugayenne mais plus encore latino-américaine du XXe siècle - "El pozo" (1939), "Para esta noche," (1943), "La vida breve" (1950),
premier volume du fameux "cycle de Santa María", ville mythique du Rio de la Plata où l'homme ne peut guère espérer s'enraciner - mais le monde qu'il nous donne, des vies engluées dans l'opacité
d'une désespérance sans rémission possible, peut expliquer la relative discrétion littéraire de cet auteur, par ailleurs d'une grande pudeur... Il regagne l'Uruguay en 1955, se remarie une
quatrième fois, connait une relation tumultueuse avec Idea Vilarino, mais doit s'exiler à Madrid en 1975 suite au coup d'Etat qui enserre dans sa répression l'Uruguay pendant dix
années.

"La vida breve" (La vie brève, 1950)
L'ablation d'un sein de Gertrudis, remémorée d`une façon obsessionnelle par son mari et le narrateur, Brausen, constitue le point de départ de ce roman, le premier de la saga de Santa María, les deux autres étant "Le Chantier" et "Ramasse-Vioques". Tout commence à Buenos Aires, où Brausen, la quarantaine, un être médiocre, rédacteur publicitaire menacé de licenciement, escompte se refaire en écrivant un scénario que des amis bienveillants lui ont commandé. Couché dans son lit, il entend les cris de plaisir, vrais ou feints, d`une voisine de palier, la Queca, une prostituée à domicile. ll traîne de la sorte son existence jusqu'au moment où il est bien obligé de concevoir son scénario.
Obsédé par les cris de sa voisine, hanté par la cicatrice de sa femme, Brausen imagine un personnage, Díaz Grey "un petit docteur pusillanime". Ce médecin, Diaz Grey - alter ego d`Onetti -, Brausen l'ínstalle d`abord dans un cabinet médical. y adjoint un laboratoire et pour finir situe le tout dans une ville-fiction peuplée de passants solitaires, de jobards, de schizophrènes, toute une populace orpheline titubant sur les décombres de rêves à jamais gâchés. ll invente aussi une sombre affaire de drogue, volontairement (et exagérément) pathétique. Alors Brausen cesse d`être le personnage falot qu`il était et devient Dieu, le créateur, présent nulle part et partout. Il aura même une statue équestre sur la place principale de sa cité mythique baptisée Santa Maria, comme d'autres s'appellent Yoknapatawpha ou Macondo. et qui servira de cadre à Onetti pour ses futurs romans.
Tout peut arriver à Santa María : quand Brausen passe de l`autre côté de la cloison pour annexer la vie de l`assassin de la Queca, le roman bascule dans la rêverie la plus démentielle : le faux Diaz Grey devient si vivant, si proche, que le vrai (faux) Brausen en vient à douter de sa propre existence, repart vers une nouvelle "vie brève" sous les masques d'un autre personnage et partage son bureau avec un certain Onetti. Rêvant qu`il est lui-même rêvé, comme s`il s`acharnait à éteindre les guirlandes qu'il vient d`allumer, comme s'il mettait en scène sa propre disparition, Onetti nous plonge dans un mirage hallucinant qui pourrait bien être la métaphore de toute entreprise romanesque.
L`auteur entame avec ce roman une réflexion sur la création qui donnera quatre ans plus tard la plus parfaite de ses œuvres. le laconique et ambigu roman "Les Adíeux" : l`écriture romanesque, toujours pétrie de réalité, devient une planche de salut pour les personnages, mais s`avère mortelle pour l'auteur. (Trad. Gallimard, 1984).
1 - La Sainte-Rose - « Le monde est fou », répéta une fois de plus la femme, comme si elle contrefaisait quelqu’un, par dérision.
Je l’entendais à travers le mur. J’imaginai sa bouche, ses lèvres qui bougeaient devant le réfrigérateur au souffle glacé ou devant le rideau de perles de bois foncé, vraisemblablement tendu entre la chambre et le soir, noyant d’ombre le désordre des meubles arrivés depuis peu. J’écoutai distraitement les phrases que la femme prononçait par intermittence, sans trop croire à ce qu’elle disait.
Quand sa voix, le bruit de ses pas indiquaient qu’elle passait de la cuisine à la chambre (je me représentais cette femme avec de gros bras et en peignoir), un homme approuvait ses paroles par monosyllabes, sans se laisser aller vraiment à plaisanter. La chaleur que la femme fendait en profitait pour se regrouper, éliminait les fissures et pesait de tout son poids sur chaque pièce, chaque renfoncement des escaliers, chaque recoin de l’édifice.
La femme allait et venait dans l’unique pièce de l’appartement contigu et je l’entendais de la salle de bains, debout, la tête baissée sous la pluie presque silencieuse de la douche.
— Oui, même si ça me brise le cœur, je le jure, dit la voix de la femme, un peu chantante, le souffle suspendu après chaque phrase, comme si un obstacle surgissait alors pour l’empêcher d’avouer quelque chose. Je ne me mettrai pas à genoux devant lui. Il a ce qu’il a voulu ! Moi aussi, j’ai mon orgueil. Même si je dois souffrir plus que lui.
— Allons, allons, disait l’homme, conciliant. J’écoutai durant un moment le silence de l’appartement du centre duquel parvenait maintenant un bruit de glaçons qu’on entrechoquait dans des verres. L’homme devait être en bras de chemise, corpulent, lippu ; elle, grimaçait nerveusement, affligée par cette sueur qui coulait sur ses lèvres et sur sa poitrine. Moi, de l’autre côté de la mince cloison, j’étais nu, debout, couvert de gouttes d’eau que je sentais s’évaporer, sans me décider à attraper la serviette, le regard tourné, au-delà de la porte, vers la pièce ombreuse où la chaleur accumulée cernait les draps propres du lit. Délibérément, je me mis à penser à Gertrudis ; la chère Gertrudis aux longues jambes ; Gertrudis avec sa vieille cicatrice blanchâtre sur le ventre ; Gertrudis se taisant et clignant des yeux, refoulant parfois sa rancœur comme on ravale sa salive ; Gertrudis avec une petite rose d’or à l’échancrure de ses robes du dimanche ; bref une Gertrudis que je connaissais par cœur.
Quand la voix de la femme retentit à nouveau, je pensai qu’il serait de mon devoir de regarder sans dégoût la nouvelle cicatrice que Gertrudis allait avoir sur la poitrine, une cicatrice circulaire et compliquée, avec des nervures rouges ou roses qui prendraient peut-être avec le temps le ton pâle, indistinct, de l’autre cicatrice qui était fine et sans relief, semblable à une signature, et que j’avais si souvent parcourue du bout de la langue sur son ventre.
— Oui, même si ça me brise le cœur, dit la femme, de l’autre côté. D’ailleurs, je ne serai jamais plus comme avant. Combien de fois Ricardo m’a fait pleurer comme une folle, pendant ces trois ans ! Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas. Cette fois-ci, il ne m’a rien fait de pire. Mais maintenant, c’est fini.
Elle devait être dans la cuisine, accroupie devant le réfrigérateur, en train de farfouiller et se rafraîchissant le visage et la poitrine dans cet air glacé qui solidifiait des odeurs végétales, huileuses.
— Je ne ferai pas un pas, même si ça me brise le cœur. Même s’il vient me supplier à genoux…
— Ne dites pas ça, dit l’homme. Il avait marché sans bruit, je suppose, jusqu’à la porte de la cuisine et appuyant un bras velu au montant de la porte, tenant de l’autre main son verre, il devait regarder de haut le corps replié de la femme. Ne dites pas ça. Des erreurs, nous en commettons tous. Mais s’il… enfin si Ricardo venait vous le demander…
— Je ne sais pas quoi lui dire ! avoua-t-elle. J’ai tant souffert à cause de lui ! Un autre verre, voulez-vous ?
Ils devaient être dans la cuisine car j’entendais la glace tomber dans l’évier. Je fis couler à nouveau la douche et je remuai le dos sous le jet, tout en pensant que le matin même, environ dix heures plus tôt, le médecin avait coupé soigneusement, ou d’un seul coup, sans aucune précaution, le sein gauche de Gertrudis. Il avait dû sentir vibrer le bistouri dans sa main, sentir comment la lame passait des graisses moelleuses à la dureté moulante de la chair.
La femme soupira et se mit à rire ; une phrase me parvint, altérée par le bruit de la douche :
— Si vous saviez comme j’en ai assez des hommes ! Elle s’éloigna vers la chambre à coucher et fit claquer les fenêtres du balcon. Mais, à votre avis, cet orage de la Sainte-Rose, c’est pour quand ?
— Pour aujourd’hui sans doute, dit l’homme sans la suivre, en haussant la voix. Patience, nous l’aurons sur le dos avant demain.
Je découvris alors que j’attendais la même chose depuis une semaine ; je me rappelai mon espoir d’un vague miracle que ferait pour moi le printemps. Il y avait des heures qu’un insecte bourdonnait, déconcerté et furieux, entre l’eau de la douche et la dernière clarté de la lucarne. Je m’ébrouai comme un chien, en regardant vers la pénombre de la chambre où la chaleur prisonnière devait palpiter. Je ne pourrais pas écrire le scénario dont Stein m’avait parlé tant que je ne parviendrais pas à oublier ce sein coupé, sans forme précise maintenant, qui s’aplatissait comme une méduse sur la table d’opération et s’offrait là comme un verre. Il était impossible de l’oublier, même si je m’efforçais de me répéter que j’avais joué à le téter, à sucer cela. J’étais obligé d’attendre, et ma pauvreté avec moi. Tous, en ce jour de la Sainte-Rose, le petit bout de femme inconnue qui venait d’emménager à côté, l’insecte qui tournoyait dans l’air parfumé à la crème à raser, tous ceux qui vivaient à Buenos Aires étaient condamnés à attendre avec moi et à guetter, conscients ou non, abrutis par la chaleur menaçante et mortelle, l’instant où éclaterait cet orage bref et grandiloquent qui amènerait un printemps soudain qui s’était frayé un passage depuis la côte et transformerait la ville en une sorte de vallée fertile où la joie pourrait surgir, soudaine et plénière, comme dans le souvenir.
La femme et l’homme étaient revenus dans la pièce.
— Je vous jure que personne n’a été fou d’amour comme nous, venait-elle de dire en sortant de la cuisine.
J’arrêtai la douche, j’attendis que l’insecte s’approchât pour le faire voltiger avec la serviette et l’écraser contre la grille du siphon, puis j’entrai nu et dégoulinant dans la chambre. À travers la persienne, je vis la nuit qui commençait à s’obscurcir en direction du nord et je calculai les secondes qui séparaient deux éclairs. Je portai à ma bouche deux pastilles de menthe et je m’allongeai sur mon lit.
… L’ablation du sein. On peut imaginer qu’une cicatrice ressemble à une entaille irrégulière pratiquée dans l’arrondi d’une coupe en caoutchouc épais d’aspect qui contiendrait une matière immobile et rose, avec des bulles à la surface, substance qui donne l’impression d’être liquide si nous faisons osciller la lampe qui l’éclaire. On peut aussi penser à ce qu’elle sera quinze jours, un mois après l’intervention, avec une ombre de peau qui s’allonge et la couvre, translucide, si mince que personne ne se risquerait à arrêter longtemps les yeux sur elle. Plus tard, les rides commencent à s’insinuer, se forment et s’altèrent ; il est maintenant possible de regarder la cicatrice en catimini, de la surprendre nue une certaine nuit et de prédire quelle rugosité, quels dessins, quels tons rosés et blancs prédomineront et deviendront définitifs. Et puis, un jour, Gertrudis se remettrait à rire sans raison, dans l’air printanier ou estival du balcon et me regarderait, les yeux brillants, fixement, un moment. Aussitôt après, elle plaquerait ses mains sur ses yeux, ne laissant plus paraître qu’un sourire que prolongerait un pli provocateur aux commissures des lèvres.
L’instant – l’heure de la farce – serait arrivé pour ma main droite de serrer dans le vide, avec précision, une forme et une résistance imaginaires mais que mes doigts n’avaient pas oubliées. « Ma paume aura peur de se creuser exagérément, mes doigts devront frôler la surface âpre ou glissante, inconnue et sans promesse d’intimité de la ronde cicatrice. »
— Comprenez. Ce n’est pas la fête ou le bal que je regrette, mais la manière, dit la femme, de l’autre côté de la cloison ; ses paroles, toutes proches, passaient par-dessus mon visage.
Elle était peut-être étendue sur le lit, comme moi, dans un lit semblable qu’on pouvait dissimuler en le repliant contre le mur dans la journée et exhumer le soir, dans un grincement désespéré de ressorts ; l’homme, corpulent, aux grosses moustaches agressivement teintes, était sans doute plié en deux sur un fauteuil, toujours en train de boire, en nage, prisonnier d’un respect de convenance, à côté des pieds nus de la femme. Il devait la regarder parler et acquiescer sans un mot ; et, parfois, détourner les yeux, fasciné par les ongles rouge vif des doigts que la femme agitait en cadence, sans réfléchir..." (Éditions Gallimard, 1987, pour la traduction française)

"Los adioses" (Les Adieux, 1954)
Chef-d`œuvre de Juan Carlos Onetti en ce qui concerne l'ambiguïté du langage, "Les Adieux" content la vie d'un ancien champion de basket-ball dans un sanatorium pour tuberculeux, un homme taciturne qui n'accepte pas de se mêler aux autres malades et rejette la vie toute vie communautaire. ll ne vit que pour écrire et recevoir des lettres - les unes dans des enveloppes écrites à la main, d`autres dactylographiées sur une vieille machine.
Un jour, l'une des correspondantes, la "femme aux lunettes noires", arrive et s'installe avec lui dans le vieil hôtel où il vit. La veille du jour de l`an, il reçoit la visite d'une jeune fille pleine de vitalité. Tous les trois vivront alors dans un chalet adossé à la montagne que l'homme avait loué. Avec la première, il joue une convaincante comédie de l'espoir ; en présence de la seconde - bien des éléments laissent supposer qu`elle pourrait être sa fille - le malade se fait bienveillant et autoritaire à la fois.
Ce qui est inquiétant dans ce roman, c'est la forme du récit. Tout semble être raconté par un narrateur objectif : nous le croyons, nous le suivons lorsqu`il imagine la débauche furtive, les appels de l`homme, les refus, les compromis et les colères impitoyables de la jeune fille. Nous acceptons les ragots que le narrateur fait courir dans le village, selon lesquels la femme est l`épouse du joueur de basket et la jeune fille sa maîtresse, jusqu'à ce que nous nous rendions compte que c'est le patron d'une épicerie-buvette, ancien tuberculeux lui aussi, qui raconte l'histoire. Mais nous sommes déjà piégés. Placés du point de vue de l'épicier, nous avons cru à l'existence du regard insomniaque de la jeune fille après la nuit qu'ils venaient de passer ensemble, nous avons composé le détail des heures d'éveil et d'étreintes, nous ne pouvons plus nous détacher de l'idée du triangle incestueux ldentifiés au narrateur, nous sommes des voyeurs qui déchargeons sur le protagoniste nos obsessions, voire nos complexes.
Ce court roman pose aussi le problème de la crédibilité du narrateur omniscient, ainsi que celui des rapports auteur-personnage. Le narrateur des "Adieux", l'épicier, malgré la satisfaction qu'il ressent, perçoit l'inébranlable détachement, l'indéracinable liberté de l'homme. Fort d'une longue expérience qu'il baptise pompeusement du nom d'intuition, il cherche à s'emparer de sa vie, à lui imposer un destin. Et contre la planification du monde d'en haut, l'ex-sportif mobilise toute son énergie, non sans susciter l'irritation et le débit du narrateur. L'intolérable indiscipline du malade, qui refuse de se soumettre, donne lieu à des commentaires sur son entêtement, sur sa volonté obstinée. Mais l'ex-champion ne se soumettra pas et se "libérera" par le suicide, comme bien des personnages d'Onetti ... (Trad. Christian Bourgois, 1985).

"El astillero" (1961, Le Chantier)
"Être un humain est une véritable épreuve" - Publié en 1961, deuxième de la saga de Santa Maria, ville imaginaire créée dans "La Vie brève", "Le Chantier" est l'un des plus sobres et des plus désolés des romans d'Onetti, l'un des plus beaux aussi.
Le vieux Jeremias Petrus, propriétaire d'un chantier naval qui a dû cesser toute activité à la demande des créanciers et dont les matériaux sont la proie de la rouille, cherche un gérant capable de relever de ses mines le chantier. Il croit le trouver en la personne de Larsen, qui, chassé autrefois de la province, a besoin de gagner sa rédemption au moyen d'une espérance. Larsen accepte donc le rêve absurde du "dieu" Jeremias Petrus, qui lui offre la réalisation de ses illusions dans un chantier en totale décrépitude. Petrus n`exige que la foi, et c'est la foi qui maintient les trois employés dans le dénuement, sans salaire, sans maison, seuls. Gálvez et Kunz, avec Larsen à leur tête, ne croient même pas à ce qu'ils touchent ni à ce qu'ils font, mais remplissent des fonctions inutiles, grimpent chaque jour l'échelle de fer et vont jouer aux sept heures de travail en sentant que le jeu est plus vrai que les toiles d'araignée, les gouttières. les rats et le bois pourri et spongieux. Pendant tout un hiver, déprimés, ils travaillent sous la pluie, le froid, dans une pénombre crasseuse; ballottés entre rien et pas grand-chose, ils sont parfois habités par une petite musique oblique, mais Onetti s'empresse vite de la faire taire.
Larsen fait une vaine tentative pour entrer dans le paradis, dans la maison de Jeremias Petrus. Il veut même le remplacer, être son héritier, devenir lui-même Dieu. C`est pour cela qu'il faisait la cour à la fille du patron, Angelica Inés, mais devant son refus, il doit se consoler avec sa domestique, dans les combles du grenier. Il se contente donc de Josefina et il meurt d'une pneumonie, se laisse mourir, ou est assassiné : l'ambiguïté demeure, comme il arrive souvent chez Onetti...
"PRÉFACE - Souvent, au cours de mes séjours en Amérique Latine, j’entendis parler de Juan Carlos Onetti. Son œuvre, m’assurait-on, rejoignait par nombre de ses aspects certaines recherches de la littérature française vivante, en particulier celles du « nouveau roman », et parfois elle les avait précédées. On s’étonnait qu’elle ne fût pas encore traduite. Je la connus, d’ailleurs, grâce à la traductrice du présent ouvrage, dont l’enthousiasme m’entraînait. Cette œuvre, dans son ensemble, disons-le à notre décharge, demeura longtemps méconnue sur les terres hispano-américaines ; mais on n’ignore plus de nos jours l’importance de son auteur.
Juan Carlos Onetti naquit en 1929, à Montevideo. Son nom n’indiquerait pas une origine italienne ; il faudrait y voir une déformation de l’irlandais O’Nety. Comme il advient parfois à ceux de ses compatriotes qui se destinent à une carrière littéraire, Onetti quitta la capitale de l’Uruguay pour Buenos Aires, où il vécut quinze ans. Il y exerça diverses activités journalistiques. Aujourd’hui, de retour dans sa patrie, il est directeur des bibliothèques municipales de Montevideo. Son œuvre compte plus de douze titres ; elle se compose de romans et de recueils de nouvelles. Le Prix National de Littérature d’Uruguay lui a été décerné en 1961.
Larsen, le héros du Chantier, surprendra-t-il le lecteur européen ? On peut imaginer, au contraire, que celui-ci découvrira dans ce personnage un « air de famille ». Larsen ne nous est pas inconnu… Il a des cousins, sur le vieux continent, qui pourraient s’appeler Meursault ou Roquentin. Le Chantier fut publié en 1961, mais à propos d’un livre précédent, Tierra de Nadie, paru en 1940, Onetti déclarait : « … Dans le pays le plus important de l’Amérique du Sud (l’Argentine) se multiplie le type de l’indifférent moral, de l’homme sans foi, sans intérêt pour son destin… » À ce type d’homme, il semble que l’auteur attache une particulière attention : ce n’est pas « l’étranger », comme nous disons, mais le desplazado, celui qui sans cesse éprouve le sentiment de n’être pas dans une situation appelant de sa part un engagement sans réserve. On est proche du portrait de l’Argentin de Buenos Aires brossé en 1932 par un jeune écrivain, Scalabrini-Ortiz, sous ce titre significatif : « L’homme qui est seul et qui attend. » (Max-Pol Fouchet, 1965)
Nous retrouverons Larsen quatre ans plus tard, ressuscité dans "Ramasse-Vioques". Il est alors investi d'une autre mission tout aussi singulière, créer le bordel parfait à Santa Maria. On a voulu voir dans la décrépitude du chantier une prémonition de la décadence de l'Uruguay. On peut aussi considérer qu'il s'agit d'une allégorie de notre chemin vers la mort : nous tous, fatalement, nous nous dégradons comme le chantier; nous nous vidons comme l'arsenal se vide de son personnel et même de ses bateaux, nous nous vidons des amis, des êtres qui nous sont chers. L'absurdité de l'existence, la fatalité, la farce que constitue la vie ici-bas sont plus accentuées dans "Le Chantier" que dans les romans précédents d'Onetti. Celui-ci sait, tous ses personnages savent que la vie est une farce. La seule chose qui reste à faire est précisément d'en accepter le jeu, accomplir un acte après l'autre sans raison, sans intérêt; exécuter la tâche de la meilleure manière possible sans se soucier du résultat, comme si un autre, ou plutôt d`autres, un maître pour chaque acte, nous payaient pour le faire. (Trad. Gallimard, 1984).
"Lorsque le gouverneur prit la décision, il y a cinq ans, d’expulser Larsen (alias Ramasse-Vioques) de la province, quelqu’un prédit, prophétie, propos en l’air, boutade sans importance, qu’il reviendrait et qu’on assisterait à la prolongation du règne des cent jours[1], page discutée et passionnante, – bien que déjà à moitié oubliée –, de l’histoire de notre ville. Bien peu y prêtèrent attention et il est sûr que Larsen lui-même, alors affaibli par sa défaite et encadré par la police, dût oublier aussitôt cette prédiction et renoncer à tout espoir qui eût trait à son retour parmi nous.
Quoi qu’il en soit, cinq ans après la conclusion de cette anecdote, Larsen descendit un matin à l’arrêt des autobus qui arrivent de Colon, posa un instant sa valise par terre pour tirer haut sur son poignet les manchettes de sa chemise de soie et entra dans Santa-Maria juste au moment où il finissait de pleuvoir ; à pas lents et roulant des épaules, un peu plus gros peut-être, un peu plus tassé, capable de passer inaperçu et dompté en apparence.
Il prit l’apéritif au comptoir du Berna, poursuivant calmement le patron des yeux jusqu’à ce qu’il en eût obtenu une tacite reconnaissance. Il déjeuna là, solitaire, et entouré par les chemises à carreaux des routiers qui disputaient à présent au chemin de fer les chargements pour El Rosario et les villages de la côte nord ; ils semblaient avoir été mis au monde tels quels, costauds et dans la fleur de l’âge, braillards et sans passé, au bord de la route goudronnée inaugurée quelques mois plus tôt. Larsen s’installa ensuite à une table proche de la porte et de la fenêtre pour boire café et pousse-café.
Nombreux sont ceux qui assurent l’avoir vu en cette mi-journée de fin d’automne. Certains ont surtout remarqué son air de ressuscité, la façon exagérée, presque caricaturale, dont il essayait de retrouver la nonchalance, l’ironie, le dédain voilé des attitudes et des expressions « d’avant » ; ils se souviennent de son désir extrême d’être identifié et reconnu, les deux doigts anxieux, prêts à monter jusqu’au bord du chapeau au moindre symptôme de salut, au moindre regard qui amorcerait la surprise de la rencontre. D’autres, au contraire, le trouvent toujours apathique et provocant, accoudé à la table, la cigarette aux lèvres, parallèle à l’humidité de l’avenue Artigas, regardant les têtes qui entraient, sans autre but que de se livrer à la comptabilité sentimentale des loyautés et des défections, comptabilisant les unes et les autres avec le même sourire, facile, bref, tout parcouru de tics.
Il paya son déjeuner en laissant le pourboire excessif de toujours, reprit possession de sa chambre à la pension du Berna et après la sieste, plus véritable, moins voyant depuis qu’il s’était débarrassé de sa valise, il se mit à parcourir Santa-Maria d’un pas pesant et frappant du talon sans y prêter attention, promenant devant les gens, les portes et les vitrines, son air d’étranger blasé. Il arpenta les quatre côtés de la place, puis ses deux diagonales comme s’il avait à résoudre le problème d’aller de A jusqu’à B en utilisant tous les chemins possibles et sans emprunter deux fois le même ; il fit les cent pas devant la grille noire, fraîchement peinte, de l’église ; il entra, plus lent, plus reconnaissable, plus que jamais sur ses gardes, dans la pharmacie que tenait toujours Barthé, pour se peser, acheter du dentifrice et des savonnettes, contempler l’écriteau qui disait « le pharmacien sera absent jusqu’à 17 heures » comme si c’eût été la photo inattendue d’un ami.
Il se hasarda ensuite dans les alentours, descendit, en exagérant le balancement de son corps, trois ou quatre cents mètres en direction du carrefour où se rejoignent la route de la côte et celle qui va à la colonie, le long de cette rue laissée à l’abandon au bout de laquelle il y a la petite maison aux balcons bleu ciel louée à présent par Morel le dentiste. On l’aperçut un peu plus tard près du Moulin de Redondo, les pieds enfoncés dans l’herbe humide, fumant, adossé à un arbre. À la ferme de Mantero, il frappa dans ses mains pour appeler, acheta un verre de lait et du pain, répondit évasivement à toutes les questions de ceux qui essayèrent de savoir qui il était (« il était triste, vieilli, avec comme une envie de se bagarrer, il montrait son argent comme si on avait peur qu’il partît sans payer »). Il réussit ensuite, sans doute, à se perdre pendant quelques heures dans la colonie, et, à sept heures du soir, il reparut au comptoir du bar du Plaza où il n’avait jamais mis les pieds quand il avait vécu à Santa-Maria. Il y répéta jusqu’à la nuit ses feintes d’agression et de curiosité qu’on attribua à sa station prolongée de la mi-journée au Berna. Avec le barman, il discuta, plein de bienveillance – et avec une allusion tacite, constante, au sujet enterré depuis cinq ans – formules de cocktail, taille des glaçons, longueur des cuillères. Peut-être s’était-il attendu à voir arriver Marcos et ses amis, le docteur Diaz Grey, il le regarda et ne daigna pas le saluer. Il paya sa nouvelle addition, poussa le pourboire sur le comptoir, descendit de son tabouret avec lourdeur, avec assurance, et s’engagea sur la bande de linoléum en se balançant sur un rythme concerté, bref et ample, persuadé que la vérité, même flétrie, naissait au seul bruit de ses pas et se répandait dans l’air, dans l’esprit des autres, avec insolence, avec simplicité.
Il sortit de l’hôtel et il y a tout lieu de croire qu’il traversa la place pour aller dormir dans sa chambre du Berna, mais aucun habitant de la ville ne se rappelle l’avoir vu pendant la quinzaine qui suivit. Et quand il reparut, c’est tout le monde qui put le voir, un dimanche, sur le trottoir devant l’église, à la sortie de la grand-messe, vieilli et poussiéreux, l’air rusé avec un petit bouquet de violettes qu’il pressait contre son cœur. Et nous vîmes aussi la fille de Jérémias Petrus – unique, idiote et célibataire – traînant son féroce bossu de père, battre des paupières d’un air ébloui et terrifié en passant devant Larsen, sourire presque aux violettes, puis, deux pas plus loin, baisser à nouveau vers le sol ses grosses lèvres boudeuses, ses yeux inquiets qui semblaient loucher...." (Éditions Gallimard, 1984, pour la traduction française revue et corrigée)

"Tan triste como elle y otros cuentos para una tumba sin nombre" (1959, Les bas-fonds du rêve)
"Coups d'éclat et coups de gueule, joutes pour rire qui débouchent sur la mort, feux de la rampe braqués l'espace d'un soir sur un champion déchu, une
courtisane défraîchie : les personnages de Juan Carlos Onetti sont ceux des tangos populaires que l'on fredonne en Uruguay, en Argentine. Minables héros d'une aventure frelatée avant d'être
vécue, ils ont pour rendez-vous Santa María.
Santa María : c'est dans cette ville imaginaire, quintessence de la vie provinciale, que se déroulent la plupart des romans et des nouvelles qu'Onetti à écrits tout au long de sa vie. Santa María : labyrinthe parcouru de fantômes voraces, hanté de rêves sordides, paradis des affaires véreuses, carrefour des tripots, terre promise de la supercherie, glorieuse de désirs inassouvis qui tuent ses habitants aussi sûrement que l'alcool qui y coule à flots. Santa María, c'est Montevideo ou Buenos Aires, où échouent les errants du monde entier en quête de fortune, d'identité, d'oubli. Écoutez cette voix poignante qui raconte avec une pitié pudique et une pointe d'humour noir l'angoisse quotidienne, le spleen et les médiocres joies du petit peuple : elle colle à la mémoire comme un air de bandonéon..." (Editions Gallimard, trad. de l'espagnol (Uruguay) par Laure Bataillon, Claude Couffon et Abel Gerschenfeld)
"L’album - Je la vis depuis la porte du journal, alors que j’étais appuyé contre le mur sous la plaque de cuivre portant le nom de mon grand père, Augustín Malabia, fondateur. J’étais venu remettre un article sur les récoltes ou sur la propreté des rues à Santa María, une de ces irrésistibles idioties que mon père appelle éditoriaux et qui, une fois imprimées, vous ont un air massif, à peine ventilé par les chiffres et qui pèsent ostensiblement en troisième page, toujours en haut et à gauche.
C’était un dimanche après-midi humide et chaud, du début de l’hiver. Elle arrivait du port ou de la ville avec une légère valise d’avion, enveloppée dans un manteau de fourrure où elle devait suffoquer, pas à pas le long des murs luisants, contre le ciel aqueux et jaunâtre, un peu raide, désolée, et on eût dit que c’était le soir tombant, le fleuve, la valse pistonnée sur la place par l’harmonie municipale, les jeunes filles tournant par couples autour des arbres nus qui l’amenaient jusqu’à moi.
À présent, elle longeait le Berna, plus jeune, plus petite dans son manteau ouvert, avec une curieuse agilité des pieds qui n’était pas transmise aux jambes, qui n’altérait pas sa dureté de statue de village.
Vásquez, le revendeur, arriva par le couloir, se planta à mes côtés, me regarda regarder en se nettoyant les ongles avec un canif, ennobli lui aussi, sans distinction de classe, par les deux mots du nom de mon grand-père. J’allumai ma pipe en attendant le moment de me mettre en mouvement et de traverser la rue en diagonale, d’effleurer peut-être la femme au passage, de repérer son âge à coup sûr et de claquer sur moi la portière de la voiture, la neuve, que mon père m’avait laissé prendre, mais elle s’arrêta au coin de la rue, cachant de la tête, de la pointe de son bonnet de laine, le pot à bière déteint que levait sur l’enseigne de la taverne un Teuton à moustache. Elle s’arrêta, les pieds joints, non pas volontairement mais parce que l’élan qui lui avait fait remonter la rue venait de mourir.
“Elle doit être un peu cinglée, dit Vásquez. Ça fait une semaine qu’elle est à l’hôtel, au Plaza ; elle est arrivée seule, chargée de malles, paraît-il. Mais tout le matin et aussi tout l’après-midi, elle balade cette petite valise le long du quai, même aux heures où n’arrivent ni ne partent aucune vedette ni aucun bac.
— Elle est moche et elle doit déjà avoir de la bouteille”, dis-je ; et je bâillai.
“Ça dépend, mon petit Georges, répondit Vásquez doucement. Il y en a encore plus d’un qui se la farcirait bien.” Il me toucha l’épaule en manière d’adieu et traversa la place en biais presque comme je projetais de le faire, petit et grisâtre, avec cette démarche héritée de son ami Junta, essayant de faire peser sur le goudron fangeux un poids qu’il n’avait pas. Il passa très près de la femme, au coin du Berna, sans tourner la tête, sans la regarder, et il entra dans la boutique.
Je savais que ce n’était pas pour moi – et peut-être pour personne ni même pour elle – que la femme s’était arrêtée, immobile et ocre au milieu de la soirée du dimanche, passivement ajoutée à la chaleur, à l’humidité, à la nostalgie sans objet. Pourtant, je restai là sans bouger, sans cesser de la regarder jusqu’à ce que ma pipe vide émette des râles, exactement au moment où il lui fallut avancer un pied et descendre du trottoir, continuer à avancer en direction de l’hôtel à travers le désert du carrefour qui nous avait séparés et réunis, à petits pas aisés, avec lesquels elle se proposait simplement de marquer l’écoulement du temps, traversant avec détachement le tremblement des cymbales, la hardiesse de la clarinette, le début de la nuit et les odeurs faibles, réticentes, dans leur anticipation de la mort.
Le lendemain matin, je pensais que Vásquez avait menti ou exagéré ou alors que la femme n’était plus à Santa María. Je revins en ville par le premier bus pour faire changer des cordes à ma raquette de tennis et pour assurer Hans que j’étais capable de mourir plutôt que de raconter qu’il m’avait coupé les cheveux un lundi matin, alors que la boutique était fermée, chuchotant lui et moi parmi des reflets de métal et de glaces dans la pénombre, puis j’achetai du tabac pour ma pipe et j’allai vers le port.
La femme n’y était pas et ne vint pas non plus ; le bac arriva avec un peu de monde, quelques sacs de blé ou de maïs et un vieil autobus tout déteint. Je fumais d’abord en me baladant, puis assis sur le quai, les jambes pendantes au-dessus de l’eau. Parfois, et de profil seulement, je surveillais le va-et-vient sur la chaussée et à la porte de la bâtisse rouge de la douane ; je n’arrivais pas à décider ce qu’il serait préférable de faire ou de penser quand la femme avec sa petite valise et son manteau trop chaud s’approcherait derrière moi pour me surprendre. Le bac donna un coup de sirène et quitta le quai à une heure précise. J’attendis encore, affamé, écœuré par la pipe. Les sacs de blé et le vieil autobus étaient restés sur le quai ; mon père écrirait dans le journal : “Avons-nous vraiment besoin d’importer du blé ? La glèbe jusqu’à hier encore féconde de Santa María…” ou encore : “Aide importante aux transports provinciaux. Le travail de modernisation entrepris systématiquement par notre commune…”
Presque appuyé sur l’horizon, tout petit, le bac s’était immobilisé. Je remontai vers la ville. J’avais déjà oublié la femme à la valise et je n’éprouvais plus ni amour ni curiosité pour cet appel, cette allusion que je lui avais vu établir dans l’espace qui nous séparait entre le coin du Berna et celui du Liberal. Désespéré, affamé, avalant le goût de phosphore de la pipe, je pensais : “Une mesure arbitraire, approuvée de façon inexplicable par les autorités dont nous dépendons, vient d’autoriser l’entrée de vingt-sept bushels et demi de blé dans le port de Santa María. Avec la même indépendance de vues qui nous a poussés à applaudir l’œuvre réalisée par le nouveau conseil, nous nous sentons cette fois dans l’obligation d’élever une voix réprobatrice mais au-dessus de tout soupçon.” (Éditions Gallimard, 1981, pour la traduction française)

"Juntacadáveres" (1964, Ramasse-Vioques)
Tout débute avec I`arrivée de trois prostituées, María Bonita la patronne, Irène la grosse et Nelly la blonde oxygénée. Les "vioques", les "cadavres" transportés dans ce trou perdu, sont pitoyables, pathétiques dans leur décrépitude. Leur venue est l'aboutissement de longs et fructueux pourparlers pour fonder la maison close qui manquait à Santa María, ville surgie d'un autre roman d'Onetti, "La Vie brève".
Larsen, alias Ramasse-Vioques, précède le trio. Il ne débarque pas à Santa María pour monter un bordel dans le seul but de se remplir les poches comme un vulgaire maquereau, mais avec l'idée grandiose de créer, avec ces trois "femmes invraisemblables", le bordel parfait, où chaque individu trouverait pour quelques instants la femme idéale. Toute la bonne société de Santa María le raille, et pourtant l'opération est on ne peut plus légale : la droite s'y opposait, mais le conseiller municipal, le pharmacien Euclides Barthé s'est battu pour obtenir ce lupanar ; il a même accepté de voter en échange la cession des travaux du port aux intérêts privés, ce à quoi il s'opposait depuis des lustres. Mais dans le sillage des trois vioques, le diable s'installe à Santa Maria. Leur présence trouble la paix de la ville dormante. Du haut de sa chaire, le prêtre Bergner lance le signal de la croisade au cours de ses homélies apocalyptiques. Son neveu Marcos, prototype du fasciste play-boy, en état d'ébriété permanent, ne vit que pour répudier la "conspiration judaïque", pendant que les jeunes filles de I'internat s`initient à l'art des lettres anonymes.
Autour de la grande place, le Bema, l'Universal, ces bars, lieux essentiels de la narration onettíenne, les ligues des honnêtes gens multiplient toutes les formes d'action pour chasser le démoniaque Larsen et ses trois résidus obscènes de femmes. Larsen lutte contre l'obscurantisme sans espoir d”être compris, d'ailleurs sans vraiment chercher à l`être. En fait il n`ignorait pas l'incapacité des Sanmariens à accéder à toute forme d`idéal. Venue défier l`ordre bourgeois de Santa María, la "maison aux volets bleus " avait introduit la peur et risquait de provoquer la dissipation. Son équipée utopique aura duré cent jours, à travers les évocations et souvenirs des trois narrateurs - Larsen, Onetti, le jeune Jorge Malabia, qui file un amour íncestueux avec Julita, veuve de son frère et assiste en spectateur à cette comédie que se jouent les adultes -, nous découvrons les "sales draps" de Santa María.
Au-delà, tel un géologue, Onetti paraît nous montrer les différentes couches qui forment la condition sud-américaine, marquée par la coexistence de groupes humains d`origines différentes, espagnols, italiens, polonais (suisses, à Santa María), créoles, exilés de toutes parts et de toutes les professions, et qui ont du mal à coexister. (Trad. Gallimard, 1987).
"Soufflant et suant, campé sur les cahots du wagon à l’embranchement d’Enduro, Ramasse parcourut le couloir et rejoignit le groupe des trois femmes, quelques kilomètres avant l’arrivée du train à Santa María. Il adressa un sourire plein d’allant aux visages gonflés d’ennui, rouges de chaleur, bâillements et bavardages. Le vert des champs le long du fleuve collait d’une faible fraîcheur aux vitres poussiéreuses.
« Dès que je leur dis que nous arrivons les voilà qui papotent, se maquillent, se rappellent leur boulot, deviennent plus laides et vieilles, font des mines de demoiselles, baissent les yeux pour examiner leurs mains. Elles sont trois et je n’ai pas mis quinze jours. Barthé a plus qu’il ne mérite, lui et tout le bourg, quoique peut-être riront-ils en les voyant et en riront-ils encore pendant des jours et des semaines. Elles n’ont plus quinze ans et habillées comme elles sont elles refroidiraient un jeune bouc. Mais elles sont correctes, elles sont bonnes, joyeuses et elles savent travailler. »
— On n’est plus très loin, dit-il avec un enthousiasme résigné.
Il tapota le genou de María Bonita et sourit aux deux autres, au visage enfantin et rond d’Irène et aux sourcils jaunes de Nelly, très hauts, droits, dessinés chaque matin pour s’accorder à l’indifférence, l’imbécillité, au vide de ses yeux.
— Je m’en doute, il était temps, répondit María Bonita. – Elle fronça la bouche vers la vitre et entreprit l’ouverture des sacs, le ballet des miroirs, poudriers, rouges à lèvres. – J’avais raison, après tout. Ce Santa María ça doit être un trou.
— Tout à fait d’accord, acquiesça Irène en égalisant d’un ongle le rouge sur sa bouche.
Irène se tapotait les ailes du nez avec la houppette de poudre de riz, languissante, sans conviction ; elle tenait ses gros genoux très écartés et son chapeau de paille, à large bord et chamarré, s’écrasait, se retroussait contre le dossier. Elle fit un demi-cercle du dos de la main sur la vitre de la portière ; elle vit un arc-en-ciel de pâtis desséchés, de champs, de lointains gris, verts et ocres chauffés par l’après-midi au ciel couvert.
— Moi je m’en fiche. C’est vrai que c’est pas la capitale ; mais j’aime la campagne.
— Tu l’as dit, ricana María Bonita, irritée. – Elle avait fini de se pomponner et tirait sur sa cigarette, droite et tranquille, assurée de son pouvoir occulte et son autorité. « Une femme », décréta Ramasse avec un orgueil sévère. – Ne crois pas courir les boutiques ni les petits bals. Faudra rester à la maison, travailler et savoir garder l’argent.
— On est venues pour ça, confirma Nelly. La ville c’est bien joli, mais ici c’est du solide.
— Il est encore à te regarder la bouche, gros tas, remarqua María Bonita.
Irène haussa les épaules et continua à faire des croix du bout du doigt sur la vitre.
— Je ne regardais pas, je vous jure, protesta Ramasse.
Il rit un peu avec elles, pour leur tenir compagnie, et il examina les autres voyageurs du compartiment. Il n’y avait aucun visage connu. « C’est sur le quai que ça va faire mal. » Il aperçut le bâtiment de l’École expérimentale, sombre et isolé au milieu d’un champ nu, dans un air immobile ; un drapeau pendait mollement, un camion chargé penchait en remontant la côte, vers la Colonie. Il pensa leur mentir sur les plantations et les récoltes, citer des chiffres et divers types de blé. Et bien qu’il ne dît rien, bien que ses pensées n’apparussent que sur la ligne blanchâtre de salive que traça son sourire, tandis qu’il se levait et aidait les femmes à descendre leurs valises, il devina que la tentation de dire des absurdités provenait de cette menace de fatigue, de cette peur de la fin qui l’avait tenaillé ces derniers mois, depuis le jour où il avait cru finalement venue l’heure de la revanche, l’heure de palper les beaux rêves, et où il s’était dit dans le doute qu’elle était peut-être arrivée trop tard.
Le quai serait comble, un groupe d’hommes regarderait depuis la porte du Cercle, un autre appuierait commodément le dos contre le coin de l’hôtel Plaza pour voir l’auto qui emmenait les trois femmes à la maisonnette de la côte ; ces trois femmes lasses, enlaidies, vieillies par le voyage, vêtues des hardes grotesques qu’elles avaient avidement achetées avec l’argent de l’avance.
II
Les femmes arrivèrent par le train de cinq heures, le premier lundi des vacances ; il n’y avait sur le quai que Tito et moi, deux porteurs et le télégraphiste. Il faisait chaud, l’air était humide et sans soleil, je sentais la dureté des sacs de maïs contre mes côtes et, plus en arrière, le silence des rues vides, de la place déserte. L’attente grossière et le refus s’étaient emparés de la ville depuis les rives du fleuve jusqu’aux champs d’avoine parallèles aux rails, atteignaient et recouvraient la position indolente de nos corps, le défi si pénible à soutenir, la tête haute et le sourire suspendu à la cigarette de Tito et à ma pipe.
« À chaux et à sable », avait dit Tito près du balcon de la coopérative ; l’agent de police nous regarda, sûr que nous continuerions à aller vers la gare, immobile et suant au carrefour, sur fond de rues solitaires, fenêtres et portes closes, souriant et nous appréciant avec la sale sagesse des adultes.
Nous étions adossés aux sacs, fumant encore et sans nous parler, quand le panache du train apparut au virage. Regardant le sourire revenu sur le visage de Tito, sa chemise ouverte, les jambes croisées, la cigarette imbibée de salive au bout des lèvres, je me vis moi-même, j’examinai ma bravade, doutai de la sincérité de ma haine. À mesure que Tito cessa de me singer et se mit à répéter les façons de son père, je fus contre lui, je me transformai presque en allié de la ville fermée.
« À chaux et à sable », avait dit le père de Tito la veille au soir ou au déjeuner, en imitant admiratif le ton de l’abbé Bergner, mon parent, à la réunion de la Ligue, le samedi. De sa main velue frappant la toile cirée à fleurs, la mère distrayant les enfants, l’employé de la quincaillerie approuvant en silence, prudent et respectueux, au-dessus de l’assiette de soupe au lointain haut bout de la table.
— Nous fermerons la ville à chaux et à sable, récita le quincailler. Je veux que ma maison reste fermée à chaux et à sable.
Et si c’était un seul mot, je pourrais l’offrir cette nuit ou demain à Julita, quand elle me demandera, comme toujours, de lui dire un mot qui puisse lui durer tout le lendemain pour l’user, comme une bougie, face au souvenir de mon frère mort. « Achozéassable », lui dirais-je, en me sentant un peu consolé, plus libre d’elle et de sa vicieuse infortune.
— Jorge, regarde sans rigoler, me dit Tito.
Il oubliait que je ne pouvais rigoler, que nous avions juré d’être indifférents, de ne pas aller au-delà de la politesse si l’une des femmes avait besoin d’aide.
Outre les trois femmes et l’homme, il ne descendit qu’un couple de vieux ; ils parlèrent avec le porteur puis ils suivirent le quai, lui en pantalon bouffant, tordu par la valise, agitant sa main libre au-dessus de la tête jaunâtre de la vieille, presque naine, et ils gagnèrent la barrière de El Triunfo, de l’autre côté de la voie ferrée.
— Ramasse-vioques, annonça Tito.
L’homme qui avait travaillé au journal de papa avant de s’occuper d’elles posa les valises par terre, prit un carton à chapeaux que lui passèrent les femmes, puis il se précipita à la portière pour les aider à descendre, sans nécessité, soutenant à peine le bout des doigts qu’elles lui tendaient, attentives à ne pas s’emberlificoter dans leurs jupes incroyables. Larsen – Ramasse – portait un complet neuf, sombre, un chapeau noir qui lui tombait sur les yeux ; il avait toujours été vêtu de gris à l’administration de El Liberal, humilié et laconique, mais trop ordinaire, trop vieux pour avoir ce que Julita appellerait une peine secrète. De toute façon, toujours gris, toujours boutonné, fortement nouée la cravate piquée d’une perle, même en été, juché sur le tabouret de l’administration, le nez busqué au-dessus des grands livres de comptabilité et les taches d’encre, les slogans politiques gravés au canif sur le pupitre, les poignets élimés de sa chemise mangeant la moitié de ses mains, avec ou sans peine secrète.
Il aida à descendre la dernière femme et toutes trois se retrouvèrent engourdies près des bagages, tapotant et lissant leur robe ; elles tournaient avec prudence leur cou pour risquer leurs mines incertaines, curieuses, sur la défensive, sur le vide du quai et le paysage décoloré, paisible où le couple de vieux rapetissait, à peine scintillant, où, au-delà de l’École expérimentale, un rayon de soleil, un seul, mince et dur, tardivement descendait éclairer l’arrivée des femmes à Santa María, promue au rang de ville quelques mois plus tôt.
Les porteurs prirent les valises, le carton à chapeaux, un sac en cretonne, et s’approchèrent de nous, trottinant et courbés, simulant l’effort ; l’un d’eux cligna un œil et nous montra une dent ; ils tournèrent à droite, martelant les dalles et la terre du chanvre de leurs espadrilles, franchirent le portillon peint en vert et installèrent les bagages dans la Ford de Carlos. Carlos fumait au volant, sérieux, sans les aider, sans répondre à leurs plaisanteries. Tito et moi cessâmes de sourire, défaisant nos sourires, douloureux, maintenant gâtés, qui pouvaient signifier n’importe quoi au lieu de e l’insouciante solidarité que nous avions décidé d’offrir aux regards.
Ramasse précédait les femmes d’un demi-pas et sa main droite pendait avec un bouquet de fleurs rouges, rachitiques. Il me regarda et ne voulut pas me reconnaître ; il arborait, contenu, l’air indulgent de celui qui revient au pays natal en triomphateur, il le dissimulait à demi sous une moue joyeuse et accommodante. Précédant les claquements de talons des femmes sur le quai, il les guidait avec la victorieuse assurance de son pas, le roulement confiant de ses épaules. Mais – pour moi, invisible aux femmes – les yeux saillants et la bouche, les joues bleutées et tombantes composaient sans insistance un masque affectueux et attentionné, insinuaient habilement que lui, Larsen – alias Ramasse-vioques – ne participait en aucune manière au destin et à la condition du trio de femmes qu’il traînait sur les dalles grises. Dans l’air voilé de l’après-midi, évoluant en mesure devant les formes et couleurs des soies, chapeaux, ornements, bijoux, figures et bras nus, le visage de Ramasse tourné vers la lutte, la trahison et le négoce, pouvait traduire, indifféremment, la vigueur ou la faiblesse de son entreprise, de lui-même par rapport à son entreprise.
Ramasse un peu en avant et elles trois en rang, évoluant en accord ; la grosse maternelle, la blonde stupide et maigre, la plus grande au milieu, juste derrière Ramasse. Toutes portaient des robes, longues, serrées à la taille, chapeaux à fleurs, fruits et voilette, volants et fanfreluches aux hanches. Elles ne semblaient pas venir de la capitale mais de beaucoup plus loin, d’un âge d’imprécise mémoire. Les voilà qui tournaient, bras dessus, bras dessous, le verbe délibérément haut, un demi-pas derrière l’homme en noir qui les conduisait, pour se diriger vers la barrière de bois vert, où attendaient les deux porteurs et trépidait le capot de la Ford de Carlos. La femme la plus grande me regarda une seconde quand elles effectuaient le quart de tour pour sortir de la gare ; elle me sourit et ferma à demi les yeux, sa bouche disparut derrière le profil de brebis de la blonde maigre...." (Éditions Gallimard, 1986, pour la traduction française)
Si Sábato explorait l'angoisse métaphysique, Onetti, lui, a plongé dans la désillusion, le désenchantement et la marginalité avec un style et une vision du monde uniques.
Onetti est le père du "cycle de Santa Maria", une ville fictive qu'il a créée et qui est devenue le décor récurrent de la plupart de ses romans majeurs (La Vie brève, Le Chantier, L'Adieu, etc.). Santa Maria n'est pas une simple ville imaginaire comme Macondo (García Márquez) ou Comala (Rulfo). C'est un espace mental, un état d'âme. C'est un port fluvial morne, étouffant, peuplé de rats, de brume et de personnages vaincus, rêveurs, alcooliques et cyniques. Elle incarne le déclin, la stagnation et la mélancolie d'une certaine réalité sud-américaine. Et contrairement au réalisme magique qui mythifie le réel, Onetti pratique un "réalisme halluciné". La réalité de Santa Maria est déformée par la subjectivité de ses personnages, leurs fantasmes et leurs échecs. Il a ainsi ouvert une voie alternative et profondément moderne pour décrire le continent.
Un Précurseur du "Boom" Latino-Américain - Onetti est souvent considéré comme le premier moderniste de la narrative sud-américaine. Alors que le "Boom" (années 60-70) a popularisé les innovations techniques, Onetti les expérimentait déjà dans les années 40 et 50. Il a complexifié la structure du roman bien avant ses célèbres successeurs. Son œuvre maîtresse, "La Vie brève" (1950), est un chef-d'œuvre de construction narrative avec des jeux sur les points de vue, les niveaux de réalité (un personnage qui en invente un autre) et une temporalité non linéaire. Des auteurs comme Mario Vargas Llosa (qui lui a consacré un essai), Juan José Saer, ou même Julio Cortázar ont reconnu sa dette envers Onetti. Il a prouvé qu'on pouvait écrire sur l'Amérique du Sud avec une langue et des techniques résolument modernes, sans folklore.
Ses thèmes de prédilection résonnent profondément avec l'histoire du continent ..
- L'échec et la fuite : Ses personnages sont des "anti-héros" par excellence. Ils fuient dans l'alcool, le sommeil, les fantasmes ou des projets absurdes pour échapper à une réalité qui les a déçus.
- La marginalité : Onetti donne une voix aux exclus, aux ratés, aux laissés-pour-compte. Il ne juge pas, il constate avec une lucidité souvent cruelle et parfois teintée d'une ironie douce-amère.
- Une vision existentielle : Son œuvre pose des questions universelles : comment donner un sens à sa vie quand tous les idéaux (l'amour, la révolution, le succès) se sont effondrés ? Comment survivre dans un monde absurde ?
Enfin, sa prose est sèche, précise, sans fioritures, mais d'une grande puissance poétique et suggestive. Il crée une atmosphère incomparable de fatalité et de mélancolie. Et bien que moins médiatique que d'autres auteurs du Boom, la stature d'Onetti est immense dans le monde littéraire : il a reçu le prix Cervantes, le plus prestigieux de la littérature en langue espagnole en 1980, consécration ultime de son importance.
Il a non seulement changé le cours de la littérature de langue espagnole en lui insufflant une modernité narrative radicale, mais son engagement lui a valu des ennuis avec la dictature militaire uruguayenne. En 1974, il est emprisonné plusieurs mois en Uruguay pour avoir été membre du jury d'un prix littéraire attribué à une nouvelle jugée "subversive" (La garde au ciel) de Nelson Marra. Il choisit ensuite l'exil en Espagne. Son engagement est une désertion active. Il ne cherche pas à convaincre la junte mais à lui échapper pour préserver son intégrité artistique et humaine. C'est une résistance par l'absurde et le retrait.
Ses personnages sont des vaincus qui se réfugient dans des mondes parallèles (comme Santa Maria). Sa vie devient l'incarnation de ses thèmes : la fuite comme ultime forme de résistance à un monde absurde et oppressant....

"Dejemos hablar al viento" (1979, Laissons parler le vent)
"Louche médecin à Lavanda, Medina doit vite abandonner ses activités. Sous la férule de Frieda von Kliestein et du douteux marchand de tableaux
Carve-Blanco, il revient à sa vocation première : la peinture. Il exécute des portraits et des nus, notamment d'Olga et de Juanina, deux femmes fascinantes dont il a fait ses maîtresses,
quoiqu'il entretienne depuis toujours avec Frieda une liaison violente, cruelle, mais, finalement, constante. Puis Medina quitte Lavanda et le monde foisonnant et ambigu qu'il y avait fréquenté.
Il renonce à son art, retourne à Santa María, «sa» ville, dont il a gardé la nostalgie, pour y exercer de nouveau le métier de commissaire, tandis que Frieda, qui l'a suivi, y devient chanteuse
de beuglant. Avec eux, encore, Seoane, jeune alcoolique et drogué qui est peut-être un fils naturel de Medina et dont Frieda a fait son amant, par jeu. Un jeu qui s'achèvera dans la tragédie. On
ne peut sans doute brosser d'univers plus grouillant d'anecdotes et de personnages, ni plus vivant, plus humain, que celui mis en scène ici par Onetti. Et, si ce monde est interlope et ses fins
désastreuses, du moins son auteur lui confère-t-il une singulière et ténébreuse beauté, tout entière à l'image de Santa María, la ville douteuse et corrompue, mais superbe, qu'Onetti a construite
pour son cycle romanesque, et qui en est comme le protagoniste principal." (Editions Gallimard, Trad. de l'espagnol (Uruguay) par Claude Couffon).

"Cuando entonces" (1987, C'est alors que)
"C'est alors que raconte l'histoire de Magda, une très belle prostituée de Buenos Aires, arrachée au bordel d'une certaine madame Safo et luxueusement
entretenue par un important chef militaire. Lequel, marié à une femme immensément fortunée, est incapable de sortir de la situation pour épouser la jeune femme. Sans doute par dépit amoureux,
Magda a-t-elle continué à exercer le plus vieux métier du monde. Jusqu'au jour où un client l'a trouvée baignant dans le sang, la tête éclatée par un coup de revolver. En même temps, un avion
s'écrasait, à bord duquel voyageait l'homme qu'elle aimait. Dans ce récit concis et précis, mais émietté, on réentend la voix du grand
romancier de La vie brève, Le chantier, Ramasse-vioques, du conteur incomparable des Bas-fonds du rêve. Et l'on retrouve sa vision du monde qui, farouchement pessimiste, ne nous laisse cependant
pas oublier que seul le pessimiste sait se révolter contre le mal quand l'optimiste, lui, ne fait que s'en étonner. Ainsi Onetti transforme-t-il son désespoir en un cri éperdu pour réclamer un
peu de solidarité, et un peu plus de tendresse." (Editions Gallimard, Trad. de l'espagnol (Uruguay) par Albert Bensoussan)
