- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Svevo - Pirandello
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki
- 1930-1940
- 1930s
- Fitzgerald
- Hemingway
- Faulkner
- Koch
- Céline
- Bernanos
- Jouve
- DosPassos
- Kojève
- Miller-Nin
- Grosz - Dix
- Green
- Ortega y Gasset
- Wittgenstein
- Russell - Carnap
- Artaud
- Jaspers
- Sapir - Piaget
- Guillén
- Garcia Lorca
- Hammett
- A.Christie
- Heidegger
- Icaza
- Huxley
- Hubble
- Caldwell
- Steinbeck
- Waugh
- Blixen
- Rhys
- J.Roth - Doderer
- Aub
- Malraux-StExupéry
- DBarnes-NWest
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bataille
- Char-Michaux
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Bloch
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Lewin - Mayo - Maslow
- Montherlant
- Buzzati - Pavese
- Vittorini
- Fallada
- Malaparte
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Welty
- Boulgakov
- Tamiki - Yôkô
- Weil
- Gadda
- Broch
- Steeman
- Jouhandeau
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Ellison
- Bergman
- Baldwin
- Fromm
- Bradbury - A.C.Clarke
- Tennessee Williams
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Carpentier
- Mishima
- Salinger - Styron
- Pasternak
- Asturias
- O'Connor
- Hoffer
- Matute - MartinGaite
- 1960-1970
- 1960s
- Abe
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- U.Johnson - C.Wolf
- Heller - Toole
- Naipaul
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Onetti - Sábato
- Capote
- Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- McCarthy - Minsky
- Sillitoe
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- Lenz
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Dolls
- Ellis
- Cortázar
- Warhol
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- HarperLee
- Fuentes
- 1970-1980
- 1970s
- Habermas
- Handke
- GarciaMarquez
- Deleuze
- Derrida
- Beck
- Satir
- Kundera
- Hrabal
- Didion
- Guinzbourg
- Lovelock
- Vietnam
- H.S.Thompson - Bukowski
- Pynchon
- E.T.Hall
- Bateson - Watzlawick
- Carver
- Irving
- Milgram
- VargasLlosa
- Puig - Donoso
- Lasch-Sennett
- Crozier - Touraine
- Friedan-Greer
- Jacob-Monod
- Dawkins
- Beattie - Phillips
- Gaddis
- Rawls
- Zinoviev
- H.Searles
- Ballard
- Jong
- Kôno
- Calvino
- Ballester-Delibes
- ASchmidt
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact
- 1960s
- Abe
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- U.Johnson - C.Wolf
- Heller - Toole
- Naipaul
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Onetti - Sábato
- Capote
- Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- McCarthy - Minsky
- Sillitoe
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- Lenz
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Dolls
- Ellis
- Cortázar
- Warhol
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- HarperLee
- Fuentes

Literatur der deutschen Teilung - Uwe Johnson (1934-1984), "La Frontière" (Mutmaßungen über Jakob, 1959), "L'impossible
biographie" (Das dritte Buch über Achim, 1961), "Deux points de vue" (Zwei Ansichten, 1965) - Christa Wolf (1929-2011), "Christa T." (Nachdenken über Christa T, 1968), "Le ciel divisé" (Der
geteilte Himmel, 1963), "Was Bleibt?" (1990) ...
Last update: 12/31/2016

RFA/RDA, "die deutsche Teilung" - La fin de la guerre laisse l'Allemagne en ruines et en phase de liquidation de son héritage nazi : en littérature, la langue allemande se reconstruit autour d'écrivains suisses ou autrichiens. Les circonstances de cette guerre, les crimes sans mesure au XXe siècle qu'elles ont générés, semble générer de nouvelles conditions existentielles, le temps d'une longue et difficile interrogation sur le pourquoi et le comment.
Mais les générations suivantes persisteront-elles dans ce questionnement? on ne lit déjà plus Hans Werner Richter, Hans Magnus Enzensberger...
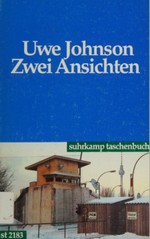

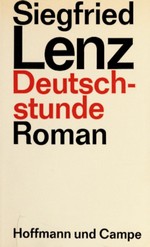

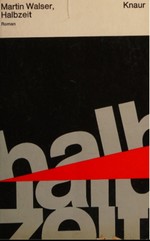
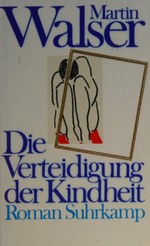

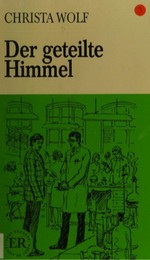
La littérature du partage RDA / RFA - Ici, on distingue selon le contexte,
- La "Literatur der DDR“, ou la littérature produite en RDA, avec ses propres débats (réalisme socialiste, critique interne, dissidence).
- La "Literatur der Bundesrepublik“, soit la littérature produite en RFA, souvent plus expérimentale et pluraliste.
Après 1990, on parle parfois de "geteilte deutsche Literatur“ (« littérature allemande partagée ») pour désigner la coexistence de deux traditions littéraires parallèles entre 1949 et 1989.
Certains critiques emploient aussi le terme "Wendeliteratur“ (« littérature du tournant », de la Wende = changement) pour les textes qui traitent explicitement de la chute du Mur et de la réunification.
Pour des auteurs comme Uwe Johnson (qui écrit depuis l’Ouest mais sur l’Est) et Christa Wolf (qui reste en RDA mais critique de l’intérieur), on parle souvent de "Literatur der deutschen Teilung“ (« littérature de la division allemande »). Le thème central est ici la séparation RDA/RFA et ses effets existentiels, politiques et culturels...

L'armée allemande capitule en 1945 et les Alliés partagent alors l'Allemagne en plusieurs zones d'occupation; en 1949, les zones américaine, française et britannique deviennent la République fédérale d'Allemagne (RFA) et la zone soviétique devient la République démocratique allemande (RDA). C'est en 1961 que la RDA, pour enrayer l'émigration massive des ressortissants d'Allemagne de l'Est vers les quartiers ouest de Berlin, érige un mur entre les secteurs oriental et occidental de Berlin. En 1969, le social-démocrate Willy Brandt devient chancelier, et cherche à rétablir de meilleures relations avec l'Union soviétique et l'Allemagne de l'Est (Ostpolitik). En 1971, Erich Honecker succède à Walter Ulbricht à la tête de la RDA, et le nouveau chancelier Helmut Schmidt, qui remplace un Willy Brandt discrédité par la fameuse affaire d'espionnage suscitée par Günter Guillaume, (1974) poursuit la politique d'ouverture de la RFA à l'Est. En 1973-1976, la situation se durcit en RDA: espionnage, propagande, Stasi et mitraillage automatique aux frontières. Les années 1980 détendent ensuite les relations inter-Allemagne. En 1989, alors que le bloc soviétique annonce son intention d'entrouvrir les frontières, la RDA suit en supprimant les restrictions sur les voyages à l'étranger, des centaines d'Allemands de l'Est se précipitent vers l'ouest, débouchant sur la Chute du Mur de Berlin.
Le renouvellement de la littérature allemande, à l'Ouest, s'effectue, dans les années cinquante, grâce à la génération rassemblée autour du "Gruppe 47", qui de 1947 à 1977, réunit des écrivains de langue allemande comme Günter Eich (1907-1972), Heinrich Böll (1917-1985), Günter Grass (1927-2015) , Uwe Johnson (1934-1984) , Ilse Ainchinger (1921-2016), Ingeborg Bachmann (1926-1973), Martin Walser (1927), qui veulent affronter la réalité en soutenant l'effort de reconstruction d'Adenauer tout en analysant les survivances morales du passé. C'est que l'on appelle couramment l'ère d'un «réalisme critique» où la description sociologique s'allie aux recherches formelles qui remettent en cause le principe même de la narration subjective.
Martin Walser dénonce l'utopie d'une conversion profonde de l'Allemagne (Chêne et lapins angora, 1962) et décrit dans ses romans (Couples à Philippsbourg, 1957) la société froide du "miracle économique". Heinrich Böll peint au travers du petit bourgeois catholique rhénan la persistance d'une certaine Allemagne, comme dans "Billard à neuf heures et demie" (1959). Uwe Johnson (Conjectures sur Jacob) part à la recherche de son personnage, tandis que Günter Grass écrit le roman du roman avec le premier volet de sa Trilogie de Dantzig, "Le Tambour". Et comme Günther Grass et Heinrich Böll, Siegfried Lenz (1926-2014) étudie les conséquences du passé totalitaire allemand sur les années d'après-guerre, et dans son roman le plus célèbre, "Deutschstunde" (la Leçon d'allemand, 1968) , il va s'intéresser directement à la notion de "devoir" : comment affecte-t-elle le père de Siggi Jepsen, son "héros", qui doit obéir aux ordres, le peintre expressionniste Nansen, guidé par sa conscience et sa vocation et que l'on veut interdire, et Siggi, le fils, qui se débat entre les deux? C'est bien la remise en question de l'autorité qui est ici évoquée.

Enfin la constitution de la RDA en 1949, puis la construction du Mur vont créer les conditions d'une littérature spécifique. Succédant à Anna Seghers et à Johannes Bobrowski, la littérature des années 1960 en RDA voit cohabiter une instrumentalisation destinée à construire "le socialisme réel existant" (Erik Neutsch) et une nouvelle génération qui introduit des attitudes et des sentiments contradictoires (Christa Wolf). D'un côté l'engagement politique et social se fait au détriment de la vie intérieure, de l'autre en se laissant gagner par l'introspection, est mis à nu le déficit des espérances déçues. Pour Christa Wolf, "le passé n'est pas mort; il n'est même pas passé. Nous nous coupons de lui et le traitons en étranger." Hantée par la nécessité de ne pas se laisser asphyxier par un passé qu'on refoule, elle a toujours eu le sentiment que dans la littérature de son pays, la République démocratique allemande, les écrivains ne parlaient pas des évènements personnels et historiques les plus aigus pour se laisser aller très loin dans l'autocensure. Deux mondes, RFA, RDA, trois décennies qui sembleront les opposer tant les idéologies et les institutions politiques qui les servent parviennent à forger des pensées, des langages, des automatismes d'écriture, jusqu'à ce que la réalité humaine en vienne insensiblement à les remettre en question ...

Uwe Johnson (1934-1984)
"Aber Jakob ist immer quer über die Gleise gegangen" (Mais Jacob a toujours traversé les voies). Uwe Johnson a connu la RDA avant le Mur, en 1956,
la répression, les tentatives de soulèvements, puis l'Allemagne de l'Ouest (Berlin) et au final n'a pu se résoudre à rejoindre l'un ou l'autre camp. Homme de bonne volonté, il lui faut
prendre de la distance pour parler des deux Allemagnes et tenter de comprendre... On lui reconnaît, avec Günter Grass, une virtuosité dans l'écriture de ses romans rarement atteinte depuis
Thomas Mann.
Uwe Johnson (1934–1984), romancier associé au Groupe 47, fut l’un des premiers à explorer la division allemande à travers la littérature. Son grand cycle Jahrestage (Anniversaires, 1970-1983) est un monument de prose expérimentale, mêlant récit quotidien, coupures de presse, souvenirs personnels et histoire collective (notamment la RDA et le nazisme). Son style fragmentaire et sa manière d’entrelacer la mémoire individuelle avec la mémoire collective l’ont rapproché des techniques du nouveau roman ou du modernisme anglo-saxon.
Considéré comme un précurseur de la littérature de la mémoire en Allemagne, son œuvre reste étudiée pour comprendre la construction de l’identité allemande après 1945, surtout la relation entre l’Est et l’Ouest. Mais il reste plus lu dans le cadre universitaire et critique que par un grand public ...
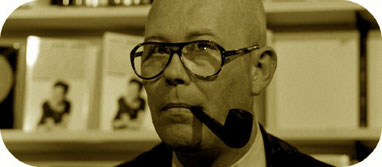
Né dans un village de Poméranie, Cammin, après ses études à Rostock et à Leipzig, Uwe Johnson quitte la RDA en 1959 - il a été en effet reconnu officiellement inapte à un emploi public, non-conformiste, haine du troupeau organisé, - vit quelque temps à Berlin-Ouest (1959), à Rome (1962) et aux USA (1966-68), avant de s'installer en Angleterre. Son premier roman "La frontière", l'impose d'emblée comme l'un des auteurs majeurs de sa génération. A travers le destin tragique d'un homme, il décrit l'Allemagne de l'après-guerre et des Allemands qui ne se sentent chez eux ni d'un côté ni de l'autre de la frontière qui maintenant les sépare. Ce thème, qui réapparaît dans tous ses livres, contribue à faire de lui "le premier auteur des deux Allemagnes" et sa technique (superposition d'images, retours en arrière, insertions de documents, articles de journaux...) celui d'un écrivain d'avant-garde. Ces mêmes principes d'écriture se retrouvent dans sa grande entreprise romanesque à laquelle il se consacre entièrement à partir de 1968 et où il reprend des personnages de son premier livre: Conjectures sur Jacob (Mutmassungen über Jakob, 1959), L’impossible biographie (Das dritte Buch über Achim, 1962), Une année dans la vie de Gesine Cresspahl (Aus dem Leben von Gesine Cresspahl, 1970, 1971, 1973, 1983), Une visite à Klagenfurt (Eine Reise nach Klagenfurt, 1974), Concomitances (Begleitumstände, 1980), L'accidenté (Skizze eines Verunglückten, 1981).
Le premier roman publié d'Uwe Johnson est un livre difficile en raison de la complexité de sa construction narrative, mais son thème (la division de l'Allemagne) a immédiatement fait connaître le jeune auteur d'après-guerre et le "Grenzganger" de l'Allemagne de l'Est. Origine : la mère de Johnson travaillait à la Reichsbahn comme contrôleuse, puis dans le transport de marchandises. Après sa fuite, son fils a pu continuer à manger à la cantine ferroviaire de Gustrow. C'est ainsi qu'il a découvert le monde du travail. Après avoir eu des difficultés à faire imprimer les premiers scripts de ses romans, Johnson écrivit entre le 6 février et le 4 décembre 1958 le livre qui devait d'abord s'appeler "Guten Tag, Jakob" et paraître sous le pseudonyme de Joachim Catt. Synopsis : Jakob Abs, 28 ans, originaire du Mecklembourg, est fonctionnaire à la Reichsbahn de la RDA à Dresde. En novembre 1956, il est écrasé par une locomotive sur le terrain de manœuvre. Que sa mort soit un accident dans le brouillard, un suicide ou même planifiée par les autorités ne peut faire l'objet que de "soupçons" qui éclairent ses antécédents (Jakob Abs, 28 Jahre alt, stammt aus Mecklenburg und ist Beamter bei der DDR-Reichsbahn in Dresden. Im November 1956 wird er auf dem Rangiergelande von einer Lok uberfahren. Ob sein Tod ein Unfall im Nebel, Selbstmord oder gar von den Behorden geplant war, kann nur Gegenstand von "Mutmassungen" sein, welche die Vorgeschichte erhellen) ... Un livre ponctué de références bibliques, à commencer par le nom de Jacob, qui lui confèrent une dimension supra-temporelle. Pour l'auteur, la complexité de la narration n'était pas un formalisme, mais l'expression adéquate de la situation allemande. Le livre, conçu comme une contribution critique à la littérature indépendante de la RDA, a fait sensation, car Johnson s'est installé à l'Ouest peu après sa publication par la maison d'édition Suhrkamp de Francfort. La RDA l'a ignoré pendant 20 ans ; on peut lire le roman "Der geteilte Himmel" (1963) de Christa R Wolf comme le contre-projet d'un impossible dialogue, le temps de quelques décennies ..

La Frontière (Mutmaßungen über Jakob, 1959)
"Un cheminot a été écrasé par un train. S'agit-il d'un accident ou d'un suicide? Uwe Johnson se livre à une véritable enquête policière : il retrace les derniers jours de Jacob Abs, évoque ses amours et ses amitiés et scrute les motifs possibles de l'attitude de son héros. Mais Uwe Johnson n'a pas voulu seulement écrire un roman policier. La Frontière est un des grands romans politiques de notre époque et il se déroule à la lisière de deux mondes, à la frontière entre les deux Allemagnes. Tout notre destin est engagé dans les actes et discussions des personnages qui peuplent ce roman que la critique du monde entier a considéré comme le livre le plus important écrit en Allemagne depuis la fin de la guerre.
Uwe Johnson se sert de toutes les techniques romanesques pour nous conter cette histoire. Il ne prend position ni pour, ni contre le roman classique, comme
il refuse d'opter exclusivement en faveur des expériences les plus récentes. Il utilise tous les moyens d'expression qui lui semblent nécessaires à l'expression de toute la complexité du monde où
nous vivons. " (Editions Gallimard)
I - Aber Jakob ist immer quer über die Gleise gegangen.
– Aber er ist doch immer quer über die Rangiergleise und die Ausfahrt gegangen, warum, aussen auf der anderen Seite um den ganzen Bahnhof bis zum Strassenübergang hätt er eine halbe Stunde länger gebraucht bis zur Strassenbahn. Und er war sieben Jahre bei der Eisenbahn.
– Nun sieh dir mal das Wetter an, so ein November, kannst keine zehn Schritt weit sehen vor Nebel, besonders am Morgen, und das war doch Morgen, und alles so glatt. Da kann einer leicht ausrutschen. So ein Krümel Rangierlok ist dann beinah gar nicht zu hören, sehen kannst sie noch weniger.
– Jakob war sieben Jahre bei der Eisenbahn will ich dir sagen, und wenn irgend wo sich was gerührt hat was auf Schienen fahren konnte, dann hat er das wohl genau gehört
unterhalb des hohen grossglasäugigen Stellwerkturms kam eine Gestalt quer über das trübe dunstige Gleisfeld gegangen, stieg sicher und achtlos über die Schienen eine Schiene nach der anderen, stand still unter einem grün leuchtenden Signalmast, wurde verdeckt von der Donnerwand eines ausfahrenden Schnellzuges, bewegte sich wieder. An der langsamen stetigen Aufrechtheit des Ganges war vielleicht Jakob zu erkennen, er hatte die Hände in den Manteltaschen und schien geraden Nackens die Fahrten auf den Gleisen zu beachten. Je mehr er unter seinen Turm kam verdunsteten seine Umrisse zwischen den finster massigen Ungeheuern von Güterzugwagen und kurzatmigen Lokomotiven, die träge ruckweise kriechend den dünnen schrillen Pfiffen der Rangierer gehorchten im Nebel des frühen Morgens auf den nass verschmierten Gleisen
– wenn einer dann er. Hat er mir doch selbst erklärt, so mit Physik und Formel, lernt einer ja tüchtig was zu in sieben Jahren, und er sagt zu mir: Bloss stehenbleiben, wenn du was kommen siehst, kann noch so weit wegsein. »Wenn der Zug im Kommen ist – ist er da« hat er gesagt. Wird er auch bei Nebel gewusst haben.
– Eine Stunde vorher haben sie aber einen Rangierer zerquetscht am Ablaufberg, der wird das auch gewusst haben.
– Deswegen waren sie ja so aufgeregt. Wenn sie auch gleich wieder Worte gefunden haben von tragischem Unglücksfall und Verdienste beim Aufbau des Sozialismus und ehrendes Andenken bewahren: der sich das aus den Fingern gesogen hat weiss es gewiss besser, wär schon einer. Frag doch mal auf diesem ganzen verdammten Bahnhof ob einer jetzt noch im November Ausreiseerlaubnis nach Westdeutschland gekriegt hat, und Jakob ist am selben Morgen erst mit einem Interzonenzug zurückgekommen. Denk dir mal bei wem er war.
– Cresspahl, wenn du den kennst. Der hat eine Tochter.
I – Mais Jakob a toujours traversé les voies en diagonale.
– Mais il a toujours traversé en diagonale les voies de triage et la sortie, pourquoi faire, à l'extérieur de l'autre côté, faire le tour de toute la gare jusqu'au passage à niveau, il lui aurait fallu une demi-heure de plus pour arriver au tram. Et il avait sept ans de chemin de fer.
– Alors regarde un peu le temps, un mois de novembre comme ça, on ne voit pas à dix pas à cause du brouillard, surtout le matin, et c'était bien le matin, et tout si glissant. On peut facilement glisser. Une minuscule loco de manœuvre, on l'entend à peine, et on la voit encore moins.
– Jakob avait sept ans de chemin de fer, je te dis, et si quelque part quelque chose bougeait qui pouvait rouler sur des rails, alors il l'avait bien entendu.
En contrebas de la haute tour de signalisation aux grands yeux de verre, une silhouette vint en traversant le champ de rails trouble et brumeux, enjamba avec assurance et indifférence les rails un à un, s'arrêta sous un mât de signalisation vert lumineux, fut cachée par le mur de tonnerre d'un express qui sortait, se remit en mouvement. À la lente et constante rectitude de la démarche, on pouvait peut-être reconnaître Jakob, il avait les mains dans les poches de son manteau et semblait, la nuque droite, surveiller les circulations sur les voies. Plus il approchait de sa tour, plus ses contours s'évaporaient entre les monstres massifs et sombres des wagons de marchandises et les locomotives essoufflées qui, rampant paresseusement par à-coups, obéissaient aux sifflements aigus et ténus des chefs de manœuvre dans le brouillard du petit matin sur les rails mouillés et souillés.
– Si quelqu'un devait... C'est lui qui me l'a expliqué, avec de la physique et des formules, on apprend pas mal de choses en sept ans, et il me dit : Surtout, s'arrêter, si tu vois quelque chose venir, même si c'est encore loin. « Quand le train arrive – il est là » qu'il a dit. Il devait le savoir aussi par brouillard.
– Mais une heure avant, ils avaient écrasé un chef de manœuvre à la butte de triage, lui aussi devait le savoir.
– C'est pour ça qu'ils étaient si excités. Même s'ils ont tout de suite retrouvé des mots comme accident tragique et mérites dans l'édification du socialisme et souvenir honoré : celui qui a inventé ça de toutes pièces sait certainement mieux, ça aurait déjà été quelqu'un. Demande donc dans toute cette foutue gare si quelqu'un a encore reçu en novembre une autorisation de sortie pour l'Allemagne de l'Ouest, et Jakob, ce matin même, venait juste de revenir avec un train interzones. Imagine chez qui il était.
– Cresspahl, si tu le connais. Il a une fille.
Mein Vater war achtundsechzig Jahre alt in diesem Herbst und lebte allein in dem Wind, der grau und rauh vom Meer ins Land einfiel hinweg über ihn und sein Haus
Mon père avait soixante-huit ans cet automne et vivait seul dans le vent, gris et rude, qui s'abattait de la mer vers les terres, passant sur lui et sa maison.
Heinrich Cresspahl était un homme puissant, large, aux mouvements lents et pesants, sa tête était une vieille tour patinée sous des cheveux gris courts, sans raie. Sa femme était morte depuis dix-huit ans, sa fille lui manquait. Dans son atelier, peu de travail était accroché aux murs, il avait depuis longtemps retiré l'enseigne de son métier de la porte d'entrée. Occasionnellement, pour le musée régional, il réparait des meubles précieux et pour des gens qui se transmettaient son nom. Il parcourait beaucoup la campagne en velours côtelé et bottes longues, cherchant de vieilles malles et des armoires paysannes. Parfois, des charrettes à cheval s'arrêtaient devant sa maison avec des pièces qu'on y portait ; plus tard, des voitures des grandes villes vinrent et emportèrent le bois brun foncé, artistiquement assemblé, avec ses ferrures décoratives aux reflets mats. C'est ainsi qu'il subvenait à ses besoins. Déclaration d'impôts en règle, compte bancaire modeste correspondant aux dépenses dans une petite ville reculée, aucun soupçon de revenus illégaux.
Achtundsechzig Jahre alt, Kunsttischler, wohnhaft Jerichow Ziegeleistrasse. Ich konnte und konnte mir nicht denken was das Referat Militärische Spionageabwehr mit dem gewinnen wollte
Soixante-huit ans, ébéniste, domicilié Jerichow, Ziegeleistrasse. Je n'arrivais pas, pas du tout, à imaginer ce que le Bureau de contre-espionnage militaire voulait gagner avec ça. Ces rapports du bureau de Jerichow, râleurs, souvent des dénonciations privées : a dit ceci, a laissé entendre cela. A chanté publiquement au bistrot de Jerichow (je ne crois pas que « publiquement » veuille dire grand-chose au bistrot, ils se connaissent tous, bon : publiquement au bistrot) la chanson du chien qui vint dans la cuisine, il y chia sur un œuf, alors le cuisinier prit la cuillère, et réduisit le chien en bouillie, alors les chiens se rassemblèrent, et firent grand éloge du cuisinier, et gravèrent sur la pierre tombale, il a quand même chié, puis le chien revint dans la cuisine et j'ai oublié la suite et oui oui je comprends bien. Voilà ce qu'ils notent. Soumettons à sérieuse réflexion. Ils ont l'air de croire que les agents ont des chants de club, la prochaine fois ils voudront peut-être introduire des insignes officiels. Attrapeurs de chiens. Ça les énerve, et bien d'autres gens s'en énervent encore, ils préfèrent laisser à Cresspahl une vieillesse paisible. Jusqu'à ce que je voie qu'il avait une fille, née en 1933, lycée à Jerichow, études d'anglais à Leipzig, école d'interprètes à Francfort-sur-le-Main, sur le Main, et depuis le début de l'année (mais ça, ceux de Jerichow ne l'avaient pas remarqué, car Cresspahl ne leur aura pas raconté :) le Q.G. de l'O.T.A.N. Je feuilletai encore les autres propositions, n'arrivai à m'enthousiasmer pour aucune, toutes du travail de radiographie bien droit, pour faire court obstiné, et vers midi je retournai à la M.S.A. et me fis annoncer chez Lagin et lui posai le dossier, si ça se fait, alors je veux en tirer quelque chose. « Ah – : galubuschka » dit-il. Il avait tout en tête, mémoire phénoménale, me demanda de lui faire un exposé. Je lui fis l'exposé. Il me fit un exposé. Rendez-vous. Eto ujasno. Rendez-vous. Récapitulation. Je dis encore : « Jesli ana ostawajetssa galubka na kryschje… », il ne comprit pas tout de suite, ils ont une autre version pour ça, puis il rit. « Lutche warabeja » dit-il. Il était très sympa, pas du tout protocolaire, après tout c'était une mission en solitaire. La colombe sur le toit. Je passai encore la soirée à la maison, mais plutôt dans mes pensées, parfois aussi agité. Après tout, l'action précédente était du bon travail, c'est pour ça qu'ils m'ont promu, et la mise en disponibilité pour usage spécial est en fin de compte une promotion supplémentaire, mais fallait-il que ce soit celle-ci, comment Cresspahl pouvait-il encore chanter de telles chansons, je peux aussi être rétrogradé à nouveau, ça ne s'arrêtera pas là. Et l'embêtement à cause de l'enfant. Je vois bien que ma fille doit dormir à vingt heures, elle a deux ans, je le comprends, mais je l'ai juste un peu soulevée pour lui dire au revoir, bon. À minuit, je descendis dans la rue. Hänschen lisait dans son éternel cours technique par correspondance et bâillait pour que je le voie, au démarrage il dit : « Les vacances auraient pu durer plus longtemps », et je dis « À Jerichow il y a une plage », mais c'était vers le sept octobre, là je me sentis de nouveau bien, nous allons voir ça. C'était début octobre et automne et nous roulâmes toute la nuit hors de Berlin vers le bas et le ciel devint toujours plus grand toujours plus blanc, là le clocher de Jerichow se dressait plutôt modestement derrière la colline. Les attrapeurs de chiens de Jerichow ont les deux pavillons dans la Bahnhofstrasse, sombres et ternes, presque délabrés, le garage juste à côté, ils n'ont juste pas encore apposé d'écriteau. Je me présentai comme Monsieur Rohlfs, fis libérer une chambre pour moi et Hänschen, ils me demandèrent les dossiers de Cresspahl dans la première demi-heure. Ça les énerve beaucoup, ils n'ont pas le sens de la musique et du chant, mais je n'avais jamais entendu ce nom, et croyaient-ils que les dossiers étaient entre-temps au Ministère ? J'aime ça. « C'est un travail difficile ici » dirent-ils, et je demandai « Et ici, comment sont les possibilités de baignade ? », ils trouvaient le temps trop froid. Ce gamin, qui pense parfois à double voie, peut devenir quelque chose.
Sie mögen gedacht haben ich bin ein Staatssekretär in den Ferien. Die Stadt ist nicht so stehengeblieben wie sie aussieht, ein Fremder fällt nicht auf, sie haben mir tatsächlich nicht gross nachgesehen und nachgesagt; die meisten sollen mich für den Buchhalter von ›Erfassung und Aufkauf‹ gehalten haben: weil sie den so selten zu Gesicht bekommen: sagt Hänschen.
Ils ont dû penser que j'étais un secrétaire d'État en vacances. La ville n'est pas aussi arrêtée qu'elle en a l'air, un étranger ne se remarque pas, ils ne m'ont en fait guère épité et critiqué ; la plupart auraient pris le comptable de 'Collecte et Rachat' pour moi : parce qu'on le voit si rarement : dit Hänschen. Bon nous sommes allés un peu nous promener, j'ai bien trouvé comment aller à la plage, Hänschen se tenait grelottant à côté de mes affaires et ne voulait absolument pas aller dans l'eau et trouvait un peu inconvenant que je me baigne. Et le soir nous étions assis là et battions la crasse de nos chaussures. Avec le temps, je rendis visite à quelques personnes à Jerichow et parlai avec elles de Jerichow, une jolie une agréable ville : disais-je, quel dommage qu'on ne puisse pas rester ici, ils étaient tous du même avis. Surtout le directeur des postes, un penseur légaliste têtu, fonctionnaire, les timbres sont vendus sans considération de la personne, les lettres sont timbrées et acheminées sans délai, comme si je n'avais pas vu le facteur lire les cartes postales, et le secret postal est un droit de l'homme. Mais que vaut la signature d'un secrétaire d'État ? tu vois. Envers l'autorité, il faut être loyal, il l'a été aussi envers les fascistes, naturellement Monsieur Mesewinkel. Pourvu que je ne confonde pas mes noms un jour. Le même jour, je voulais justement appeler à la maison, ma fille va bien j'espère, je le vis pour la première fois, Cresspahl, grand et large devant le guichet, le velours côtelé fripé autour de ses jambes, la veste largement bosselée et tachée, les lunettes. Les lunettes s'étaient coincées dans l'étui, obstinément la tête penchée il tirait dessus, dit « Un denn gäms mi noch twintich to twintich ». Elle avait l'air nouvelle ici et ne maîtrisait pas le dialecte local, il essayait de lui expliquer, « wek föe Breif » dit-il, vingt timbres à vingt pfennigs. Je pouvais l'observer en détail, j'étais le suivant dans la queue. Il sortit pesamment avec son large dos, s'arrêta à la porte et installa les lunettes, il faut dire, avec dévotion dans le métal tordu de l'étui, « Moin » dit-il et marcha d'un pas lourd autour de l'église vers la briqueterie, se tint avec quelqu'un au coin, parla. Pour ce que j'en ai à faire : je dis. Je ne reproche rien à personne, je ne suis pas si vieux. Mais la cause du socialisme vaincra et subsistera, et simplement comme ça au jour le jour et sortir de la République et partir vers la mer Méditerranée, ça ne va pas. Elle est trop jeune pour ça, au moins devrait-elle se laisser parler, il faut parler avec tout le monde.
Aber wenn einer Sie mal fragen sollte:
Mais si jamais on vous demandait :
Mais si jamais on me demande : les indications du signalement doivent être améliorées. Gesine (prénom usuel souligné) Lisbeth Cresspahl. Bon. Le nom est courant ici, Lisbeth s'appelait la mère. Lisbeth Cresspahl, morte en 1938. La tombe densément couverte de lierre, pas de séparation, et il y a des grilles très ouvragées à proximité. Sur la pierre, seulement le nom (pas Elisabeth), pas le nom de jeune fille, pas de citation biblique, pas de croix, seulement les dates. Donc Gesine Lisbeth. Et que faire de la taille : moyenne. À l'époque. Il y a cinq ans. Couleur des yeux : gris. Ça peut aussi être vert, au bureau d'état-civil il fait si sombre que tout le monde a les yeux gris foncé ; et quelle couleur de cheveux ont-ils notée ? foncé. Date de naissance, nationalité, signes particuliers : aucun. Je ne sais pas non plus comment ce serait mieux, mais avec ça, personne ne peut rien faire. La photo d'identité venue de la moquette solennelle du magasin de photo à côté du magasin Konsum à deux étages, atelier photo moderne, Bonjour Mademoiselle Cresspahl, veuillez vous asseoir. Pull marin remonté jusqu'au menton, veuillez pencher un peu plus la tête, l'oreille gauche est trop basse.
– Comme elle est, elle est.
– Et peut-être un peu plus aimable ?
– Non. C'est une photo d'identité.
Oder: »Das’s ein Passbild«. Das Gesicht sehr achtzehnjährig Haarfarbe dunkel vielleicht nicht ganz schwarz straff rückwärts die Haut fest sonnenbraun über den starken Backenknochen gleichmütig ernsthaft querköpfig blickende Augen, Augenfarbe: grau. Gewinnen Sie diese Person dlja weschtschi ssozialisma. Eto ujasno. Die Taube auf dem Dach
Ou : « C’est une photo d’identité ». Le visage très dix-huit ans couleur de cheveux foncée peut-être pas tout à fait noirs tirés en arrière la peau ferme bronzée sur les pommettes puissantes regard égal sérieux entêté des yeux, couleur des yeux : gris. Gagnez cette personne dlja weschtschi ssozialisma. Eto ujasno. La colombe sur le toit.
Heinrich Cresspahl avait accompagné sa fille à la porte d'entrée pendant huit ans. Il s'appuyait au cadre et lui disait pour ainsi dire un dernier mot, elle se tenait devant lui les mains dans le dos et ne le regardait pas, elle levait les yeux et riait dans son visage, elle sautait autour de lui et le menaçait et le réprimandait, elle marchait à côté de lui jusqu'au bord du trottoir et le regardait encore une fois brièvement et hochait la tête, avant de longer le commandement soviétique de la ville pour aller à l'école et plus tard à la gare ; et Cresspahl se tenait, puissant, devant sa maison et pointait avec sa pipe à tabac vers le paysage et faisait entrer le temps qu'il faisait ce jour-là dans son expérience. D'ailleurs, il disait probablement à peu près la même chose chaque matin. Et alors que sa fille venait juste de commencer à accepter ses paroles avec une révérence polie et rebelle – certains week-ends du printemps de la quatrième année de la République Démocratique Allemande –, Cresspahl, un matin, ne vint pas comme prévu en traversant la rue chez le magasin d'Ilse Papenbrock pour les petits pains de sa fille, car cette nuit-là, elle n'était pas restée jusqu'au petit déjeuner. D'ailleurs, Cresspahl n'acheta dans les années suivantes que du pain noir, Ilse Papenbrock apprit que sa fille était partie voyager. Elle avait dû se contenter de cette information pendant trois ans et demi encore ; devrait-on penser qu'une jeune fille parcourait le monde si longtemps sans protection paternelle ? et le monde était grand...."
Travailleur, calme, loyal, prudent à l'égard de la politique est-allemande et plutôt sceptique à l'égard de l'Allemagne de l'Ouest, Abs est surveillé par le contre-espionnage depuis que sa mère et son amie Gesine Cresspahl, qui travaille désormais pour l'OTAN, sont passées à l'Ouest. L'intrigue est marquée par la semi-perméabilité du rideau de fer pendant la courte période de dégel, qui prend fin après le soulèvement hongrois de 1956 - Jakob, en tant que cheminot, remarque les transports militaires soviétiques. Gesine rend visite à son père Heinrich et à Jakob, sous la pression du capitaine de l'Abwehr Rohlfs. Alors qu'il arrête le Dr Blach, un assistant universitaire critique envers le régime et amoureux de Gesine, Rohlfs laisse le couple Cresspahl-Abs en liberté afin de les gagner tous les deux, si possible sans violence, de sorte que Jakob peut même se rendre à l'Ouest, d'où il revient volontairement malgré l'amour de Gesine et meurt le jour même.
L'histoire est certes mystérieuse mais peu spectaculaire, typique des difficultés des relations interallemandes, qu'elles soient privées ou politiques, elle se déroule de manière analytique et n'est en aucun cas linéaire. A l'instar du personnage de Max Frisch, Stiller, Jakob Abs doit être reconstruit par d'autres. C'est pourquoi la majeure partie des cinq chapitres est constituée de fragments de conversations entre le collègue Joche et Jonas Blach, entre ce dernier et Gesine, entre cette dernière et Rohlfs, ainsi que de monologues intérieurs en italique, que le lecteur doit attribuer aux personnes de contact de Jakob dans un jeu de reconstruction. A cela s'ajoutent des passages dans lesquels un narrateur établit le contexte...

L'impossible biographie (Das dritte Buch über Achim, 1961)
"Achim est un célèbre cycliste de l'Allemagne Orientale, à qui deux livres ont été consacrés. Le gouvernement cherche à ce que la biographie de ce héros national soit officiellement et définitivement établie. Cet ouvrage s'intitulera L'impossible biographie; et c'est un ami d'Achim, journaliste à Hambourg, qui se charge de ce travail.
A travers l'existence du champion, Uwe Johnson reprend un des thèmes qui lui tiennent à coeur : le partage de son pays en deux Etats. Le journaliste Karsh
cherche à comprendre la vie d'Achim. Il croit tout savoir sur lui, mais, en réfléchissant, il s'aperçoit qu'il ne le connaît pas. Il découvre que ce héros est un homme comme les autres. De même
il se sent étranger dans cette zone de l'Est et ne sait pas pourquoi. Il veut tout voir, tout apprendre, il tente de tout imaginer, mais le mystère et l'ambiguïté ne font que s'accroître."
(Editions Gallimard)

Deux points de vue (Zwei Ansichten, 1965)
"Lors d'un voyage à Berlin, B. (lui) fait connaissance de D. (elle). Il est photographe à Hambourg, et n'a qu'une vraie passion : les voitures de sport. Elle est infirmière dans un hôpital de Berlin-Est. Elle n'y est pas fort bien vue : son père était un officier supérieur pendant la guerre. À peine les deux jeunes gens se sont-ils liés, que survient la construction du mur de Berlin. D. ne peut plus sortir de l'Est. B. s'emploie à la faire fuir. L'essentiel du livre est la relation des efforts qu'ils font, lui à l'Ouest, elle à l'est – petites démarches, contacts, espoirs, promesses – pour leur permettre de se rejoindre.
La fuite, finalement, réussira. Mais le vrai sujet du livre n'est peut-être pas là. Ce serait plutôt la dérision des efforts individuels, au milieu des grands conflits politiques. B. et D. ne manqueraient-ils pas de conviction profonde, dans le désir de se rejoindre? D'ailleurs, l'auteur ne nous a-t-il pas tout au long montré que D. et B., dans leurs démarches semblables, voient les choses de façon tout à fait différente? C'est l'Est et l'Ouest : deux points de vue. Deux points de vue qu'il serait trop simple de réduire à la distance proprement politique.
Ils appartiennent à deux mondes, deux manières de voir, deux «métaphysiques» différentes. Comme dans la Frontière et l'Impossible biographie, la division de l'Allemagne permet à Uwe Johnson de décrire, avec la précision poétique qui le caractérise, une division d'un tout autre ordre, d'une toute autre profondeur." (Editions Gallimard)
"..Le lendemain matin, les émetteurs d'Allemagne de l”Est déclaraient la fermeture des frontières de Berlin-Ouest, mesure de sécurité que les postes de diffusion de la ville interdite traduisaient ainsi : blocus du territoire pour tout habitant moyen de Berlin-Est et de l'Allemagne de l'Est, qu'il veuille faire des achats ou rendre visite à des amis, aller au cinéma ou bien gagner le camp de fugitifs afin d'être transporté par avion de l'autre côté, dans un monde libre, dans un autre mode de vie. D. courut tout de suite au chemin de fer de ceinture. Les trains ne partiraient plus. Sur la longue coursive, sur l'eau des vacances et dans le vent des roseaux, elle avait oublié de chialer mais non sans éprouver maintenant une ironie maligne envers ceux qui, comme elle, avaient trop pris le temps de réfléchir à leur pays.
A vrai dire, elle ne connaissait guère plus exactement cet Etat que de nom. Les tenants du pouvoir ne lui avaient pas été présentés dans l'exercice de leurs fonctions mais à demi cachés par le pupitre d'orateur, protégés par la balustrade des balcons d'opéra. Le nouveau système expliquait ses qualités d'après les défauts de l'ancien, attribuant sa propre puissance à l'issue de la guerre. Comme D. avait alors trois ans et demi, il ne lui restait maintenant qu'à se fier aux informations des aînés. Longtemps l'Etat avait été pour elle une institution d'adultes, de fonctionnaires comme l'instituteur et contre laquelle il importait de se prémunir par une bonne croissance, des notes suffisantes, l'exécution de la tâche imposée. Seulement elle ne pouvait pas faire plus que de travailler pour cet Etat, après qu'elle l'eût pris en flagrant délit de mensonge. A moins que ce fût par indifférence politique ou parce que ses frères étaient encore si petits ou aussi parce qu'il n'y avait pas de cours l'après-midi et que les garçons du même âge étaient si avides de promenades en forêt et de tripotages de sexes. Plus tard, elle fut exclue des classes supérieures de l'école, les études lui furent interdites parce que, d'après le rang militaire de son père, l'Etat la considérait comme fille de criminel, si mort fût-il. Elle s'était rebellée contre les instituteurs défenseurs de l'Etat, elle avait taquiné de naïfs condisciples avec la musique plus alerte des émetteurs d'Allemagne de l'Ouest, les vêtements plus modernes des vitrines de Berlin-Ouest ou les taxes scolaires qu'on avait supprimées, - sur le papier de la Constitution.
Néanmoins, avant même qu'elle fût en mesure de penser, elle avait involontairement fait confiance à cet Etat aussi impénétrable qu'omniprésent. Quand elle se mit à réfléchir, les cours d'infirmière étaient plus urgents : aussi urgents que de fuir la famille ou d'établir une froide comparaison entre les deux modes de vie de l'Allemagne. Elle avait donc vécu sous ce gouvernement comme en son propre pays, chez elle, confiante en un avenir ouvert et dans le droit de choisir éventuellement l'autre côté. Emprisonnée de ce côté-ci, elle se sentait trahie, trompée, bernée. C'était un sentiment comparable à celui d'une offense qu'on ne peut rendre; il serrait la gorge, oppressait presque insensiblement le souffle mais devait s'exprimer..."

Une année dans la vie de Gesine Cresspahl
(Jahrestage aus dem Leben von Gesine Cresspahl, 1970-1983)
Tome I : 20 août 1967 - 19 décembre 1967
"Gesine Cresspahl est la jeune fille du premier roman d'Uwe Johnson, La Frontière (Gallimard, 1962), enquête infructueuse sur la mort suspecte du cheminot Jacob, dans l'Allemagne de l'Est. Gesine a quitté l'Europe, elle vit depuis dix ans à New York avec la fille qu'elle a eue de Jacob. Elle est cadre moyen dans une banque. Le récit est fait d'une chronique très vivante de la vie new-yorkaise qui s'entremêle aux souvenirs de sa jeunesse au bord de la Baltique dans les années 31 à 34. Elle essaie de la reconstituer le plus exactement possible pour satisfaire la curiosité de sa fille qui veut tout savoir sur leurs origines." (Gallimard)

Une année dans la vie de Gesine Cresspahl
(Jahrestage aus dem Leben von Gesine Cresspahl, 1970-1983)
Tome II : 20 décembre 1967 - 19 avril 1968
"À travers le récit de Gesine Cresspahl, une Allemande établie à New York en 1967-1968, l'auteur poursuit la double chronique de la petite ville de
Jerichow, proche de la Baltique, sous le nazisme, et de l'Amérique agitée par les remous de la guerre du Viêt-nam, les questions raciales et les faits divers de la violence. La réalité
saisissante de ce récit qui couvre ici quatre mois, du 20 décembre 1967 au 19 avril 1968, est due aux motivations profondes que Uwe Johnson attribue à Gesine. Jeune Allemande marquée par son
passé, celle-ci ne peut s'adapter au monde américain avec la même facilité que sa fille âgée de dix ans. La vivacité de ses impressions, son avidité à accumuler quotidiennement les informations
du New York Times lui confèrent un rôle de témoin historique. Parallèlement, Gesine tente de reconstituer, en réponse aux questions de sa fille qui veut connaître ses origines «pour quand tu
seras morte», après les années 1936-1945 à Jerichow : angoisses, tragédies, atrocités vécues dans sa propre enfance et restituées à travers les incertitudes de la mémoire. Les différents procédés
d'écriture, narration, lettres, dialogues entre Gesine et un questionneur qui est peut-être sa conscience, fondent le destin personnel, familial et collectif dans l'écoulement du temps."
(Gallimard)

Une année dans la vie de Gesine Cresspahl
(Jahrestage aus dem Leben von Gesine Cresspahl, 1970-1983)
Tome III : Avril - Juin 1968
"Le printemps de 1968 se joue, en Europe, à Prague, tandis qu'aux États-Unis, les manifestations contre la guerre au Vietnam et l'assassinat de Robert
Kennedy émeuvent l'opinion. Mais nous sommes aussi en 1946, dans le Mecklembourg, en Allemagne de l'Est, lieu des origines et de la mise en question : dans les conversations entre Gesine
Cresspahl, employée de banque à New York, et sa fille Marie, devenue une petite Américaine, les demandes et les réponses prennent souvent la forme d'un affrontement. Marie veut savoir, tout
savoir du passé de sa mère. Et c'est ainsi que nous assistons à la transformation du pays après la guerre, aux démêlés du père de Gesine, nommé maire de sa commune, avec la population et avec le
commandant soviétique, à son arrestation et à son internement dans un camp, alors qu'autour de lui les esprits «évoluent», les gens «s'adaptent», chacun s'efforçant de survivre à sa manière. Face
à cette adolescente têtue et révoltée, éprise de justice et de pureté, Gesine Cresspahl ne peut que raconter, très simplement, comment les choses se sont passées. Ce qui rend d'autant plus
émouvant, dans un monde où, vingt ans après, la violence occupe toujours le devant de la scène, tandis que la compromission se cache dans le secret des consciences, ce retour sur un passé qui
demeure à jamais mystérieux, tout comme le présent où l'accumulation des informations contradictoires ne fait qu'accroître l'incertitude et l'angoisse." (Gallimard)

Une année dans la vie de Gesine Cresspahl
(Jahrestage aus dem Leben von Gesine Cresspahl, 1970-1983)
Tome IV : Juin 1968 - Août 1968
"Née en 1933, Gesine Cresspahl a connu le nazisme et les débuts de la R.D.A., qu'elle a quittée en 1953 pour l'Allemagne de l'Ouest, d'où elle est partie en 1961 pour les États-Unis. Elle vit à New York comme employée de banque, avec sa fille Marie, qu'elle a eue en 1957 de Jakob, le héros du premier grand roman de Johnson. C'est à l'adolescente que s'adresse le récit de Gesine, combinant de façon complexe l'évocation du présent (cette fois, la période du 20 juin au 20 août 1968, dominée par le Printemps de Prague) et celle du passé allemand (cette fois, l'après-guerre jusqu'en 1953 et parfois au-delà). Elle-même fort critique vis-à-vis du présent comme du passé, Gesine a en la personne de sa fille (avec laquelle le lecteur est amené à s'identifier) une auditrice plus critique encore."

Christa Wolf (1929-2011)
"Le passé n'est pas mort; il n'est même pas passé. Nous nous coupons de lui et le traitons en étranger." Hantée par la nécessité de ne pas se
laisser asphyxier par un passé qu'on refoule, Christa Wolf a toujours eu le sentiment que dans la littérature de son pays, la République démocratique allemande, les écrivains ne parlaient pas
des évènements personnels et historiques les plus aigus pour se laisser aller très loin dans l'autocensure. Dans "Trame d'enfance" (Kindheitsmuster), elle revient sur ce rejet de toute
amnésie volontaire: "J'avais le même âge que les jeunes garçons enrôlés par Hitler, mais j'avais la chance d'être une fille et je n'ai pas été obligée de faire le coup de feu. C'est ainsi que
j'ai vécu, moi aussi, près de Berlin, la fin de la guerre, mais dans convoi de réfugiés. Ce que nous ressentions vraiment à l'époque, comment nous avons vécu notre rencontre avec l'armée rouge,
cela n'a pas encore, à mon avis, été décrit avec sincérité." Ses romans et ses essais évoquent directement ou transposés les problèmes de l'Allemagne de l'Est et de la société contemporaine.
Toutes les héroïnes de ses romans, Caroline, Cassandre, Médée, Christa ou Rita, sont toutes des femmes possédant la volonté inépuisable, comme on l'a écrit, de traverser des nuits pour ne pas
perdre la lumière, prêtes à se blesser pour ne pas se trahir, incarnant cet l'héroïsme du quotidien qu'engendre toute existence mesurée à l'aune d'un régime
totalitaire.
Christa Wolf est sans doute la figure féminine majeure de la littérature est-allemande, et elle a conservé une place centrale dans l’ensemble de la littérature allemande du XXᵉ siècle. Restée en RDA, malgré tout, elle a incarné la position de l’intellectuel loyal-critique : fidèle aux idéaux socialistes mais lucide sur les dérives autoritaires. "Nachdenken über Christa T." (Réflexions sur Christa T., 1968) a marqué une rupture, car ce roman s’éloignait du réalisme socialiste officiel et mettait en scène la subjectivité et le conflit intérieur. Elle a ainsi défendu une littérature qui ne soit pas propagande mais outil d’exploration de la vérité individuelle. "Kindheitsmuster" (Trame d’enfance, 1976) est un texte fondamental sur la mémoire du nazisme et la difficulté de se confronter à son propre passé d’enfant ayant grandi sous Hitler. Elle relie ainsi la problématique de la culpabilité (Vergangenheitsbewältigung) à la question identitaire de l’Allemagne divisée. Par son style introspectif, ses héroïnes souvent en décalage avec le collectif, elle est devenue une référence pour la littérature féministe en RDA et au-delà. Ses récits montrent comment la vie intime des femmes est traversée par l’histoire et par les contraintes politiques. Ses livres restent incontournables pour comprendre la vie intellectuelle et les dilemmes intérieurs d’une écrivaine dans un État autoritaire.
Christa Wolf incarne la complexité de l’engagement intellectuel dans un système oppressif — un sujet encore brûlant dans le monde contemporain : elle a été critique du régime, mais aussi longtemps proche du pouvoir, et ses rapports avec la Stasi (elle a été brièvement informatrice avant de s’en détacher) nourrissent le débat sur les compromis moraux en dictature.
1. "Nachdenken über Christa T." (1968, Réflexions sur Christa T.)
Roman sur une femme qui meurt jeune, racontée par une narratrice qui tente de comprendre sa vie et ses contradictions.
Rupture avec le réalisme socialiste officiel → affirmation de l’individu, de la sensibilité et du doute. Devient un texte fondateur de la « littérature critique » en RDA.
2. "Kindheitsmuster" (1976, Trame d’enfance)
Autofiction où Christa Wolf confronte sa propre enfance sous le nazisme et le problème de la culpabilité collective.
Montre la difficulté de “parler en je” quand le passé est honteux ; associe mémoire individuelle et histoire collective. Contribution majeure à la Vergangenheitsbewältigung (travail sur le passé) en Allemagne.
3. "Kassandra" (1983)
Réécriture mythologique où Cassandre, prophétesse condamnée à n’être jamais crue, devient porte-parole des voix marginalisées.
Dénonciation des structures de pouvoir patriarcales et militaristes. Œuvre féministe universelle, qui dépasse le cadre est-allemand.
4. "Was bleibt" (1990, Ce qui reste)
Récit écrit en 1979 mais publié seulement après la chute du Mur : une journée d’une écrivaine sous surveillance de la Stasi.
Texte intimiste sur la peur, la pression et la résistance intérieure dans une dictature Symbole des dilemmes de Wolf face au régime et du malaise de la RDA finissante.

En 1945 la famille, fuyant l'arrivée des Russes, s'installe dans la région du Mecklenbourg. Christa obtient son baccalauréat en 1949, juste au moment où le Mur est construit ; elle choisit de rester à l'Est et fait des études de germanistique à Iéna puis à Leipzig. C'est à cette date qu'elle devient membre du SED (le parti unique de l'ex-Allemagne de l'Est), et elle le restera jusqu'à sa dissolution. Elle se marie en 1951 avec l'essayiste Gerhard Wolf avec qui elle a une fille un an plus tard. Son premier récit, "Moskauer Novelle", qui raconte la relation entre une femme médecin originaire de Berlin Est et un interprète russe, est publié en 1959 mais ne parait pas à l'Ouest. "Le Ciel partagé" ("Der geteilte Himmel", 1963) relate l'immersion d'une étudiante en usine, mais aussi la séparation d'un couple par le Mur de Berlin. "Méditation sur Christa T." ("Nachdenken über Christa T.", 1968), publié en R.D.A. avec difficulté, dépeint le destin tragique d'une romancière morte trop tôt, et critique la société socialiste. En 1976, Christa Wolf est l'une des premières à protester contre l'expulsion de l'auteur-compositeur Wolf Biermann. L'affirmation du droit de l'individu à l'épanouissement devient alors un thème central chez C. Wolf, comme dans "Aucun lieu, nulle part" ("Kein Ort.Nirgends", 1979), rencontre fictive entre Kleist et la poétesse Günderode. L'Histoire et ses mythes la passionnent: "Trame d'enfance" ("Kindheitsmuster", 1976) interroge les traces du nazisme sur sa génération, "Cassandre" ("Kassandra. Eine Erzählung. Voraussetzungen einer Erzählung, 1983) se penche sur le caractère destructeur des sociétés modernes.

Dans les années 1990, elle est accusée d'avoir travaillé entre 1959 et 1962 pour la Stasi : son roman, "Ce qui reste" ("Was bleibt", 1990), décrit un jour dans la vie d'une femme écrivain qui, se sachant observée par la Stasi, prend différentes mesures pour protéger sa vie privée, et éclaire son choix d'être resté en RDA pour continuer d'écrire, s'être opposé au pouvoir mais sans jamais être entrée en dissidence. Christa Wolf ne cache pas avoir souffert de ces accusations. Dans "Adieu aux fantômes" ("Auf dem Weg nach Tabou", 1994), elle critique la façon dont s'était faite la réunification. " Beaucoup de gens qui vivaient en RDA se sont sentis bafoués, humiliés, exclus, on ne les pas reconnus. C'est sûrement ce qui m'a fait le plus mal.". En 2010, Christa Wolf revient sur cette période difficile d'avant et après la chute du Mur dans "Stadt der Engel oder The Overcoat of Dr. Freud" et parle sans langue de bois de sa vie derrière le Mur, des rêves et des cauchemars qui l'ont peuplée.

Christa T. (Nachdenken über Christa T, 1968)
Communiste convaincue, Christa Wolf est, de 1963 à 1967, membre suppléant du comité central du Parti socialiste unifié (SED). Elle s'oppose néanmoins à la soumission de l'art et de la culture au pouvoir politique, ce qui lui vaut son exclusion du comité central et sa mise sous surveillance par la sécurité d'État (Stasi). Désormais, chacun de ses livres va refléter les grandes évolutions et les impasses politiques de la RDA. Christa T., son second grand roman, retrace la vie d'une jeune femme depuis son enfance jusqu'à sa mort des suites d'une leucémie. La forme est nouvelle : succession de pensées, de souvenirs, d'essais, de retours en arrière de la narratrice sur sa façon d'écrire et sa propre subjectivité. Christa Wolf met en scène la tension entre l'évolution programmée d'un État et le développement d'une personnalité qui a besoin de liberté.
"Méditer, sur elle. Méditer sur sa tentative d’être soi-même. C’est l’idée qu’on déchiffre dans les journaux intimes qui nous restent d’elle, sur les feuilles volantes des manuscrits retrouvés, entre les lignes des lettres que je connais. Qui m’ont appris à oublier le souvenir que j’ai d’elle, Christa T. La couleur du souvenir est trompeuse.
Faut-il donc la porter disparue ?
Car, je le sens, elle s’évanouit. Dans son cimetière de village, elle repose sous les deux buissons d’argousier, défunte parmi les défunts. Est-ce bien là sa place ? Un mètre de terre au-dessus d’elle, puis le ciel du Mecklembourg, les cris des alouettes au printemps, les orages d’été, les tempêtes d’automne, la neige.
Elle s’évanouit. Plus d’oreille pour percevoir des plaintes, plus d’œil pour voir des larmes, plus de bouche qui réponde aux reproches. Plaintes, larmes, reproches ont perdu leur raison. À jamais éconduits, nous cherchons consolation dans cet oubli qu’on appelle souvenir.
De l’oubli, nous le jurons, on n’a pas à l’en préserver. On voulait dire : empêcher de tomber dans l’oubli. C’est alors la bonne excuse qu’on avance. Car elle-même, bien sûr, elle oublie ou elle a oublié, elle-même, nous autres, ciel, terre, pluie, neige. Moi, cependant, je la vois encore. Pis : je dispose d’elle. Rien ne m’est plus aisé que de la citer à la barre comme je pourrais à peine le faire pour un vivant. Elle se met en mouvement si je veux. De son pas équilibré elle avance sans effort devant moi, oui, voilà ses grandes enjambées, oui, c’est là sa démarche dégingandée, et voici même, preuve suffisante, le gros ballon rouge et blanc qu’elle poursuit sur la plage. Ce que j’entends n’est pas la voix d’un fantôme : pas de doute, c’est bien elle, Christa T. L’évoquant, mettant mon soupçon en sourdine, je prononce même son nom et me voilà sûre d’elle. Mais pendant tout ce temps je sais : un film fantôme se déroule, jadis éclairé par la lumière réelle des villes, des paysages et des habitations. Inquiétant et troublant : pourquoi cette peur en moi ?
Car la peur est nouvelle. Comme si elle allait mourir encore une fois ou comme si j’allais manquer une chose importante. Pour la première fois, je me rends compte qu’elle n’a pas changé en moi depuis fort longtemps et que, là, il n’y a plus de changement à espérer. Rien ni personne ne fera grisonner comme la mienne sa chevelure sombre et emmêlée. Nulle ride nouvelle n’ira plisser le coin de ses yeux. Elle, mon aînée, d’ores et déjà plus jeune : trente-cinq ans, terriblement jeune.
Alors je sais : ce sont les adieux. La bobine tourne encore, ronronne avec empressement, mais le film est fini, le bout déchiré de la pellicule s’échappe tout à coup, tourne une fois, encore une, stoppe l’appareil, pendille en balançant dans l’air léger qui passe.
La peur, oui, malgré tout.
Pour un peu elle était vraiment morte. Mais je veux qu’elle reste. Voici venu l’instant de méditer sur elle au-delà, de la faire vivre et vieillir comme c’est le droit de chacun. Deuil négligent, souvenir imprécis, connaissance approximative l’ont fait disparaître, on le comprend. Abandonnée à elle-même, elle est donc partie, tout simplement, c’était bien elle.
À la dernière minute on décide de lui consacrer du travail.
Or on sent là, indéniablement, comme une contrainte. Contraindre qui ? Elle ? À quoi ? À rester ? Mais nous voulions pourtant laisser là les bonnes excuses.
Non : la contraindre à se faire reconnaître.
Sans aller prétendre que nous le faisons pour elle. Une fois pour toutes : elle n’a pas besoin de nous. Tenons-le-nous pour dit : c’est pour nous que nous le faisons, car c’est nous, semble-t-il, qui avons besoin d’elle.
Dans la dernière lettre que je lui ai écrite – je le savais, c’était la dernière, et je n’avais pas appris à écrire de lettres ultimes –, je ne trouvai rien de mieux que de lui faire grief de son départ, voulu ou contraint. Je cherchais sans doute un moyen pour empêcher son éloignement. Alors je lui rappelai cet instant que j’ai toujours tenu pour le début de notre relation. Notre première rencontre. L’aura-t-elle noté, cet instant, ou alors celui où j’ai bien pu entrer dans sa vie… je ne sais.
Nous n’en avons jamais parlé.
1 - C’était le jour où je la vis imiter le son de la trompette. Elle devait être alors dans notre classe depuis quelques mois. Je connaissais déjà par cœur ses membres élancés, sa démarche dégingandée, sa courte queue de cheval retenue dans la nuque par une simple barrette, je connaissais aussi sa voix profonde, quelque peu rauque et son léger zézaiement.
Tout cela vu et entendu pour la première fois le premier matin où elle fit, dans notre classe, son apparition, difficile d’appeler la chose autrement. Elle était assise au dernier rang et ne montrait nulle ardeur à lier connaissance. Du zèle elle n’en montra jamais. Elle était là, à son banc, considérant notre professeure avec cette expression justement, cette absence de zèle, si ces mots arrivent à dépeindre la chose. Aucune expression rebelle dans son regard, bien qu’il eût pu sembler tel, tranchant sur ces regards d’adoration auxquels nous avait habituées notre professeure, laquelle, je le crois aujourd’hui, ne vivait pas d’autre chose.
Alors, bienvenue parmi nous. Comment s’appelait la nouvelle ? Elle ne se leva pas. D’une voix un peu rauque, au zézaiement léger, elle dit son nom : Christa T. Était-ce possible, aurait-elle froncé les sourcils lorsque notre professeure l’avait tutoyée ? Sur-le-champ on l’eût remise à sa place.
D’où venait-elle donc, la nouvelle ? Ah, elle n’était pas des régions bombardées de la Ruhr, ni de Berlin en ruines ? Eichholz… Seigneur ! Tout près de Friedeberg. Zechow, Zantoch, Zanzin, Friedeberg, les trente autochtones que nous étions refaisaient mentalement le trajet du tortillard. Indignées, cela va de soi. Ça habitait dans une école de village, même pas à cinquante kilomètres d’ici, et un regard comme celui-là ! Oui, quand on laisse derrière soi toute une escouade de cheminées d’usine ou, pour le moins, la gare de Silésie et le Kurfürstendamm… mais là, des pins et des genêts et des bruyères, et cette odeur d’été que nous avions nous aussi dans le nez, jusqu’à plus soif et pour la vie, des pommettes hautes, une peau mate, et puis ces façons ?
Que dire de tout cela ?
Rien. Rien et vraiment rien. Je n’en pensais rien de bien. Je regardais par la fenêtre, l’air dégagé : qui voudrait mon avis saurait à quoi s’en tenir. Je regardais la prof de gym baliser de fanions son éternel terrain de balle au chasseur, je préférais ça plutôt que d’être témoin de l’attitude de la nouvelle envers notre professeure. Cette façon qu’elle avait de lui tenir la dragée haute. De transformer en dialogue ce qui aurait dû être un interrogatoire, et comme elle savait en imposer le sujet ! Je n’en croyais pas mes oreilles : la forêt ! En bas, on sifflait le rassemblement pour le jeu, et moi, tournant la tête, je regardais la nouvelle qui ne voulait pas nommer sa matière d’élection, car ce qu’elle préférait, c’étaient les promenades en forêt. Et la prof, elle avait sa voix de quand elle cède, nous n’avions jamais vu ça.
Il y avait de la trahison dans l’air. Mais qui trahissait, qui donc était trahi ?
Eh bien, comme à son habitude, la classe était contente d’accueillir cordialement dans ses rangs Christa T., la nouvelle, l’amie de la forêt. Je fis la moue ; non. Cordialité, zéro. Pas question d’accueillir. La quarantaine.
Pourquoi me tenait-on quand même au courant des faits et gestes de la nouvelle, c’est difficile à dire. Bon, et après, disais-je à chaque phrase, mais cette phrase je l’avais enregistrée au préalable : qu’elle avait un an de plus que nous, car elle venait d’un cours complémentaire et redoublait sa classe. Qu’elle avait pris pension en ville et ne rentrait chez elle que pour les week-ends. Bon, et après ? Qu’à la maison on l’appelait Krischan1.
Krischan ? Ça lui ressemble bien : Krischan.
Par la suite, c’est ainsi que je l’appelais, la plupart du temps.
Du reste, elle ne cherchait nullement à se faire accepter. Que l’accueil fût spontané ou contraint, elle ne demandait rien. Nous ne l’intéressions pas « outre mesure », l’expression devenait en vogue parmi nous. On ne peut pas dire qu’elle soit polie outre mesure, hein ? Je levais les yeux au ciel et je disais : et après ?
Sacré orgueil, cette nouvelle ! Elle est sonnée, ma parole.
La vérité : elle n’avait pas besoin de nous. Elle arrivait et repartait, on ne pouvait en dire plus.
Je savais déjà d’elle à peu près tout ce que je voulais savoir. Sinon presque tout, du moins un bon bout, la suite le confirma.
Les alertes se faisaient plus longues, les levers des couleurs plus moroses et faiblards, nous n’en percevions rien et là-dessus novembre revint. Du moins c’était un jour gris, donc sans doute novembre. Un mois sans la moindre sagesse, pour nous non plus. Nous traversions la ville en petites hordes, la fin de l’alerte nous avait prises au dépourvu, trop tard pour retourner à l’école, trop tôt pour rentrer à la maison. Depuis belle lurette, il n’était plus question de faire des devoirs, et le soleil se refusait ; que cherchions-nous, flânant parmi tous ces soldats, veuves de guerre, auxiliaires de la Luftwaffe ? Et en plus, dans ce jardin public où était enclos le parc aux chevreuils, mais les chevreuils avaient disparu et nous ne devions plus y faire du patin à glace.
Qui donc venait de le dire ? Personne. Alors pourquoi nous regardions-nous donc de cette façon ?
Pas de raison : qui manque de sommeil finit par voir passer des fantômes ou en entendre...."
(La traduction française du livre de Christa Wolf, "Nachdenken über Christa T." (1969), fut publiée aux éditions du Seuil en 1972 sous le titre Christa T.)
Christa Wolf est sans aucun doute l'écrivain le plus important à avoir vécu et travaillé en République démocratique allemande. Socialiste convaincue, membre du parti au pouvoir,elle semblait toutefois consciente de certaines contradictions du système. La difficulté de sauvegarder une identité personnelle et un sentiment de probité dans une société qui donne constamment la priorité au collectif apparaissent souvent dans son œuvre.
"Christa T.", livre qui fut très controversé en Allemagne de l'Est, présente un récit dense et non linéaire organisé autour de la tentative de la narratrice de reconstruire la vie de son amie, Christa T., récemment morte de leucémie. Cette dernière a toujours lutté pour trouver un juste équilibre entre son excentricité profonde et le conformisme politique que l'on attend d'elle, entre une existence privée et son désir de servir sa communauté. La narratrice, alter ego évident de l'auteur, mêle ses souvenirs fragmentés de Christa T. à des extraits de Iettres, journaux intimes et autres documents. Dès le début, elle admet que son projet ne peut aboutir puisqu'il est impossible de «connaître» parfaitement une autre personne; en ce sens, le sujet du livre est autant une découverte de soi que celle d'une amie décédée. L'enquête de la narratrice se transforme en méditation sur la politique et la moralité, sur la mémoire et l'identité, ainsi que sur l'objectif de l'écriture, thèmes chers à Christa Wolf.
"... Ce qu’a dit le général.
Et si elle l’avait tout simplement inventé ? Car s’il n’existait pas, du moment qu’elle en avait besoin, elle l’aurait inventé. Pourtant ce courage de l’invention, elle ne l’avait pas, on en reparlera plus loin. C’est donc que le général existait, il entre réellement en scène, même si par prudence on le cache aussitôt et on essaie de le nier en le collant derrière ce titre ironique : Ce qu’a dit le général.
Si vous voulez approcher, mademoiselle.
Ce qui s’approchait n’était pas la simple curiosité, la crédulité aux miracles, l’empressement fruste à s’incliner devant les talents surnaturels d’un autre… L’homme, un Autrichien, général en retraite, assisté d’une jeune femme aux allures effarouchées, en robe tyrolienne, – c’est ce que cet homme devine tout de suite.
Il l’invite à prendre place, le visage vers la lumière, ainsi font-ils toujours. Lui-même, près de la fenêtre, n’est qu’une silhouette à contre-jour, ainsi débutent le plus souvent les petits tours de magie, les confessions et les interrogatoires.
Votre nom déjà ? Étudiante, n’est-ce pas ? Vous voyez. D’ailleurs, c’est sans importance. Et vous ne travaillez pas, à cette époque de l’année ? Ou bien les vacances commenceraient-elles plus tôt que jadis, comme c’est soi-disant le cas pour tout à notre époque ? – Il rit – Bon, bon. Chacun peut éprouver le besoin de se reposer en dehors du temps prescrit.
Elle n’a pas encore fini de parcourir la pièce des yeux, lu les sentences fixées au mur et qui toutes parlent de la vanité des forces humaines, elle n’a pas encore jaugé du regard les pots d’étain sur l’étagère qu’il sait déjà ce qu’il doit savoir.
Lui abandonner sa main, elle trouve cela d’un goût douteux ; si elle s’en allait ? Le général l’a bien senti, l’émotion s’est transmise jusque dans la main. Vous voyez, dit-il, ce sera tout. Et il va jusqu’à montrer d’un geste méprisant les accessoires de son art… pas de marc de café, pas de cartes… Pourtant, il lui arrive d’employer cartes et marc de café, elle le sait bien, et lui, tout en cherchant son regard, a un léger haussement d’épaules : le monde, mademoiselle, veut qu’on le trompe. Mais vous… Quand on peut s’enorgueillir d’avoir des lignes de la main aussi précises… Tu peux sortir, dit-il froidement à sa femme.
Votre père, mademoiselle, exerce une profession intellectuelle, n’est-ce pas ? Un bon père, intelligent, habile aux travaux manuels également. Vit-il encore ? Certes. Même si, comme vous n’auriez garde de l’oublier, la vie humaine a ses limites… Vous êtes trois enfants, à ce que je vois. Une sœur seulement ? Très aimée, oui, ce n’est que trop clair. En ce qui concerne le troisième enfant, je vous prie de garder à l’esprit qu’existent non seulement ceux qui sont restés en vie, non seulement ceux qui vinrent au monde, auxquels je dois me référer.
Alors elle pense, bien sûr : cette fausse couche. Les parents ont voulu nous la cacher à l’époque, je m’en suis toujours doutée.
Le général est content.
Savez-vous par ailleurs, mademoiselle, que le rythme lunaire a une grande influence sur vous ? Que c’est lui qui règle votre préférence pour la ligne sud-est ? Certes, cela n’a pas dû tellement se manifester dans votre jeune existence jusqu’à présent. Mais plus tard, quand vous habiterez une ville comme… eh bien disons : Dresde, vous penserez à moi, je suppose…
Voyons les astres… Oui, Vénus et Saturne sont très proches. Vénus, l’amour, voire la tendresse, toujours présente. D’ailleurs, réjouissez-vous, je vois réunie autour de vous une large constellation astrale. Une grande diversité s’y cache et s’y révèle, une richesse de dons, les intérêts les plus variés…
À cet endroit il fait preuve d’une intuition issue d’une affinité d’âmes : comment ignorer que cette richesse elle-même peut vous peser de temps à autre ?
Allons donc ! bien sûr, voudrais-je ajouter ici, car cela m’a intriguée, bien sûr, forcément elle l’a inventé, son général, le lendemain de la séance, seule dans sa chambre donnant sur les dix-sept peupliers, devant elle son journal ouvert : elle l’a inventé en se jurant d’être précise, objective, en se forçant à coucher sur le papier le discours du général avec ses propres mots à lui, sans l’interrompre une seule fois, malgré un sentiment de pudeur : est-il possible d’être encore plus juste ? Aussi est-elle juste comme nous le sommes tous : elle en extrait le maximum qui peut lui convenir, mais tout le reste, hétéroclite, erroné, voire même bête jusqu’à la niaiserie, à peine en fait-elle mention.
Je m’arroge le droit de la corriger et moi aussi je m’invente mon général. Je suis juste, comme l’est tout un chacun, après tout.
Vous allez passer un examen, dit son général. Ce ne sera pas particulièrement brillant. Mais ce que je vous dis là, vous le savez déjà. Moyen, pourrait-on dire, si l’on ne savait que l’étendue de votre intelligence et mémoire, encore limitée pour l’instant, ira s’élargissant. Comme vous le savez sans doute, la femme atteint son épanouissement intellectuel à la fin de la vingtaine. Chez vous, mademoiselle, ce sera sans doute plus tard.
Soyez prudente, dit son général. Les six mois à venir ne vont pas être de tout repos. Vous avez les nerfs en mauvais état. Je vois plusieurs maladies. La période que vous traversez actuellement, je la qualifierais de déficience passagère de vitalité.
Là, mon général à moi la dévisage rapidement, se demande si elle va lâcher les rênes ou non. Il constate qu’il peut pousser plus loin.
Vos difficultés psychiques augmenteront, dit son général, chaque fois que vous aurez des décisions à prendre.
Christa T., ah ! Krischan, assise là, qui se sent penser : il a raison. Et la lumière à laquelle il l’a exposée en la faisant asseoir là, lui révèle cette pensée à lui aussi, il se carre dans son fauteuil, relâche un peu sa main et se laisse aller enfin à meubler le vide avec l’abracadabra habituel qu’il a en réserve.
Vous assisterez bientôt à un enterrement, dit son général. Peut-être une tante entre soixante et soixante-dix ans qui va mourir.
Il se rend compte aussitôt : sa visiteuse lui échappe. Rien à faire, il faut qu’il fasse un effort, mon général.
Vous ruminez trop, dit son général, avec une certaine insistance dans le ton. Si je peux vous donner un conseil, perdez cette habitude préjudiciable à vos nerfs. Croyez-moi : dans trois, quatre ans – je ne me trompe pas, j’ai bien en face de moi quelqu’un de vingt-quatre ans ? Vous voyez ! Eh bien, à vingt-six, vingt-sept ans, tout changera pour vous. Votre horoscope me le montre clairement : vous dépasserez les gens de votre âge. Cela sera manifeste plus tard si vous arrivez enfin à avoir confiance en vous : agir avec détermination, mais se garder d’abuser de ses forces, éviter les extrêmes : un peu d’art de vivre, ma chère demoiselle, ne saurait vous nuire…
Maintenant, maintenant seulement, je le vois, elle amène les voiles, moi aussi du reste. Et si, malgré tout, il était en quête d’êtres humains, si lui et lui seul en ces semaines avait trouvé les mots qu’il faut pour la calmer, pour l’apaiser…
Quant à l’amour en ce moment – ai-je raison de penser que vous voudriez savoir là aussi ce qu’il en est ?
Là elle ne fait pas un geste, ne hoche pas la tête, rougit dans la franche lumière à laquelle il l’a exposée, elle fait un mouvement pour retirer sa main, et le général, qui veut ne s’être aperçu de rien, laisse la main glisser.
Vous aimez aimer, dit son général à elle, ou quel est celui qui parle en ce moment ? Vous aimez tendrement et profondément, mais votre amour ressemble à de l’amitié : aussi avez-vous de bons amis, vous avez l’esprit de camaraderie, vous savez compatir. Jusqu’au moment où une sorte d’insatisfaction vous submerge, vous savez sûrement ce que je veux dire. Alors vous devenez lunatique, allant jusqu’à repousser même les gens qui vous sont proches, même ceux qui vous aiment, vous savez pourquoi. Ce sont les époques pénibles du grand froid qui succèdent aux grandes amours…
Qui vient de lui parler là ? Sait-elle maintenant ce qui l’a amenée ici ? Mais lui, comment peut-il savoir tout cela ? ...."
Le roman prend la forme d’une narration rétrospective : une narratrice anonyme, amie de Christa T., tente de recomposer la vie de cette femme décédée prématurément d’une leucémie à 35 ans. La narratrice utilise fragments de souvenirs, journaux intimes, lettres, conversations. Mais elle se heurte sans cesse à l’impossibilité de saisir totalement une existence : Christa T. reste insaisissable, fuyante, contradictoire : Enfance et jeunesse marquées par la guerre / Études de lettres après 1945, formation d’enseignante / Mariages et maternité / Engagement initial dans le projet socialiste, puis désillusion progressive / Maladie et mort précoce. La vie de Christa T. n’est pas héroïque ni spectaculaire, mais traversée de petits refus, de doutes, de moments de rébellion silencieuse...
Le roman s’interroge sur la capacité de la littérature à saisir une existence. Jamais la RDA n’est attaquée frontalement, mais à travers Christa T., Wolf montre les tensions entre idéaux socialistes et réalité vécue : rigidité bureaucratique, manque de liberté individuelle, pression à se conformer. Reste la vie intérieure, subjective, un espace de vérité sur lequel la société socialiste semble ne pas avoir de prise ...

En 1959, le programme culturel du "Bitterfelder Weg" fixe pour objectif à la littérature socialiste de RDA de surmonter la séparation de l'art et de la vie ("Trennung von Kunst und Leben"), d'intégrer le monde ouvrier dans ses thématiques, de raconter l'Histoire du point de vue des acteurs les plus modestes. Deux ans après la construction du Mur de Berlin, Christa Wolf écrit "Der geteilte Himmel" qui, dans le contexte du "socialisme réel existant", raconte la séparation des deux Allemagne à travers la fracture d'un couple. Mais le roman accorde une large place à la sensibilité des protagonistes et n'élude pas les réalités des difficultés de la société est-allemande, d'où son succès indiscutable.

"Le ciel divisé" (Der geteilte Himmel, 1963)
Un soir de la fin août 1961, Rita Seidel, une jeune femme de 19 ans, reprend conscience dans une chambre d'hôpital. Murée dans le silence, elle fond en
larmes dès que le médecin tente de la questionner. L'histoire, qui se passe au moment de l'édification du Mur, est celle de la rupture entre Rita, une étudiante qui choisit de rester en RDA, et
son ami Manfred qui préfère se réfugier en RFA. "Le ciel divisé", paru anciennement sous le titre "Le ciel partagé", est le premier roman de Christa Wolf et celui grâce auquel elle connut un
immense succès : traduit dans une vingtaine de langues, il fut adapté au cinéma, avec Renate Blume, par Konrad Wolf en 1964, grand réalisateur de la RDA et jeune frère de Markus Wolf (1923-2006),
maître-espion et Hauptverwaltung Aufklärung de la Stasi, l'un des hommes les plus redoutés des services secrets occidentaux.

Quand Rita rencontre Manfred Herrfurth, un ingénieur de dix ans plus âgé qu'elle, elle vit dans son village natal où elle exerce un travail alimentaire de
peu d’envergure. "Le jour, Rita travaillait ; le soir, elle lisait des romans, sentant croître en elle un sentiment d'abandon. Alors elle rencontra Manfred et vit soudain des choses qu'elle
n'avait jamais vues. Cette année-là, les arbres perdirent leurs feuilles dans un feu d'artifice de couleurs, et la voiture de la poste avait parfois quelques insupportables minutes de retard. A
nouveau une chaîne solide et sûre de pensées et d'aspirations la reliait à la vie.." Mais elle a d’autres rêves. S’éprenant de lui, elle va alors tout quitter pour le suivre en ville, où
elle pourra à la fois intégrer une brigade de production d’une entreprise de wagons et devenir institutrice. Nous sommes en août 1961, en RDA, juste avant l’édification du mur de Berlin. Manfred
a de plus en plus de mal à supporter un régime qui sape les bonnes volontés et berce les gens d'illusions : "Le socialisme est fait pour les peuples de l'Est. Parce qu'ils n'ont pas été
déformés par l'individualisme et une civilisation développée, ils peuvent tirer pleinement profit des avantages simples de la société nouvelle. Mais nous, aucun chemin ne nous y ramène - ce qu'il
vous faut, ce sont des héros intacts. Et ce que vous trouvez ici, ce sont des générations brisées." Et quand Manfred décide de s’enfuir vers l’Ouest, Rita se trouve face à un dilemme :
doit-elle le suivre et demeurer une étrangère dans cette ville inconnue ou rester chez elle, seule ? Rita le rejoint, mais elle ne se sent pas à sa place dans ce monde sans idéal collectif et
voué à la consommation, même avec Manfred à son côté - et elle revient à l'Est. Le ciel qui a abrité leur amour se trouve irrémédiablement déchiré, comme le pays qui les a vus naître. Ce grand
roman de Christa Wolf évoque avec brio la division présente dans chacun de nos êtres lors des choix cruciaux qui jalonnent notre existence. En évoquant la période charnière qui sépara l’Allemagne
en deux, elle fait ressurgir la profonde injustice de l’Histoire qui sépare les êtres ; même ceux qui s’aiment. (Editions Stock)

"Trame d’enfance" (Kindheitsmuster, 1976)
Christa Wolf s'installe à Berlin en 1976, année où paraît son troisième grand roman. Comme dans le précédent, il s'agit de reconstituer le passé oublié, refoulé, déformé. Mais dans ce récit autobiographique, la narratrice part cette fois à la recherche de son enfance vécue sous le IIIe Reich à Landsberg.
"Christa Wolf n’a que seize ans à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Au moment de l’exode en 1945, elle rencontre un homme qui a survécu aux camps, en fuite comme elle. Il porte un pyjama rayé et, constatant l’étonnement de la jeune fille devant sa tenue, il lui demande : « Mais dans quel monde avez-vous vécu ? » C’est à cette question que l’écrivain tente de répondre dans Trame d’enfance. À l’occasion d’un voyage sur les lieux de son enfance (une partie de l’Allemagne devenue polonaise après 1945), elle s’efforce de faire revivre par l’écriture le souvenir d’une époque, l’Allemagne des années 1930 et 1940, et le destin de sa famille qui, comme beaucoup, a laissé le nazisme s’installer, non sans succomber parfois aux tentations de cette idéologie.
Christa Wolf écrit ce texte en 1976, alors qu’elle a pris ses distances avec le régime communiste de RDA. Elle sera parmi les premiers écrivains allemands à affronter l’effet de séduction que les valeurs du nazisme ont pu avoir sur elle enfant, et à oser lier les deux grandes folies collectives du XXe siècle. Son éducation n’aurait-elle pas en effet favorisé l’élan avec lequel elle a défendu la mise en place du communisme dans la RDA de l’après-guerre ? On retrouve de fait dans les deux systèmes le respect à la lettre de l’autorité, ou l’habitude de penser par idées reçues. Explorant ainsi avec audace et finesse le lourd passé familial et national, Christa Wolf livre un grand texte littéraire, qui résonne en chacun de nous." (Stock)

"Aucun lieu nulle part" (Kein Ort Nirgends, 1979)
Christa Wolf s'interroge ici sur la place de l'écrivain dans la société et sur sa capacité de réaction et d'intervention. Le roman met en scène une rencontre fictive entre l'écrivain Heinrich von Kleist et la poétesse Caroline von Günderrode, qui lui permet de s'interroger sur la réalisation de l'être humain dans la société bourgeoise. Cette réflexion se poursuit dans "Cassandre" (Kassandra, 1983).
"Christa Wolf écrit ces dix récits de 1965 à 1989, année décisive au cours de laquelle elle met la dernière main au manuscrit de Ce qui reste. Il était important de redonner à lire la description saisissante une journée durant laquelle la romancière constate qu’elle est sous la surveillance de la Stasi.
Les six premiers textes du recueil mettent en lumière le ton nouveau que Christa Wolf apportait dans la prose de la RDA : poétique du quotidien, monologue intérieur, irruption du rêve et veine satirique. Puis en 1979 paraît un magnifique récit dans lequel l’auteur imagine une rencontre entre deux héros tragiques du romantisme allemand, Kleist et Caroline de Günderode. Le titre est éloquent : pour le bonheur, la création, la liberté, il n’existe Aucun lieu. Nulle part. L’écrivain traverse alors une période de crise et d’affrontement avec le pouvoir. Elle choisira, pendant plusieurs années, de situer ses récits loin de l’époque contemporaine, avant d’y revenir, avec Incident, suscité par la catastrophe de Tchernobyl, et le roman Scènes d’été, publié quelques mois avant les bouleversements de l’automne 1989.
Ce recueil permet d’apprécier combien Christa Wolf, sans jamais entrer dans une dissidence ouverte, a manifesté une attitude de plus en plus critique envers le pouvoir est-allemand et a contribué, par ses prises de position, au tournant de l’automne 1989. ." (Stock)

"Was bleibt" (1990, Ce qui reste)
Récit écrit en 1979 mais publié seulement après la chute du Mur. Symbole des dilemmes de Wolf face au régime et du malaise de la RDA finissante.
"Was bleibt" est une nouvelle (Erzählung) à la forme autobiographique et introspective. Le récit, écrit à la première personne, se déroule sur une seule journée dans la vie d'une écrivaine est-allemande, clairement identifiée comme Christa Wolf elle-même. Mais c'est bien plus qu'une simple nouvelle ; c'est un phare des débats sur la mémoire et la culpabilité dans l'Allemagne post-réunification. Elle a forcé l'Allemagne à avoir une conversation douloureuse mais nécessaire sur la nature de la dictature en RDA. Elle a mis en lumière le fait que la résistance n'était pas toujours un acte héroïque et visible, mais souvent un combat intérieur, silencieux et moralement ambigu.
L'œuvre est un chef-d'œuvre du genre autobiographique et de l'"écriture subjective", caractéristique de Christa Wolf. Elle pose la question : comment témoigner de l'Histoire à hauteur d'homme, avec ses doutes et ses failles ? Elle est devenue un texte clé pour comprendre la littérature est-allemande et ses dilemmes.
La narratrice se sait surveillée par la Stasi (la police secrète de RDA). Ce jour-là, elle remarque une voiture stationnée devant chez elle, confirmant la présence des surveillants. Elle reçoit la visite d'une jeune admiratrice, une femme fragile et désespérée qui cherche du réconfort et de la reconnaissance auprès de son idole. Tout au long de la journée, la narratrice est tiraillée entre sa peur, son sentiment d'impuissance, sa culpabilité de ne pas en faire assez pour les autres, et la difficulté d'écrire dans de telles conditions. Elle analyse ses propres mécanismes de défense, l'autocensure et la paralysie induite par la surveillance constante...
"Nur keine Angst. In jener anderen Sprache, die ich im Ohr, noch nicht auf der Zunge habe, werde ich eines Tages auch darüber reden. Heute, das wußte ich, wäre es noch zu früh. Aber würde ich spüren, wenn es an der Zeit ist? Würde ich meine Sprache je finden? Einmal würde ich alt sein. Und wie würde ich mich dieser Tage dann erinnern? Der Schreck zog etwas in mir zusammen, das sich bei Freude ausdehnt. Wann war ich zuletzt froh gewesen? Das wollte ich jetzt nicht wissen. Wissen wollte ich – es war ein Morgen im März, kühl, grau, auch nicht mehr allzu früh –, wie ich in zehn, zwanzig Jahren an diesen noch frischen, noch nicht abgelebten Tag zurückdenken würde. Alarmiert, als läute in mir eine Glocke Sturm, sprang ich auf und fand mich schon barfuß auf dem schön gemusterten Teppich im Berliner Zimmer, sah mich die Vorhänge zurückreißen, das Fenster zum Hinterhof öffnen, der von überquellenden Mülltonnen und Bauschutt besetzt, aber menschenleer war, wie für immer verlassen von den Kindern mit ihren Fahrrädern und Kofferradios, von den Klempnern und Bauleuten, selbst von Frau G., die später in Kittelschürze und grüner Strickmütze herunterkommen würde, um die Kartons der Samenhandlung, der Parfümerie und des Intershops aus den großen Drahtcontainern zu nehmen, sie platt zu drücken, zu handlichen Ballen zu verschnüren und auf ihrem vierrädrigen Karren zum Altstoffhändler um die Ecke zu bringen. Sie würde laut schimpfen über die Mieter, die ihre leeren Flaschen aus Bequemlichkeit in die Mülltonnen warfen, anstatt sie säuberlich in den bereitgestellten Kisten zu stapeln, über die Spätheimkehrer, die beinahe jede Nacht die vordere Haustür aufbrachen, weil sie immer wieder ihren Schlüssel vergaßen, über die Kommunale Wohnungsverwaltung, die es nicht fertigbrachte, eine Klingelleitung zu legen, am meisten aber über die Betrunkenen aus dem Hotelrestaurant im Nebenhaus, die unverfroren hinter der aufgebrochenen Haustür ihr Wasser abschlugen.
« Surtout pas de peur. Un jour, dans cette autre langue que j'ai à l'oreille mais pas encore sur la langue (Jeu de mots intraduisible littéralement. "Eine Sprache auf der Zunge haben" signifie la maîtriser, être sur le point de la parler. Wolf évoque une nouvelle langue (de vérité, de liberté, d'écriture) qu'elle perçoit mais ne maîtrise pas encore), je parlerai aussi de tout cela. Aujourd'hui, je le savais, ce serait encore trop tôt. Mais est-ce que je sentirais quand le moment serait venu ? Est-ce que je trouverais un jour ma langue ? Un jour, je serais vieille. Et comment me souviendrais-je alors de ces jours ? L'effroi contracta en moi quelque chose qui se dilate dans la joie. Quand avais-je été joyeuse pour la dernière fois ? Je ne voulais pas le savoir maintenant. Ce que je voulais savoir – c'était un matin de mars, frais, gris, plus très tôt non plus –, c'était comment, dans dix, vingt ans, je me remémorerais ce jour encore frais, pas encore vécu. Alertée, comme si une cloche sonnait le tocsin en moi, je bondis et me retrouvai déjà pieds nus sur le beau tapis à motifs de la pièce berlinoise, je me vis écarter les rideaux, ouvrir la fenêtre donnant sur la cour arrière, qui était occupée par des poubelles débordantes et des gravats, mais vide de gens, comme abandonnée pour toujours par les enfants avec leurs vélos et leurs radios-cassettes, par les plombiers et les ouvriers du bâtiment, même par Mme G., qui descendrait plus tard en tablier et bonnet de laine vert pour prendre les cartons de la graineterie, de la parfumerie et de l'Intershop dans les grands conteneurs en fil de fer (Magasins en RDA où l'on pouvait acheter, avec des devises occidentales, des produits de l'Ouest généralement inaccessibles), les aplatir, les lier en ballots maniables et les emporter sur sa charrette à quatre roues chez le ferrailleur du coin. Elle rouspéterait fort contre les locataires qui jetaient leurs bouteilles vides par commodité dans les poubelles, au lieu de les empiler soigneusement dans les casiers prévus à cet effet, contre les rentrants tardifs qui fracassaient presque chaque nuit la porte d'entrée principale parce qu'ils oubliaient sans cesse leur clé, contre l'administration communale des logements qui n'était pas foutue de tirer une ligne de sonnette, mais surtout contre les ivrognes du restaurant hôtelier de la maison d'à côté, qui pissaient effrontément derrière la porte d'entrée défoncée.
Die kleinen Tricks, die ich mir jeden Morgen erlaubte: ein paar Zeitungen vom Tisch raffen und sie in den Zeitungsständer stecken, Tischdecken im Vorübergehen glattstreichen, Gläser zusammenstellen, ein Lied summen (»Geht nicht, sagten kluge Leute, zweimal zwei ist niemals drei«), wohl wissend, alles, was ich tat, war Vorwand, in Wirklichkeit war ich, wie an der Schnur gezogen, unterwegs zum vorderen Zimmer, zu dem großen Erkerfenster, das auf die Friedrichstraße blickte und durch das zwar keine Morgensonne hereinfiel, denn es war ein sonnenarmes Frühjahr, aber doch Morgenlicht, das ich liebe, und von dem ich mir einen gehörigen Vorrat anlegen wollte, um in finsteren Zeiten davon zu zehren.
Aber das weiß ich doch, daß man durch willentlichen Entschluß keinen Himmelsschatz erwirbt, der sich unter der Hand vermehrt; weiß doch: Alle Nahrung über des Leibes Notdurft hinaus wächst uns zu, ohne daß wir sie Stück um Stück zusammentragen müßten oder dürften, sie sammelt sich von selbst, und ich fürchte ja, alle diese wüsten Tage würden nichts beisteuern zu dieser dauerhaften Wegzehrung und deshalb unaufhaltbar im Strom des Vergessens abtreiben. In heller Angst, in panischer Angst wollte ich mich jetzt an einen dieser dem Untergang geweihten Tage klammern und ihn festhalten, egal, was ich zu fassen kriegen würde, ob er banal sein würde oder schwerwiegend, und ob er sich schnell ergab oder sich sträuben würde bis zuletzt. So stand ich also, wie jeden Morgen, hinter der Gardine, die dazu angebracht worden war, daß ich mich hinter ihr verbergen konnte, und blickte, hoffentlich ungesehen, hinüber zum großen Parkplatz jenseits der Friedrichstraße.
Übrigens standen sie nicht da. Wenn ich recht sah – die Brille hatte ich mir natürlich aufgesetzt –, waren alle Autos in der ersten und auch die in der zweiten Parkreihe leer. Anfangs, zwei Jahre war es her, daran maß ich die Zeit, hatte ich mich ja von den hohen Kopfstützen mancher Kraftfahrzeuge täuschen lassen, hatte sie für Köpfe gehalten und ob ihrer Unbeweglichkeit beklommen bestaunt; nicht, daß mir gar keine Fehler mehr unterliefen, aber über dieses Stadium war ich hinaus. Köpfe sind ungleichmäßig geformt, beweglich, Kopfstützen gleichförmig, abgerundet, steil – ein gewaltiger Unterschied, den ich irgendwann einmal genau beschreiben könnte, in meiner neuen Sprache, die härter sein würde als die, in der ich immer noch denken mußte. Wie hartnäckig die Stimme die Tonhöhe hält, auf die sie sich einmal eingepegelt hat, und welche Anstrengung es kostet, auch nur Nuancen zu ändern. Von den Wörtern gar nicht zu reden, dachte ich, während ich anfing, mich zu duschen – den Wörtern, die, sich beflissen überstürzend, hervorquellen, wenn ich den Mund aufmache, angeschwollen von Überzeugungen, Vorurteilen, Eitelkeit, Zorn, Enttäuschung und Selbstmitleid.
Wissen möchte ich bloß, warum sie gestern bis nach Mitternacht dastanden und heute früh einfach verschwunden sind.
Les petites astuces que je m'autorisais chaque matin : ramasser quelques journaux de la table et les fourrer dans le porte-revues, lisser les nappes en passant, rassembler les verres, fredonner une chanson (« Ça ne marche pas, disaient les gens intelligents, deux fois deux n'est jamais trois »), sachant pertinemment que tout ce que je faisais était un prétexte, qu'en réalité, j'étais, comme tirée par une ficelle, en route vers la pièce de devant, vers la grande fenêtre en bow-window qui donnait sur la Friedrichstraße et par laquelle, il est vrai, ne tombait aucun soleil matinal, car c'était un printemps pauvre en soleil, mais tout de même la lumière du matin, que j'aime et dont je voulais me constituer une bonne réserve pour m'en nourrir en des temps obscurs.
Mais je sais bien qu'on n'acquiert par une décision volontaire aucun trésor céleste qui s'accroît entre nos mains ; je sais bien : toute nourriture au-delà de ce dont le corps a besoin nous est donnée sans que nous ayons à ou puissions la rassembler pièce par pièce, elle s'accumule d'elle-même, et je crains justement que toutes ces journées dévastées ne contribuent en rien à cette durable provision de route et ne dérivent donc irrémédiablement dans le flux de l'oubli. Dans une peur claire, dans une peur panique, je voulais maintenant m'accrocher à l'une de ces journées vouées à la perdition et la retenir, peu importe ce que je réussirais à saisir d'elle, si ce serait banal ou grave, et si cela se laisserait faire rapidement ou se débattrait jusqu'au bout. Je me tenais donc, comme chaque matin, derrière le rideau, qui avait été placé là pour que je puisse me cacher derrière, et je regardais, invisible je l'espérais, vers le grand parking de l'autre côté de la Friedrichstraße.
D'ailleurs, ils n'étaient pas là. Si je voyais bien – j'avais bien sûr mis mes lunettes –, toutes les voitures de la première et aussi de la deuxième rangée de stationnement étaient vides. Au début, il y avait deux ans de cela, c'est comme ça que je mesurais le temps, je m'étais laissé tromper par les appuie-tête élevés de certains véhicules, les ayant pris pour des têtes et les ayant contemplés avec inquiétude devant leur immobilité ; non pas que je ne faisais plus aucune erreur, mais j'avais dépassé ce stade. Les têtes sont de forme inégale, mobiles, les appuie-tête sont uniformes, arrondis, raides – une différence colossale, que je pourrais un jour décrire avec précision, dans ma nouvelle langue, qui serait plus dure que celle dans laquelle je devais encore penser. Comme la voix maintient obstinément la hauteur tonale sur laquelle elle s'est un jour calée, et quel effort il faut pour en changer ne serait-ce que les nuances. Sans parler des mots, pensai-je, alors que je commençais à me doucher – des mots qui, se bousculant avec empressement, jaillissent quand j'ouvre la bouche, gonflés de convictions, de préjugés, de vanité, de colère, de déception et d'apitoiement sur moi-même.
Je voudrais juste savoir pourquoi ils étaient là jusqu'à minuit hier et ont simplement disparu ce matin.
Ich putzte mir die Zähne, kämmte mich, benutzte gedankenlos, doch gewissenhaft verschiedene Sprays, zog mich an, die Sachen von gestern, Hosen, Pullover, ich erwartete keinen Menschen und würde allein sein dürfen, das war die beste Aussicht des Tages. Noch einmal mußte ich schnell zum Fenster laufen, wieder ergebnislos. Eine gewisse Erleichterung war das natürlich auch, sagte ich mir, oder wollte ich etwa behaupten, daß ich auf sie wartete? Möglich, daß ich mich gestern abend lächerlich gemacht hatte; einmal würde es mir wohl peinlich sein, daran zu denken, daß ich mich alle halbe Stunde im dunklen Zimmer zum Fenster vorgetastet und durch den Vorhangspalt gespäht hatte; peinlich, zugegeben. Aber zu welchem Zweck saßen drei junge Herren viele Stunden lang beharrlich in einem weißen Wartburg direkt gegenüber unserem Fenster.
Fragezeichen. Die Zeichensetzung in Zukunft gefälligst ernster nehmen, sagte ich mir. Überhaupt: sich mehr an die harmlosen Übereinkünfte halten. Das ging doch, früher. Wann? Als hinter den Sätzen mehr Ausrufezeichen als Fragezeichen standen? Aber mit simplen Selbstbezichtigungen würde ich diesmal nicht davonkommen. Ich setzte Wasser auf. Das mea culpa überlassen wir mal den Katholiken. Wie auch das pater noster. Lossprechungen sind nicht in Sicht. Weiß, warum in den letzten Tagen ausgerechnet weiß? Warum nicht, wie in den Wochen davor, tomatenrot, stahlblau? Als hätten die Farben irgendeine Bedeutung, oder die verschiedenen Automarken. Als verfolgte der undurchsichtige Plan, nach dem die Fahrzeuge einander ablösten, verschiedene Parklücken in der ersten oder zweiten Autoreihe auf dem Parkplatz besetzten, irgendeinen geheimen Sinn, den ich durch inständiges Bemühen herausfinden könnte; oder als könnte es sich lohnen, darüber nachzudenken, was die Insassen dieser Wagen – zwei, drei kräftige, arbeitsfähige junge Männer in Zivil, die keiner anderen Beschäftigung nachgingen, als im Auto sitzend zu unserem Fenster herüberzublicken – bei uns suchen mochten.
Je me brossai les dents, me coiffai, utilisai machinalement mais consciencieusement divers sprays, m'habillai, les affaires d'hier, pantalon, pull, je n'attendais personne et j'allais pouvoir être seule, c'était la meilleure perspective de la journée. Je dus encore courir vite à la fenêtre, à nouveau sans résultat. C'était bien sûr aussi un certain soulagement, me dis-je, ou voulais-je prétendre que je les attendais ? Il se peut que je me sois ridiculisée hier soir ; un jour, j'aurai probablement honte en repensant au fait que je m'étais avancée toutes les demi-heures dans la pièce obscure vers la fenêtre et que j'avais espionné par la fente du rideau ; honte, admettons. Mais dans quel but trois jeunes messieurs étaient-ils restés assis de longues heures, obstinément, dans une Wartburg blanche (Marque de voiture emblématique de la RDA), juste en face de notre fenêtre ?
Point d'interrogation. À l'avenir, prendre la ponctuation plus au sérieux, s'il te plaît, me dis-je. D'ailleurs : se tenir davantage aux conventions inoffensives. C'était possible, avant. Quand ? Quand il y avait plus de points d'exclamation que de points d'interrogation derrière les phrases ? Mais avec de simples auto-accusations, je ne m'en sortirais pas cette fois. Je mis de l'eau à chauffer. Le mea culpa, laissons ça aux catholiques. Comme le pater noster aussi. Aucune absolution en vue. Blanc, pourquoi justement blanc ces derniers jours ? Pourquoi pas, comme les semaines précédentes, rouge tomate, bleu acier ? Comme si les couleurs avaient une quelconque signification, ou les différentes marques de voiture. Comme si le plan insondable selon lequel les véhicules se relayaient, occupant différentes places de parking dans la première ou la deuxième rangée du parking, poursuivait un sens secret que je pourrais découvrir par un effort intense ; ou comme s'il pouvait être utile de réfléchir à ce que les occupants de ces voitures – deux, trois jeunes hommes vigoureux, en âge de travailler, en civil, qui n'avaient d'autre occupation que de s'asseoir dans leur voiture et de regarder vers notre fenêtre – pouvaient bien chercher chez nous.... »
L'œuvre décrit de l'intérieur l'impact psychologique étouffant d'un État policier. La narratrice est déchirée entre son désir de retraite protectrice et son sentiment de devoir moral envers ceux qui souffrent et lui demandent de l'aide. Le texte s'interroge sur le processus même de la création littéraire sous pression. Comment trouver les "bons" mots, comment rester authentique quand on sait que tout peut être utilisé contre vous ? C'est une plongée sans complaisance dans la conscience de l'auteure, qui questionne ses propres compromis et son positionnement dans le système est-allemand.
Le génie de "Was bleibt" réside dans son approche. Ce n'est pas un simple récit accusateur contre la Stasi. C'est une étude psychologique fine et complexe de l'impact de l'oppression sur l'esprit humain, en particulier sur l'esprit d'un artiste. Wolf ne se présente pas en héroïne de la résistance, mais en individu vulnérable, apeuré et profondément troublé. Cette honnêteté crue est sa plus grande force littéraire.
La "Querelle des Écrivains" (Der Literaturstreit) - La publication en 1990 a déclenché l'une des controverses littéraires et politiques les plus virulentes de l'après-réunification. Les critiques, venant principalement de l'Ouest (comme Ulrich Greiner et Frank Schirrmacher), ont accusé Christa Wolf d'Opportunisme (avoir attendu la chute de la RDA pour publier une critique du régime, alors qu'elle était en sécurité), d'Hypocrisie (avoir été une intellectuelle privilégiée et reconnue par le régime (elle était membre du parti SED) tout en se présentant après coup comme une victime), d'Égocentrisme (avoir transformé un problème collectif (l'oppression en RDA) en un drame personnel et narcissique ("Le malheur de moi sous la Stasi"). La "Querelle des Écrivains" a symbolisé le choc culturel entre l'Est et l'Ouest. L'Ouest accusait l'Est de n'avoir pas suffisamment résisté ; l'Est reprochait à l'Ouest une supériorité morale et une incapacité à comprendre la réalité de la vie sous un régime totalitaire. "Was bleibt" se trouve au centre de cette fracture.
Les défenseurs de Wolf, dont Günter Grass, ont rétorqué que l'œuvre était justement écrite et lue en RDA dans les années 80 dans des cercles privés. Elle n'était pas "cachée" pour être publiée plus tard, mais parce que sa publication à l'époque était impossible. Le texte est un document historique précieux précisément parce qu'il montre la complexité de la position des intellectuels en RDA, pris entre loyauté, critique interne et peur. Il montre les "accommodements" et les ambiguïtés, bien plus révélateurs qu'un simple récit manichéen.
Le scandale qu'elle a provoqué en fait un document indispensable pour quiconque souhaite comprendre les tensions, les non-dits et les difficultés du processus de réunification allemande et de la gestion du passé communiste. C'est une œuvre qui continue d'interroger profondément sur le rôle de l'intellectuel, les limites de la résistance et le prix de la liberté de création.
"Der Kaffee mußte stark und heiß sein, gefiltert, das Ei nicht zu weich, selbsteingekochte Konfitüre war erwünscht, Schwarzbrot. Luxus! Luxus! dachte ich wie jeden Morgen, als ich das alles beieinanderstehen sah – ein nie sich abnutzendes Schuldgefühl, das uns, die wir den Mangel kennen, einen jeden Genuß durchdringt und erhöht. Die Nachrichten aus dem Westsender (Energiekrise, Hinrichtungen im Iran, Abkommen über die Begrenzung der strategischen Rüstungen: Vergangenheitsthemen!) hörte ich kaum, mein Blick war auf die Eisenstange gefallen, die den zweiten Ausgang unserer Wohnung – jene Tür, die von der Küche über die Hintertreppe zum Hofausgang führt – einbruchsicher verrammelt. Mir fiel ein, in meinem nächtlichen Traum war diese unbenutzte, schmale, verdreckte, mit ausrangierten Möbeln vollgestellte Treppe reinlich gewesen und lebhaft begangen von allerlei dreistem Volk, das ich in meinen Traumgedanken »Gelichter« nannte – ein Wort, das ich diese drahtigen, behenden, lemurenhaften, jeden Schamgefühls baren Männer niemals hören lassen würde, die sich, was ich schon immer so sehr gefürchtet hatte!, durch die todsichere Hintertür Einlaß in unsere Küche verschafft hatten, sich nun auf der Schwelle drängten, sich an die eiserne Stange preßten, die unerschütterlich in ihren Halterungen lag und merkwürdigerweise von jenen Elenden respektiert wurde, die doch leicht unter ihr hätten durchschlüpfen können, statt dessen aber ihre Leiber gegen sie quetschten, während immer neue, von einem mir unsichtbaren Höllenrachen ausgespiene Figuren – ja, sie wirkten wie Pappfiguren, flach – von hinten nachschoben, unglaublich agil und beredt. Was hatten sie eigentlich gesagt. Daß wir uns nur ja nicht stören lassen sollten. Daß wir so tun sollten, als seien sie gar nicht da. Daß es das allerbeste wäre, wir würden sie vollständig vergessen. Sie höhnten nicht, es war ihr Ernst, das erbitterte mich am meisten in meinem Traum. Da man sich einen Traum nicht verbieten, wohl auch nicht vorwerfen kann, lachte ich auf, um mir zu beweisen, daß ich eigentlich schon über den Dingen stand. Das Lachen klang gezwungen.
« Le café devait être fort et brûlant, filtré, l’œuf pas trop mou, de la confiture maison était souhaitable, du pain noir. Luxe ! Luxe ! pensai-je comme chaque matin en voyant tout cela rassemblé – un sentiment de culpabilité qui ne s’use jamais, qui, nous qui connaissons la pénurie, imprègne et rehausse chaque jouissance. Les nouvelles de la radio occidentale (crise énergétique, exécutions en Iran, accord sur la limitation des armements stratégiques : des thèmes du passé !), je les entendais à peine, mon regard était tombé sur la barre de fer qui verrouille de façon anti-effraction la seconde sortie de notre appartement – cette porte qui mène de la cuisine par l’escalier de service à la sortie sur la cour.
(La "barre de fer" anti-effraction sur la porte de derrière est un symbole physique puissant de l'enfermement et de la peur. La narratrice se barricade littéralement chez elle. Cependant, cette barrière physique est immédiatement contrecarrée par l'image onirique de l'intrusion psychologique. La peur de l'effraction est si forte qu'elle envahit son subconscient. Le rempart est à la fois nécessaire et inefficace contre l'angoisse)
Il me revint qu’au cours de mon rêve nocturne, cet escalier étroit, inutilisé, crasseux, encombré de meubles hors d’usage, avait été propre et vivement fréquenté par toutes sortes de gens effrontés que je nommai dans mes pensées oniriques « racaille » (Gelichter) – un mot que je ne laisserais jamais entendre à ces hommes filiformes, agiles, lémuriens, dépourvus de toute pudeur, qui, ce que j’avais toujours tant redouté !, s’étaient fait ouvrir l’entrée de notre cuisine par la porte de derrière pourtant si sûre, se bousculaient maintenant sur le seuil, se pressaient contre la barre de fer qui reposait, inébranlable, dans ses supports et était, chose étrange, respectée par ces misérables qui auraient pourtant pu facilement passer en dessous, mais qui instead écrasaient leurs corps contre elle, tandis que toujours de nouvelles figures – oui, elles donnaient l’impression d’être en carton, plates – crachées par une gueule infernale qui m’était invisible, poussaient par derrière, incroyablement agiles et loquaces. Qu’avaient-ils donc dit ? Que nous ne devions surtout pas nous laisser déranger. Que nous devions faire comme s’ils n’étaient pas du tout là. Que le mieux serait que nous les oublions complètement. Ils ne ricanaient pas, ils étaient sérieux, c’est ce qui m’exaspérait le plus dans mon rêve. Comme on ne peut s’interdire un rêve, ni sans doute se le reprocher, je me mis à rire, pour me prouver qu’en réalité, je planais déjà au-dessus des choses. Ce rire sonnait forcé. »
("Oubliez-nous complètement" est une injonction impossible et terrifiante. C'est précisément parce qu'il faut constamment essayer de les oublier qu'ils deviennent obsédants. Leur sérieux ("Ils ne ricanaient pas") rend la menace plus grave et plus insidieuse que s'ils étaient caricaturaux).
Le passage s'ouvre sur le mantra "Surtout pas de peur", montrant que la peur est l'état par défaut qu'il faut combattre. Le projet de cette "autre langue" est une réponse esthétique et éthique à l'absurdité de sa situation. Ce n'est pas juste un style d'écriture, c'est une nouvelle façon de percevoir le monde. Ce passage est crucial car il montre le mécanisme de défense intellectuel et psychologique que la narratrice tente de construire face à l'oppression, ainsi que la manière insidieuse dont la surveillance s'intègre dans le quotidien...
"Keine Angst. Meine andere Sprache, dachte ich, weiter darauf aus, mich zu täuschen, während ich das Geschirr in das Spülbecken stellte, mein Bett machte, ins vordere Zimmer zurückging und endlich am Schreibtisch saß – meine andere Sprache, die in mir zu wachsen begonnen hatte, zu ihrer vollen Ausbildung aber noch nicht gekommen war, würde gelassen das Sichtbare dem Unsichtbaren opfern, würde aufhören, die Gegenstände durch ihr Aussehen zu beschreiben – tomatenrote, weiße Autos, lieber Himmel! – und würde, mehr und mehr, das unsichtbare Wesentliche aufscheinen lassen. Zupackend würde diese Sprache sein, soviel glaubte ich immerhin zu ahnen, schonend und liebevoll. Niemandem würde sie weh tun als mir selbst. Mir dämmerte, warum ich über diese Zettel, über einzelne Sätze nicht hinauskam. Ich gab vor, ihnen nachzuhängen. In Wirklichkeit dachte ich nichts.
Sie standen wieder da.
Es war neun Uhr fünf. Seit drei Minuten standen sie wieder da, ich hatte es sofort gemerkt. Ich hatte einen Ruck gespürt, den Ausschlag eines Zeigers in mir, der nachzitterte. Ein Blick, beinahe überflüssig, bestätigte es. Die Farbe des Autos war heute ein gedecktes Grün, seine Besatzung bestand aus drei jungen Herren. Ob diese Herren ausgewechselt wurden wie die Autos? Und was wäre mir lieber gewesen – daß es immer dieselben waren oder immer andere? Ich kannte sie nicht, das heißt, doch, einen kannte ich: den, der neulich ausgestiegen und über die Straße auf mich zu gekommen war, allerdings nur, um sich an dem Bockwurststand unter unserem Fenster anzustellen, und der mit drei Bockwürsten auf einem großen Pappteller und mit drei Schrippen in den Taschen seiner graugrünen Kutte zu dem Auto zurückgekehrt war. Zu einem blauen Auto, übrigens, mit der Nummer... Ich suchte den Zettel, auf dem ich die Autonummern notierte, wenn ich sie erkennen konnte. Dieser junge Herr oder Genosse hatte dunkles Haar gehabt, das sich am Scheitel zu lichten begann, das hatte ich von oben sehen können. Einen Augenblick lang hatte ich mir in der Vorstellung gefallen, daß ich als erste die beginnende Glatze des jungen Herrn bemerkte, eher als seine eigene Frau, die womöglich nie derart aufmerksam auf ihn herabsah. Ich hatte mir vorstellen müssen, wie sie dann gemütlich in ihrem Auto beieinanderhockten (im Auto kann es ja sehr gemütlich sein, besonders wenn draußen Wind geht und sogar einzelne Tropfen fallen), wie sie die Bockwürste aufaßen und nicht einmal frieren mußten, denn der Motor lief leise und heizte ihnen ein. Aber was tranken sie dazu? Führten sie, wie andere Werktätige, jeder eine Thermosflasche voll Kaffee mit?
« Surtout pas de peur. Mon autre langue, pensai-je, continuant à me leurrer tandis que je mettais la vaisselle dans l'évier, faisais mon lit, retournais dans la pièce de devant et me trouvais finalement assise au bureau – mon autre langue, qui avait commencé à croître en moi, mais n'était pas encore parvenue à son plein développement, sacrifierait avec sérénité le visible à l'invisible, cesserait de décrire les objets par leur apparence – des voitures rouge tomate, blanches, bon ciel ! – et laisserait de plus en plus transparaître l'essentiel invisible. Cette langue serait percutante, du moins je le pressentais, précautionneuse et bienveillante. Elle ne ferait de mal à personne sinon à moi-même. Je commençais à comprendre pourquoi je ne dépassais pas ces notes, ces phrases isolées. Je feignais de m'y attarder. En réalité, je ne pensais rien.
Ils étaient de nouveau là.
Il était neuf heures cinq. Ils étaient de nouveau là depuis trois minutes, je l'avais remarqué immédiatement. J'avais senti une secousse, la déviation d'une aiguille en moi, qui vibrait encore. Un coup d'œil, presque superflu, le confirma. La couleur de la voiture était aujourd'hui un vert sourd, son équipage se composait de trois jeunes messieurs. Est-ce que ces messieurs étaient remplacés comme les voitures ? Et qu'est-ce que j'aurais préféré – que ce soient toujours les mêmes ou toujours d'autres ? Je ne les connaissais pas, c'est-à-dire que si, je connaissais l'un d'eux : celui qui était descendu récemment et avait traversé la rue vers moi, seulement pour faire la queue au stand de saucisses sous notre fenêtre, et qui était retourné à la voiture avec trois saucisses sur une grande assiette en carton et trois petits pains dans les poches de sa veste gris-vert. À une voiture bleue, d'ailleurs, avec le numéro... Je cherchai le papier sur lequel je notais les numéros des voitures quand je pouvais les distinguer. Ce jeune monsieur ou camarade avait des cheveux foncés qui commençaient à se clairsemer sur le sommet du crâne, j'avais pu le voir d'en haut. Un instant, je m'étais complu dans l'idée que j'étais la première à remarquer le début de calvitie du jeune monsieur, avant sa propre femme, qui peut-être ne le regardait jamais d'aussi haut avec autant d'attention. J'avais dû imaginer comment ils étaient alors tranquillement blottis les uns contre les autres dans leur voiture (on peut être très à l'aise dans une voiture, surtout quand il vente dehors et que même quelques gouttes tombent), comment ils mangeaient les saucisses et n'avaient même pas froid, car le moteur tournait doucement et les chauffait. Mais qu'est-ce qu'ils buvaient avec ? Est-ce qu'ils emportaient chacun une bouteille thermos pleine de café, comme les autres travailleurs ? »
C'est le aspect le plus singulier du passage. Pour survivre psychologiquement, la narratrice humanise ses geôliers. Elle note les détails triviaux : ils mangent des saucisses, l'un d'eux commence à perdre ses cheveux. Elle imagine leur vie intime ("sa propre femme") et même leur confort ("ils n'avaient même pas froid"). Cette humanisation est une tentative désespérée de ramener la situation à quelque chose de normal, de compréhensible, de contrôlable. En faire des "travailleurs" qui prennent leur pause café, c'est essayer de nier leur fonction réelle : être les instruments anonymes d'un système qui la détruit psychiquement. Pourtant, cette tentative échoue. La question finale ("Mais qu'est-ce qu'ils buvaient avec ?") est presque comique dans son trivialité, mais elle trahit une anxiété qui ne trouve pas d'issue. Même en les humanisant, elle reste obsédée par eux. Le système a réussi : ses pensées tournent inlassablement autour de ses surveillants, même pour en faire des êtres humains. Ils occupent entièrement son paysage mental ..
"Unsere Empfindungen bei solchen Gelegenheiten sind kompliziert. Und die richtigen Wörter hatte ich immer noch nicht, immer noch waren es Wörter aus dem äußeren Kreis, sie trafen zu, aber sie trafen nicht, sie griffen Tatsachen auf, um das Tatsächliche zu vertuschen, so unbekümmert würde ich nicht mehr lange drauflos reden können, aber was ist einer, der nicht unbekümmert ist? Bekümmert? Kummervoll? »Kummer«, las ich in Hermann Pauls Deutschem Wörterbuch, immer tiefer hineintreibend in meine Besessenheit: »Kummer« habe im Mittelhochdeutschen »Schutt, Beschlagnahme, Not«, in der älteren Rechtssprache sogar »Arrest« bedeuten können. Beschlagnahme, ja, das traf es, in Beschlag genommen dahinkümmern. »Es reuete ihn, daß er die Menschen gemacht hatte, und es bekümmerte ihn in seinem Herzen.« Doktor Martin Luther, der mir weismachen wollte, daß wir nur zustimmen oder ablehnen, Freund oder Feind sein können. Deine Rede sei ja, ja und nein, nein.
Was darüber ist, ist vom Übel. Des Doktor Luther Geschimpf auf den Papst, die gefräßige Sau, dann auf die Bauern, die tollwütigen Hunde. Glücklicher Mensch, der seinen Erzfeind aus sich herausstellen kann. In meiner Sprache werden Tiernamen nur auf Tiere angewendet werden, nie würde ich, wie andere es taten, die Namen von Schweinen und Hunden, nicht einmal die von Frettchen oder Reptilien auf die jungen Herren da draußen münzen können. Was mir fehlte, war wahrscheinlich ein gesunder nivellierender Haß.
Ich kannte sie ja nicht. Was wußte ich schon von ihnen. Selbst das Kennzeichen »Ledermäntel« war ja ein überholtes Klischee, Dederonanoraks hatten sich schon längst durchgesetzt, aber ob dieses Einheitskleidungsstück ihnen von ihrer Dienststelle für den Außendienst geliefert wurde oder ob sie zum Jahresende eine Verschleißgebühr bekämen und wie hoch die etwa sein könnte – das alles hätte ich nicht zu sagen gewußt. Und kannte man heutzutage nicht schon den halben Menschen, wenn man seine Arbeitsbedingungen kannte? Zum Beispiel hätte mich auch interessiert, wie bei ihnen die tägliche Arbeitseinteilung vor sich ging, oder der Befehlsempfang, wie man das wohl nennen mußte, und ob bestimmte Posten beliebter waren als andere, die Autoposten zum Beispiel beliebter als die Türstehposten. Und, wenn ich schon mein Interesse anmeldete: Ob jene, die mit ihren Umhängetaschen auf den Straßen patroullieren, tatsächlich in diesen Täschchen ein Sprechfunkgerät mit sich führen, wie das Gerücht es steif und fest behauptet. Ich hatte manchmal den Verdacht, in den Taschen wäre nichts als ihr Frühstücksbrot, das sie aus menschlich verständlicher Imponiersucht konspirativ versteckten. Eine verzwickte Art von Amtsanmaßung. Jedenfalls verbot es sich, vor einen von ihnen hinzutreten und höflich zu fragen: Verzeihen Sie bitte, was haben Sie eigentlich in Ihrer Tasche? Ebensowenig konnte man sich bei den Autobesatzungen erkundigen, ob sie mit Abhörgeräten ausgerüstet waren und wie weit gegebenenfalls deren Radius reichte. Andere Vertraulichkeiten hingegen würden sich nicht verbieten, auch im Umgang mit ihnen gab es einen Codex, der sich allerdings kaum erlernen ließ, man hatte ihn oder man hatte ihn nicht. Zum Beispiel bedauerte ich es immer noch, daß ich nicht gleich damals, als es anfing, in den ersten kalten Novembernächten, meinem Impuls gefolgt war und ihnen heißen Tee hinuntergebracht hatte. Daraus hätte sich eine Gewohnheit entwickeln können, persönlich hatten wir doch nichts gegeneinander, jeder von uns tat, was er tun mußte, man hätte ins Gespräch kommen können – nicht über Dienstliches, Gott bewahre! –, aber über das Wetter, über Krankheiten, Familiäres.
Nun aber Schluß...."
« Nos sentiments en de telles occasions sont compliqués. Et je n'avais toujours pas les mots justes, c'étaient toujours des mots du cercle extérieur, ils tombaient juste, mais ils ne touchaient pas, ils saisissaient des faits pour dissimuler le factuel, je ne pourrais plus encore longtemps parler avec autant d'insouciance, mais qu'est-ce qu'une personne qui n'est pas insouciante ? Soucieuse ? Affligée ? »Chagrin«, lus-je dans le Deutsches Wörterbuch de Hermann Paul, m'enfonçant toujours plus profondément dans mon obsession : »Kummer« (chagrin) pouvait signifier en moyen haut-allemand « gravats, confiscation, détresse », et même « arrestation » dans l'ancien langage juridique. Confiscation, oui, c'était ça, dépérir confisqué. »Il regretta d'avoir fait l'homme, et son cœur en fut affligé.« Docteur Martin Luther, qui voulait me faire croire que nous ne pouvons qu'approuver ou refuser, être ami ou ennemi. Que votre parole soit oui, oui, non, non.
Ce qui est en dehors de cela est mauvais. Les injures du docteur Luther contre le pape, la truie gloutonne, puis contre les paysans, les chiens enragés. Homme heureux, qui peut expulser hors de lui son ennemi juré. Dans ma langue, les noms d'animaux ne s'appliqueront qu'aux animaux, jamais je ne pourrais, comme d'autres l'ont fait, appliquer les noms de cochons et de chiens, pas même ceux de furets ou de reptiles, aux jeunes messieurs là-dehors. Ce qui me manquait, c'était probablement une haine nivelatrice et saine.
Je ne les connaissais pas, après tout. Que savais-je d'eux. Même le qualificatif « manteaux de cuir » était un cliché dépassé, les anoraks en Dederon s'étaient déjà imposés depuis longtemps, mais si ce vêtement uniforme leur était fourni par leur service pour les missions extérieures ou s'ils recevaient une indemnité d'usure en fin d'année et à combien celle-ci pourrait s'élever – je n'aurais su dire tout cela. Et est-ce qu'on ne connaissait pas déjà un homme à moitié quand on connaissait ses conditions de travail ? Par exemple, je me serais aussi intéressée à la façon dont se passait la répartition quotidienne du travail chez eux, ou la réception des ordres, comme il faut probablement appeler cela, et si certains postes étaient plus prisés que d'autres, les postes en voiture par exemple plus que les postes où l'on doit rester debout à la porte. Et, puisque je manifestais mon intérêt : Est-ce que ceux qui patrouillent dans les rues avec leurs sacoches portent vraiment un émetteur-récepteur dans ces petits sacs, comme la rumeur l'affirme catégoriquement. J'avais parfois le soupçon que dans les sacs il n'y avait rien d'autre que leur petit-déjeuner, qu'ils cachaient conspirativement par une vanité humainement compréhensible. Une forme compliquée d'usurpation de fonction. En tout cas, il était exclu de s'approcher de l'un d'eux et de demander poliment : Excusez-moi, qu'avez-vous donc dans votre sac ? Tout comme on ne pouvait pas se renseigner auprès des équipages des voitures pour savoir s'ils étaient équipés d'appareils d'écoute et jusqu'où s'étendait leur rayon d'action le cas échéant. D'autres familiarités, en revanche, ne seraient pas interdites, dans les relations avec eux aussi il existait un code, qui cependant ne s'apprenait guère, on l'avait ou on ne l'avait pas. Par exemple, je regrettais encore de ne pas avoir suivi mon impulsion à l'époque, quand cela a commencé, durant les premières nuits froides de novembre, et de leur avoir apporté du thé chaud. Une habitude aurait pu s'installer, personnellement nous n'avions rien les uns contre les autres, chacun de nous faisait ce qu'il devait faire, on aurait pu entamer une conversation – pas à propos du service, Dieu nous en garde ! – mais sur la météo, les maladies, les affaires de famille.
Mais maintenant, stop. »
La recherche du mot « Kummer » (chagrin) n'est pas une digression. C'est une tentative de trouver une profondeur historique et une précision qui manquent au langage contemporain.
Les définitions anciennes – « gravats, confiscation, arrestation » – sont bien plus puissantes et pertinentes pour décrire son état : elle se sent « confisquée » (en état d'arrestation dans sa propre vie) et réduite à l'état de « gravats ». Cette méthode montre comment la narratrice cherche dans la langue elle-même les outils pour comprendre et résister à son expérience....

"Adieu aux fantômes" (Auf dem Weg nach Tabou, 1994)
" Où veux-je en venir? Je crois que le temps est venu, tant à l'est qu'à l'ouest de l'Allemagne, de prendre congé du fantôme qui fut longtemps pour chacun l'autre pays, et donc également le sien propre. Nous savons bien ce qu'il advient de la réalité quand elle est niée et refoulée: disparaissant dans les zones obscures de la conscience, elle y dévoie activité et créativité tout en faisant surgir mythes, agressivité et délire. Ce sentiment de vide et de déception qui se répand est un terrain propice aux maladies sociales et aux anomalies qui voient les gens franchir " soudainement " les bornes de la civilisation, rejeter des conventions supposées bien établies _ jeunes zombies sans pitié ni pour les autres ni pour eux-mêmes. " Au séisme intellectuel et moral qui secoue l'Allemagne depuis le " tournant " de l'automne 1989, répond l'éclatement des textes de l'auteur de Cassandre réunis dans ce volume: articles, discours, conférences, essais, pièces de correspondance (avec Volker Braun, Efim Etkind, Günter Grass, Jürgen Habermas, etc.), extraits du journal intime, chacun témoigne à sa façon de la violence d'un déchirement social qui se lit ici comme une crise intérieure, tous ensemble dessinent les contours de ce que pourrait être une conscience allemande réunifiée. (Fayard)
La dissociation RFA / RDA - Johnson et Wolf se rejoignent par leur intérêt pour la RDA, mais avec des perspectives différentes : Johnson écrit depuis l’exil et dans une prose fragmentaire, Wolf témoigne depuis l’intérieur avec une dimension existentielle et féminine : avec "Jahrestage" (1970–1983, Anniversaires), Uwe Johnson (1934–1984) compose une fresque polyphonique où l’histoire familiale et la grande Histoire (nazisme, RDA, guerre froide) s’entrecroisent. C'est une critique lucide du régime de la RDA mais auss un observateur critique de la RFA ; il vit longtemps en exil (New York, Angleterre). Il incarne un modèle de littérature de la mémoire et de l’exil intérieur/extérieur, très étudié académiquement.
La condition de l’individu en RDA et la contradiction entre idéal socialiste et réalité politique, sont les thèmes centraux de Christa Wolf (1929–2011). "Nachdenken über Christa T." (1968, Réflexions sur Christa T.) nous offre un portrait d’une femme déçue par la RDA, "Kindheitsmuster" (1976, Trame d’enfance), une réflexion sur la mémoire individuelle et collective du nazisme et du socialisme. Elle incarne l'écrivaine critique restée en RDA, s'assumant entre loyauté au socialisme et désillusion croissante. Elle est l’une des voix féminines majeures de la littérature est-allemande ; après 1989, son œuvre reste une référence pour comprendre l’expérience de la RDA “de l’intérieur”.
Brigitte Reimann (1933–1973) incarnera la jeune génération qui voulait croire au socialisme, mais en dévoile très tôt les contradictions avec "Franziska Linkerhand" (roman inachevé, publié en 1974) et "Die Geschwister" (Les Frères et sœurs, 1963). Ses romans mettent en scène des héroïnes fortes, indépendantes, souvent en lutte contre la rigidité des dogmes et la place secondaire accordée aux femmes. Son journal intime (Ich bedaure nichts, “Je ne regrette rien”, publié après sa mort) est un témoignage précieux de la vie intellectuelle et intime en RDA.
Maxie Wander (1933–1977) marquera profondément la conscience féministe en RDA et au-delà, en révélant frustrations, aspirations et résistances quotidiennes, notamment avec "Guten Morgen, du Schöne" (1977, Bonjour, toi la belle), un recueil d’entretiens avec des femmes de tous âges et milieux en RDA. C'est un texte fondateur pour une prise de parole féminine : il donne une visibilité aux voix souvent invisibles (ouvrières, mères, étudiantes).
Sarah Kirsch (1935–2013) symbolisera la rupture entre poètes et régime dans les années 1970. Ses poèmes (Landaufenthalt, 1967 ; Zaubersprüche, 1973) et récits traduisent l'attitude d'une poétesse majeure, d’abord proche du réalisme socialiste, puis critique du régime. Ses poèmes associent une voix féminine intime, la nature et une sensibilité politique. Elle quittera la RDA en 1977 après avoir protesté contre la déchéance de nationalité de Wolf Biermann (chanteur dissident).
Irina Liebmann (née en 1943), reconnue pour "Berliner Mietshaus" (1982) et "In Berlin" (1994), est une écrivaine de l’observation, attentive aux lieux et aux histoires cachées derrière les façades de Berlin. Ses textes donnent une vision presque documentaire mais très littéraire de la vie quotidienne et de la mémoire urbaine en RDA puis après la réunification.
Helga Schubert (née en 1940), nouvelliste et essayiste, souvent centrée sur la psychologie intime et la condition des femmes en RDA. (Elle a remporté en 2020 le prestigieux Ingeborg-Bachmann-Preis, preuve de la reconnaissance durable de sa voix.)
Heiner Müller (1929–1995), dramaturge, poète, essayiste, est considéré comme le plus grand dramaturge de la RDA après Brecht, avec "Die Hamletmaschine" (1977) ou "Der Auftrag" (1980). Ses pièces déconstruisent les mythes politiques et littéraires (Hamlet, Prométhée…) pour en faire des métaphores de l’histoire allemande et des blocages du socialisme.
Volker Braun (né en 1939), poète, dramaturge, romancier, auteur de "Die Kipper" (1965), "Hinze-Kunze-Roman" (1985), fut très engagé dans le projet socialiste au départ, pour devenir de plus en plus critique dans les années 1970-1980. Sa langue inventive joue sur l’ironie et la satire pour dévoiler les contradictions de la RDA. Il représente l’intellectuel critique qui reste en RDA, sans rupture totale, mais avec une distance grandissante.
Franz Fühmann (1922–1984), nouvelliste, romancier, essayiste, ancien sympathisant nazi devenu partisan puis critique du socialisme, explorent dans "Kameraden" (1955), "Das Judenauto" (1962), "Vor Feuerschlünden" (1982) la culpabilité, la mémoire de la guerre et les illusions politiques. Il incarne la figure de l’intellectuel en constant processus d’autocritique.
Wolf Biermann (né en 1936), poète, chansonnier ("Die Drahtharfe" (1965), chansons satiriques et contestataires), devenu icône de la contestation artistique. Expulsé de RDA en 1976 après un concert à Cologne → déclenche une vague de protestations parmi les écrivains (Sarah Kirsch, Christa Wolf, Volker Braun…).
Günter de Bruyn (1926–2020), romancier, essayiste, "Buridans Esel" (1968), "Preisverleihung" (1972), ou "mémoires" (Zwischenbilanz), souvent ironiques, critiquent subtilement la bureaucratie, les carrières intellectuelles et le conformisme. Après la réunification, il publie des mémoires très influents sur l’expérience est-allemande.
Christoph Hein (né en 1944), romancier, dramaturge, essayiste, fut le Porte-parole d’une génération plus jeune, celle qui a grandi entièrement en RDA. Ses romans analysent le quotidien banal, mais révélateur, des individus sous surveillance et pression idéologique : "Der fremde Freund" (1982, traduit en français sous le titre L’Ami étranger), "Horns Ende" (1985). Ilse révèlera d'importance aussi après 1989, comme intellectuel engagé dans la transition.
