- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Svevo - Pirandello
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki
- 1930-1940
- 1930s
- Fitzgerald
- Hemingway
- Faulkner
- Koch
- Céline
- Bernanos
- Jouve
- DosPassos
- Kojève
- Miller-Nin
- Grosz - Dix
- Green
- Ortega y Gasset
- Wittgenstein
- Russell - Carnap
- Artaud
- Jaspers
- Sapir - Piaget
- Guillén
- Garcia Lorca
- Hammett
- A.Christie
- Heidegger
- Icaza
- Huxley
- Hubble
- Caldwell
- Steinbeck
- Waugh
- Blixen
- Rhys
- J.Roth - Doderer
- Aub
- Malraux-StExupéry
- DBarnes-NWest
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bataille
- Char-Michaux
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Bloch
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Lewin - Mayo - Maslow
- Montherlant
- Buzzati - Pavese
- Vittorini
- Fallada
- Malaparte
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Welty
- Boulgakov
- Tamiki - Yôkô
- Weil
- Gadda
- Broch
- Steeman
- Jouhandeau
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Ellison
- Bergman
- Baldwin
- Fromm
- Bradbury - A.C.Clarke
- Tennessee Williams
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Carpentier
- Mishima
- Salinger - Styron
- Pasternak
- Asturias
- O'Connor
- Hoffer
- Matute - MartinGaite
- 1960-1970
- 1960s
- Abe
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- U.Johnson - C.Wolf
- Heller - Toole
- Naipaul
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Onetti - Sábato
- Capote
- Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- McCarthy - Minsky
- Sillitoe
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- Lenz
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Dolls
- Ellis
- Cortázar
- Warhol
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- HarperLee
- Fuentes
- 1970-1980
- 1970s
- Habermas
- Handke
- GarciaMarquez
- Deleuze
- Derrida
- Beck
- Satir
- Kundera
- Hrabal
- Didion
- Guinzbourg
- Lovelock
- Vietnam
- H.S.Thompson - Bukowski
- Pynchon
- E.T.Hall
- Bateson - Watzlawick
- Carver
- Irving
- Milgram
- VargasLlosa
- Puig - Donoso
- Lasch-Sennett
- Crozier - Touraine
- Friedan-Greer
- Jacob-Monod
- Dawkins
- Beattie - Phillips
- Gaddis
- Rawls
- Zinoviev
- H.Searles
- Ballard
- Jong
- Kôno
- Calvino
- Ballester-Delibes
- ASchmidt
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact
- 1970s
- Habermas
- Handke
- GarciaMarquez
- Deleuze
- Derrida
- Beck
- Satir
- Kundera
- Hrabal
- Didion
- Guinzbourg
- Lovelock
- Vietnam
- H.S.Thompson - Bukowski
- Pynchon
- E.T.Hall
- Bateson - Watzlawick
- Carver
- Irving
- Milgram
- VargasLlosa
- Puig - Donoso
- Lasch-Sennett
- Crozier - Touraine
- Friedan-Greer
- Jacob-Monod
- Dawkins
- Beattie - Phillips
- Gaddis
- Rawls
- Zinoviev
- H.Searles
- Ballard
- Jong
- Kôno
- Calvino
- Ballester-Delibes
- ASchmidt

Arno Schmidt (1914-1979), "Scènes de la vie d'un faune" (Aus dem Leben eines Fauns, 1953), "La république des savants" (Die Gelehrtenrepublik, 1957), "Zettels Traum" (1970) - ...
Last update: 01/15/2020
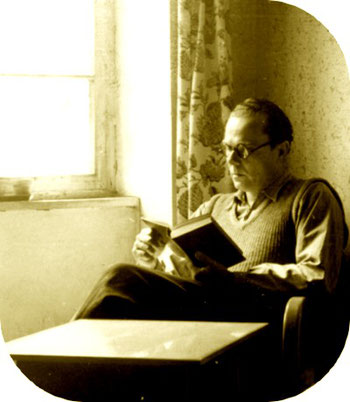
Tailleur de mots et architecte de la prose, Arno Schmidt est l'auteur en 1970 d'un fac-similé de 1334 pages, "Zettels Traum", ou Rêve de Fiches, qui demande 700 heures de lecture (plus de 5000 pages dites normales), qui a provoqué en son temps un véritable choc en Allemagne : il offrait une immense séance d'analyse freudienne (et schmidtienne) du travail d'Edgar Allan Poe.
Schmidt appliquait une lecture psychanalytique très libre, voire obsessionnelle, centrée sur la sexualité refoulée et les pulsions. S'il est une réalité , elle ne peut être appréhendée qu’à travers le langage, mais un langage, saturé d’inconscient, toujours ambigu et trompeur. Toute tentative d’accéder à une vérité objective par le langage échoue nécessairement. Seule la conscience de cette ambiguïté linguistique permet une véritable lucidité intellectuelle et existentielle.
Schmidt place explicitement Freud et Poe au cœur de son analyse : la littérature est l’expression de pulsions inconscientes profondes, souvent sexuelles ou refoulées, qui structurent implicitement tout texte littéraire. Son œuvre est une démonstration radicale : la psychanalyse est l'outil principal permettant de comprendre réellement la littérature, bien au-delà d'une lecture esthétique traditionnelle.
Ajouter à cela un Schmidt qui, comme Joyce avec l’Irlande, critique férocement la société allemande de son temps, particulièrement dans ses récits plus courts et satiriques. Il révèle les hypocrisies, les refoulements collectifs, les traumatismes de la guerre, la médiocrité intellectuelle et morale de son époque. Cette critique sociale se combine à une critique des formes littéraires traditionnelles : la littérature conventionnelle est accusée d'être complice de cette hypocrisie sociale.
Considéré comme l'une des figures majeures du modernisme tardif et du postmodernisme littéraire en Allemagne, Arno Schmidt fut un écrivain expérimental, souvent comparé à James Joyce et Samuel Beckett par son ambition linguistique, stylistique, et formelle. Un auteur culte, reconnu principalement par des cercles littéraires restreints d’intellectuels, d’universitaires, et de passionnés de littérature expérimentale. Toutefois, son impact mondial demeure plus confidentiel, surtout en raison de la complexité linguistique et culturelle de ses œuvres, difficilement accessibles hors du contexte germanophone. La traduction anglaise récente (2016) de "Zettels Traum" (Bottom’s Dream) a accru sa visibilité, mais reste marginale comparée à l'influence mondiale de Joyce.*
James Joyce (1882-1941), notamment avec" Ulysse" (1922) et "Finnegans Wake" (1939), a exercé une influence immense sur la littérature mondiale :
- Révolution linguistique et stylistique majeure.
- Influence directe sur des écrivains essentiels comme Samuel Beckett, William Faulkner, Jorge Luis Borges, Thomas Pynchon, et bien d’autres.
- Une figure centrale, régulièrement étudiée dans toutes les littératures du monde, un repère incontournable pour toute littérature expérimentale ultérieure.
Schmidt a eu une influence notable sur :
- Les écrivains germanophones des années 1970 à nos jours, surtout ceux explorant la langue comme matériau littéraire (par exemple Reinhard Jirgl, Wolfgang Hilbig ou Uwe Johnson).
- Des écrivains expérimentaux européens contemporains intéressés par les frontières de la littérature, du langage et de la psychanalyse.
- Cependant, Schmidt n’a pas produit un effet d’entraînement comparable à Joyce hors du monde germanophone. Sa radicalité, son exigence linguistique, et son érudition élitiste limitent sa diffusion. Il est admiré mais rarement imité à grande échelle...

Une grande partie de la substance littéraire de Schmidt réside précisément dans ses exploits linguistiques intraduisibles.
Traduire Schmidt "littéralement" produirait souvent un texte incompréhensible en français ou anglais...
Il faut reconnaître de plus que les traductions françaises et anglaises des œuvres d'Arno Schmidt sont souvent partielles, adaptées, ou considérées comme des "approximations": "Aus dem Leben eines Fauns" (1953) en est un parfait exemple. Ainsi de la traduction française ("Le Faustus du faune", Tristram, 2008 - trad. Claude Riehl), clairement présentée comme une adaptation/version abrégée. Riehl a pris la décision éditoriale (nécessaire selon lui) de simplifier radicalement la structure syntaxique et de réduire les néologismes les plus complexes pour rendre le texte lisible en français. Des passages entiers sont condensés, l'architecture des phrases est souvent "normalisée". C'est une interprétation plutôt qu'une traduction littérale. Quant à la traduction anglaise ("The Fair-Haired Eckbert" dans Nobodaddy's Children, Dalkey Archive, 2011 - trad. John E. Woods), Woods, qui est le traducteur attitré et dévoué de Schmidt en anglais, nous donne certes une traduction plus complète et fidèle dans l'esprit et le contenu narratif que la française. Cependant il a du faire nombre de choix douloureux pour rendre les jeux de mots et néologismes (soit en trouvant un équivalent ingénieux, soit en expliquant en note). La densité des références reste un défi pour le lecteur non-germanophone....
Pour accéder à la pleine puissance de son œuvre, la lecture de l'original allemand reste indispensable, souvent avec un dictionnaire et des ouvrages de référence à portée de main...

Arno Schmidt (1914-1979)
Arno Schmidt est né à Hambourg et, en 1928, après le décès de son père, sa famille s’installe en Silésie. Il entame des études de commerce à Görlitz qui le mènent à travailler dans les bureaux d’une grande fabrique de vêtements, où il fait la rencontre d’Alice Murawski, avec qui il se mariera en 1937. En 1935, il fait parvenir des poèmes à Hermann Hesse et débute l'établissement d'une table de logarithmes de sept à dix chiffres d’une part, et l’écriture d’une biographie monumentale de Friedrich de La Motte-Fouqué d'autre part.
Arno Schmidt n'a pas simplement "découvert" Joyce ; il l'a absorbé, traduit (à sa manière), idolâtré, et finalement pris comme défi à surpasser....
Schmidt découvre Joyce dès les années 1930, alors qu'il est un jeune homme isolé intellectuellement dans l'Allemagne nazie. Sa lecture d' "Ulysse" (dans la traduction allemande de Georg Goyert, 1927) puis de "Finnegans Wake" (dont il étudie des fragments) est une révélation foudroyante. Il perçoit immédiatement Joyce comme le pionnier absolu de la modernité littéraire, celui qui a radicalement transformé les possibilités du langage et de la narration. Le parallèle avec "Finnegans Wake" est essentiel pour comprendre "Zettels Traum" - cette idée de livre-monstre comme territoire à conquérir. Mais il faut souligner que Schmidt se voyait en rival, pas en disciple (dans ses essais (comme "Der Triton mit dem Sonnenschirm"), il analyse Joyce avec une acuité féroce, mêlant admiration sans borne et volonté de marquer sa propre différence).
En 1947, Schmidt publiera une traduction partielle et très personnelle de passages de Finnegans Wake (sous le titre "Aus dem Finnegans Wake"). Cette traduction est un manifeste esthétique : Schmidt ne cherche pas une fidélité littérale, mais à réinventer Joyce en allemand, en poussant encore plus loin les jeux de mots et les associations, adaptant les références au contexte allemand. C'est déjà du "Schmidt" autant que du Joyce. Cet exercice lui permet de s'approprier les techniques de Joyce pour forger son propre style.

Durement confronté au nazisme, cet autodidacte provocateur à la culture encyclopédique, rebelle à toute « école », affirma toujours sa marginalité.
Soldat en 1940, il se rend en 1945 aux troupes britanniques et devient interprète au camp de prisonniers de Munster. Il est libéré fin décembre et s'installe avec son épouse au Mühlenhof à Cordingen, une région de landes qui lui rappelle son enfance.
Arno Schmidt n'était ni un nazi, ni un résistant. Il fut un opposant intellectuel passif, contraint à des compromis administratifs ...
Schmidt considérait les nazis avec un profond mépris intellectuel. Dans son journal intime et ses lettres d'époque, il les qualifie de "crétins" ("Dumpfbacken") et de "gang" ("Rotte"). Il rejetait l'idéologie nazie, son nationalisme exacerbé, son anti-intellectualisme et son esthétique kitsch. Sa pensée était fondamentalement individualiste et rationaliste, à l'opposé du culte du chef et du mysticisme nazi. Il n'a jamais adhéré au NSDAP (le parti nazi).
Mais, pour pouvoir publier légalement, tout écrivain devait être membre de la RSK (Reichsschrifttumskammer), contrôlée par les nazis : Schmidt fit ainsi une demande d'adhésion en 1940, qui fut rejetée (probablement en raison de l'absence de publications significatives à l'époque). Ce rejet l'a empêché de publier sous le régime, mais l'a aussi protégé d'éventuelles demandes de propagande. Il n'a donc jamais écrit ou publié de textes soutenant le régime.
Toujours en 1940, Schmidt 'est enrôlé dans la Wehrmacht. Grâce à ses compétences en mathématiques, il est affecté comme "technicien auxiliaire" (Hilfskanoneer) dans une unité d'artillerie en Norvège, loin du front principal. Ce statut lui évita de participer directement aux combats. Il passa une grande partie de la guerre dans des tâches administratives et techniques relativement protégées. Il considérait cette période comme une perte de temps abrutissante. Il adopta une stratégie de "retrait intérieur" (innere Emigration). Il ne participa pas à la résistance active, mais tenta de préserver son intégrité intellectuelle en se concentrant sur ses lectures, ses réflexions et ses projets d'écriture personnels (non publiables). Son attitude était celle du survivant pragmatique, cherchant avant tout à éviter les ennuis et à traverser la période sans compromission majeure. Nous sommes d'un héros de la résistance. Mais son expérience du nazisme et de la guerre marqua profondément son œuvre ultérieure. Il développa une critique féroce de l'Allemagne, de son passé militariste et autoritaire, et de la "bêtise" collective qui avait permis la barbarie nazie. Des œuvres comme "Das steinerne Herz" ou "Léviathan" explorent l'héritage toxique du nazisme et la difficulté de la reconstruction morale.
Bien qu'il n'ait pas été un collaborateur, son silence public sous le régime et son manque de résistance active furent parfois l'objet de discussions critiques après la guerre. Schmidt lui-même semblait avoir une conscience aiguë des ambiguïtés et des compromis de cette période.

Avril / Mai 1945 - Schmidt, démobilisé de la Wehrmacht (où il servait dans l'artillerie en Norvège), tente de rejoindre sa femme Alice dans la région de Celle, en Basse-Saxe (Allemagne du Nord). L'Allemagne est en plein effondrement, les fronts s'écroulent, les Alliés avancent. Les déplacements sont chaotiques et dangereux. En mai ou juin 1945, alors qu'il tente de franchir les lignes pour atteindre la zone contrôlée par les Britanniques, Schmidt est arrêté par les troupes britanniques. Malgré son statut de civil allemand et non de prisonnier de guerre, il est interné dans le gigantesque camp de personnes déplacées (DP Camp) de Fallingbostel, près de Bergen-Belsen. Ce camp, initialement un camp militaire nazi (Stalag XI B), était utilisé par les Britanniques pour regrouper les masses de réfugiés, travailleurs forcés libérés, anciens détenus des camps et aussi... des civils allemands errants comme Schmidt...
Schmidt n'était pas une "personne déplacée" au sens strict (victime déportée par les nazis en dehors de son pays). Il était un civil allemand sans papiers ni domicile fixe, errant dans une zone de conflit. Les autorités britanniques l'ont traité comme un réfugié potentiellement dangereux ou simplement comme un individu à contrôler dans le chaos ambiant. Le camp de Fallingbostel comptait des dizaines de milliers de personnes (principalement des anciens travailleurs forcés et prisonniers des pays de l'Est, mais aussi des Allemands) qui vivaient dans des conditions précaires : baraquements surpeuplés, nourriture rare et de mauvaise qualité, hygiène déplorable, violence latente. Schmidt a vécu cette période comme une humiliation profonde et une injustice. Lui, l'intellectuel antinazi, se retrouvait parqué avec des victimes du régime qu'il méprisait, mais aussi avec d'anciens nazis potentiels, dans des conditions inhumaines. Il se sentait traité comme du bétail. Cette expérience a renforcé son cynisme envers les vainqueurs (les Britanniques) et sa vision désespérée de l'humanité en général. Elle a cristallisé son sentiment d'être un paria dans son propre pays.
Schmidt sera libéré du camp à l'automne 1945 (probablement septembre ou octobre), après plusieurs mois d'internement. Il a pu enfin rejoindre Alice, qui vivait dans une cabane de bûcheron misérable dans la lande de la Lüneburger Heide. Leur vie dans l'immédiat après-guerre fut marquée par une extrême pauvreté et une lutte quotidienne pour survivre. Cette expérience hante son œuvre, notamment ses textes des années 1940 et 1950 qui dépeignent l'Allemagne en ruines ("Brand's Haide", 1951; "Leviathan", 1949). Elle a nourri sa critique féroce de l'hypocrisie de la reconstruction allemande, où les anciens bourreaux et les véritables victimes étaient souvent mélangés dans le même chaos, et où les Alliés n'étaient pas nécessairement des libérateurs bienveillants à ses yeux. Elle a renforcé son identification aux exclus, aux parias et aux victimes des systèmes (même si son propre statut était ambigu), sa marginalité ...
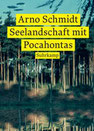
Il publie son premier texte en 1949, "Léviathan". En 1955, la parution de "Seelandschaft mit Pocahontas" dans le recueil "Trommler beim Zaren"lui vaut un procès pour blasphème et pornographie : deux adolescents qui s'accouplent dans un paysage post-apocalyptique et le mythe de la "bonne sauvage" comme antidote à l'Allemagne puritaine ...
L'action se déroule dans une Allemagne dévastée après une guerre nucléaire (un thème récurrent chez Schmidt). La nature reprend ses droits sur les ruines. Deux adolescents, le narrateur, un jeune homme d'une quinzaine d'années, et sa cousine (ou voisine), une fille nommée "Düte" (diminutif de "Editha"), à peu près du même âge, une excursion, les deux adolescents s'échappent pour une journée dans un paysage lacustre et forestier isolé, au milieu des ruines. Le cœur de la nouvelle est la description longue, explicite et lyrique de leur première expérience sexuelle, sur une île au milieu d'un lac. Schmidt décrit l'acte avec un mélange de crudité quasi-scientifique et de métaphores poétiques puisées dans la nature environnante. Dans un monde ravagé par la guerre et la destruction (allégorie de l'Allemagne post-nazie), l'éveil sexuel des adolescents représente l'impulsion la plus primitive et la plus pure de la vie. Malgré la description très physique, Schmidt insiste sur l'innocence des adolescents. Leur acte n'est pas pervers ou coupable, mais un élan naturel, instinctif et mutuel, libéré des tabous sociaux et religieux...

"Nobodaddy's Kinder" (1963)
Recueil de quatre nouvelles, "Leviathan", ou la déshumanisation capitaliste (un représentant de commerce, Karl Richter, erre dans une ville dévastée par la guerre, de l'absurdité du travail dans une société de consommation naissante et de la culpabilité refoulée des Allemands "ordinaires" sous le IIIe Reich); "Caliban über Setebos", ou la manipulation des masses (un ancien nazi, devenu prédicateur, exploite la crédulité populaire dans un village, et une référence au monstre de "La Tempête" de Shakespeare et à son dieu tyrannique, Setebos); "Gadir oder Erkenne dich selbst", ou de l'échec des utopies (Pendant la crise des missiles de Cuba (1962), deux amis débattent dans un bunker); "Nobodaddy’s Kinder", ou le vide métaphysique (un intellectuel solitaire dialogue avec un double halluciné,"Kamerad Satan"). Nous sommes les enfants de Personne. Notre père est un fantôme, notre mère une tombe : autant détruire les illusions par une langue elle-même explosive ...
La publication de "Nobodaddy's Kinder" (1963) par Arno Schmidt représente un moment charnière dans la littérature allemande d'après-guerre. L'œuvre paraît dans une Allemagne en plein "miracle économique", où le refoulement du passé nazi domine. Schmidt dénonce l'amnésie collective et l'absence de véritable dénazification. Le titre lui-même est un cri : les "enfants de Personne-Père" (traduction de Nobodaddy, néologisme emprunté à William Blake) symbolisent une génération abandonnée par ses pères compromis, livrée à un vide moral. Schmidt y développe sa révolution formelle, des monologues intérieurs fragmentés et flux de conscience, des néologismes et jeux de mots subversifs ("Vaterland" modifié en "Verbrecherland" / "pays des criminels"). L'aliénation du petit-bourgeois (Leviathan), la manipulation des masses par la religion et la politique (Caliban über Setebos), l'échec des utopies (socialisme, capitalisme) face à la barbarie humaine (Gadir oder Erkenne dich selbst), une critique acerbe de la RFA (Allemagne de l'Ouest) et de sa restauration conservatrice,
"Nobodaddy's Kinder" peut être vu comme l'acte fondateur d'une contre-culture littéraire en Allemagne. Schmidt y fusionne innovation formelle, critique politique et métaphysique du désastre pour forcer son époque à regarder son reflet dans le miroir brisé de l'Histoire. Son exigence radicale reste un défi lancé à toute littérature complice du silence.
Schmidt verra le Groupe 47 comme l'incarnation d'une normalisation littéraire complice du miracle économique ouest-allemand, qui évitait de confronter pleinement les traumatismes du nazisme ; et Hans Werner Richter, fondateur du Groupe 47, qualifieraa Schmidt de "malade mental" et jugera son œuvre "indécente". Schmidt trouva appui auprès de quelques écrivains marginaux, Helmut Heißenbüttel, théoricien de l'avant-garde qui partageait ses expérimentations linguistiques, et Hans Magnus Enzensberger qui, bien que membre du Groupe 47, le défendit dans la revue Kursbuch, saluant son "anarchisme linguistique"...
On notera, ce qui peut prêter à confusion, que John E. Woods a choisi en 1981 de regrouper et de publier sous le titre "Nobodaddy’s Children: Scenes from the Life of a Faun, Brand’s Heath, Dark Mirrors" une traduction de trois romans publiés par Schmidt séparément, "Aus dem Leben eines Fauns" (1953), "Brand’s Haide" (1951), "Schwarze Spiegel" (1956). Ce sous-titre général a été choisi afin de faire référence à un thème commun (le rejet des figures d'autorité paternelle/divine, inspiré par le terme "Nobodaddy" de William Blake).

Après le scandale de "Paysage lacustre avec Pocahontas" et des années de précarité, Arno Schmidt et son épouse Alice (sa première lectrice, sa dactylographe (tapant ses manuscrits complexes), sa gestionnaire pratique et son soutien indéfectible) décident de se réfugier en 1958 dans le petit village de Bargfeld, en Basse-Saxe (Allemagne du Nord). Schmidt quitte la relative agitation de Darmstadt et se coupe volontairement des cercles littéraires et des milieux intellectuels des grandes villes, pour se consacrer entièrement à son projet d'écriture monumental.
La petite maison de Bargfeld, entourée de champs et de forêts (le paysage caractéristique de la "Lüneburger Heide"), devient son laboratoire littéraire...
C'est à Bargfeld qu'Arno Schmidt écrit ses œuvres les plus ambitieuses et expérimentales, celles qui allaient définir sa légende :
- "KAFF auch Mare Crisium" (1960) : Déjà très expérimental.
(Traduction anglaise : KAFF also Mare Crisium, traduit par John E. Woods (1982) - Traduction française : KAFF ou Mare Crisium, traduit par Claude Riehl (1991) - Récit de science-fiction expérimental où un écrivain s'installe dans une colonie lunaire, mélangeant satire sociale, réflexion philosophique et expérimentations linguistiques).
- "Die Gelehrtenrepublik" (La République des Savants, 1957 - écrite peu avant le déménagement définitif, mais Bargfeld devient le lieu de ce type de travail).
- "Zettel's Traum" (Le Rêve de Zettel, 1970) : L'œuvre-monstre. C'est principalement dans l'isolement de Bargfeld, entre 1963 et 1970, que Schmidt conçoit et rédige ce texte colossal de plus de 1300 pages en format A3. L'immensité du projet nécessitait cet isolement et cette concentration absolue. Un livre énorme, chaotique, utilisant toutes les formes et techniques d'expression pour lequel il a élaboré pendant 10 ans un classement démentiel de 130000 fiches, met en scène quatre personnages qui discutent inlassablement de l'oeuvre d'Edgar Poë, revue et corrigée par celle de Freud. Le livre a divisé la critique comme rarement. Certains y verront un chef-d'œuvre génial et révolutionnaire (l'"Ulysse" allemand), d'autres une imposture illisible, prétentieuse et obscène. Cette polarisation même alimentera le choc et le scandale.
- "Abend mit Goldrand" (Soir au liseré d'or, 1975) : Une autre œuvre majeure de sa période tardive.
- "Julia, oder die Gemälde" (Julia, ou les tableaux, posthume) : Dernier grand projet.
C'est aussi là qu'il mène ses immenses travaux de traduction (Edgar Allan Poe, James Fenimore Cooper) et d'essais (ses études sur Karl May, Friedrich de La Motte Fouqué, et bien sûr ses analyses de Joyce).
Schmidt mourra t à l'hôpital de Celle (près de Bargfeld) des suites d'un grave incendie qui a ravagé sa maison à Bargfeld le 31 mai 1979. Un incendie qui a détruit une partie de sa bibliothèque personnelle (estimée à 12 000 volumes), ses notes préparatoires, des manuscrits en cours (dont une partie de son roman inachevé "Julia, oder die Gemälde").
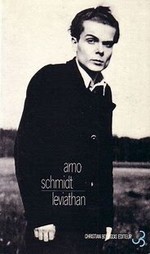
"Leviathan" (1949)
Traduction anglaise : Leviathan, traduit par John E. Woods (1983) - Traduction française : Léviathan, traduit par Claude Riehl (1991) - Roman court, satire politique et existentielle décrivant l'Allemagne d'après-guerre, mêlant pessimisme profond et ironie corrosive ...
C'est l'un des premiers grands romans allemands à aborder frontalement, sans fard ni pathos gratuit, l'expérience de la défaite et du retour des soldats dans un pays en cendres. Il ignore tout discours rédempteur ou nostalgique.
Le narrateur, Walter Eggers, un ancien soldat allemand (ou peut-être un déserteur) erre dans un paysage dévasté du nord de l'Allemagne (probablement la Lüneburger Heide, région chère à Schmidt). Le récit est largement porté par un flux de conscience tourmenté, souvenirs fragmentés, vocabulaire concret, parfois violent ou grotesque, néologismes, reflet du chaos intérieur du personnage et du monde environnant.
Eggers croise la route d'un autre errant, Ivan (ou "Iwan") Kulka, un soldat soviétique déserteur. Malgré la barrière de la langue et la méfiance initiale (des ennemis d'hier), une forme de complicité fragile naît entre ces deux parias, unis par leur rejet de la guerre et leur fuite. Les deux hommes marchent ensemble à travers un paysage apocalyptique : villages bombardés, forêts calcinées, populations traumatisées, débris et cadavres. Ils cherchent simplement à survivre, à trouver de la nourriture et un abri précaire. Le "Léviathan" fait référence à un énorme canon d'artillerie ferroviaire (un monstre d'acier similaire aux canons "Schwerer Gustav" allemands) abandonné au milieu de la lande, rouillé et menaçant, et qui devient le symbole central du roman : symbole de la destruction massive et de la technologie militarisée de la guerre moderne, et allégorie du pouvoir écrasant de l'État (référence directe au "Léviathan" de Thomas Hobbes, représentant l'État souverain tout-puissant, ici perverti par le totalitarisme nazi et stalinien). Un objet de fascination et d'horreur pour les deux personnages.
Leur frêle alliance et leur quête de survie tournent court de manière absurde et violente. Kulka est accidentellement tué par une sentinelle allemande (ou des civils paniqués ? les versions diffèrent) lors d'une tentative désespérée de voler de la nourriture. Eggers se retrouve seul, définitivement perdu dans un monde dépourvu de sens et d'espoir.
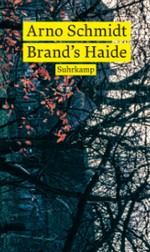
"Brand's Haide" (1951)
Arno Schmidt, le chroniqueur le plus implacable de l'effondrement et des ambiguïtés de son pays...
(Traduction anglaise : Brand's Heath, traduit par John E. Woods (1981) - Traduction française : La lande de Brand, traduit par Claude Riehl (1990) - On a marché sur la lande, Tristram, 2005)
- Allemagne de l'Ouest en 1946, dans une région de lande dévastée (la "Lüneburger Heide", paysage obsessionnel chez Schmidt). "Brand's Haide" (la "Landes de Brand") est une vaste étendue sauvage, marquée par un incendie récent qui a laissé des cicatrices noires et une atmosphère apocalyptique. Schmidt écrivit cette nouvelle alors qu'il était lui-même réfugié dans un camp pour personnes déplacées.
Heinrich Düring, un ancien soldat allemand démobilisé, intellectuel désabusé et profondément cynique. Il erre sans but précis dans la lande, survivant de petits trafics et d'expédients. La nouvelle n'a pas une intrigue linéaire forte, mais présente une série de rencontres et de scènes révélatrices :
- Le Vieux Brand : Un paysan misérable et à moitié fou qui vit dans une cahute isolée. Il est hanté par le souvenir de sa femme morte et obsédé par la peur des incendies (d'où le nom de la lande). Il représente l'ancrage désespéré dans un monde révolu.
- Les "Personnes Déplacées" (DPs) : Des travailleurs forcés étrangers (polonais, russes) libérés des camps mais bloqués en Allemagne, vivant dans des baraquements précaires. Düring observe leur misère et leur résignation amère.
- Les Profiteurs et Trafiquants : Des figures louches qui tirent profit du chaos (marché noir, vols). Düring lui-même participe à ce système pour survivre.
- Les "Cadavres" du Passé : Des rencontres fugaces avec d'anciens nazis camouflés ou des victimes traumatisées, évoquant l'omniprésence du passé non résolu.
- Et l'Événement Central : le pillage spectaculaire d'un train militaire allié transportant des vivres. La scène, chaotique et violente, montre la décomposition de l'ordre et la lutte sauvage pour la survie. Düring y participe, en spectateur actif et cynique. Nulle véritable fin, celui-ci poursuit son errance dans un paysage qui continue à se consumer. Les anciens nazis se recyclent, les profiteurs prospèrent, tandis que les véritables victimes (les DPs, les gens ordinaires écrasés) sont ignorées. Le récit avance par bribes, dialogues saccadés, monologues intérieurs. La décomposition morale de l'Allemagne en 1946, nul "miracle" en germe...
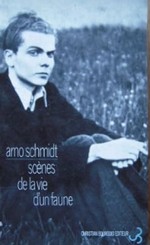
"Aus dem Leben eines Fauns" (1953)
Traduction anglaise : Scenes from the Life of a Faun, traduit par John E. Woods (1983) - Traduction française : Scènes de la vie d’un faune, traduit par Claude Riehl (1991) Julliard 1962 / nouvelle traduction Éditions Tristram 2011 -
Récit satirique à la première personne, où le protagoniste (un intellectuel solitaire) critique amèrement la société et explore ses fantasmes sexuels et intellectuels sur fonds de montée et d'expansion du nazisme. Un ouvrage censuré en RFA, il est vrai que les fantasmes de Düring réduisent souvent les femmes à des objets érotiques, que la densité des références peut décourager le lecteur non-initié, et qu'aucune rédemption n'est offerte à l'Allemagne, si ce n'est une retraite hors du monde ..
Düring est fonctionnaire dans une sous-préfecture de l'Allemagne du Nord. Dans les rues, des haut-parleurs crachent des slogans nazis. Au bureau, les talons claquent, des "Heil Hitler!" retentissent dès que s'ouvre une porte, et des vannes bestiales fusent quand on est entre collègues. Premiers signes d'oppression politique et de lâcheté individuelle face au nazisme triomphant. À la maison l`attend une épouse acariâtre, il faut se méfier de tout, même de ses propres enfants qui paradent déjà en uniformes constellés d'insígnes.
Mais Düring mène une double vie et tient un journal.
Le projet initial de Düring - vivre en "faune" libre, retiré du monde - sera pulvérisé par l'histoire. Son silence sera l'aveu de cet échec. La barbarie anéantira toute possibilité de retrait ou d'innocence face à la machinerie totalitaire du monde que se forge les hommes. L'impossibilité de fuir l'histoire et la politique dans l'Allemagne nazie ...
"Faune"? La figure du faune chez Schmidt se voulait une arme de subversion par l'ironie, la mythologie et l'érudition, c'était l'énergie chaotique du dieu Pan. "Ceux-là qui se démènent en chemises brunes, déversent à pleins gaz ces airs martiaux, qui se gargarisent de mots de pacotille, tout cela n’est pas mon peuple ! C’est le peuple d’Adolf Hitler ! (Un demi-million, peut-être, sont différents, c’est-à-dire meilleurs ; mais dans ce cas nous devrions changer de nom, émigrer, dans la Saskatchewan, – ah, tout ça est si déprimant et nul, et je continuai, maussade, à piqueter le macadam de mes jambes maigres. Ou pourquoi pas dans les Malouines.)...
"Faune", il tentera de l'être aussi parce qu'il hantera les bois avec la belle Käthe, sa "Louve" ("Louve" pour sa sauvagerie érotique et sa ruse de survivante), sur les traces du "loup-garou" Caterre, un déserteur de l'armée napoléonienne fuyant la conscription. Sa cabane dans les marais, vieille de 150 ans, leur servira de refuge quand leur lotissement sera pris sous un bombardement apocalyptique.
Schmidt procède par paragraphes brefs (une succession d'instantanés scintillants, en vrac), disposés comme en contrepoint des communiqués bêtifiants hurlés dans les rues, et inaugurés par des incipits en italique qui agissent sur les nerfs comme une sirène annonçant l'imminence d'une déflagration poétique et furieuse ...
"... Scandale, scandale : Le cousin d’Otte (celui de Berlin), à l’occasion de sa visite, s’était promu de son propre chef au grade de Scharführer de la SA{74}, et allait être excommunié. : Et donc pas plus critiquable que les « chefs » d’en haut qui n’arrêtaient pas de s’inventer l’un pour l’autre des titres nouveaux, des nouveaux grades et des uniformes style Arabian Nights{75}. Le peuple entier est atteint de la fièvre des distinctions et des insignes et vibre avec ferveur en écoutant la saga de sa propre grandeur ! : Faut croire que cette veste leur est taillée sur mesure, aux Allemands !
Je préfère encore les élégantes blagues salaces de Schönert, « Oui ? » qui faisaient rire malgré soi : il me montrait discrètement la devise de Fräulein Knoop – c’était la grosse fille zélée à la placidité rose et blanche – une fille nue, une bougie à la main, avec pour légende « nosce te ipso » –. L’acuité d’esprit d’un Schönert (pas la finesse) ; mais lui aussi, il est « contre » as far as it goes, et la nausée commune suffit à instaurer une sorte de sympathie ; et au fond presque tout un chacun est d’une ignorance proportionnée à sa finesse d’esprit.
L’instrument de musique que je déteste entre tous : l’accordéon du peuple ! Avec ses sons nasillards, ternes, ses boutons.
« HeilittlerVousdésirez ? » (d’accord pour être citoyen et pour la cohésion du pays ; ta main droite doit ignorer. Et donc, je l’élevai mollement esquissant le salut allemand, tout en serrant le poing de la gauche, la main libre : de la sorte, je scinderai ma vie en deux : une moitié paume ouverte, loyaliste envers l’État. Et la gauche serrant le poing).
(Je me réserve toute action contre l’État ! : c’est la condition nécessaire à ma sécurité d’être humain ! En effet, l’État peut me contraindre par la force à faire tout ce qui semblera bon à ses dirigeants responsables-irresponsables : moi, par contre, je n’ai pas le pouvoir, au besoin par la force, de contraindre l’État à la raison ou à la justice ou au respect de ses devoirs. Il me faut donc constamment – à l’exception du droit fondamental à quitter l’État sans être inquiété avec tout ce que je possède – faire front contre l’arbitraire de l’État{76}. Et ne venez pas m’objecter finement que le petit employé que je suis n’est pas capable de juger des choses !! Et tous vos généraux et vos politiciens peuvent bien me rebattre les oreilles de l’assurance que nous vivons l’avènement de l’Âge d’or : dans dix ans, vous aurez rayé l’Allemagne de la carte ! Alors nous verrons qui avait raison : tous ces grands bonzes avec 95 % des Allemands ou le petit Düring ! Mais tout se révolte en moi à l’idée d’être forcé contre mon âme et conscience à danser avec les autres ; et je m’arrangerai pour agir en conséquence !)
Un coup de fil : « Monsieur le Sous-préfet ? – –. – –. » : « 11 heures 30, entendu. – Entendu. » Clac, raccroché. — « Réunion de tous les chefs de bureau chez le grand patron », expliqué-je à Peters, « sûrement encore pour nous passer un savon : nous traiter de déficients. »
Chez le Sous-préfet et silence. Comme prévu, il nous fait attendre, ça impressionne ; huit types et l’assistante sociale, sa médaille de la Reine Louise sur la walkyrienne poitrine de lin bleu. Après tout, j’ai rien contre : tout ça, c’est pris sur notre temps de travail ! (et sur notre vie aussi, malheureusement). Léger chuintement provenant du chauffage central.
Au-dessus de lui, sur le mur : von Seeckt, le « fondateur de la nouvelle Wehrmacht allemande », Heil, le monocle persuasif : un usage remontant à Wotan{77} parmi les officiers de haut rang (cf. le reportage de Rudolf Herzog{78} sur le Crépuscule des Dieux : « … son œil unique étincelait et lançait des éclairs »).
« Non, vous pouvez disposer, Frau Woltermann » ; il se cala en arrière (il avait l’air de penser très intensément à rien). « Lequel d’entre vous a – euh – une pause habile ; il releva une fois de plus la feuille légèrement vers lui (alors qu’il la connaissait sûrement par cœur ; c’était certainement ici le moment de l’engueulade habituelle) – un diplôme supérieur ? », il prononça ces mots avec un regret poli « – ou à défaut le bac » (« ou un papier dans le genre » aurait été plus approprié. Pour sa part, il a obtenu un doctorat avec pour sujet de thèse “L’évolution économique de la menuiserie dans le duché de Leiningen, son importance actuelle et ses perspectives d’avenir” !). « Les autres messieurs peuvent retourner à leur travail – », cela se passait comme à la cour du prince Irénée{79}. Mais nous trois restant, il nous considéra de plus près. « Vous n’avez pas plus de 26 ans, Herr Schönert ? – 27 – ? Mm. – Bon, ça ne fait pas l’affaire, merci. » L’air exténué, il regarda vers la fenêtre et se pinça longuement la peau blanche au-dessous du menton : Dieu, que c’était difficile de se faire comprendre par des seulement-bacheliers ! « Avez-vous retenu quelques rudiments de langues étrangères ? – latin, ou anglais, ou français ? – » (comme se risquant à peine à poser une question sans espoir, le « et » hors du possible ; et je souris intérieurement avec suffisance et commisération, fielleux et l’air supérieur : ô Dieu, quel mépris réciproque !!). « Pas moi, monsieur le Sous-préfet », fit Nevers, jetant l’éponge avec une frayeur non feinte, et il nous laissa seuls à son tour. « Ainsi : You do speak English ? » demanda-t-il l’air conciliant et il sourit aimablement ; et nous échangeâmes quelques expressions maladroites, des bribes coprolithiques, moi m’efforçant d’imiter son accent défectueux. Oui. (Yes). « Bien », fit-il, dégrisé et revenant aux faits : « d’ailleurs – où avez-vous appris à vous débrouillez si – euh – passablement – ? » « Première Guerre mondiale, monsieur le Sous-préfet. J’ai servi en France ; et puis ensuite en captivité en Angleterre. Comme interprète dans le camp de prisonniers de guerre ; et je lis d’ailleurs encore assez souvent dans la langue. » « Ah, vous avez été soldat ! » feignit-il la surprise : « – euh – Quel grade ? » « Toujours homme du rang, monsieur le Sous-préfet », avec crânerie (en fait, les trois derniers mois, sous-officier, mais je ne le lui dis pas : toujours garder ses distances dans la mesure du possible avec ces gens-là !).
« Oui, c’est vrai que vous avez déjà – euh – ? » « 51 ans, monsieur le Sous-préfet. » Il hocha la tête en pressant les lèvres : « Ça convient bien ! » dit-il expressément ; puis : « Avez-vous des opinions particulières ; ou des attaches religieuses ; avec l’Église ou autre ? » « Pour moi, en tant que fonctionnaire, je ne connais que des Églises, monsieur le Sous-préfet », répondis-je conformément aux prescriptions : « Moi, ça m’est égal d’inscrire dans un passeport “catholique” ou “turc” ou “sans religion”. » Il sourit vaguement et, approbateur : « Donc non », résuma-t-il, hocha la tête et prit sa décision : « d’ailleurs, il est grand temps d’en finir avec toutes ces inepties. » Un coup d’œil à la pendule, et avec plus d’animation : « Et donc, c’est bon, Herr Düring ! – Il s’agit de la chose suivante : nous venons d’être chargés de créer ici dans nos bureaux quelque chose comme des archives concernant l’histoire de notre circonscription – nous mettons à disposition une ou deux pièces en bas, dans les sous-sols – euh – pour les documents, les actes, etc., de toutes les communes concernées, que nous allons rassembler, examiner et inventorier. Cela vaut aussi éventuellement pour les registres des paroisses ; et puis, s’il nous reste encore assez de temps, pour les documents privés. C’est là un travail d’une ampleur relativement considérable — naturellement en même temps d’une grande responsabilité » – ajouta-t-il conformément à ses obligations, « et qui suppose donc aussi certaines connaissances en langues. Latin, français, anglais majoritairement — euh – il vous faudra aussi dans certains cas examiner les choses sur place – à », il s’interrompit pour regarder, en face de lui, au mur, la grande carte de la circonscription – « – à – euh : Ahlden et Rethem par exemple : il doit y en avoir des montagnes ; Walsrode peut-être aussi ; éventuellement à Stellichte{80}, chez Herr von Baer – » d’une main impatiente, il chassa dans l’air une imaginaire objection importune de ma part : « mais non, je le connais personnellement, je pourrais – au besoin – vous fournir une – recommandation – » : il leva un visage engageant, ouvert : « Ce serait là une mission vraiment intéressante, trouvez pas ?! – Vous êtes quelqu’un d’intelligent : –? » (Quel porc arrogant ; mais je trouvai aussitôt la parade : je souris avec un tel air d’imbécile heureux et m’inclinai si béatement flatté, qu’il s’en aperçut et qu’il affecta la gravité ; lentement il se mordit les petits boudins gris de ses lèvres. Silence.) « Je n’aimerais pas la confier à l’un de nos universitaires », poursuivit-il sans enthousiasme, « et puis ces messieurs se font prier, posent leurs conditions. – Vous en chargeriez-vous ? » : il eut un regard clair et pur comme la montagne au matin chez Nietzsche. Je fronçai brièvement le front ; puis (pour fixer clairement les choses) je m’informai sur la durée de la mission. « Mais oui, bien sûr », acquiesça-t-il, « je proposerais que vous y consacriez 3 jours par semaine – j’adjoindrais alors à votre département un stagiaire de plus parmi les anciens. – Qui pourrait vous remplacer en permanence durant ces 3 jours ? Qui proposez-vous ? Peters, Schönert : lequel est le plus fiable ? » (Encore une belle peau de banane glissée en douce, ce genre de question !) « Le plus fiable, c’est Peters ; mais Schönert est plus intelligent – » fis-je en critique impartial, consciencieux. « Et donc ? » insista-t-il (souriant intérieurement, bien curieux de ma réponse ; mais je ne me trahis pas). « Si je peux me permettre une proposition », fis-je hésitant bravement, puis cédant à l’éthique : « Herr Peters ! » « Eh bien, c’est parfait », me signifia-t-il, satisfait, avec un hochement de tête. « Mais vous devrez encore attendre différents ordres de mission, et puis – j’aimerais aussi pouvoir m’assurer de vos compétences – : pouvez-vous passer ce soir chez moi, juste pour une heure, à la maison ? » (“À la maison”, quelle modestie : c’était la villa de 12 pièces sur la Walsroder Straße !) « Alors disons – : 18 heures – : d’accord ?! » (Ridicule puisqu’il est le “maître” et moi l’esclave !) ; pour finir, il s’arracha un sourire cheese et un signe de tête dans le vide, accablé de travail et surmené...." (Février 1939)
Comment l'individu (et l'Allemagne) traverse le temps historique par le déni, la mythologie personnelle et l'échec. La structure narrative est le message que transmet l'auteur, un Journal intime écrit en trois phases clés avant et pendant la guerre, fevrier 1939, mai-août 1939, aout-septembre 1944, une tripartition cruciale par laquelle Schmidt refuse toute linéarité pour montrer comment 1939 et 1944 se contaminent dans la conscience de son personnage principal. Les souvenirs pré-guerre ressurgissent en 1944 comme des présages auxquels on n'a guère voulu prêté attention ..
Le protagoniste ? Düring, un fonctionnaire, archiviste dans l'administration locale, veuf ou jamais marié, fuyant le régime nazi en simulant la folie? Sa "retraite" dans une forêt ressemble à une allégorie de la résistance passive. Ils m'ont congédié comme un chien malade – parce que je ne hurlais pas avec la meute ...
".. Ma vie ! : n’est pas un continuum! (pas seulement qu’elle se présente en segments blancs et noirs, fragmentés par l’alternance jour, nuit ! Car même de jour, chez moi, c’est pas le même qui va à la gare ; qui fait ses heures de bureau ; qui bouquine ; arpente la lande ; copule ; bavarde ; écrit ; polypenseur ; tiroirs qui dégringolent éparpillant leur contenu ; qui court ; fume ; défèque ; écoutelaradio ; qui dit « monsieur le Sous-préfet » : that’s me !) : un plein plateau de snapshots brillants.
Pas un continuum, pas un continuum ! : tel est le cours de ma vie, tel celui des souvenirs (de la façon qu’un spasmophile peut voir un orage la nuit) :
Flash : une maison nue de cité ouvrière grince des dents dans la broussaille d’un vert toxique : la nuit.
Flash : des faces blanches qui zyeutent, des langues dentellent au fuseau, des doigts font leurs dents : la nuit.
Flash : membres d’arbres dressés ; gamins poussant leur cerceau ; des femmes "coquinent" ; des filles taquinent à corsage ouvert : la nuit.
Flash : pauvre de moi : la nuit !!
Mais moi, dire que ma vie m’apparaisse comme le fleuve majestueux d’une chaîne de production, ça non, je peux pas dire ! (et les raisons).
Banquises au ciel : débâcle du gel, un champ. Dégel ; un champ. Des fissures noires où ont rampé des étoiles (étoiles de mer). Clair, nacré, un ventre de poisson (poisson-lune). Ensuite :
Gare de Cordingen : la neige en silence picotait les murs ; noir, un fil d’aiguillage frémissait vibrato à l’hawaïenne ; (près de moi parut la louve pailletée d’argent partout. Voir d’abord à monter dans le train)."
(...)

"Février 1939" est le chapitre fondateur qui jette Heinrich Düring au cœur de la machine totalitaire nazie en marche.
À travers le prisme d'un voyage en train glaçant et d'une arrivée dans un lieu d'exil hostile, Arno Schmidt dépeint avec une précision clinique et une ironie dévastatrice l'emprise quotidienne du régime, la complicité lâche ou enthousiaste de la population, la persécution visible, l'étouffement de la culture et la prémonition de l'horreur absolue (les camps). C'est la mise en place implacable du piège dans lequel le "Faune" Düring va tenter, désespérément, de préserver une parcelle de liberté intérieure. L'horreur est déjà là, palpable et inéluctable.
Février 1939, durant un hiver rigoureux. Le narrateur, Heinrich Düring, effectue un voyage en train à travers l'Allemagne, de sa Rhénanie natale vers son lieu d'"exil" forcé à Cordingen en Basse-Saxe (lande de Lunebourg). Le trajet devient une métaphore du pays tout entier.
L'Anschluss (annexion de l'Autriche) est passée, la Nuit de Cristal (pogrom de novembre 1938) a eu lieu quelques mois plus tôt. L'étau totalitaire se resserre, la persécution des Juifs et des opposants est visible, la propagande de guerre s'intensifie. Le voyage de Düring est une traversée d'un pays en pleine mutation fasciste. Le voyage en train est une métaphore du pays tout entier : un espace clos, surveillé, où chacun joue son rôle sous la contrainte ou la peur.
Düring quitte sa Rhénanie, région frontalière déjà fortement militarisée et surveillée. Son déplacement est présenté comme un "déplacement administratif" ou une forme d'exil intérieur, peut-être lié à son passé jugé suspect ou à son refus de s'aligner. Passagers Complices ou Résignés : Dans le compartiment, Düring observe ses compagnons de voyage : petits-bourgeois satisfaits, fonctionnaires zélés, militaires. Leurs conversations banales ou leur silence complice révèlent l'acceptation généralisée du régime ou la peur de parler. La propagande imprègne les esprits (journaux contrôlés, rumeurs colportées).
Paysage Hivernal et Politique : Par la fenêtre du train, Düring décrit un paysage glacial et désolé : champs sous la neige, forêts sombres, usines militarisées. Ce paysage devient le reflet métaphorique de l'état du pays : figé, menaçant, vidé de sa liberté. Les symboles nazis (drapeaux, affiches, installations militaires) ponctuent le voyage comme des stigmates.
Rencontres et Signes de la Terreur - Contrôles Policiers : Le train est soumis à des contrôles fréquents de la Gestapo ou de la police ferroviaire. Düring observe avec une ironie mordante la brutalité routinière, la suspicion généralisée, l'humiliation des contrôles d'identité. Ces scènes illustrent l'omniprésence de l'État policier. - Persécution Visible : Düring est témoin (directement ou par ouï-dire dans le train) des conséquences des persécutions - Allusions aux boutiques juives "aryanisées" (fermées, vendues de force) dans les gares traversées. Mention des camps déjà existants (comme Dachau, Buchenwald) comme une réalité connue mais occultée par la plupart. Présence de travailleurs forcés ou de personnes visiblement traquées, évitées par les autres passagers par peur.
Découverte d'un Tract (Élément Clé) : Dans les toilettes du train ou sur un quai, Düring trouve (ou voit brièvement) un tract antifasciste clandestin. Cet objet interdit, trace de résistance, est un choc. Il le lit furtivement avec un mélange d'espoir et de terreur avant de devoir s'en débarrasser (le jeter, le déchirer) pour ne pas être pris. Cet épisode souligne la rareté et le danger extrême de toute opposition.
Arrivée à Cordingen : Le Piège se Referme - Premières Impressions Glaciales : Düring arrive à Cordingen, son lieu d'affectation/d'exil. Le village lui apparaît encore plus médiocre, étriqué et imprégné de l'idéologie nazie que ce qu'il craignait. L'hiver renforce l'impression d'isolement et d'hostilité. - Installation Précaire : Il s'installe dans sa "Laubenkolonie", une cabane de jardin délabrée qui deviendra son refuge/observatoire. Cette installation dans un lieu marginal et inconfortable symbolise son statut de paria intellectuel.
Premiers Contacts Hostiles : Il croise ses futurs voisins, dont la redoutable Mme Schlick, dont le regard soupçonneux et le fanatisme latent sont immédiatement perceptibles. Les villageois le voient comme un étranger, un suspect potentiel.
La "Bibliothèque" Confisquée ou Menacée - Scène Symbolique : Düring tente d'installer sa précieuse collection de livres dans sa cabane. Il est immédiatement confronté à la censure et à la suspicion, soit des autorités locales (maire, responsable du parti) qui viennent "inspecter" ses livres, confisquant ou menaçant de confisquer ceux jugés "dégénérés", "bolchéviques" ou simplement trop intellectuels (Marx, la littérature classique non-nationale, etc.); soit il est averti que la possession de tels livres est dangereuse, l'obligeant à les cacher (sous le plancher, dans des caisses), réduisant son dernier refuge intellectuel à une cachette. Les livres sont l'âme de Düring ; leur confiscation ou leur mise au secret est une première violence contre son identité.
L'Odeur du Camp (Prémonition) - Alors qu'il explore les alentours de Cordingen, cherchant un semblant de paix dans la nature hivernale, Düring perçoit quelque chose d'inquiétant. Il sent une odeur étrange, écœurante (chair brûlée? chaux?) portée par le vent froid, ou entend des bruits lointains et inquiétants (cris étouffés? coups? machines). Il ne comprend pas encore clairement la source (le camp de concentration annexe qui sera révélé plus tard), mais une angoisse viscérale l'envahit. Le paysage idyllique potentiel est déjà souillé par une horreur invisible mais palpable. - Premier Contact avec la Barbarie : Cette scène établit un lien subliminal entre le lieu de son "exil" (Cordingen) et le système concentrationnaire, préparant la révélation brutale du chapitre "août-septembre 1944".
Düring est un observateur étranger dans son propre pays, incapable de partager son horreur ou sa lucidité avec quiconque dans le train ou à son arrivée...

"Mai-Août 1939" plante le décor d'une Allemagne étouffante et menaçante à l'orée de la catastrophe. C'est un chapitre fondateur qui établit les thèmes centraux du roman (résistance par l'écriture, critique radicale du nazisme, solitude de l'individu lucide) et prépare le terrain pour l'escalade de la terreur et de la violence dans les chapitres suivants, notamment "août-septembre 1944". Schmidt y pose la question : comment préserver son humanité et sa liberté intérieure quand le monde extérieur devient un piège totalitaire ?
Fin du printemps et été 1939 dans le village fictif de Cordingen, en Basse-Saxe (lande de Lunebourg). Le narrateur, Heinrich Düring, est un fonctionnaire rhénan "déplacé" (pour raisons politiques ou bureaucratiques obscures) dans ce trou perdu. Contexte historique : Les derniers mois avant l'invasion de la Pologne (1er septembre 1939). L'Allemagne nazie est en pleine préparation militaire et propagandiste, l'étau se resserre sur la société.
L'Arrivée et l'Installation du "Faune" - Düring, surnommé ironiquement ou aspirationnellement "le Faune" (en référence à la figure mythologique libre et sensuelle), s'installe dans une cabane de jardin délabrée, une "Laubenkolonie". Ce lieu devient son refuge symbolique contre le monde extérieur. Une relation amoureuse naît avec la jeune voisine, Käthe, qui l’accompagne parfois dans ce lieu, transformant le refuge en un “nid” érotique. Sentant l’imminence de la guerre, il retire toutes ses économies et stocke des denrées, anticipant la raréfaction des ressources — un acte discret, prudent, un glissement vers la préparation intérieure au conflit. Il décrit avec un mélange de dégoût et d'humour noir la médiocrité du village, la petitesse des habitants, la laideur du paysage transformé par une exploitation sylvicole intensive. Une tentative désespérée de cultiver un retrait "arcadien", une vie simple centrée sur la lecture (ses livres sont sa richesse), l'observation de la nature et une sensualité refoulée.
L'Environnement Nazi, la propagande omniprésente : Düring est bombardé par les signes du régime, affiches grandiloquentes ("Ein Volk, ein Reich, ein Führer!"), discours hystériques à la radio, journaux remplis de mensonges et de menaces. Conformisme et Dénonciation - Il observe la soumission peureuse ou l'adhésion fanatique des villageois. La figure de Mme Schlick, voisine acariâtre et nazie convaincue, émerge déjà comme une menace potentielle (préfiguration de la dénonciation future). - Militarisation : Les préparatifs de guerre s'intensifient : mouvements de troupes, bruits d'avions militaires, exercices paramilitaires locaux. L'atmosphère est lourde de menace imminente.
La "Vie de Faune" sous Contrainte : Düring tient un journal intime (qui forme la matière même du roman). C'est son acte de résistance primaire : noter, observer, critiquer mentalement, préserver sa lucidité et son moi. La Lecture comme Échappatoire : Il se plonge dans ses livres (philosophie, littérature classique et romantique, sciences), cherchant un antidote intellectuel à la bêtise ambiante. Ses références (Schopenhauer, les Romantiques) deviennent des armes contre l'idéologie nazie.
Sensualité Frustrée : Le désir du "Faune" est étouffé par le contexte puritain et répressif du régime et du village. Ses fantasmes et observations érotiques (souvent liés à des figures féminines croisées) restent largement intérieurs et source de tension.
Rencontres et Observations - Figures Villageoises : Schmidt brosse des portraits au vitriol des habitants : le maire petit chef, les commerçants véreux, les paysans bornés, les femmes soumises ou bigotes. Aucune figure positive n'émerge de cette galerie, soulignant l'isolement de Düring. - Une Nature Ambivalente : La lande environnante est à la fois un espace de liberté potentielle (promenades, observations naturalistes) et un lieu marqué par l'exploitation économique (coupes forestières) et, plus subtilement, par la menace politique (on sent que cet espace pourrait devenir un lieu de cachotterie ou de danger).
Prémonitions de la Catastrophe - Rumeurs et Anxiété : Malgré la propagande triomphaliste, des rumeurs sur les tensions internationales, les persécutions (contre les Juifs, les opposants) et la préparation à la guerre filtrent et créent une anxiété sourde. - Dramatisation Ironique des "Préparatifs" : Düring observe avec un humour grinçant les mesures dérisoires de "défense passive" (black-out, abris improvisés) qui contrastent avec l'ampleur de la catastrophe qu'il pressent.
Un sentiment de Piège : Le chapitre se clôt sur un sentiment croissant d'enfermement. La tentative de Düring de vivre en "Faune" retiré et libre se heurte violemment à la réalité totalitaire qui encercle son jardin et pénètre son quotidien. Il pressent que la guerre va anéantir son fragile refuge.

X. Les ellipses entre les périodes (1939 à 1944) figurent l'amnésie volontaire. Düring n'écrit pas pendant les pires années de la guerre : silence coupable...
Les années manquantes (1940-1943) correspondent à l'apogée militaire du IIIᵉ Reich (conquête de l'Europe), à la radicalisation de la terreur intérieure (Gestapo, déportations), et à la mise en œuvre de la Shoah. C'est la période où le régime nazi est le plus puissant et le plus meurtrier. Ces ellipses temporelles ne sont pas un hasard narratif, mais un acte littéraire et politique délibéré d'Arno Schmidt. Elles symbolisent effectivement une amnésie volontaire, un silence coupable et une impossibilité d'écrire pendant les années les plus sombres du nazisme et de la guerre. Pour Düring, écrire son journal est un acte de résistance intérieure. Son silence pendant ces années signifie que la terreur a atteint un seuil où même l'écriture clandestine devient impossible. La surveillance (notamment de Mme Schlick), les contrôles, la peur des représailles étouffent toute velléité de témoignage. Ne pas écrire, c'est ne pas formaliser l'indicible, ne pas lui donner de prise sur soi.
Ce silence fait-il de Düring un complice passif ? En ne documentant pas la catastrophe en temps réel, participe-t-il à l'oubli collectif que l'Allemagne d'après-guerre cultivera ? Le roman ne tranche pas, mais pose la culpabilité en filigrane.
L'ellipse narrative reflète l'aveuglement volontaire de millions d'Allemands pendant la guerre. Schmidt dénonce cette "amnésie pratique" qui permettait de vivre "normalement" à côté des camps et des crimes. Düring, en cessant d'écrire, devient malgré lui le symbole de cette lâcheté collective. En refusant de combler cette lacune, Schmidt refuse aussi la fiction réparatrice
Quand Düring reprend son journal en août 1944, l'Allemagne est en ruines. L'effondrement du régime rend possible (et nécessaire) la parole. Son récit des bombardements et de la découverte du camp est un retour du refoulé : l'horreur longtemps tue ressurgit avec violence.

"août-septembre 1944" (Aus dem Leben eines Fauns)
Fin de l'été 1944, dans le village fictif de "Cordingen" (inspiré de la lande de Lunebourg), où le protagoniste, Heinrich Düring, vit en retraité forcé, "déplacé" de sa Rhénanie natale. L'Allemagne nazie est en pleine débâcle (débarquement allié en Normandie, avancée soviétique à l'Est). La terreur intérieure (Gestapo, dénonciations) s'intensifie.
"En rêve : de nouveau à Hambourg, avec Käthe (habillés en cheminots, avec lampe et sifflet tuutt tuutt). On scie les barreaux des fenêtres, à l’intérieur, on emballe les tableaux dans des couvertures, on ajuste à l’angle, en sifflotant, on noue bien solidement ; on laisse comme par oubli les cartables contenant les documents (des faux, bien entendu !). « Des vitres pour le chef », fîmes-nous, l’air sombre, à la Gare centrale, en montrant nos papiers (ceux du père de Käthe !). Elle portait, martiale, la capote de contrôleuse sur ses puissantes épaules, la casquette noire à visière sur les cheveux, sa bouche taciturne soulignant l’énergie des yeux railleurs. Seuls à travers des trains désertés par les lampes, dans la nuit cahotante de troisième classe, des voyageurs avec de grands paquets légers, “Les trains doivent rouler pour la victoire”{178}, muets le plus souvent, et ma grande femelle condor calait ses jambes tubulaires contre le bas du siège d’en face, oh, autour de nous des réclames fanées blanc verdâtre pour une pâte dentifrice (et des vues de “Wasserburg” et de “Hainleite”{179} vissées aux parois) ; à grand bruit, les rails défilaient autour de nous ; nous assommâmes quelques couples de Polonais qui traînaient par là ; nous pointions le nez par des demi-portes ; nous nous trimballions dans des escaliers ; nous glissions sur l’échiquier de paysages : forêt-noir, champs-blanc ; je brisai des dents un crayon rouge, tirai à l’arc à lampe, me débattais dans des chaussures, Käthe installée sur les banquettes et moi à la recherche de seins dans le tapis du corsage rayé en long, maisons volantes et oiseaux migrateurs sur l’Ernst-August-Platz...."
Düring, surnommé "le Faune" pour son désir d'une vie sensuelle et libre hors des normes, étouffe dans l'atmosphère paranoïaque et conformiste du village. Son refuge est sa cabane ("Laubenkolonie") et ses lectures subversives (écoute clandestine de la BBC). Schmidt montre l'histoire "d'en bas", dans son quotidien sordide et violent, loin des grands récits.
Il observe avec un mélange de dégoût et d'ironie la propagande nazie (affiches, discours) et l'adhésion béate ou craintive des villageois. - La Dénonciation de Mme Schlick : La voisine de Düring, Mme Schlick, fanatique nazie, le dénonce à la Gestapo pour "défaitisme" et écoute d'émetteurs ennemis. Une dénonciation illustre la mécanique perverse de la terreur quotidienne. - Des agents de la Gestapo font une descente à la cabane de Düring. La scène est empreinte de violence sourde et d'arbitraire. Perquisition, humiliation et interrogatoire. Par chance (et peut-être grâce à l'inefficacité bureaucratique ou au chaos de la fin de guerre), il n'est pas immédiatement arrêté ou déporté. Il reste sous surveillance, vivant dans une peur constante.
"... La lampe à pétrole, dans ma main, fit avec moi un bond, et la secousse fit tomber l’abat-jour laiteux. L’armoire m’asséna un coup que je ne pus que de justesse parer du poing, mais ses battants continuèrent à s’acharner sur moi. Ma femme vacilla derrière la grille de son tablier, tenant une table dans ses mains ! Les vitres tintèrent et bronchèrent en ruant dans leur cadre ; une tasse s’élança dans l’air et retomba entre mes pieds écartés ; l’air jumpait (heureusement que toutes les fenêtres, estivales, étaient ouvertes !) ; je fus précipité à travers des portes, tête baissée, dansai désordonné sur l’escalier qui titubait, et m’affalai au milieu de gens sur le pas de la porte.
« Ils attaquent l’Eibia !! » le vieux Evers hurla et tremblait comme un manteau noir, j’attrapai Käthe saisie au hasard et nous galopions déjà, premiers secours techniques, derrière le vent dans cette direction sombre, nos semelles claquaient, on enjambait les barrières ; deux corneilles grasseyaient à nos côtés ; l’une des deux se tournant vers moi me lança un hargneux : Craass !! Craass !!
De nouvelles secousses formidables, et les maisons là-bas faisaient entendre des rires déments, des éclats aigus de vitres et de verres. Le pot au noir applaudissait de ses poings tonnants, explosine et mille détonations lançaient leurs grappins vers l’horizon. (Aujourd’hui, les éclairs hameçonnaient de bas en haut ; et chacun, jupitérien, é-tonnait grandement et frappait de stupeur le nuage où il disparaissait !)
La longue route tressauta. Un arbre nous désigna de son doigt énorme, tituba plus avant et referma derrière nous la prison de son branchage. On grimpa pardessus la terre à carreaux rouges, à travers des ruines nourries de flammes, on mastiqua à pleines mâchoires un air gélatineux au goût de fumée, on repoussa de nos paumes nues des éblouissements assourdissants, et nos pieds palpaient le sol toujours plus avant, dans nos chaussures aux lacets emmêlés, toujours soudés l’un à l’autre. Des pointes de feu lacéraient nos fronts jusqu’à la défiguration ; le tonnerre nous brassait peau et pores, enfonçant dans nos bouches des bâillons d’éboulis : et à nouveau des lames énormes nous trituraient menu.
Tous les arbres déguisés en torches (sur le Sandberg) : tout un front de maisons trébucha et faillit basculer sur nous, une écume de soie rose au coin de la gueule béante, aux yeux des fenêtres, des flammes vacillantes. Des boulets d’acier hauts comme des maisons déployaient, noirâtres, leur grondement autour de nous, meurtrier déjà leur seul écho ! Je me projetai contre Käthe, l’enveloppai de mes bras obstinés, et arrachai de là ma grande costaude : la moitié de la nuit se déchira, alors nous tombâmes, morts, au sol, sous l’effet du tonnerre (malgré tout, opiniâtres, on regrimpa hors de là, désemparés, cherchant notre souffle dans tous les volcans).
Deux rails s’étaient détachés et partaient à la pêche, en pince de crabe ; leur tenaille se retourna, passa, formant un arc qui sonnait harmonieusement au-dessus de nos deux têtes (et nous courûmes et nous aplatîmes sous le lent fouet d’acier). En dessous, quelque chose frappa, avec un défi rageur, contre nos os : la gueule d’un tuyau s’ouvrit, déversant tranquillement ses acides.
Toutes les filles ont des bas rouges ; elles ont toutes du vermillon dans leurs seaux : un long silo de poudre se scalpa lui-même, laissant déborder son cerveau efflorescent : par en dessous, il se fit hara-kiri, balançant plusieurs fois son corps monumental au-dessus de la boutonnière sanglante, avant, d’un jet, de se séparer de son tronc. Des mains blanches s’activaient, s’affairaient partout à la fois ; certaines avaient dix doigts sans phalanges, un seul était fait de nodosités rouges (et au-dessous de nous la grande danse des socques de bois marquait la cadence !). Les HJ grouillaient comme des loups-garous paramilitaires. Les pompiers, sans but, s’activaient. Des centaines de bras jaillissaient des cicatrices de l’herbe et distribuaient des tracts de pierre, et sur chacun s’inscrivait « Mort », grand comme une table.
Des vautours de béton aux serres d’acier rougies au feu passaient avec des cris malsonnants au-dessus de nous, par grandes bandes (jusqu’à ce qu’ayant trouvé leur proie en face, dans le lotissement, ils eussent fondu sur elle). Une cathédrale aux dentelures jaunes s’éleva poussant des hurlements dans la nuit aux franges violettes : c’est ainsi que l’énorme clocher sauta dans les airs ! Des gerbes de balles traçantes rouges comme l’amour se déployaient au-dessus de Bommelsen et nos visages étaient de deux couleurs : la moitié droite était verte, la gauche d’un brun ennuagé ; le sol, en dansant, se dérobait sous nous ; nous levions nos longues jambes en cadence ; un cordon lumineux traçait des loopings déments dans le ciel : à droite, bonbon vitreux, à gauche, le violet profond du vertige.
Le ciel prit la forme d’une scie, la terre, d’un étang rouge vif.
Et frétillants, noirs, des poissons humains : une jeune fille, buste nu, traversait l’air dans notre direction, en caquetant, la peau, telle une collerette de dentelle, lui pendant autour des seins recroquevillés ; sortant des aisselles, ses bras flottaient derrière elle comme deux bandelettes blanches. Au ciel, les serpillières rouges frottaient bruyamment, dégouttant de sang. Une longue remorque pleine de gens bouillis et cuits, passa sans bruit sur des roues garnies de pneus. Des mains aériennes de géants nous saisissaient constamment, nous soulevaient puis nous larguaient à terre. D’autres, invisibles, nous tamponnaient l’un contre l’autre nous laissant tremblants d’épuisement en sueur (ma belle suante et puante petite fille, viens, partons d’ici !).
Une citerne d’alcool enterrée se libéra sous les secousses, partit en roulant, s’ouvrant, se répandant comme des cristaux liquides sur un sol ardent, formant un Halemaumau (d’où s’écoulèrent deux rivières de feu : un policier, éberlué, s’interposa devant celle de droite et se sublima en service). Une nuée obèse se dirigea vers le dépôt, y dégaza sa grosse panse météorisée et d’un rot fit sauter une tarte à la crème en l’air, avec un gros rire : eh ben ! et en glougloutant, fit des nœuds emmêlés de ses bras et jambes, tourna par ici son croupion, et poussa des pets pleins de gerbes de tubes d’acier brûlants, sans répit, en vraie pétomane, à faire plier et craquer les buissons autour de nous..."
Les Bombardements Alliés - Le chapitre décrit avec une précision clinique et sensorielle les raids aériens alliés sur les cibles industrielles voisines (comme les usines Leuna-Werke). Le ciel déchiré par les projecteurs, le grondement des moteurs, les explosions, la terre qui tremble, l'odeur de la poussière et du feu. Schmidt montre la violence aveugle de la guerre moderne et ses conséquences pour les civils, sans pour autant excuser le régime qui l'a provoquée.
La Découverte du Camp (KZ-Außenlager) : Point culminant moral du chapitre : Düring découvre par hasard les traces d'un camp annexe de concentration (KZ-Außenlager) caché dans les bois près de Cordingen. - Scènes insoutenables : Il voit des déportés squelettiques, en tenue rayée, soumis à des travaux forcés épuisants, sous la surveillance de gardiens SS brutaux. Il perçoit l'odeur de la mort et de la souffrance. - Prise de conscience brutale : Cette révélation est un choc. Elle concrétise l'horreur du régime que Düring méprisait intellectuellement mais dont il ignorait (ou refusait de voir) l'ampleur monstrueuse à sa porte. C'est la face cachée, l'envers barbare du village "ordinaire". - La Réaction de Düring / La "Résistance" du Faune : sa réaction reste intellectuelle (trop dangereux, trop tard, sentiment d'impuissance) et il se réfugie dans l'écriture (son journal, base du roman), la lecture, l'observation naturaliste et l'ironie noire comme armes de survie psychique. Son refus de participer, de croire à la propagande, et sa lucidité désespérée sont présentés comme une forme de résistance minimale, celle de préserver son humanité et sa pensée libre dans un système qui les nie.
Le chapitre se clôt sur une atmosphère de désintégration imminente. La peur des représailles (des nazis, des Alliés), la destruction physique, la révélation de la barbarie et le sentiment d'être pris au piège dominent. Düring, survivant désabusé, attend la fin, conscient que la défaite nazie n'effacera ni les crimes ni la complicité silencieuse de la société allemande.
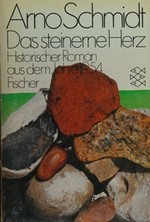
"Das steinerne Herz" (1956)
Traduction anglaise : The Stony Heart, traduit par John E. Woods (1989) - Traduction française : Pas de traduction publiée - Roman semi-autobiographique sur l'après-guerre en Allemagne, où Schmidt explore l'aliénation intellectuelle et morale dans un pays en reconstruction.
Les cent pages centrales qui nous promènent dans le Berlin marxiste des années 50 restent un morceau d'anthologie. L'intrigue est aussi simple que burlesque : Walter Eggers se fait passer pour un marchand de biens pour s'installer dans la maison du couple Thumann. Il espère y découvrir les almanachs de l'ancien royaume de Hanovre rédigés par l'arrière-grand-père de Frieda Thumann. Il a vu juste, tout y est, sauf un volume. Il se rend donc à Berlin-Est avec Karl, le mari, et subtilise le volume en question à la bibliothèque. Après maintes tribulations, les deux hommes repartent vers l'Ouest avec Line, la petite amie berlinoise de Karl. Frieda, au courant de cette relation, accepte sans peine sa présence, étant elle-même amoureuse d'Eggers. Et quand ce dernier dénichera un trésor dans le plafond de sa chambre, l'idylle sera parfaite.
Dans l`Allemagne d`Adenauer et sous l`égide de la princesse d'Ahlde et de Königsmark, Arno Schmidt mettait donc en scène un ménage à quatre, et cela dans un style échevelé, avec un récit construit comme un kaléidoscope et parsemé de transcriptions phonétiques du langage parlé le plus cru. La critique cria au scandale ....
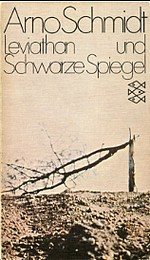
"Schwarze Spiegel" (1956)
Le troisième volet de ce qu'on appelle souvent la "trilogie de la guerre" ou la "Heath-Trilogie" d'Arno Schmidt (bien qu'il n'ait pas conçu ces trois romans comme une trilogie à l'origine). C'est une œuvre majeure de la littérature allemande d'après-guerre, appartenant au genre de la science-fiction post-apocalyptique, mais profondément ancrée dans une réflexion philosophique et métaphysique sur la condition humaine. Les "Miroirs Noirs" pour évoquer les lacs sombres de la lande, qui reflètent le ciel et le paysage comme des miroirs, mais d'un noir inquiétant; la conscience humaine ("miroir de l'âme") devenue sombre, tourmentée, incapable de refléter une vérité lumineuse; l'absence de reflet ou le reflet déformé de l'humanité dans le désastre qu'elle a créé, l'impossibilité de voir clairement le passé, le présent ou l'avenir.
Le Contexte est Post-Apocalyptique : le roman se déroule plusieurs années après une catastrophe nucléaire mondiale (la "Troisième Guerre Mondiale" ou "l'Événement"). L'Allemagne, et probablement le monde entier, est dévastée et pratiquement dépeuplée. La nature reprend ses droits sur les ruines de la civilisation. Le narrateur (qui n'est jamais nommé) est l'un des très rares survivants, vivant en ermite dans la lande de Lunebourg (Lüneburger Heide).
Le récit est structuré comme le journal intime du narrateur, retrouvé après sa disparition. C'est un flux de conscience, capturant ses journées, ses observations, ses souvenirs, ses lectures et ses réflexions philosophiques, un Journal de Survie et de Réflexion. Le texte est lui-même écrit dans un style très particulier, sans ponctuation traditionnelle (pas de points, virgules, majuscules en début de phrase), utilisant uniquement des barres obliques (//) pour marquer les pauses ou les changements de pensée. Il est dense, allusif, érudit et souvent difficile d'accès.
"(1. 5. 1960)
Lumières ? (Je me hissai sur les pédales) — : — Nulle part. (Donc, comme toujours ces cinq dernières années).
Mais : la lune laconique le long de la route effritée (l’herbe et le chiendent ont rampé depuis les accotements, défonçant le bitume et ne laissant que deux mètres de chaussée au milieu : ça me suffit !)
Pédaler plus dur : fixant depuis le genévrier, le masque argenté pointu — donc en avant —
La vie de l’homme : ça signifie quarante ans d’esquives et de détours. Et si par hasard du sort (je joue souvent ces jours-ci !), ils sont quarante-cinq ; pourtant leur force n’est que quinze ans de guerre et trois misérables inflations.
Rétropédalage : (et ça a couiné avec le frein ; faudra tout graisser demain). Par précaution, je braquai la gueule de ma carabine sur l’épave graisseuse : les vitres épaisses de poussière ; ce n’est qu’après l’avoir frappée de la crosse que la portière s’entrouvrit un peu. Banquette arrière vide ; une dame squelettique au volant (donc, comme toujours ces cinq dernières années !) ; bon : savoure ton bonheur ! Mais il ferait bientôt nuit aussi, et je ne faisais toujours pas confiance à la créature : que ce soit une embuscade de fougères ou des oiseaux moqueurs : j’étais prêt avec dix cartouches dans l’automatique : donc pompe en avant.
Perpendiculaire au carrefour : jadis, au-dessus de la jolie petite plaine unie, se levaient de délicats voiles de poussière, dans lesquels M. Gust faisait des pirouettes : mais quelle direction maintenant ?! Des panneaux en face ; je me traînai jusqu’à eux, las, <CORDINGEN LUMBER> juché sur des poteaux cerclés de jaune et noir infernalement vifs. À côté, sur la raie de labour délavée, un fût effilé. Je déchiffrai un moment la légende gravée : ah, voilà : un t.p. ! Et je ris faiblement : un flic m’avait expliqué un jour, en toute naïveté, que la police est aussi chargée de vérifier tous les points de triangulation tous les six mois, pour s’assurer qu’ils sont toujours là. Et comment l’un d’eux se trouvait à un quart de chemin dans un sentier, alors lui et les fermiers concernés avaient déplacé le truc d’un mètre cinquante vers la droite dans les bois où il ne gênerait personne, puis avaient continué année après année à signaler tranquillement qu’il était <en place> ! Depuis, je me méfie des résultats séculaires des géodésiens concernant le déploiement futur du massif alpin, ou le soulèvement de l’Allemagne du nord : cherchez les pandores ! — Oui, mais à gauche ou à droite ?
Bon : capita aut navim. Le penny tomba, et Édouard VII, fidei defensor, et aussi un tas d’autres choses, m’indiqua la droite : Bon ! (Et ma petite remorque biquille sautillait et cliquetait).
Un passage à niveau (Dieu merci les barrières levées) et une descente de plus en plus prononcée. Un pont Bailey (à moitié pourri ; vestige de la seconde guerre mondiale) enjambant le cours d’eau sinueux et silencieux (bel étang à ma droite, plaqué du dernier jaune du soir) ; puis la route vira à gauche, et avec une élégance lasse, je glissai, à la Seigneur du Monde, dans le virage : si quis, tota die currens, pervenit ad vesperam : satis est.
Je me penchai en arrière et sortis mon pied-de-biche et mon pistolet : <SUHM> était écrit sur la porte, et à côté une pub de loterie. J’enfonçai le lourd bec de ciseau dans le bois, en haut ; puis en bas ; la serrure sauta avec un aboiement, un éclair et une détonation.
Comme toujours : les coques vides des maisons. Les bombes atomiques et les bactéries avaient fait du bon travail. Machinalement, mes doigts pressaient la lampe de vélo à dynamo. Dans une pièce, un cadavre : puanteur équivalente à douze hommes : donc au moins un Siegfried dans la mort (rare, d’ailleurs, que ça pue encore ; tout ça remonte à si longtemps). Au premier étage gisaient presque une douzaine de squelettes, hommes et femmes (on voit ça aux os du bassin). Donc, six hommes (et/ou garçons) ; cinq femmes et filles.
Dehors : autrefois sans doute bien entretenu ; maintenant la cour chancelait autour de la maison creuse. De beaux sapins vigoureux, cependant. Murs gris, mauvaises herbes grises hochant dessus, plus lupins et plantains. Les maisons étaient faites de murs gris ; les villes de maisons, les continents de villes : qui pourrait encore s’y retrouver ! C’est bien, vraiment, que Tout ait pris fin ; et je crachai le mot : Fin ! Je décrochai la remorque et la traînai derrière moi par le seuil (première pièce à droite ; pas la peine d’en faire un plat).
(...)
L'existence du Narrateur n'est que routine de survie : chasser, pêcher, récupérer des objets dans les ruines, lire les livres qu'il trouve, consigner ses pensées. Sa principale occupation intellectuelle se résume à tenter de comprendre comment une catastrophe d'une telle ampleur a pu se produire. Il cherche la réponse dans les livres qu'il collectionne (philosophie, histoire, science) et dans sa propre introspection.
Après cinq à sept années d’isolement, survient la rencontre avec Lisa, une autre survivante. Une rencontre d'abord marquée par une peur et une méfiance primitive, animale, le narrateur l'épie, la suit, la surveille pendant des jours avant d'oser se révéler. Lisa réagit avec une terreur presque sauvage. Leur "relation" se construit très lentement, sur la base d'un pragmatisme de survie et d'un besoin profond de contact humain, aussi effrayant soit-il. Ils échangent de la nourriture, des objets utiles, observent mutuellement leurs rituels de survie. La communication verbale est rare, difficile, souvent tronquée. Observation Clinique et Désir Brutal s'imposent ensuite, une pulsion biologique dans un monde sans codes sociaux. Il n'y a pas d'"idylle" au sens romantique ; c'est une cohabitation tendue, empreinte de solitude persistante et d'incompréhension. Malgré leur proximité physique temporaire, tout semble les séparer, leurs souvenirs, leurs traumatismes et leur façon de gérer la situation entre eux créent un fossé qu'ils ne parviennent pas à combler. Le narrateur se heurte constamment à l'impossibilité de vraiment "connaître" Lisa ou de partager une intimité véritable. Il n'y aura pas entre eux de véritable conflit ou de séparation dramatique clairement motivée. Lisa disparaît simplement. Un matin, le narrateur constate qu'elle est partie, sans explication, sans mot d'adieu. Elle a emporté ses affaires et... une copie du journal du narrateur qu'il lui avait donnée.
"... ll regarda à nouveau la fenêtre et constata avec étonnement qu’il ne courait plus dans le jardin mais était rassis sur sa chaise à deux places ; raide et d’un argent terne, le parc magique se tenait au loin et attendait…
La tasse apparut dans les airs (d’abord je ne l’avais pas vue du tout) et fut agitée avec impatience, sans qu’on lève les yeux de la page : cela signifiait donc, <verse-moi du thé>, bon très bien ; j’arrêtai l’objet vacillant ainsi que les doigts pâles et remplis. « Pre… » commençai-je ; mais déjà elle la tenait droite, et ce fut seulement par souci d’achèvement que je murmurai « … caution ». (Elle était belle avec ses lunettes de lecture carrées et sa robe longue et étroite ; mais après 8 ans, un homme verrait une Hélène dans toute silhouette féminine, me rappela le critique). Son intérêt était sans doute un compliment à mon égard.
Elle hocha lentement la tête et, sans me regarder, saisit la feuille suivante : (Ça n’intéresserait personne de toute façon).
Minuit depuis longtemps passé : elle plia soigneusement les pages et les serra fermement. Je me postai à la fenêtre et regardai le quartier de lune (crescit : il ment) ramper lentement et voûté sur les prés ; lune des prés à travers le silence automnal ; toutes les horloges s’éteignent ; on devrait être un esprit : planer au-dessus des prairies d’automne, c’est ainsi que serait mon paradis rosé. Elle se tenait derrière moi dans le rideau ; posa sa main sur ma manche : « Est-ce que ça a été très dur pour toi ? » demanda-t-elle, confuse et chagrine ; bien sûr je ne répondis pas, et nous écoutâmes ça gémir et bruisser autour de la maison.
Arpentant le sentier : « Je ne peux rester éternellement » dit-elle à voix haute pour elle-même : « Il faut que je trouve d’autres gens. » Nuit froide. Je parlai au ralenti : « Et si tu ne rencontres Personne d’autre ? » (Demi-tour sur les rails ; immobile ; la lune sombra lentement dans les ramures en aiguilles et les rubans de brume : l’être argenté avait viré au roux, les pointes inférieures disparues désormais, en dessous).
« Alors je reviendrai » chuchota-t-elle avec consolation, respirant haut et profond. Triste et beau. —
Brouillard silencieux sur l’Ostermoor : déterrant des pommes de terre sans un bruit. La terre luisait noir et rouge ; nous fouissions lentement dans les mottes froides, avec des mains bordeaux tachetées ; pression sous nos ongles ourlés de noir. Le feu nuageux tourna bientôt en cendre ; les pâturages en contrebas restèrent froids et d’un vert crépusculaire, tandis que je nouais le sac grumeleux. L’air se fit coupant, et les buissons tourbillonnèrent un peu dans leur feuillage noir. Le silence s’étendait, vigoureux d’automne, sur <tout> le pays.
Elle demanda : « Pourquoi continues-tu vraiment d’écrire ? — Pourquoi as-tu jamais écrit des livres ? » (Réponse : pour gagner de l’argent. Les mots mon seul savoir.
« Ce n’est pas vrai ! » dit-elle outrée. J’ai essayé autre chose. Aussi : j’aime fixer en mots des images de la nature, des situations, et pétrir des nouvelles).
Elle siffla La Marche de la Cavalerie finlandaise : püpüpi : püpüpi : püpüpüperüpüpü (og frihet gar ut fra den ljugande pol) ; elle dit, lèvres pincées : « Donc jamais pour tes lecteurs ? Jamais pour une quelconque propagande ou intention <éthique> ? »
« Pour des lecteurs ? » demandai-je, profondément étonné ; et <intention éthique> m’était également inédit. « Je voulais simplement dire — » tempéra-t-elle, mais creusa plus avant avec douceur : « mais dis-moi : — ? ».
« J’ai toujours été un lecteur enthousiaste de Wieland : Poe, Hoffmann, Cervantès, Lessing, Tieck, Cooper, Jean Paul — je me suis parfois demandé : seraient-ils satisfaits de mon travail, ou Alfred Döblin et Johannes Schmidt. Mais des <lecteurs> en général ? ? — Nan ! ! » (Je n’y connais rien).
« Culte du héros ? » ricanai-je avec mépris : « Ma chère fille ! » Quiconque a vécu aussi longtemps que moi avec moi-même ne croit plus aux héros (quelques-uns peut-être, mais ils sont bel et bien morts depuis longtemps). Pourtant je suppliai : « Lisa : reste ! » mais elle était déjà trop loin, à dix sillons au moins, et remplissait son panier d’osier de tubercules pâles et pierreux.
Gel à minuit : le salon de bois était blanc et noir des mensonges lunaires ; un point rouge épais dormait dans le poêle. Nous nous éveillâmes transis, et elle enfonça ses épaules bien-aimées en moi. Je parcourus tout de mes mains caressantes, dis : « Je vais faire du feu, » embrassai les cheveux endormis, et claudiquai, vêtu de nuit : zébré comme au bagne vers le splendide poêle. Bénis soient nos scies, et tous ces après-midi de copeaux ; je plongeai dans le petit bois ombreux et bâtis prestement un ingénieux treillis autour du point rouge, soufflai, lèvres en dauphin ivre de sommeil, et aussitôt la flamme pullula dans la voûte de fer, s’étira avide et frugale dans les courants d’air, ma tête vacilla sur ma poitrine froide, et je trébuchai jusqu’à Lisa.
Au bout de 15 minutes, la vague de chaleur nous submergea. Elle gémit, contente, végétale et sans volonté (et je repartis en hâte fourrer d’autres bûches de hêtre). Nous entrelaçâmes mains et jambes, paisibles et en sécurité. Quand ce fut bien chaud, elle dit, débauchée :
« Allez : allons au genévrier ! » Je me levai, acquiesçant sans contredire, car la lune m’avait aussi rendu fou ; nous nous déguisâmes, fronts tendus et agiles, et marchâmes l’un derrière l’autre à travers les murs de planches.
Lune des genévriers : il scintillait et bleu-blancoyait généreusement. Les plantes se dressaient noir-soyeux avec des gestes anomlous (il faut supprimer le <*a*> pour la rythmique de la phrase). Une fois encore : Lisa glissa dans la maison chercher les bouteilles. — Nous bûmes, accroupis sur le sol ferme d’aiguilles, silencieux et contenus.
Elle tendit son cou, sa voix dit : « Je pars. » Je vis les genévriers s’agiter autour de moi, assis ; j’empoignai la branche voisine : « Pourquoi ? » demandai-je sèchement et sans. En face, le verre de la bouteille cligna dans la lumière ouverte : « La vie est trop belle ici avec toi » cela vint en un souffle sur trois taches de mousse. D’un bond tonitruant je fus près de la blanche et saisis sa chair : « Lisa ! ! »
Je dis : « Lisa ! : — »
« Ma peau frissonne rien qu’à voir un morceau de tes vêtements. Et mon cœur est comme un poussin trouvé si seulement je pense à ton nom : ne vivrons-nous pas comme des princes. Ma champignonne ? »
Elle répondit d’une voix perçante : « Je n’ai pas de chaussures. » (Vrai : ses pieds étaient nus !) J’ouvris violemment ma veste et calai ses plantes contre ma poitrine, ses genoux reposaient dans mes mains. La lune-aubergiste déversa son blanc sur nous ; à sa droite une main jaune, à sa gauche une main rayée : et elles approchèrent de mon corps. Je frottai ses genoux et me pressai contre elle ; mais elle tendit ses jambes et me repoussa.
« Demain je pars : juste à temps, avant de devenir trop grasse et insolente. Tu es trop fort pour moi. » Elle se redressa ; dit calmement : « Tu peux m’aider à me préparer : vérifie mon vélo et la remorque ; je vais m’habiller. »
Gonfla le pneu ; accrocha la remorque. J’entrai dans la maison ; elle se tenait dans la cuisine et emplissait un sac à dos de boîtes et bouteilles. J’appelai : « Reste ! » (Le verre et le fer-blanc résonnèrent tout aussi sourdement).
« Lisa ! » mais une corde faisait des nœuds et bruissait. Alors je sortis et contemplai, bouche bée, le gel en train de se former sur le sol.
En salopette et casquette : et ainsi elle saisit le guidon. Elle but une dernière gorgée d’accro ; tendit le récipient vitreux vers moi, et j’embrassai la bouche froide et humide de la bouteille, la bouche de femme froide et humide d’alcool, tremblant de froid et de détresse.
« Il le faut » ! déclara-t-elle avec détermination, « ici avec toi — je ne sais pas — je deviens plus lourde et plus classique. — C’est sûrement mon sang gitan et je le regretterai avant huit jours. — Tu restes ici, et je saurai toujours où trouver mon dernier refuge : — ? ! » Elle retint ma main par-dessus le cadre, et je l’attrapai par la chair de son cou et embrassai ce que je trouvai jusqu’à ce que nous manquions basculer.
« Je suis folle ! » affirma-t-elle dans un gémissement : « Mais nul ne peut changer sa nature. Déracinée par trois guerres, ah — » Elle s’interrompit et ordonna : « Recule. Dans le cercle d’arbustes. » J’obéis. Elle s’assit calmement et regarda encore une fois autour d’elle :
Les prés luisaient, silencieux et aériens, dans le cadre noir de purin des sapins. La lune comme clé de voûte dans la voûte céleste finement effilée. Je dis inutilement : « Tu as bien des allumettes aussi — hein ? ». Elle s’éveilla et répondit avec intérêt : « Non ! — Va m’en chercher : d’accord ? ! »
Dans la maison : mais où sont-elles ? ! Je fouillai tiroirs et papier d’emballage : mais où ? ! —
Disparue : Elle était partie ! Bien sûr ! Et je restai tête baissée comme dans une pierre bleue. Stupide face. Au milieu des plantes. Dans ma main droite une boîte d’allumettes.
Vers le matin des nuages se levèrent (et des averses). Une fumée jaune fraîche vint vers moi : mon poêle ! Alors je laissai le bois et me dirigeai vers la maison : le dernier être humain.
Une dernière fois tête haute : il se tenait là, vert dans les nuages matinaux rouge vif. Gel sur les paysages de prairies. Et le vent se leva. Vent.
(...)
Après le départ de Lisa, le narrateur retombe dans une solitude encore plus profonde et désespérée. Le narrateur réalise l'inutilité de ses efforts, comprend qu'il est condamné à la solitude perpétuelle, et semble accepter son sort avec une sorte de fatalisme résigné.
"Im Haus: wo sind die denn?! Ich zerriß Schübe und Packpapier: wo denn!! —
Fort: Sie war fort! Natürlich! Und ich stand mit geducktem Kopf wie in einem blauen Stein. Blödes Gesicht. Inmitten Pflanzen. In der Rechten ein Paket Streichhölzer.
Gegen Morgen kam Gewölk auf (und Regenschauer).
Frischer gelber Rauch wehte mich an: mein Ofen! So verließ ich den Wald und schob mich ans Haus: der letzte Mensch.
Noch einmal den Kopf hoch: da stand er grün in hellroten
Morgenwolken. Reif in Wiesenstücken. Auch Wind kam auf. Wind. "
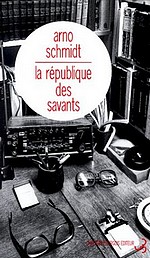
"Die Gelehrtenrepublik" (1957)
(La République des Savants. Traduit de l'allemand par Martine Vallette et J.C. Hémery, Christian Bourgois, 2001, 222 pages) - Maître de l'ironie, Arno Schmidt, comme il avait stigmatisé la barbarie nazie dans "Scènes de la vie d'un faune", fustige la menace atomique dans "La République des savants". Nous sommes en 2009. La vieille Europe a succombé sous les bombes atomiques. Elle avait eu auparavant la sagesse de mettre à l’abri sur une "île à hélices" ses savants, penseurs et artistes les plus notoires. Charles Henry Winer, un journaliste américain, est autorisé à visiter l’île. Mais il doit au préalable traverser une autre réserve, une zone dévastée par les radiations atomiques, où prolifèrent des êtres monstrueux, et isolée du monde par une gigantesque muraille.
Grâce à une ravissante centauresse, Winer parvient jusqu’à la République des Savants. Il partagera les 50 heures qui lui sont allouées entre la zone neutre, la zone américaine et la zone russe. Ce qui nous vaut une cruelle galerie de portraits : vieilles gloires stériles, fonctionnaires de la culture réglementant la « création collective », agents secrets rivalisant de perfidie. Le visiteur découvre de prestigieux bâtiments : musées, salles de concert, bibliothèques… mais aussi cimetières, monuments aux morts et d'inquiétants laboratoires greffant des cerveaux d'artistes ou de savants reconnus sur des corps jeunes… Le climat de guerre froide est tourné en dérision et dans chaque partie de l'île, le guide touristique qui pilote Winer s'avère être un maître espion.
La division de Berlin entre Est et Ouest a certainement influencé des passages de ce récit. Horrifié par les pratiques des uns et des autres (« métempsychose » des Russes, hibernation des Américains), Winer regagne avec soulagement le monde menacé et médiocre du commun des mortels."
22.6.2008 : Auf Kankerstelzen aus Licht der kleingeschnürte Sonnenleib über der Landschaft.
Spätnachmittag im Auto[1] : nochmal nachfühlen — ? — Ja : Notizblock, Fernrohr, Grüne Brille; Ausweise vor allem. / Und die Straße rappelte : Sonne & Kakteen gemischt. Faul lag mein Fingerzeugs vor mir. Daneben rauchte der Captain (und sang; immer auf ‹uun› : moon und noon und June und racoon — gibt es etwa schon Menschengruppen, die nur einen auf bestimmte Vokale hin gefärbten Wortschatz erlernen ?).
»Schlechte Straße !« — Aber er zuckte nur eine Achsel: geht eben auf die Mauer zu. / Um 16 Uhr hatten wir Prescott, Arizona, verlassen, und man saß in der Hitze wie in Bernstein; (Menschen in Kunstharzblöcken : das gibt’s längst. Um der Nachwelt Moden und so zu überliefern. Nr. 238, im Museum zu Detroit, war mal, als Junge, meine große Liebe gewesen (obwohl heute natürlich lächerlich altmodisch; ich pflegte ihr damals jede Knabenerektion zu bringen. Seit elf Jahren nicht mehr gesehen : wegtrotteten die Gedanken.)).
Der staubige Streifen am Horizont ? : »Ja. ’s die Mauer.« (Und wurde langsamer; der Motor noch leiser. Wir fuhren grade draufzu.)
Dann nach Norden biegen; immer daran entlang : »Neinein : 8 Yards hoch !« / Und das ist schon keine Kleinigkeit, wenn man sich überlegt: zweimal 4.000 Meilen Betonmauer, um unsern amerikanischen Atomkorridor nach beiden Seiten hin abzusperren ! (Neugierig bin ich, wie’s drinnen im Streifen aussehen wird : man will ja schon Trupps von Zentauren in Nevada gesichtet haben ! Von sonstigen wilden Gerüchten mal ganz abgesehen. Ich war immerhin der Erste, der seit 11 Jahren die Durchreiseerlaubnis erhalten hatte !).
Und immer an der endlos=hellgrauen Betonwand entlang (aus Tafeln, 2×2 Yards gefügt). / Hinten, die beiden Gekhakiten, lümmelten ihre zusammen 13 Fuß auf den Postsäcken. Ab und zu zigarettete der linke; einmal steckte sich Einer den Radioapparat ins Ohr, und hörte was Lächerliches (man sieht’s meist am Gesichtsausdruck, was sie sich vordudeln lassen !). / »Wissen Sie, was für einen Querschnitt die Mauer hat ? Wie dick und so ?«. — Er nahm erst sorgfältig die Kurve, und spitzte dann einen abwehrenden Gleichgültigkeitsmund; schüttelte auch den Kopf und spreizte die Schulterspitzen : »Wozu ?« / (Li’ll’ Information here).
17 Uhr 20 : »Das Wachthaus.« (Na endlich !). / Wir machten einen feinen Viertelbogen und hielten : sofort zeigten sich auf den weißen Wänden, in den schwarzen Öffnungen, Köpfe der Besatzung. / (Thermometer an der Tür : 35 Grad im Schatten. Und weitere Erwärmung vorausgesagt; kann ja heiter werden).
»Winer ? — : Wieso ? !« : und ich mußte gleich meine Papiere vorzeigen : Personalausweis mit Lichtbild, Daumenabdruck, Zahnfeinbau, Penisvariante. Dann die achtfach (also von sämtlichen Weltmächten) gestempelte Erlaubnis zum Besuch der Gelehrtenrepublik — das war ihnen allerdings noch nicht vorgekommen ! / Dann der auf einem guillochierten Sonderblatt erteilte USA=Permit zur Durchquerung des Hominidenstreifens. (Den nahm er, während seine Stirn sich lauernd runzte, mehrfach an sich, der Herr Oberst. Es dachte hinter seiner estpoint=Stirnwand. Er begab sich mit meinem kostbaren Schein in ein hinteres Büro. Sprach dort auch fern; lange. — Als er wieder herkam, lächelte es irgendwie unten auf seinem unangenehmen Soldatengesicht: man sah, daß er schon vorher, drinnen, genickt haben mußte.) Und nickte weiter :
»Right. — : Well. — : Sie müssen natürlich zuerst untersucht werden. Und ich geb’Ihnen einen Sachbearbeiter mit : wir haben Ostwind; das ist günstig.« —
Auf einem weißen Hof (und mein Einhandgepäck stand pathetisch=winzig neben mir). Drüben prüfte ein Sergeant, ob mein Taschenfernrohr auch die vorschriftsmäßige 20=fache Vergrößerung habe (mehr ist ja für Zivilisten verboten; laut Interworld soundso : könnten ja aufm Mond zu viel sehen, was ?). Die Kunstharzlinsen ergaben aber genau 19,74; hätt’ ich ihm vorher sagen können; war von Caltech geprüft. Und er gab es mir widerstrebend zurück. / Dann war der Arzt so weit :
»Anheben bitte !« : hob ich also an; und der Geigerzähler glitt weiter über mich, um mich, in mich. Drüben wurde die — überflüssig große -Blutprobe zentrifugiert : eine muntere Assistentin visierte mit dem linken Auge durchs Mikroskop (während das rechte mich Nackten wie eine Tapetenfigur musterte); ihr Mund gab Zahlengruppen von sich. / : »Wieso haben Sie so’n dollen Hormondruck ? — Mit der Freundin gezankt ? So.« (Dabei hatte ich absichtlich, entsprechend dem Rat meines väterlichen Freundes — der nebenbei eben Derjenige war, der 8 Jahre zuvor die Gelehrtenrepublik hatte besuchen dürfen ! — 4 Wochen gespart. Er hatte mir, to the wise a word is sufficient, deutlich genug angedeutet, daß es auf der Propellerinsel ‹hoch her ginge›; man bekäme, zur Erzielung des bestmöglichen Reportereindrucks, erlesene Sekretärinnen zugeteilt, ‹zum Ansagen›; und ich, obwohl erst 30, hatte ein Übriges tun zu müssen geglaubt.) / »Tatsächlich ? : Einhundertdreiundvierzig ? ! — Messen Sie doch lieber nochmal nach.« Maß sie also nochmal nach : ? : derselbe Wert ! (Und jetzt riskierte die WAC beide umschminkte Augen !).
22.6.2008 : Sur des échasses cancéreuses de lumière, le corps solaire enserré menue au-dessus du paysage.
Tard dans l’après-midi, en voiture : ressentir encore — ? — Oui : bloc-notes, longue-vue, lunettes vertes ; surtout les papiers. / Et la route cahotait : soleil et cactus mêlés. Paresseusement gisait mon attirail devant moi. À côté fumait le Capitaine (et chantait ; toujours en ‹uun› : lune et midi et juin et raton-laveur — existe-t-il déjà des groupes humains n’apprenant qu’un vocabulaire teinté de voyelles spécifiques ?).
« Mauvaise route ! » — Mais il haussa seulement une épaule : on se dirige droit vers le Mur. / À 16h nous avions quitté Prescott, Arizona, et on cuisait dans la chaleur comme dans l’ambre ; (des humains dans des blocs de résine synthétique : ça existe depuis longtemps. Pour transmettre modes et autres à la postérité. Le n° 238, au musée de Détroit, fut, enfant, mon grand amour (bien que ridiculement démodé aujourd’hui ; à l’époque, je lui apportais chaque érection pubertaire. Plus revue depuis onze ans : les pensées s’égaillèrent)).
La bande poussiéreuse à l’horizon ? : « Oui. C’est le Mur. » (Et il ralentit ; le moteur plus feutré encore. Nous roulions droit dessus.)
Puis bifurquer vers le nord ; toujours le longer : « Non non : 8 yards de haut ! » / Et ce n’est pas rien, quand on y pense : deux fois 4000 miles de mur en béton, pour clore notre corridor atomique américain des deux côtés ! (Je suis curieux de voir à quoi ressemble l’intérieur de la bande : on aurait aperçu des troupes de centaures dans le Nevada ! Sans parler des autres rumeurs folles. J’étais tout de même le premier à obtenir l’autorisation de traversée depuis 11 ans !).
Et toujours le long du mur infini = gris clair (assemblé de panneaux de 2×2 yards). / À l’arrière, les deux Gekhakites, vautraient leurs 13 pieds cumulés sur les sacs postaux. Parfois, celui de gauche cigaretillait ; une fois l’un se colla l’appareil radio dans l’oreille, écoutant quelque chose de risible (on voit généralement à leur expression ce qu’ils se passent en fond sonore !). / « Savez-vous quel profil a le Mur ? Son épaisseur et tout ? ». — Il prit d’abord soigneusement le virage, puis pinça une bouche d’indifférence décourageante ; hocha aussi la tête et écarta les pointes d’épaules : « Pour quoi faire ? » / (Li’ll’ Information here).
17h20 : « Le poste de garde. » (Enfin !). / Nous décrivîmes un joli quart d’arc et stoppâmes : aussitôt apparurent, sur les murs blancs, dans les ouvertures noires, des têtes de la garnison. / (Thermomètre sur la porte : 35° à l’ombre. Et réchauffement annoncé ; ça va être charmant).
« Winer ? — : Comment ça ?! » : et je dus aussitôt exhiber mes papiers : carte d’identité avec photo, empreinte digitale, dentition fine, variante pénienne. Puis l’autorisation octuple (donc de toutes les puissances mondiales) pour visiter la République des Savants — ça, par contre, ils n’avaient encore jamais vu ! / Puis le laissez-passer USA délivré sur feuillet spécial guilloché pour traverser la Bande hominidé. (Celui-là, il le prit, tandis que son front se plissait aux aguets, à plusieurs reprises, le Colonel. Cela pensait derrière son front-paratonnerre. Il se retira avec mon précieux papier dans un bureau à l’arrière. Y téléphona aussi ; longtemps. — Quand il revint, un sourire flottait bizarrement en bas de son déplaisant visage de soldat : on voyait qu’il avait dû acquiescer là-bas, à l’intérieur.) Et il continua d’acquiescer :
« Right. — : Well. — : Il faut bien sûr d’abord vous examiner. Et je vous donne un gestionnaire : nous avons vent d’est ; c’est favorable. » —
Sur une cour blanche (et mon bagage à une main se tenait pathétiquement minuscule à côté de moi). Là-bas, un sergent vérifiait si ma longue-vue de poche avait bien le grossissement réglementaire de 20 fois (plus est interdit aux civils ; selon l’Interworld machin : pourraient voir trop de choses sur la Lune, hein ?). Les lentilles en résine synthétique donnaient pourtant exactement 19,74 ; j’aurais pu le lui dire ; certifié Caltech. Et il me la rendit à contrecœur. / Puis le médecin fut prêt :
« Levez s’il vous plaît ! » : je levai donc ; et le compteur Geiger continua de glisser sur moi, autour, en moi. Là-bas, on centrifugeait l’échantillon de sang — trop grand - : une assistante enjouée visa de l’œil gauche dans le microscope (pendant que le droit dévisageait mon moi nu comme un motif de papier peint) ; sa bouche émettait des groupes de chiffres. / : « Comment se fait-il que vous ayez une telle pression hormonale ? — Une querelle avec l’amie ? Voilà. » (Pourtant j’avais délibérément, suivant le conseil de mon ami paternel — qui était d’ailleurs Celui-là même ayant pu visiter la République des Savants 8 ans plus tôt ! — économisé pendant 4 semaines. Il m’avait, to the wise a word is sufficient, assez clairement laissé entendre que sur l’Île-Propulsion ‹ça allait fort› ; on se voyait attribuer, pour un reportage optimal, des secrétaires triées sur le volet, ‹pour dicter› ; et moi, bien que n’ayant que 30 ans, avais cru devoir en faire un peu plus.) / « Vraiment ? : Cent quarante-trois ?! — Mesurez donc plutôt encore. » Elle remesura donc : ? : même valeur ! (Et là, la WAC[⁶] risqua ses deux yeux maquillés !)...."

"Zettels Traum" (1970, Arno Schmidt)
Malgré une diffusion confidentielle, Zettels Traum a acquis un statut culte dans les cercles littéraires internationaux, souvent comparé aux travaux les plus expérimentaux du modernisme et du postmodernisme (Finnegans Wake, Gravity’s Rainbow).
L'intrigue centrale : Une journée à la campagne
Le cadre narratif est, à première vue, relativement simple : l'action entière se déroule en l'espace de 24 heures, pendant une journée d'été, dans un village rural du nord de l'Allemagne. Le personnage principal, Daniel Pagenstecher, écrivain et critique littéraire excentrique, reçoit chez lui un couple, Paul et Wilma Jacobi, accompagnés de leur fille adolescente Franziska. Ils souhaitent discuter des traductions et de l’interprétation des œuvres d’Edgar Allan Poe, sujet sur lequel Daniel est expert.
La majeure partie du texte est constituée par leurs dialogues, leurs promenades dans les environs, et leurs échanges intellectuels passionnés autour de Poe, de la psychanalyse freudienne, et de questions linguistiques et philosophiques.
Mais une œuvre littéraire exceptionnelle, considérée comme unique à plusieurs égards,
- Publié en fac-similé de son manuscrit, l'ouvrage faisait 1334 pages imprimées sur des feuilles de format A3 (environ 42 x 30 cm), rassemblées dans un seul volume de 4 kg. C'est l'une des œuvres les plus volumineuses de la littérature moderne, comparée à Finnegans Wake de James Joyce (et son coût était équivalent à une semaine de salaire moyen, en faisant un objet luxueux et provocant).
- L'œuvre est composée sous forme de texte à trois colonnes parallèles, narration principale en colonne centrale; notes, commentaires et réflexions sur le texte central, en colonne de gauche : notes, commentaires et réflexions sur le texte central; commentaires critiques et érudits sur Edgar Allan Poe, ses écrits, et la psychanalyse freudienne, en colonne de droite. Ce format visuel inédit rappelle une partition musicale ou un manuscrit médiéval annoté, faisant de l’acte de lecture une expérience labyrinthique unique.
- Une expérimentation linguistique poussée : Schmidt emploie une langue allemande inventive, riche en néologismes, jeux de mots et dialectes, ce qui rend la lecture exigeante. Il se rapproche de Joyce par la complexité verbale, mais développe un style proprement germanique.
- L'ouvrage est structuré autour d'une réflexion continue sur l'œuvre d'Edgar Allan Poe et intègre constamment des références et analyses psychanalytiques. Schmidt se place explicitement dans la lignée de Joyce en terme d'ambition narrative et formelle.
- Roman, essai, critique littéraire et psychanalyse :"Zettels Traum" ne peut pas être simplement classé comme un roman. C’est aussi un texte critique sur la littérature (notamment Poe), une réflexion sur la psychanalyse freudienne et lacanienne, et une méditation sur l’art, la sexualité, le langage et l’inconscient.
- Schmidt utilise des variations typographiques (gras, italique, majuscules, soulignages), et des placements inhabituels du texte, créant une véritable chorégraphie visuelle sur la page, influencée par le modernisme visuel et le collage littéraire.
- Le texte offre plusieurs voix en simultané, encourageant une lecture non linéaire, fractale et interactive. Le lecteur est invité à choisir son parcours à travers les différentes colonnes et annotations, rendant chaque lecture singulière.
- Les thèmes sexuels sont abordés avec une franchise inhabituelle pour l'époque, souvent de manière clinique, provocante ou à travers des métaphores grotesques. Cela choquait dans le contexte encore conservateur de l'Allemagne de l'Ouest.
- Longtemps inaccessible pour les lecteurs non germanophones, Zettels Traum n’a été traduit en anglais qu'en 2016 sous le titre Bottom’s Dream. Sa difficulté, sa taille et son prix élevé en font une œuvre destinée à un public restreint d’experts ou d’amateurs passionnés.
Sous une intrigue apparemment modeste se déploient des enjeux intellectuels immenses :
- L’œuvre d’Edgar Allan Poe comme miroir
La rencontre est prétexte à une étude approfondie des textes de Poe. Daniel, tout au long du récit, propose une relecture psychanalytique, dévoilant des significations sexuelles, inconscientes, et souvent très provocatrices derrière les mots de Poe.
Cette analyse détaillée fait émerger progressivement les obsessions inconscientes, les tensions sexuelles et les frustrations cachées des invités eux-mêmes, notamment celles du couple Jacobi et de leur fille adolescente.
- Psychanalyse et sexualité refoulée
Schmidt fait du texte une démonstration concrète du fonctionnement du refoulement et de la sublimation freudienne. Les protagonistes découvrent, au fil des dialogues et des interprétations littéraires, leurs propres névroses, pulsions refoulées et désirs inconscients.
La tension sexuelle sous-jacente entre les personnages, en particulier la fascination ambiguë de Daniel pour la jeune Franziska, devient l'une des clés interprétatives du récit, ce qui lui donne une dimension à la fois provocante et dérangeante.
- Exploration du langage et de l'inconscient
Le livre met en scène comment l’inconscient influence constamment le langage, les jeux de mots, les lapsus et les expressions idiomatiques. Schmidt illustre magistralement comment le langage est structuré par l’inconscient.
Ce procédé linguistique explique aussi l'abondance des jeux de mots et des néologismes dans le texte, qui cherchent à révéler les vérités cachées derrière l'apparente neutralité du discours quotidien.
Si l’intrigue est simple en apparence (une journée de discussions érudites à la campagne), sa véritable finalité est bien plus profonde ...
- Dévoilement de l’inconscient individuel et collectif
Schmidt ne se contente pas de présenter une simple analyse de textes littéraires : il entreprend une véritable psychanalyse des personnages et, indirectement, du lecteur lui-même.
Le but est de révéler les pulsions sexuelles et les conflits psychiques inconscients qui structurent les comportements humains, notamment la manière dont ils influencent inconsciemment notre façon de lire, écrire et interpréter les textes littéraires.
- Métalittérature et critique littéraire radicale
Schmidt utilise son roman pour déconstruire radicalement les méthodes critiques traditionnelles. Il propose une approche provocatrice : tout texte littéraire est saturé d’inconscient, de sexualité refoulée, et ne peut être compris qu’à travers une lecture psychanalytique rigoureuse.
Ainsi, la finalité réelle du roman est aussi théorique : Schmidt veut démontrer que toute lecture est profondément subjective, saturée d’inconscient, et que l’acte critique doit prendre conscience de cette subjectivité pour être véritablement pertinent.
Une Expérimentation littéraire absolue ...
L’œuvre est un manifeste pour une littérature radicalement expérimentale : elle pousse la forme romanesque à ses limites extrêmes en refusant toute linéarité classique, en favorisant une lecture non linéaire et une structure visuelle complexe.
Schmidt désire transformer radicalement le rapport du lecteur au texte, en proposant une expérience immersive, interactive, presque performative de la lecture.

"Abend mit Goldrand" (Soir bordé d'or, 1975)
Traduction anglaise : Pas de traduction anglaise. - Traduction française : Pas de traduction française. - Texte plus court, satirique, typiquement schmidtien, où il dépeint avec une ironie mordante la vie intellectuelle et sociale provinciale allemande...
Roman dialogué dans lequel des "sectateurs du Paradis sur terre" font irruption dans l`univers tranquille d'une assemblée de fins lettrés cacochymes perdue au fin fond de la lande de Lunebourg. Ann`Ev`, leur meneuse, a élu domicile dans un tonneau près de la maison des bibliomanes. Cette diogénesse, douée de pouvoirs occultes, s'est liée d`amitié avec Martina (15 ans), "vierge mal léchée" en butte aux invectives de Grete (sa mère) et d'Asta, la femme de charge. Les trois "onomastiqueurs", Eugen, major d`artillerie amputé des membres inférieurs, Olmers, bibliothécaire à la retraite, et A&O, "écrivain retiré des affaires", sont des êtres pour lesquels le monde se résout à une vaste bibliothèque.
Pourtant A&O s'amourache de la jeune AE (son "ANNum AEternum"). La tempête se déchaîne malgré lui : comme suscité par "Le Jardin des délices" de Jérôme Bosch qui trône dans sa bibliothèque, un cirque bigarré d'acrobates du sexe investit la meule de foin proche de la maison. Et les deux matrones. séduites par le Caliban priapique Bastard Marwenne et le "philosoif & bateleur" Egg, suivront la troupe vers l`île fortunée des antipodes, la Tasmanie. Avec cette "Farce-Féerie pour amateurs de crocs-en-langue" où la frénésie sexuelle la plus obscène (à orthographe "phallacieuse") côtoie une autobiographie des plus tragiques, Arno Schmidt a livré le meilleur de lui-même et de ses lectures.
