- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Svevo - Pirandello
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki
- 1930-1940
- 1930s
- Fitzgerald
- Hemingway
- Faulkner
- Koch
- Céline
- Bernanos
- Jouve
- DosPassos
- Kojève
- Miller-Nin
- Grosz - Dix
- Green
- Ortega y Gasset
- Wittgenstein
- Russell - Carnap
- Artaud
- Jaspers
- Sapir - Piaget
- Guillén
- Garcia Lorca
- Hammett
- A.Christie
- Heidegger
- Icaza
- Huxley
- Hubble
- Caldwell
- Steinbeck
- Waugh
- Blixen
- Rhys
- J.Roth - Doderer
- Aub
- Malraux-StExupéry
- DBarnes-NWest
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bataille
- Char-Michaux
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Bloch
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Lewin - Mayo - Maslow
- Montherlant
- Buzzati - Pavese
- Vittorini
- Fallada
- Malaparte
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Welty
- Boulgakov
- Tamiki - Yôkô
- Weil
- Gadda
- Broch
- Steeman
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Ellison
- Bergman
- Baldwin
- Fromm
- Bradbury - A.C.Clarke
- Tennessee Williams
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Carpentier
- Mishima
- Salinger - Styron
- Pasternak
- Asturias
- O'Connor
- Hoffer
- Matute - MartinGaite
- 1960-1970
- 1960s
- Abe
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- U.Johnson - C.Wolf
- Heller - Toole
- Naipaul
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Onetti - Sábato
- Capote
- Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- McCarthy - Minsky
- Sillitoe
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- Lenz
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Dolls
- Ellis
- Cortázar
- Warhol
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- HarperLee
- Fuentes
- 1970-1980
- 1970s
- Habermas
- Handke
- GarciaMarquez
- Deleuze
- Derrida
- Beck
- Satir
- Kundera
- Hrabal
- Didion
- Guinzbourg
- Lovelock
- Vietnam
- H.S.Thompson - Bukowski
- Pynchon
- E.T.Hall
- Bateson - Watzlawick
- Carver
- Irving
- Milgram
- VargasLlosa
- Puig - Donoso
- Lasch-Sennett
- Crozier - Touraine
- Friedan-Greer
- Jacob-Monod
- Dawkins
- Beattie - Phillips
- Gaddis
- Rawls
- Zinoviev
- H.Searles
- Ballard
- Jong
- Kôno
- Calvino
- Ballester-Delibes
- ASchmidt
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact
- 1970s
- Habermas
- Handke
- GarciaMarquez
- Deleuze
- Derrida
- Beck
- Satir
- Kundera
- Hrabal
- Didion
- Guinzbourg
- Lovelock
- Vietnam
- H.S.Thompson - Bukowski
- Pynchon
- E.T.Hall
- Bateson - Watzlawick
- Carver
- Irving
- Milgram
- VargasLlosa
- Puig - Donoso
- Lasch-Sennett
- Crozier - Touraine
- Friedan-Greer
- Jacob-Monod
- Dawkins
- Beattie - Phillips
- Gaddis
- Rawls
- Zinoviev
- H.Searles
- Ballard
- Jong
- Kôno
- Calvino
- Ballester-Delibes
- ASchmidt

Gonzalo Torrente Ballester (1910-1999), "Javier Mariño" (1943), "El señor llega" (1957, premier tome de la trilogie "Los gozos y las sombras"), "Donde da la vuelta el aire" (1958), "La Pascua triste" (1962), "Don Juan" (1963), "La saga/fuga de J.B." (1972), "Fragmentos de Apocalipsis" (1977), "La isla de los jacintos cortados" (1983), "Crónica del rey pasmado" (1989) - Miguel Delibes (1920-2010), "La sombra del ciprés es alargada" (1947, L’ombre du cyprès est allongée), "El camino" (1950, Le Chemin), "Diario de un cazador" (1955, Journal d'un chasseur), "Las ratas" (1962, Les Rats), "Cinco horas con Mario" (1966, Cinq heures avec Mario), "El disputado voto del señor Cayo" (1975, Le vote contesté de M. Cayo), "Los santos inocentes" (1981, Les saints innocents), "Señora de rojo sobre fondo gris" (1989, Dame en rouge sur fond gris) - ...
Last update: 01/15/2017
L’Espagne des années 1940-1970, au sortir de la Guerre civile (1936-1939), traverse une époque de censure stricte, catholicisme d’État, répression politique et culturelle, avec la dictature franquiste (1939-1975), et marquée par deux grandes orientations littéraires, un réalisme social dominant dans les années 1940-1950 (Cela, Delibes), puis, correspondant à une ouverture politique partielle, dans les années 1960-1970, un début d’expérimentation narrative (Torrente, Benet, Martín-Santos). Que l'on peut traduire par une certaine fatigue vis-à-vis du réalisme et une envie de formes nouvelles : ironie, humour noir, expérimentation narrative, carnavalesque.
Gonzalo Torrente Ballester (1910-1999) et Miguel Delibes (1920-2010) offrent ainsi deux attitudes littéraires emblématiques de cette époque : tous deux critiquent le pouvoir franquiste ou les structures sociales espagnoles, tous deux rejettent les grands récits officiels et la propagande, mais y répondent différemment...

Torrente Ballester, un sceptique total, baroque, ironique, qui attaque le pouvoir comme fiction collective à déconstruire ...
Galicien, issu d’une famille cultivée, ouvert à l’Europe, plutôt conservateur à ses débuts, mais rapidement sceptique et ironique vis-à-vis de toutes les idéologies, Gonzalo Torrente Ballester a travaillé pour le régime franquiste dans les années 40 (notamment comme journaliste culturel), mais s’en est éloigné progressivement, jusqu’à devenir un critique très subtil de celui-ci. Il se méfiera de toutes les formes de pouvoir, pas uniquement du franquisme, Église, État, académies, institutions littéraires, et optera pour une critique ludique, carnavalesque, baroque, pas frontalement militante. Son arme : la déconstruction des mythes collectifs, la satire des discours officiels. Son public plutôt un public intellectuel, universitaire ou littéraire, attiré par les jeux métatextuels et la réflexion sur la fiction.

Delibes, un humaniste, réaliste, empathique, critique de la misère sociale et de la violence du pouvoir avec compassion et morale...
Castillan, enraciné dans le monde rural, très attaché à la terre, aux valeurs locales, à la dignité humaine ordinaire, catholique convaincu, mais profondément critique vis-à-vis de l’hypocrisie morale et sociale, Miguel Delibes ne s’attaquera pas directement au régime, mais dénoncera la misère sociale, la répression et l’injustice, à travers des récits réalistes. Il refusera la violence, rejettera l’idéologie, mais gardera une posture morale et éthique, proche d’un humanisme compatissant. Son public sera souvent rural ou provincial, qui se reconnaît dans ses personnages simples et dans son regard empathique.
Nombre d'écrivains ont cherché à montrer que le pouvoir n’est qu’une fiction - que ce soit le pouvoir politique, religieux, moral ou linguistique,
- en utilisant le grotesque, l’absurde, le carnavalesque pour ridiculiser ces fictions.
- et en évitant la confrontation frontale (presque impossible sous Franco) et préfèrent la satire indirecte, le jeu, la farce.
Dans cette optique, Gonzalo Torrente Ballester est un maître de la polyphonie et un démystificateur des pouvoirs, si l'on entend par "pouvoirs" tant les structures politiques explicites (État, Église), que les mythes fondateurs d’identité : au fond, la tendance humaine à inventer des récits pour se rassurer.
Ses romans, labyrinthiques et ironiques, montrent que toute structure d’autorité (politique, religieuse, narrative) repose sur des fictions, et que ces fictions méritent d’être déconstruites.
Ses œuvres phares - "La saga/fuga de J.B.", "Fragmentos de Apocalipsis", "Don Juan", "Crónica del rey pasmado" - incarnent pleinement cet apport fondamental à la littérature espagnole contemporaine. Sa polyphonie n’est pas seulement technique ou « moderne » ; elle est teintée d’un goût baroque pour le masque, la farce, l’illusion. Il utilise la polyphonie pour jouer, pas seulement pour dénoncer. Même quand il dénonce, il rit, il ridiculise, il joue avec le grotesque.
Pourquoi le carnaval ?
- Parce qu’il permet de subvertir le pouvoir sans l’affronter frontalement.
- Parce que la censure franquiste interdit la critique directe, mais tolère parfois la satire déguisée.
- Parce que le grotesque et le rire permettent de « désacraliser » le discours officiel.

Gonzalo Torrente Ballester (1910-1999)
Né à Serantes (El Ferrol), Gonzalo Torrente Ballester se consacre à l'enseignement et au journalisme, et devient l'un des membres de la fameuse triades des
écrivains espagnols nés dans les années 1910-1920, Camilo José Cela et Miguel Delibes, Gonzalo Torrente Ballester entame sa carrière littéraire avec "Javier Mariño" (1943) qui évoque, dans le
Paris de 1936, les velléités politiques, amoureuses et religieuses d'un aristocrate galicien, qui finit par rejoindre les rangs franquistes. Fortement imprégné par sa Galice natale, il mêle, dans
une œuvre abondante, parfois difficile, la réalité et le fantastique, avec une verve puissante, une critique sociale non dénuée d'ironie, et un halo d'irréalité ne cesse d'auréoler ses
personnages. "Les Délices et les ombres" (Los gozos y las sombras, 1957-1962) est une fresque décrivant les déchirements de la société provinciale d'un petit port de pêche galicien, pendant la
seconde République espagnole, à la veille de la guerre civile. "Off side" (1969), dénonce les mœurs de l'Espagne contemporaine. "Don Juan" (1972), réinterprète le mythe du séducteur à l'aune
d'une imagination sans bornes. "La Saga/Fuga de J.B" (1972) entraîne dans une fantaisie expérimentale débridée toute une ville de Galicie qui entre en lévitation et s'évanouit dans le ciel. "La
isla de los jacintos cortados" (1980, L'île des jacinthes coupées) est une de ses oeuvres les plus représentatives.

Javier Mariño (1943)
Ce premier roman de Gonzalo Torrente Ballester est partiellement autobiographique. En 1943, le roman est reçu favorablement dans les cercles conservateurs car il ne rompt pas frontalement avec les valeurs traditionnelles, tout en ouvrant une réflexion critique.
Javier, jeune bourgeois galicien, cultivé mais encore naïf, quitte sa Galice natale, un milieu marqué par la tradition, la famille et la religion. Il ressent une envie de liberté, de nouveauté, et nourrit une certaine rébellion latente contre les attentes familiales et sociales. À Paris, Javier découvre la vie intellectuelle bouillonante.Il entre en contact avec des étudiants cosmopolites, des cercles d’intellectuels, et découvre de nouvelles idéologies (libéralisme, marxisme, existentialisme naissant). Il fréquente des cafés, participe à des discussions politiques et philosophiques. Il se lie d’amitié avec un petit groupe d’étudiants espagnols exilés ou en rupture avec le régime franquiste, et vit sa première histoire d’amour sérieuse avec une jeune femme française cultivée et indépendante, qui incarne l’émancipation féminine, Magdalena de Hauteville. La liberté d’esprit de celle-ci et son indépendance déroutent Javier, qui est tenté par des idéaux plus absolus (qu’ils soient religieux, politiques ou sentimentaux). Mais cette relation devient aussi un symbole de son éveil sentimental et sensuel. Fasciné intellectuellement et esthétiquement par Magdalena qu'il idéalise comme une figure inaccessible, il découvre avec elle une première véritable expérience érotique, qu’il vit à la fois avec passion et angoisse. Cet éveil sensuel déclenchera aussi une crise morale et existentielle: elle refusera en effet de s’enfermer dans une relation stable, et après leur rupture, Javier ressentira une grande désillusion et une immense perte d'identité. Ni vraiment intégré au milieu parisien, ni encore lié à son passé galicien, il comprend que la liberté qu’il recherchait à Paris est peut-être un mirage. La modernité, incarnée par Magdalena, l’attirait, mais ne pouvait pas combler son besoin d’enracinement et de sens. Il regagnera la Galicie, désabusé mais lucide, transformé, avec une identité plus complexe.
L’Espagne était alors déchirée entre tradition rurale, catholicisme, régionalismes, et les aspirations modernistes européennes. Torrente Ballester, comme Javier, est partagé entre la tradition galicienne (terre, catholicisme, passéisme) et l’attrait des idées européennes modernes. Il se montre lucide face à un idéalisme que l'on peut juger naïf, mais en même temps conscient de l’impossibilité de s’en détacher totalement. Beaucoup d’intellectuels espagnols des années 30 se retrouvent dans une forme d’exil intérieur : même restés en Espagne, ils sont mentalement et moralement étrangers à leur société.
"Javier Mariño" préfigure l’un des grands thèmes futurs de Torrente Ballester: la quête d’une identité impossible à stabiliser, le labyrinthe intérieur. Cette quête deviendra une marque de fabrique dans ses romans plus tardifs, notamment "Don Juan" (1963) et "La saga/fuga de J.B..". Encore réaliste, il va peu à peu intégrer le fantastique et le mythe comme outils pour aborder la complexité espagnole ...
Dans l'Espagne franquiste des années 1940, domine un réalisme conventionnel. Torrente Ballester ose innover avec une structure polyphonique - trois narrateurs pour un même personnage central, l'intrigue tourne en effet autour d'un mystère : qui est vraiment Javier Mariño ? C'est ce que note un critique tel que Francisco Caudet et d'autres spécialistes de Torrente Ballester, non pas trois personnages au sens stricts, mais trois "modes" de narration qui brouillent la perception du personnage : une voix "classique", réaliste, qui décrit objectivement l’action et les déplacements de Javier; la voix des pensées, doutes et contradictions de Javier, souvent à la troisième personne mais de façon très intime; et une voix ironique, distanciée, qui deviendra plus fréquente dans les oeuvres ultérieures. Trois "voix" pour nous montrer combien Javier Mariño n’est pas un personnage figé mais un "prototype d’intellectuel" qui n’a pas encore choisi qui il veut être ...
Gonzalo Torrente Ballester (1910–1999) est considéré comme l’un des plus grands prosateurs espagnols du XXᵉ siècle, notamment pour sa maîtrise de la narration polyphonique et sa critique ironique et acerbe des structures de pouvoir.
Qu’entend-on par « polyphonie » ?
Inspiré de Mikhaïl Bakhtine, le terme désigne une narration à plusieurs voix ou plusieurs points de vue qui coexistent sans qu’aucun ne soit présenté comme absolument « vrai » ou dominant.
Torrente Ballester met en scène des personnages qui portent chacun leur vérité, leur vision du monde, souvent contradictoires. Il joue avec les registres narratifs (ironie, grotesque, sérieux, mythe) et mélange fiction et réalité, jusqu’à brouiller les frontières.
Polyphonie et critique du pouvoir
Ses récits montrent que la vérité est fragmentaire et relative, ce qui mine toute autorité « officielle » (religieuse, politique ou idéologique). Il ironise sur les discours dominants, sur les mythes nationaux, et sur le besoin humain de se créer des fictions consolatrices.
Très peu traduit en anglais et en français (Crónica del rey pasmado), Torrente Ballester reste largement méconnu hors Espagne. La "saga/fuga de J.B." est de plus extrêmement difficile à traduire (jeu sur le langage, mythe local, polyphonie), ce qui explique l'absence de traduction complète.

La Trilogie "Los gozos y las sombras"(1957-1962, Les Délices et les ombres)
Une trilogie composée de "El señor llega" (1957), "Donde da la vuelta el aire" (1958) et "La Pascua triste" (1962), qui reflète les mutations de l’Espagne rurale à l’orée de la guerre civile et du franquisme. Dans cette vaste fresque de type Comédie humaine, on y voit les tensions entre tradition et modernité, entre la noblesse provinciale et les nouveaux riches, entre conservatisme religieux et débuts d’idéologies progressistes. Torrente Ballester entendait recréer la complexité d’une société en déclin, en utilisant tous les registres, ironie, réalisme, analyse psychologique, allusions mythiques.
La démystification des élites locales est l'une des grandes forces de la trilogie, et un fil conducteur constant dans l’écriture de Torrente Ballester. Dans la ville fictive de Pueblanueva del Conde, on trouve deux types d’élites principales, l’ancienne aristocratie rurale (de vieilles familles, propriétaires terriens, autrefois dominantes, dont le pouvoir est fondé sur la tradition, l’honneur, l’image d’une lignée noble : symbolisée notamment par la famille Churruchaos), et la bourgeoisie montante (de nouveaux riches, commerçants, banquiers, industriels, pragmatique, plus agressive, plus "moderne", mais aussi cynique, représentée par des personnages comme Carlos Deza, qui revient pour reprendre le pouvoir familial en essayant d’adopter des méthodes nouvelles).
Torrente Ballester use, pour les démystifier,
- de la révélation de leurs contradictions internes
(l’aristocratie est montrée comme stérile, décadente, paralysée par son propre mythe : la famille Churruchaos se réclame d’une grandeur passée, mais n’a plus nin puissance économique ni morale et vit d’apparences et de souvenirs),
- d'un conservatisme sans substance
(ces élites prétendent défendre des "valeurs éternelles" (honneur, catholicisme, ordre social), mais ces valeurs ne sont qu'outils de conservation du pouvoir, leurs discours sont creux, répétitifs, et incapables de répondre à la réalité nouvelle),
- d'un double registre de langage
(il relate les discours pompeux des notables, tout en glissant des indices qui révèlent leur hypocrisie ou leur nullité. L'ironie est permanente)
Torrente Ballester ne préservera pas pour autant les nouveaux venus pour autant : il montre que cette nouvelle élite est également avide, matérialiste, sans illusions morales. La transition ne va donc pas d’un "ancien monde noble" vers un "nouveau monde vertueux" : les deux ne sont qu'impostures. Carlos Deza est emblématique de cette posture : il représente l’aristocratie éclairée qui veut sauver l’ancien monde en s’adaptant; il revient de Madrid pour "rétablir l’ordre", mais se heurtera à la lâcheté des siens, à l’hostilité des bourgeois locaux, et à sa propre incapacité à concilier idéalisme et pragmatisme. Sa trajectoire finit par dévoiler que même "le retour du héros" est un mythe vide.
"Los gozos y las sombras" est une symphonie narrative sans équivalent dans la littérature esoagnole des années 1950-60 et une œuvre charnière entre la génération de 1898 et le postmodernisme. Une oeuvre qui résonne aujourd’hui avec la question de la mémoire historique, de la société espagnole d’avant et après la guerre civile.
Sa force réside dans son ambivalence tragique : ni pamphlet ni fable moralisatrice, mais le portrait d’une société où "les délices" (les privilèges) génèrent eux-mêmes "les ombres" (la corruption). Cette trilogie confirme Torrente Ballester comme le plus cervantin des romanciers espagnols modernes...
Adaptée en série télévisée, avec Amparo Rivelles et Eusebio Poncela (1982), la trilogie est aujourd’hui étudiée comme chef-d’œuvre du réalisme critique...
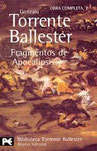
Fragmentos de Apocalipsis (1977, Fragments d'apocalypse)
"Apocalipsis" pour révélation, dévoilement, mais aussi fin du monde, ici fin du monde de la fiction traditionnelle, de la narration linéaire, du roman classique, et "Fragmentos", parce que le texte est volontairement fragmenté, inachevé, parcellaire. Impénitent bâtisseur de fiction, Gonzalo Torrente Ballester présente ici, "en temps réel", le frénétique journal de travail d’un écrivain dont il met en scène le combat contre les résistances du matériau romanesque. Ssouvent considéré par les critiques espagnols comme un des romans les plus audacieux et radicaux de Gonzalo Torrente Ballester - mais aussi l’un des plus complexes et moins accessibles.
Écrit pendant la Transition démocratique espagnole, moment d’effervescence intellectuelle et de libération après la mort de Franco (1975), publié en 1977, juste après "La saga/fuga de J.B."(1972), l’autre chef-d’œuvre absolu de Torrente Ballester, le livre reprend les thèmes chers à l’auteur : le pouvoir de la fiction, la mise en abyme, la polyphonie ironique, la déconstruction du récit.
Le roman se présente comme un "journal intime d’un écrivain" reclus dans un hôtel à Santander, qui essaie d’écrire un roman. Mais il est sans cesse distrait par des idées, des voix, des visions hallucinées, n’arrive pas à avancer dans son « vrai » roman, et le texte que nous lisons n’est qu’un ensemble de fragments, digressions, réflexions sur l’art d’écrire, aphorismes, faux commencements, etc. Ces fragments forment en réalité une méditation ironique et jubilatoire sur la création littéraire, le rôle de l’auteur, et la futilité des grands récits cohérents. Enormément de métatextes (l’auteur commente son propre texte en train de naître), beaucoup d’humour, d’ironie, d’auto-dérision et des "mini-récits" insérés (l’histoire d’un musicien, l’évocation d’un manuscrit fictif, des scènes érotiques, des visions d’Apocalypse) - (traduction Actes Sud)

La isla de los jacintos cortados (1980, L'île des jacinthes coupées)
Un roman que l'on situe dans la phase la plus expérimentale et réflexive de Torrente Ballester, celle où il joue pleinement avec la frontière entre fiction, histoire et mythe. Le roman se présente comme une fiction historique autour de la figure de Joséphine de Beauharnais (veuve de Napoléon Ier). Le narrateur est un écrivain contemporain, isolé dans un hôtel du sud de la France, qui décide d’enquêter sur une mystérieuse île imaginaire (la fameuse "île aux jacintos coupés") où Joséphine aurait vécu en exil après la chute de Napoléon. Il veut écrire la « véritable » histoire de Joséphine, qu’il imagine comme une femme sensuelle, mélancolique, déchue, vivant entourée de plantes exotiques (les jacintos) et d’amants. Mais plus il avance, plus l’enquête devient un labyrinthe mental, un puzzle d’archives, de légendes et d’inventions. L'oeuvre est très fragmentée : lettres fictives, fragments d’autobiographie, récits secondaires, réflexions sur l’histoire et la fiction. Et comme dans "Fragmentos de Apocalipsis", on passe sans cesse d’un niveau narratif à un autre, de la vie "réelle" de Joséphine à des projections imaginaires du narrateur ou des commentaires ironiques sur sa propre incapacité à finir son récit. L'"île aux jacintos coupés", parce que symboliquement, l’île est un lieu de fuite et d’exil, mais aussi une allégorie du rêve inatteignable, de la création littéraire idéale qu’on ne peut jamais complètement saisir.
Parmi les thèmes, la frontière floue entre histoire et fiction : peut-on vraiment "connaître" un personnage historique ? - La crise de l’auteur moderne : écrire n’est plus raconter une histoire vraie, mais explorer des possibles. Un roman complexe, ambitieux, très riche sur le plan formel, et considéré comme un sommet de la réflexion sur la fiction historique en Espagne.
Mais pas un "grand roman populaire", on le comprendra (traduction française Actes Sud, la présentation de l'éditeur interroge ...: il est vrai qu’ "un professeur d’université (le narrateur-écrivain) raconte une histoire à une jeune étudiante (nommée Adriadna dans la version française), il y a bien une dimension de séduction littéraire dans la relation entre eux, le récit devient un jeu de pouvoir, une façon d’attirer Adriadna", à vendre sans doute comme une fable historique "exquise et diabolique", pleine d’aventures ...).
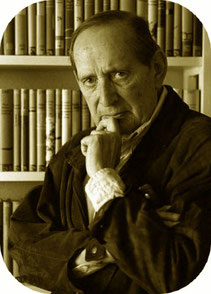
Miguel Delibes (1920-2010)
Né à Valladolid, Miguel Delibes, qui est, avec Camilo José Cela et Gonzalo Torrente Ballester, l'une des grandes figures de la littérature de l'après-guerre
civile (1936-1939), a 17 ans quand la guerre civile fait rage et, pour éviter les combats d'infanterie, il choisit de s'engager dans la marine. Il mène par la suite de front une carrière de
professeur de droit, de caricaturiste et de journaliste (il est rédacteur en chef au journal de Valladolid, El Norte de Castilla, de 1958 à 1963, date à laquelle la censure franquiste le
contraint à démissionner), et bien-entendu d'écrivain. Traduite dans le monde entier, son œuvre romanesque reflète les changements qui ont marqué l'Espagne de son temps.
Tournée vers l'apprentissage de la vie et la découverte du monde des adultes par les yeux de l'enfance, son oeuvre est aussi celle de l'évocation des êtres
défavorisés ou marginaux, ce qui ne va pas sans une critique acerbe de la bourgeoisie de province. Partant d'un réalisme traditionnel, - le roman, déclare-t-il, "c'est l'homme dans ses réactions
authentiques, spontanées, sans mystification", - son univers foisonne de personnages, surtout centré sur la Castille profonde (Diario de un cazador, 1955; Las ratas, 1962; Los santos inocentes,
1982), et, dans les registres les plus divers de son style, tend un véritable miroir à son époque tout en emportant ses lecteurs dans les reflets doux-amers de la vie et de la
mort.
Son premier roman, à 28 ans, "La sombra del ciprés es alargada" (L'ombre du cyprès est allongée, 1947), est l'histoire d'un orphelin à jamais meurtri par une éducation dommageable; "Aún es de día" (Il fait encore jour, 1949) prolongera ce pessimisme foncier qui le caractérise. Les difficultés de l'enfance consituent le premier thème privilégié de "El Camino" (Le Chemin, 1950), "Mi idolatrado hijo Sisí" (Sissi mon fils adoré, 1953) et "El Príncipe destronado" (Le Prince détrôné, 1973). L'hypocrisie de la petite bourgeoisie de province est aussi l'une de ses cibles favorites. "Cinco horas con Mario" (1966, Cinq heures avec Mario), souvent considéré comme son plus grand roman, dresse le portrait d'une femme, Carmen, qui s'allonge dans le cercueil, une bible à la main, où gît son mari, Mario, qui vient de mourir, et se livre à une confession surprenante, aussi mesquine que réactionnaire : ah! si seulement Mario avait été plus conciliant avec le régime, explique en substance Carmen, leur vie en aurait été totalement autre! En 1991, "Senora de rojo sobre fondo gris" évoque la mort, à 50 ans, de la femme tant aimée de Miguel Delibes qui entre alors dans une profonde dépression. Son dernier roman, « L’hérétique », qui sera publié en 1998, offre non seulement une extraordinaire fresque historique du Valladolid à l'époque de Charles Ier, mais livre, dans la complexité des relations humaines et des passions, un dernier message prônant la tolérance et la liberté de conscience.

La sombra del ciprés es alargada (L'ombre du cyprès est allongée, 1947)
Pedro est un petit orphelin qui grandit loin de toute affectation et chaleur humaine, d'abord élevé par un oncle et puis par Don Mateo, un enseignant qui
lui transmet une vision pessimiste de la vie. La mort de son grand ami Alfredo le précipite dans une crise existentielle profonde qui l'amène à embrasser la carrière de marin et à vivre ainsi
sans amour et sans attache. Pourtant, surgit dans son existence Jane, une jeune américaine pleine de vitalité, qui semble lui ouvrir d'autres possibles perspectives de vie, mais la réalité ne le
lui permettra pas...

El camino (Le Chemin, 1950)
Ce roman, l'un des plus traduits de Miguel Delibes, est souvent associé à deux autres romans, Les Rats (1962) et Les Saints Innocents (1981) sous le titre
"La Trilogia del campo". Il conte avec une tendresse très retenue la vie d'un petit garçon, - Daniel le Hibou, "el Mochuelo", 11 ans -, la vie de son village de Castille qu'il va
quitter pour la ville, les arbres, les oiseaux, les jeux, les rires, les pleurs, un monde, "son monde" dont il doit faire le deuil au nom du nécessaire "progrès" de sa vie comme des hommes, une
ville, une idée du progrès qui sépare les hommes et les déracine...
"— Descends vite ; elle doit être là.
Daniel le Hibou et Germán le Teigneux avançaient courbés en deux pour mieux supporter les énormes brassées de pommes. Le Hibou eut une peur terrible que
quelqu’un puisse le surprendre ainsi. Il soutint le parti du Teigneux avec véhémence :
— Allez, descends, Bouseux. On a assez de pommes.
La crainte lui faisait perdre son calme. Sa voix était agitée, un ton au-dessus d’un simple murmure. Roque le Bouseux cassa une branche sous le poids de
son corps en essayant de descendre précipitamment. Cela claqua comme un coup de fusil dans cette atmosphère paisible de frôlements et de chuchotements. Son excitation augmentait
:
— Attention, Bouseux !
— J’arrive.
— Zut !
— Celui qui saute le mur le premier est une mauviette.
Ce n’est pas facile de déterminer d’où surgit l’apparition. Après cela, Daniel le Hibou se mit à croire aux sorcières, aux esprits et aux fantômes.
Elle, la Mica, était devant eux, grande et svelte, moulée dans une robe d’un blanc spectral. Dans les ténèbres épaisses, sa silhouette prenait une allure surnaturelle, un peu comme le Pico Rando,
mais plus vague et plus fuyante.
— Comme ça, c’est vous qui volez les pommes, hein ? dit-elle.
Daniel le Hibou et Germán le Teigneux laissèrent rouler les fruits un à un jusqu’au sol. La consternation les tétanisait. La Mica parlait tout
naturellement, sans emportement dans le ton de sa voix :
— Vous aimez les pommes ?
Un instant, l’affirmation apeurée de Daniel le Hibou trembla dans l’air :
— Ou… i.
On entendit le rire étouffé de la Mica, comme s’il venait par à-coups d’une secrète satisfaction. Ensuite elle leur dit :
— Prenez deux pommes chacun et venez avec moi.
Ils lui obéirent. Tous les quatre, ils se dirigèrent vers l’entrée. Une fois arrivés, la Mica tourna un commutateur caché derrière une colonne et la
lumière se fit. Daniel le Hibou remercia la colonne charitable qui s’interposa entre la lampe et son visage abattu. La Mica rit de nouveau, sans raison. Daniel le Hibou fut assailli par la
crainte qu’elle aille les livrer à la garde civile.
Il n’avait jamais vu la fille de l’Américain d’aussi près ; son visage et sa silhouette lui faisaient oublier par moment cette situation compromettante.
Sa voix aussi, qui avait les doux accents modulés d’un chardonneret. Sa peau était lisse et brune et ses yeux obscurs assombris par des cils très noirs. Ses bras étaient minces et souples, et
comme ses jambes longues et sveltes, ils offraient la teinte dorée de la poitrine des perdrix mâles. Quand elle se déplaçait, la légèreté de ses mouvements donnait la sensation qu’elle pourrait
s’envoler et se perdre dans l’espace comme une bulle de savon.
— Bien, dit-elle soudain, comme ça vous êtes tous les trois des petits voleurs.
Daniel le Hibou s’avoua qu’il pourrait passer sa vie à l’écouter dire qu’il était un petit voleur sans se lasser le moins du monde. Quand elle disait «
petit voleur » c’était comme si elle lui caressait les joues de ses mains, de ses deux petites mains légères et pleines de vie."
(Edition Verdier)

377A, madera de héroe (L'Etoffe d'un héros, 1987)
Qu'est-ce que l'héroïsme dans un monde que le soulèvement franquiste va totalement brouiller et qui va produire ces tragédies interchangeables de croyants
crucifiés par des "rouges" et des rouges martyrisés par des "croisés". Comme Gervaisio, né dans une famille chaleureuse et étriquée de la petite bourgeoisie traditionaliste, quelques êtres vont
être ici aspirés entre enfance et adolescence dans le tourbillon sanglant de la Guerre civile. Le destin de Gervaiso est d'autant plus emblématique qu'il est doté d'une intense émotivité qui
semble le destiner à un destin héroïque irrépressible.
"Une fois que l’enfant Gervasio García de la Lastra éprouva ces étranges phénomènes, que les membres les plus pieux de la famille attribuèrent à des
causes surnaturelles et les autres, plus sceptiques, à de purs phénomènes physiques opérant sur une sensibilité délicate, ce fut, comme il ressort des journaux du colonel de cavalerie aujourd’hui
disparu don Felipe Neri Luna (1881-1953), au cours de la veillée familiale du samedi 11 février 1927, bien que – c’est ce qui apparaît dans ces mêmes cahiers, trois jours avant – certains indices
se soient déjà manifestés lorsque le petit, faisant irruption comme un ouragan dans le cabinet de son grand-père maternel don León de la Lastra alors qu’il déjeunait de son habituel chocolat et
biscottes, lui avait demandé à brûle-pourpoint :
— Papa León, je peux être un héros sans mourir
?"
(Edition Verdier)
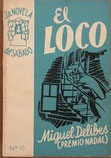
El loco (1953, Le Fou)
Delibes entame ici la chronique intimiste d'un homme ordinaire qui verse dans la nouvelle fantastique. Dans une taverne où il est entré par hasard, un petit
employé de banque rencontre un homme étrange qu’intuitivement il sent lié à son passé. Dès lors cette sensation ne le quitte plus. Tandis que sa vie devient un enfer, son entourage juge ses
désordres de plus en plus inquiétants. De surprise en révélation, sa quête effrénée d’une nouvelle rencontre avec le personnage de la taverne l’entraînera jusqu’en France, à Pau, où sa famille a
vécu bien des années auparavant. Là, les visages et les lieux reconnus retisseront les liens perdus de la mémoire, le piège se refermera et l’intrigue se dénouera autour de la figure
obsédante.

Las ratas (Les Rats, 1962)
"Les Rats, c’est le destin du paysan de Castille contraint par une nature inclémente à trouver dans son propre dénuement sa dignité, mais c’est aussi la
tragédie d’une société dont les fondements vacillent et qui accule les hommes à leur propre destruction. Toute l’ingénuité et le savoir du Nini, l’enfant rebelle, ne parviendront pas à rédempter
cette humanité condamnée ; le chasseur de rats affirmera dans la fureur sa liberté… Cet univers où les personnages nous sont donnés dans leur existence élémentaire, manifeste à la fois une
profonde complicité avec le monde et une cruauté portée à son expression la plus pure et la plus dépouillée."

''Cinco horas con Mario'' (''Cinq heures avec Mario'', 1971)
Le roman connut un succès retentissant dans une Espagne soldant le franquisme, on y découvre via le personnage d'une veuve, Carmen, au cours d'un soliloque
de lieux communs, toute la médiocrité et le conformisme de la petite bourgeoisie des années 1960, mais aussi les frustrations et la solitude de la femme, de l'épouse, dans une société
refermée sur elle-même.
Fragmento:
"Y no es que yo vaya a decir que no haya injusticias, ni corrupción, ni cosas de esas que tú dices, pero siempre las ha habido, ¿no?, como siempre hubo
pobres y ricos, Mario, que es ley de vida, desengáñate. Yo me troncho contigo, cariño, "nuestra obligación es denunciarlas", así, lo dijo Blas, punto redondo, pero, ¿quién te ha encomendado a ti
esa obligación, si puede saberse? Tu obligación es enseñar, Mario, que para eso te hiciste catedrático, que para denunciar la injusticia ya están los jueces y para remediar las penas, la
beneficencia, que os ponéis insoportables con tantas ínfulas..."
"Y no es que yo vaya a decir que no haya injusticias, ni corrupción, ni cosas de esas que tú dices, pero siempre las ha habido, ¿no?, como siempre hubo
pobres y ricos, Mario, que es ley de vida, desengáñate. Yo me troncho contigo, cariño, "nuestra obligación es denunciarlas", así, lo dijo Blas, punto redondo, pero, ¿quién te ha encomendado a ti
esa obligación, si puede saberse? Tu obligación es enseñar, Mario, que para eso te hiciste catedrático, que para denunciar la injusticia ya están los jueces y para remediar las penas, la
beneficencia, que os ponéis insoportables con tantas ínfulas..."
"Si nous avons de quoi nous nourrir et de quoi nous couvrir, nous sommes comblés. Ceux qui veulent s’enrichir succombent aux tentations, aux embûches, aux multiples envies folles et pernicieuses qui entraînent les hommes à leur perte et à leur ruine, car la racine de tous les maux, c’est l’avidité, c’est bien pour ça qu’il me sera très difficile de te pardonner, mon cœur, même si je vis mille ans, de m’avoir fait renoncer à mon envie d’une voiture. Je comprends que juste après notre mariage, c’était un luxe, mais aujourd’hui tout le monde a une 600, Mario, même les concierges si tu veux le savoir, il suffit d’ouvrir les yeux. Tu ne le comprendras jamais, mais une femme, comment te dire ça, est humiliée de voir toutes ses amies en voiture et elle toujours à pinces, parce que, je te le dis franchement, chaque fois qu’Esther ou Valentina ou même Crescente, l’épicier, me parlaient de leur balade du dimanche, j’en étais malade, ma parole. Même si ce n’est pas à moi de te le dire, tu as eu la chance de tomber sur une femme d’intérieur, une femme qui se dépatouille avec un rien et tu t’es laissé aimer, Mario, c’était bien commode, et tu crois qu’avec une broche à trois sous ou une petite attention pour ma fête tu étais quitte, mais pas du tout, bougre d’âne, et je me suis épuisée à te dire que tu vivais dans un autre monde, mais toi, cause toujours ! Et ça, tu sais ce que c’est, Mario ? De l’égoïsme pur, si tu veux le savoir, et je sais bien qu’un professeur de lycée n’est pas millionnaire, hélas, mais il ne s’agit pas de ça, à mon avis, au jour d’aujourd’hui personne ne se contente d’un seul emploi. Bien sûr, tu vas me dire que tu avais tes livres et El Correo, mais si je te disais que tes livres et ta feuille de chou ne nous ont rapporté que des ennuis, je mentirais peut-être ? Ne dis pas le contraire, mon grand, des ennuis avec la censure, des ennuis avec les gens, et tout ça pour quatre sous. Et je n’en suis pas du tout surprise, Mario, parce que comme je dis : qui aurait pu lire ces malheureuses histoires de gens qui meurent de faim et se vautrent dans la fange comme des porcs ? Voyons voir, fais travailler ta tête, qui aurait pu lire ce bla-bla du Château de sable où on ne parle que de philosophie ? Et toi toujours avec ta thèse et l’impact et toutes ces histoires, peux-tu me dire comment on peut avaler ça ? Les gens s’en moquent comme de leur première chemise des thèses et des impacts, crois-moi, et toi, mon amour, ce sont ceux de ton Cercle qui ont causé ta perte, Aróstegui et Moyano, l’autre barbu, parce que ce sont des inadaptés. Et ce n’est pas que papa ne t’ait pas averti, le brave homme, parce qu’il a lu tes livres à la loupe, Mario, scrupuleusement, tu m’entends, et il a dit que non, que si tu écrivais pour t’amuser, d’accord, mais si tu espérais la gloire ou l’argent, il te fallait choisir une autre voie, tu te souviens ? Mais toi, bien sûr, têtu comme une mule. Et je comprends que tu te fiches de ce que peut dire tel ou tel, mais papa, un homme objectif comme lui, ne me dis pas, qui collabore au cahier illustré de l’ABC, depuis sa fondation je crois bien, qui est si dévoué – s’agissant d’autre chose, je ne dis pas, mais pour ce qui est d’écrire, il en connaît un rayon, on peut le dire ! Et moi-même, Mario, je ne t’ai pas dit moi-même mille fois de chercher un bon sujet, sans aller plus loin : l’histoire de Maximino Conde, celui qui s’est marié avec cette veuve et puis qui est tombé amoureux de sa belle-fille ? Ce sont des sujets comme ça qui intéressent les gens, Mario, ouvre les yeux, je sais bien qu’il était un peu… disons un peu cru, d’accord, mais il fallait faire réagir le héros de manière décente quand elle, la fille, se donne à lui, et de cette façon le roman aurait même pu être édifiant. Mais toi, tu n’en fais qu’à ta tête, ça rentre par une oreille et ça sort par l’autre, deux ans après tu as publié Le Patrimoine, une histoire irrésistible, je te le dis franchement, parce qu’on ne sait pas par quel bout l’attraper, mais : est-ce que tu crois, Mario, que ça peut intéresser quelqu’un, un livre qui se passe dans un pays qui n’existe pas et dont le héros est un troufion qui a mal aux pieds ?" (Edition Verdier)

Los santos inocentes (Les Saints Innocents, 1982)
Décrivant le quotidien du monde rural dans l'Estrémadure de l’après-guerre, Delibes aborde l'humiliation et le mépris avec lesquels les propriétaires
terriens imposent leur tyrannie sur toute cette couche sociale de domestiques et de paysans qui ne peuvent que subir, enfermés qu'ils sont dans le dénuement et l'inculture. L’Azarías est un
de ces êtres rustiques qui sourient au ciel et parlent aux oiseaux, et dans le même temps obéissent aux maîtres sans la moindre hésitation. Un petit drame entamera pourtant la torpeur de ce monde
innocent... En 1984, Mario Camus en réalise l’adaptation cinématographique qui valu à ses acteurs, Francisco Rabal et Alfredo Landa, le prix de la meilleure interprétation masculine au festival
de Cannes.

Senora de rojo sobre fondo gris (1991, Dame en rouge sur fond gris)
Admirable portrait de la femme aimée que la maladie a trop tôt enlevé à l’affection de l’époux désemparé, Miguel Delibes lui-même. La mort d’Ángeles, la
mère de ses sept enfants, est exprimé sur le mode d'un monologue d'une extrême retenue, murmuré à l’une de ses filles, donnant à la grisaille des jours, au goût âcre de la maladie, une
inépuisable leçon de vie...
"Ses cheveux étaient pour moi une chose tellement essentielle que j’ai retardé leur sacrifice jusqu’au dernier moment. Alicia nous a accompagnés et sa coiffeuse, dont elle m’avait parlé comme d’une fille irresponsable, a pris soin de sa tête avec une sollicitude extrême. Je ne sais si ma présence l’intimidait, mais elle n’osait pas parler. Elle se contentait de répondre à ta mère par monosyllabes et une fois que ta sœur s’est assise près du balcon et a ouvert une revue, elle s’est enfermée dans un mutisme complet. Moi, je la regardais faire, appuyé au montant de la porte, sans me résoudre à entrer. Nous essayions tous de donner un air de geste quotidien à ce rituel, alors qu’à la vérité la tension était telle que l’on aurait cru assister aux préparatifs de sa décapitation. La fille a soulevé timidement les cheveux de la nuque : Je coupe ici. Ses yeux brillaient quand ta mère lui a donné courage : Coupe, ne t’inquiète pas. Elle a donné le premier coup de ciseaux et dans le silence de la petite pièce a résonné le léger impact de la mèche au contact du parquet. Ta mère serrait sur sa poitrine la perruque qu’elle avait achetée la veille. Elle l’avait essayée des douzaines de fois à la maison : les unes sur le front, les autres enfoncée sur la nuque ; comme une calotte, ensuite. À chaque fois, elle accompagnait l’essayage d’un commentaire ironique et elle contrefaisait quelqu’un. Tu veux bien me peigner cette perruque ? Tout à coup, elle a dit : Elle est horrible, d’une seule pièce, comme un casque, je ne peux pas la supporter. La fille séparait les mèches de cheveux et plaçait les ciseaux à leur base. Inopinément, elle a levé une main et interrompu l’opération. Elle m’a dit : Pourquoi tu n’irais pas faire un tour ? On n’a pas besoin de toi ici. Comment pourrais-je te laisser seule ? Je jouais les indispensables, le rôle de l’homme fort. Elle a ajouté : Alicia est là pour me tenir compagnie, ça me suffit. Je me suis empressé de déserter. Je me suis senti excusé et j’ai fui, j’ai descendu les escaliers quatre à quatre, sans me soucier de l’ascenseur." (Edition Verdier)
