- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Svevo - Pirandello
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki
- 1930-1940
- 1930s
- Fitzgerald
- Hemingway
- Faulkner
- Koch
- Céline
- Bernanos
- Jouve
- DosPassos
- Kojève
- Miller-Nin
- Grosz - Dix
- Green
- Ortega y Gasset
- Wittgenstein
- Russell - Carnap
- Artaud
- Jaspers
- Sapir - Piaget
- Guillén
- Garcia Lorca
- Hammett
- A.Christie
- Heidegger
- Icaza
- Huxley
- Hubble
- Caldwell
- Steinbeck
- Waugh
- Blixen
- Rhys
- J.Roth - Doderer
- Aub
- Malraux-StExupéry
- DBarnes-NWest
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bataille
- Char-Michaux
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Bloch
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Lewin - Mayo - Maslow
- Montherlant
- Buzzati - Pavese
- Vittorini
- Fallada
- Malaparte
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Welty
- Boulgakov
- Tamiki - Yôkô
- Weil
- Gadda
- Broch
- Steeman
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Ellison
- Bergman
- Baldwin
- Fromm
- Bradbury - A.C.Clarke
- Tennessee Williams
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Carpentier
- Mishima
- Salinger - Styron
- Pasternak
- Asturias
- O'Connor
- Hoffer
- Matute - MartinGaite
- 1960-1970
- 1960s
- Abe
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- U.Johnson - C.Wolf
- Heller - Toole
- Naipaul
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Onetti - Sábato
- Capote
- Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- McCarthy - Minsky
- Sillitoe
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- Lenz
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Dolls
- Ellis
- Cortázar
- Warhol
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- HarperLee
- Fuentes
- 1970-1980
- 1970s
- Habermas
- Handke
- GarciaMarquez
- Deleuze
- Derrida
- Beck
- Satir
- Kundera
- Hrabal
- Didion
- Guinzbourg
- Lovelock
- Vietnam
- H.S.Thompson - Bukowski
- Pynchon
- E.T.Hall
- Bateson - Watzlawick
- Carver
- Irving
- Milgram
- VargasLlosa
- Puig - Donoso
- Lasch-Sennett
- Crozier - Touraine
- Friedan-Greer
- Jacob-Monod
- Dawkins
- Beattie - Phillips
- Gaddis
- Rawls
- Zinoviev
- H.Searles
- Ballard
- Jong
- Kôno
- Calvino
- Ballester-Delibes
- ASchmidt
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact
- 1970s
- Habermas
- Handke
- GarciaMarquez
- Deleuze
- Derrida
- Beck
- Satir
- Kundera
- Hrabal
- Didion
- Guinzbourg
- Lovelock
- Vietnam
- H.S.Thompson - Bukowski
- Pynchon
- E.T.Hall
- Bateson - Watzlawick
- Carver
- Irving
- Milgram
- VargasLlosa
- Puig - Donoso
- Lasch-Sennett
- Crozier - Touraine
- Friedan-Greer
- Jacob-Monod
- Dawkins
- Beattie - Phillips
- Gaddis
- Rawls
- Zinoviev
- H.Searles
- Ballard
- Jong
- Kôno
- Calvino
- Ballester-Delibes
- ASchmidt

Harold F. Searles (1918–2015), "The Effort to Drive the Other Person Crazy" (L'effort pour rendre l'autre fou, 1979) - Wilfred Bion (1897-1979), "Experiences in Groups" (1961) - Mara Selvini Palazzoli (1916-1999), "Paradoxe et contre-paradoxe"(1975)- Marie-France Hirigoyen (1949), "Harcèlement moral : La violence perverse au quotidien" (1998) - Donald Winnicott (1896-1971), "Collected Papers: Through Paediatrics to Psycho-Analysis" (1958), Stephen A. Mitchell (1946-2000), "Relational Concepts in Psychoanalysis" (1988) - ...
Last update: 12/12/2024

Rendre l'autre fou est une entreprise subtile, il ne s'agit pas de hurler, mais de murmurer des contradictions qui, lentement, effritent son sens de la réalité. - Bien que moins connu du grand public que Lacan ou Winnicott, Harold Searles a profondément influencé la psychanalyse relationnelle (Mitchell, Bromberg), les approches intersubjectives et les théories du trauma, ainsi que la psychothérapie institutionnelle (notamment en France). Son travail reste une référence pour les cliniciens travaillant avec des patients borderline ou psychotiques.
Searles croyait que même dans les cas les plus désespérés, une rencontre authentique entre patient et thérapeute était possible. Sa vision a bousculé les dogmes de son époque et reste d'une actualité frappante aujourd'hui, à l'heure où les approches relationnelles et systémiques gagnent en importance.
Contrairement à l'idée répandue de son époque (années 1950-60) selon laquelle les psychotiques étaient "inanalysables", Searles a démontré que la psychanalyse pouvait être adaptée à leur traitement. Il a mis en lumière l'importance du transfert et du contre-transfert dans ces cas, y compris les sentiments violents ou chaotiques qu'ils provoquent chez le thérapeute. Dans "L'Effort pour rendre fou" (1979), il analyse comment la folie peut être co-créée dans les relations (famille, couple, thérapie). Il décrit ainsi des mécanismes comme la projection massive, les double contraintes ou les identifications pathologiques qui "poussent" l'autre à perdre contact avec la réalité. Searles a particulièrement insisté sur l'impact des relations précoces dysfonctionnelles (notamment avec la mère) dans le développement de la schizophrénie, anticipant les théories attachmentistes. "The Effort to Drive the Other Person Crazy" (1959) est devenu un classique de la littérature psychanalytique.
Harold Searles a d'abord publié "The Effort to Drive the Other Person Crazy" sous forme d'article en 1959 (dans le British Journal of Medical Psychology), puis l'a intégré bien plus tard (en 1979) dans un recueil de textes portant le même titre (The Effort to Drive the Other Person Crazy) : un texte d'une vingtaine de pages, devenu un classique de la littérature psychanalytique qui introduit la notion d’"effort pour rendre fou" comme mécanisme relationnel inconscient.
"Evil is Banal" (1984) by Marlene Dumas (1953, a South African artist and painter based in the Netherlands), un autoportrait dans lequel l'artiste interrogeait sa propre duplicité en tant que jeune fille blanche élevée en Afrique du Sud sous le régime de l’apartheid ...

"The Effort to Drive the Other Person Crazy" (L'effort pour rendre l'autre fou, 1979)
"Rendre l'autre fou est dans le pouvoir de chacun : qu'il ne puisse pas exister pour son compte, penser, sentir, désirer en se souvenant de lui-même et de ce qui lui revient en propre." Telle est l'expérience faite par Harold Searles, psychiatre et psychanalyste américain, qui a travaillé pendant quinze ans à Chestnut Lodge, établissement internationalement connu pour le rôle pilote qu'il a joué dans l'approche psychothérapique intensive des schizophrènes. Voici un psychanalyste qui dit ce qu'il fait, qui donne entendre les mots simples des passions humaines - haine et amour, chagrin, vengeance, mépris, adoration ; il rapporte ce qu'il ressent et le parti qu'il tire de ses propres motions dans la rencontre éprouvante, bouleversante, avec le psychotique. Jamais l'idée qu'il n'y a pas de psychose sans interaction de processus inconscients n'a été pareillement mise en évidence. L'auteur et, avec lui, le lecteur qui l'accompagne en ami sont sans cesse confrontés à l'intolérable souffrance psychique du "fou", si souvent méconnue aujourd'hui. (Traduction et édition Gallimard, 1977, Connaissance de l'inconscient.)
Harold F. Searles (1918–2015) était un psychiatre et psychanalyste américain pionnier dans le traitement des patients psychotiques, notamment ceux souffrant de schizophrénie. Il est considéré comme l’un des penseurs les plus originaux et influents de la psychanalyse post-freudienne, particulièrement dans le champ des troubles graves de la personnalité et des dynamiques intersubjectives. Médecin psychiatre formé à la Yale Medical School, il se spécialise en psychanalyse et travaille avec des figures majeures comme Frieda Fromm-Reichmann (à Chestnut Lodge, un centre réputé pour le traitement des psychoses). Il fut inspiré par Freud, mais aussi par les théoriciens des relations d'objet (Melanie Klein, Winnicott) et les approches humanistes.
Contrairement à beaucoup de ses contemporains, Searles partageait ouvertement ses erreurs, ses doutes et ses émotions en thérapie (y compris sa propre rage ou confusion face aux patients). Ses écrits sont remplis d'exemples cliniques vivants, montrant comment le thérapeute peut être "entraîné" dans la folie du patient.
Outre "L'Effort pour rendre fou", ses livres incluent "Le Contre-transfert" (1965), un ouvrage fondateur sur l'utilisation des émotions du thérapeute comme outil thérapeutique, "L'Environnement non humain" (1960, sur la relation des patients psychotiques aux objets inanimés, "Ma lutte avec la chronicité" (1986), une somme de réflexions sur le traitement des cas lourds.
"... LES MODES SELON LESQUELS ON REND L'AUTRE FOU
Avant de décrire les modes ou les techniques employés par la personne qui s’efforce de rendre l’autre fou — ou, pour utiliser le terme technique, schizophrène —, je tiens à souligner ma conviction que cet effort est mené à un niveau essentiellement inconscient, et que ce n’est là qu’un des éléments d’une relation pathogène complexe qui dépasse de loin la capacité de l’un ou des deux participants à la contrôler pleinement. Selon moi, on peut dire de manière générale que l’instauration de toute interaction interpersonnelle qui tend à favoriser un conflit affectif chez l’autre — qui tend à faire agir les unes contre les autres différentes aires de sa personnalité — tend à le rendre fou (c’est-à-dire schizophrène).
Par exemple, la femme d’un patient en analyse raconte que son mari ne cesse de « mettre en question l'adaptation » de sa sœur cadette, jeune femme psychologiquement fragile, si bien que celle-ci finit par être de plus en plus angoissée; pour cela, il attire constamment l’attention de sa belle-sœur sur des aires de sa personnalité dont elle est, tout au plus, vaguement consciente, et qui ne s’accordent absolument pas avec la personne qu’elle se considère être. Les refoulements qui ont été nécessaires pour que se maintienne le fonctionnement du moi se trouvent ainsi affaiblis (sans que la jeune femme ait la possibilité d'entreprendre une psychothérapie) : le conflit et l’angoisse sont, par là, renforcés.
On peut constater, de même, que l’analyste inexpérimenté ou inconsciemment sadique qui fait un grand nombre d’interprétations prématurées tend à rendre le patient psychotique — tend à affaiblir le moi du patient plutôt qu’à le renforcer (selon son intention consciente) en aidant celui-ci, grâce à des interprétations plus opportunes, à assimiler progressivement le matériel auparavant refoulé.
Ou encore, une personne en excitera sexuellement une autre, dans des circonstances où il serait catastrophique que cette seconde personne cherche à satisfaire les besoins sexuels qui ont été éveillés en elle; là encore, un conflit est créé, C’est une chose que l’on rencontre très souvent dans les histoires de cas de schizophrènes : un parent a eu un comportement exagérément séducteur à l’égard de l'enfant, créant ainsi chez celui-ci un conflit intense entre, d’une part, des besoins sexuels et, d’autre part, des représailles sévères de la part du Surmoi (conformément au tabou culturel contre l’inceste). On constate aussi que cette circonstance peut créer un conflit chez l’enfant entre son désir de développer et d’atteindre sa propre individualité, et son désir régressif de se maintenir dans une symbiose infantile avec le parent, de se maintenir à ce stade, quitte à investir même ses aspirations sexuelles — qui constituent son atout dans le jeu de la réalisation de soi — dans cette relation régressive.
La stimulation et la frustration — simultanées ou alternant rapidement — d’autres besoins en dehors des besoins sexuels peuvent avoir, selon moi, un effet identique de désintégration. Un patient, sortant d’une psychose où ses sentiments intenses d’ambivalence à l'égard de sa mère avaient joué un rôle central, a pu assez bien décrire la relation qu'il avait eue avec sa mère pendant son enfance. Fait qui caractérise bien l’attitude de rejet de la mère, le patient ne se souvenait pas l’avoir jamais vue embrasser son père — qu’elle avait dominé et sur lequel elle s'était impitoyablement acharnée. Il se rappelait qu’il l'avait vue un jour commencer à embrasser son mari. Cela s'était passé à une époque tardive de son enfance : on transportait son père sur un chariot pour le conduire à la salle d'opération où il devait subir une grave intervention chirurgicale à la suite d’un accident de voiture. La mère s'était baissée comme pour embrasser son mari et le patient avait vu le visage de son père inondé de joie. Mais la mère, se ravisant, s’était redressée. Le patient décrivit l'incident avec une émotion désolée, comme si lui-même avait bien souvent vécu entre les mains de sa mère ce genre de frustration.
Il en va de même avec le désir de l’enfant — que celui-ci sent aussi comme un devoir — d'aider un parent, par exemple : on constate souvent dans l’histoire des schizophrènes que l’un des parents (ou les deux) n’a cessé de faire appel à la sympathie, à la compréhension de l'enfant, et à ce qu’on pourrait appeler une intervention thérapeutique de sa part, tout en rejetant ses efforts pour aider, si bien que la sympathie sincère de l'enfant et son désir d’aider ont fini par se combiner à une culpabilité, à une rage et peut-être surtout à un sentiment d’impuissance et d’inutilité personnelles. Dans ce contexte, Bateson et ses collaborateurs ont montré l’importance des injonctions parentales de nature contradictoire, ou « double entrave » [double bind], dans l’étiologie de la schizophrénie.
Une autre technique, étroitement liée à celle de la stimulation-frustration, consiste à traiter l’autre à deux niveaux de relation (voire plus) n’ayant absolument aucun rapport entre eux. Cette technique tend à forcer l’autre à dissocier sa participation à l’un ou l’autre de ces niveaux (peut-être même aux deux) : il sent, en effet, que ce serait « follement » inadéquat de réagir en fonction de ce niveau particulier puisque celui-ci semble n’avoir absolument aucun rapport avec ce qui se passe à l’autre niveau, plus conscient et plus manifeste.
Un exemple : au cours d’un travail qui dura plusieurs années avec une schizophrène paranoïde, attirante physiquement et souvent très séductrice, il m’est arrivé une ou deux fois d’avoir beaucoup de mal à ne pas devenir fou quand, simultanément, elle avait les deux comportements suivants : a) elle engageait une discussion politico-philosophique où elle s’exprimait avec une sorte de vigueur virile et compétente et, de mon côté, bien que pouvant difficilement placer un mot, je me sentais absolument poussé à discuter avec elle de certains de ces points, et je discutais; à) pendant ce temps, elle se promenait à travers la pièce ou se campait sur son lit, vêtue d’un costume de danse à jupe très courte, dans une attitude provocante. Elle ne faisait aucune référence verbale au sexe, si ce n’est pour m’accuser au début de la séance d’avoir des désirs « lubriques », « érotiques »; après quoi, toute l’interaction verbale se limitait à cette discussion sur la théologie, la philosophie et la politique internationale, alors que, pour moi, cela crevait les yeux que l'interaction non verbale était sexuelle. Mais — et c’est là, à mon avis, le point capital — je ne sentais aucun accord de sa part
(à un niveau conscient) à propos de cette interaction plus voilée; cette interaction sexuelle non verbale avait tendance à apparaître comme une « folie » de ma part, pur produit de mon imagination. Je savais que ma réaction à ces deux niveaux sans rapport l’un avec l’autre avait une base réelle, mais il me fallait faire un tel effort que j'avais l'impression, je le répète, de perdre la raison. Un enfant insécure ayant avec un parent une une inter-relation aussi nettement scindée subirait, à mon avis, des traumatismes importants de la personnalité si une situation de ce genre se reproduisait souvent.
Une autre technique, étroitement apparentée à celle qui consiste à entrer en rapport avec l’autre à deux niveaux distincts (ou plus) en même temps, consiste à passer brusquement d’une longueur d’onde affective à une autre, comme le font si fréquemment les parents de schizophrènes. Par exemple, la mère d’un jeune schizophrène gravement atteint, une femme exaltée qui parlait avec une rapidité de mitraillette, me déversa, en un flot ininterrompu de paroles, ces phrases si incohérentes dans leur tonalité affective que j'en restai un moment abasourdi : « Il était très heureux. Je ne peux pas imaginer que cette chose lui arrive. Il n’était jamais déprimé, jamais. Il adorait son travail de réparation de radios chez Mitchell à Lewiston. M. Mitchell est quelqu'un de très exigeant. Je crois qu'aucun des hommes qui ont travaillé chez lui avant Edward n’est resté plus de quelques mois. Il rentrait à la maison et disait (la mère imitant ici un soupir épuisé) : ‘‘ Je ne peux plus supporter ça!” » Avant son hospitalisation, le patient avait passé, pendant plusieurs mois, presque tout son temps en compagnie de sa mère, et il me parut significatif que, pendant les premiers mois de son séjour à l'hôpital, il ait montré à toutes sortes de signes (les expressions du visage, etc.) qu’il était assailli par des sentiments qui changeaient de qualité avec une soudaineté et une fréquence confondantes. À un moment donné, son visage reflétait un mélange de haine et de dégoût, puis soudain il sursautait comme s’il avait été frappé par un objet massif, et son visage prenait alors une expression d’intense chagrin.
Si j'en conclus que ce phénomène résultait en partie d’un contact prolongé avec la personnalité mal intégrée de sa mère, ce n’est pas pour écarter la possibilité que le processus ait simultanément opéré en sens inverse. Bien au contraire, j'ai été frappé de constater chez la mère une meilleure intégration après que le patient eut quitté le foyer familial, et il est fort possible qu’au moment de mon entretien avec elle, lorsque son fils fut admis à l'hôpital psychiatrique, elle ait manifesté les effets différés d’un contact qu’elle avait eu des années durant avec un être très mal intégré, psychotique, dont la faculté d’ébranler l'intégration de l’autre me devint si désagréablement familière pendant que je travaillais avec lui.
On touche ici au problème de la lutte, entre l'enfant et le parent ou entre le patient et le thérapeute, pour se rendre mutuellement fous; jy reviendrai plus loin...."
Searles s'interroge sur le fait que certaines personnes, souvent dans des relations intimes (familiales ou thérapeutiques), peuvent inconsciemment chercher à "rendre fou" l'autre. Cette dynamique est particulièrement présente dans les relations avec des patients psychotiques, mais aussi dans des interactions plus courantes (couples, parents-enfants). Il va montrer comment la folie peut être transmise plutôt que simplement individuelle.
Contrairement à une vision classique de la psychose comme maladie purement intrapsychique, Searles insiste sur le rôle des interactions dans la genèse et le maintien des troubles mentaux. Il décrit comment un individu peut être "poussé à la folie" par des comportements subtils (dénis, contradictions, manipulations inconscientes). Ses travaux rejoignent ainsi ceux de Bateson sur la double contrainte et ceux de Laing sur les dynamiques familiales schizophrénogènes.
Son travail a ouvert la voie à une compréhension plus relationnelle des troubles mentaux, anticipant des courants comme la psychanalyse intersubjective (Stolorow, Atwood), la théorie de l’attachement et les approches systémiques. A une époque de montée des troubles relationnels (narcissisme, manipulations, gaslighting), ses idées résonnent fortement. Son approche humaniste et profondément empathique contraste avec des visions plus médicalisées de la folie.
Le passage le plus emblématique de "L'Effort pour rendre fou" de Harold Searles est sans doute celui où il décrit de manière saisissante comment un individu peut être poussé à la folie par des mécanismes relationnels insidieux, particulièrement dans les relations intimes (familiales, thérapeutiques ou amoureuses).
L’effort pour rendre l’autre fou est rarement conscient. Il se manifeste par une série d’attitudes apparemment banales, ce peut être nier la réalité de ce que l’autre perçoit,
lui imposer des contradictions impossibles à résoudre, invalider ses émotions tout en exigeant qu’il les exprime, alterner entre rejet et emprise sous prétexte d’amour. Ces manœuvres, répétées, plongent l’autre dans un état de confusion tel qu’il finit par douter de sa propre santé mentale.
Un passage qui résume la thèse centrale du livre : La folie n’est pas toujours une pathologie individuelle, mais peut être le produit d’une dynamique relationnelle perverse.
Searles montre que des comportements quotidiens (gaslighting, double contrainte, déni) peuvent fabriquer de la folie chez l’autre. Searles illustre comment ces mécanismes ressemblent à ceux observés dans les familles de patients psychotiques (cf. les travaux de Bateson sur la double contrainte). Contrairement à d’autres théoriciens, Searles écrit avec une violence lucide, décrivant des situations où le thérapeute lui-même peut devenir l’instrument de la folie du patient.
La folie n’est pas seulement ce qui se passe dans la tête d’un seul homme ; c’est un processus à deux, parfois à plusieurs...

Bien des ouvrages montrent que la folie n’est jamais seulement une pathologie individuelle, mais aussi le reflet de dynamiques relationnelles, familiales ou sociales pathogènes. Elle émerge de jeux de pouvoir, de négations ou de projections. Et chaque relation (familiale, professionnelle, amoureuse) peut devenir pathogène sous certaines conditions....
Rendre l’autre fou est dans le pouvoir de chacun ...

La folie comme co-construction : Winnicott et la "mère suffisamment mauvaise"
("Collected Papers: Through Paediatrics to Psycho-Analysis", De la pédiatrie à la psychanalyse, 1958) - Donald Winnicott, pédiatre et psychanalyste, révolutionne la compréhension des origines de la folie en insistant sur le rôle crucial de l’environnement précoce, notamment à travers les concepts de "mère suffisamment bonne" (good enough mother) et de "mère imposante" (impinging mother). La folie n'est pas la conséquence de quelque "erreur" de l’individu, mais le symptôme d’une histoire relationnelle blessée...
La notion de "mère suffisamment bonne" (good enough mother), centrale dans l'œuvre de Winnicott, est considérée comme le fondement de la santé psychique parce qu'elle crée les conditions nécessaires pour que l'enfant développe un sentiment continu d'exister (going-on-being), une confiance basique en la réalité, et une capacité à être authentique.
La mère "suffisamment bonne" répond aux besoins physiologiques et émotionnels de l'enfant (nourriture, contact, regard) sans être parfaite, mais en étant prévisible et adaptée (fonction du holding). Elle est celle qui entretient l'illusion nécessaire(celle de "créer le monde"), donnant l'impression à l'enfant que c'est lui qui crée le sein (en le présentant au moment exact où il en a besoin). Cette illusion nourrit le sentiment de toute-puissance infantile, essentiel pour développer la créativité et l'estime de soi. Puis elle sera celle qui favorise la "désillusion progressive" : elle ne comble plus tous les besoins immédiatement au fil du temps, introduisant doucement la frustration. L'enfant apprend que la réalité existe en dehors de lui (différenciation soi/autre)...
Mais, selon Winnicott, la folie (psychose, états limites, faux-self) émerge lorsque l'environnement précoce échoue à répondre aux besoins fondamentaux de l'enfant, entraînant des mécanismes pathogènes spécifiques. La "mère imposante" est source de pathologies graves : c'est une mère qui envahit l’enfant par ses propres besoins (anxiété, contrôle, intrusivité), empêchant son développement authentique...
- L’effraction du moi (Impingement) : envahissement brutal de l’espace psychique de l’enfant par des stimuli externes inadaptés (mère intrusive, imprévisible, ou absente).
Conséquence : l’enfant ne peut pas développer un moi intégré → risque de dissociation ou psychose (rupture avec la réalité).
- Le faux-self (False Self) : construction d’une fausse personnalité pour satisfaire les attentes de l’environnement, étouffant le vrai self (désirs authentiques).
Conséquence : dépression essentielle (effondrement du vrai self) ou troubles borderline (alternance entre faux-self et explosions de rage).
- L’échec de l’illusion/désillusion : la mère ne permet pas à l’enfant de croire qu’il "crée" le monde (phase d’illusion), ni de découvrir progressivement la réalité (désillusion).
Conséquence : le délire (tentative de recréer un monde cohérent) ou dépendance pathologique (incapacité à être seul).
- La peur de l’effondrement (Fear of Breakdown) : l'angoisse d’un effondrement psychique qui a déjà eu lieu dans l’enfance (carence précoce) mais n’a pas été vécu consciemment.
Conséquence : des comportements autodestructeurs (mise en danger, addictions) pour éviter de revivre l’effondrement passé.
- L’absence d’objet transitionnel : un défaut d’accès à des objets/symboles (doudou, jeu) permettant de supporter l’absence. Conséquence : un défaut de symbolisation (passage à l’acte, somatisation).
Winnicott rattache donc explicitement les défaillances environnementales à des pathologies sévères ..
- Psychose : Résulte d’un effondrement (breakdown) précoce non intégré, lié à un environnement trop défaillant (mère absente) ou trop intrusif.
- Délire : Tentative de réparation d’une réalité externe vécue comme incoherente.
- Acting-out : Répétition d’un trauma relationnel non symbolisé.

Les familles "schizophrénogènes" et R.D. Laing
(The Divided Self (1960) / Soi et les autres, 1961) - Les théories des familles "schizophrénogènes" (années 1950-60) et les travaux de R.D. Laing (années 1960-70) ont révolutionné la compréhension de la folie en la situant dans un contexte relationnel pathologique. Certaines dynamiques familiales peuvent ainsi "pousser à la folie",
- Les familles "schizophrénogènes", un terreau relationnel toxique
A l'origine du concept, la théorie de Bateson (1956), qui introduit la "double contrainte" (double bind) : des messages contradictoires et inévitables ("Sois spontané !" / "Ne me contredis jamais !"), l’enfant ne peut ni obéir, ni fuir, ni métacommuniquer (parler de la contradiction).
L'École de Palo Alto (Watzlawick) montrera que ces paradoxes bloquent la pensée et favorisent la déréalisation.
Parmi les caractéristiques des familles schizophrénogènes, on citera une communication paradoxale, le déni de la réalité et des stratégies d’étouffement. L’enfant décroche alors de la réalité pour échapper aux contradictions (symptômes psychotiques, délire, hallucinations).
- R.D. Laing et la folie comme stratégie de survie ...
La thèse radicale de Laing est que la schizophrénie est une réponse rationnelle à un monde irrationnel" (The Divided Self, 1960). La folie n’est pas une maladie, mais un langage codé pour exprimer l’indicible (traumas familiaux). Parmi les mécanismes familiaux selon Laing, nous noterons, la "mystification" (les parents imposent leur version de la réalité, "Tu es méchant" au lieu de "Je suis fatigué"), l'effacement de l’identité (l'enfant traité comme "le prolongement" d’un parent, menant à la dépression ou à l'explosion psychotique), l'étouffement de l’autonomie (Laing décrit des familles où l’amour est conditionnel à la soumission)..
Comme Searles, Laing montre que la folie est une réponse logique à un environnement irrationnel, mais il insiste plus sur l’ontologie de la sécurité (peur d’exister).
Ronald D. Laing & Aaron Esterson, dans "L’Équilibre mental, la folie et la famille" (Sanity, Madness and the Family: Families of Schizophrenics, 1964) publient des études de cas montrant comment les familles détruisent la raison de leurs membres via des injonctions paradoxales : la schizophrénie est une réponse intelligente à une situation insensée...

Psychanalyse des psychoses : Marguerite Sechehaye et "La Réalisation symbolique"
("Autobiography of a Schizophrenic Girl: The True Story of 'Renée", Journal d'une schizophrène, 1950) - Marguerite Sechehaye révèle ici comment la folie se construit à travers une carence radicale de l'amour maternel et une absence de symbolisation, en documentant le cas de sa patiente "Renée", et comment la thérapie a permis une reconstruction symbolique. Searles partage cette vision réparatrice, mais insiste plus sur la réciprocité folle dans la relation thérapeutique.
La folie comme effondrement du lien primaire : la psychose de Renée (schizophrénie) naît d’un manque fondamental de "nourriture affective" dans l’enfance, une mère froide et distante qui ne répond pas aux besoins émotionnels, un environnement qui nie la réalité subjective de l’enfant ("Tu n’as pas faim", "Tu exagères"). Renée décrira un vide abyssal : "Je n’étais rien, je n’avais même pas de corps."(effondrement du sentiment d’exister).
Et le délire comme langage symbolique : quand les besoins primaires (amour, sécurité) ne sont pas satisfaits, l’enfant crée des équivalents délirants. Renée hallucine un "soleil noir" qui la dévore (symbole de la mère absente), elle croit être en verre (métaphore de sa fragilité et de l’impossibilité d’être touchée affectivement). Le délire est un message chiffré, une tentative désespérée de dire l’indicible.
Pour reconstruire la psyché, Sechehaye va combler symboliquement les manques précoces et Renée basculera du "Je suis un fantôme" à "Je sens mon corps, je peux aimer". Une preuve que la folie est réversible par la relation...
Sechehaye s’opposait ici à l'idée que la schizophrénie est héréditaire ou incurable et à l'utilisation de traitements médicamenteux ou électrochocs sans travail relationnel.
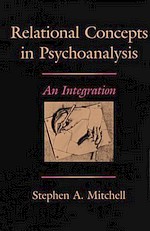
La folie est interpersonnelle ...
Pour la psychanalyse relationnelle, la folie n’est pas une "erreur" du cerveau, mais une cicatrice des liens brisés : soit ne réponse à des ruptures relationnelles précoces, un langage codé pour exprimer l’indicible (traumas non symbolisés), un phénomène dynamique qui se modifie dans des relations nouvelles....
(Relational Concepts in Psychoanalysis, Mitchell, 1988 / The Bonds of Love, Benjamin, 1988)
Selon la Psychanalyse relationnelle (Relational Psychoanalysis), une vision radicalement différente de la psyché par rapport à la psychanalyse freudienne classique, le psychisme ne se forme pas uniquement à travers des pulsions internes, mais se construit dans et par la relation à l'autre, y compris dans ses dimensions pathologiques.
- La structure psychique se forme dans les premières relations (attachement, interactions parent-enfant).
- Les symptômes "fous" (psychotiques, borderline, etc.) sont des réponses adaptatives à un environnement dysfonctionnel.
Cette approche émerge aux États-Unis dans les années 1980-90, influencée par Ferenczi (l’importance du trauma réel et de la réparation relationnelle), Winnicott (la "mère suffisamment bonne" et l’environnement facilitateur), Kohut (psychologie du Self et besoins narcissiques), Mitchell, Aron, Bromberg (théorie relationnelle contemporaine).
Un développement qualifié de "sain" se construit via,
- un attachement sécurisant (Bowlby, la base de la régulation émotionnelle),
- des réponses empathiques (Kohut, la validation des besoins de l’enfant),
- un contexte de jeu et de créativité (Winnicott, l'espace transitionnel où le soi se déploie).
Cette construction devient pathologique au fil des troubles psychiques qui vont naître des ruptures répétées dans les relations précoces, à savoir
- des traumas relationnels (abus, négligence, attachement désorganisé), Les enfants avec des attachements désorganisés (abus, négligence) ont un risque accru de développer des troubles dissociatifs ou psychotiques : la folie devient ici une stratégie de survie. Un parent qui nie systématiquement la réalité de l’enfant ("Ce n’est pas grave !" face à une détresse) peut induire une rupture avec la réalité chez lui : la folie est bien co-construite. Les abus ou négligences créent des états dissociatifs qui, répétés, deviennent des symptômes chroniques (le trauma relationnel, Ferenczi, Bromberg).
- des Injonctions paradoxales ("Sois autonome !" dit un parent étouffant).
- un déni des besoins ("l'enfant triste qu’on force à "sourire").
A compléter par la théorie de l’esprit (Fonagy & Target) qui soutient que la "mentalisation" (ou la capacité à comprendre ses propres états mentaux et ceux d’autrui) se développe via des interactions saines : son absence (dans les familles traumatiques) favorise les dysrégulations émotionnelles extrêmes (folie borderline, paranoïa).
La relation thérapeute-patient agit comme outil de guérison. Le thérapeute n’est pas un "miroir neutre" (Freud), mais un partenaire relationnel engagé. La psychanalyse relationnelle montre que nos blessures comme nos ressources naissent dans la relation. Cela ouvre une voie thérapeutique plus humaniste, où le lien lui-même devient réparateur ...
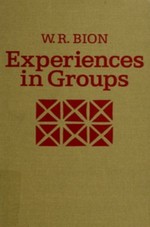
Comment un groupe peut "rendre fou" un membre par des projections massives ..
Bion a montré que la folie n’est pas toujours individuelle : elle peut être co-créée par un système. Une clé pour comprendre les lynchages modernes (réseaux sociaux, harcèlement professionnel) ...
Wilfred Bion, psychanalyste britannique pionnier de la psychologie des groupes, a décrit de manière fascinante comment un groupe peut "rendre fou" un de ses membres par des projections massives et des mécanismes de défense collectifs. Sa théorie, développée dans "Experiences in Groups" (1961), montre comment les groupes régissent souvent de manière irrationnelle, en désignant des boucs émissaires ou en déversant leurs angoisses sur un individu.
Bion s’inspire de Mélanie Klein (dont il fut l’analysé) pour expliquer comment les groupes utilisent l’identification projective à grande échelle ..
La PROJECTION est un mécanisme psychologique dans lequel un groupe (ou une personne) rejette sur un membre des émotions ou traits qu’il refuse de reconnaître en lui-même (par exemple, un groupe de travail est inefficace par manque d’organisation, mais au lieu de l’admettre, il accuse un membre d’être "trop lent" ou "négatif").
Un groupe peut ne pas vouloir assumer certaines réalités, parce que trop menaçantes pour son image ou sa cohésion et va donc attribuer ses conflits internes à un individu, maintenant une illusion d’unité (effet bouc émissaire), ou "choisir" un membre qui va finir par incarner ces éléments (le "fou", le "saboteur", le "vulnérable", identification projective pathologique).
Mais il faut bien noter que dans ces projections qui deviennent collectives et automatiques dans les groupes, personne ne conspire activement : c’est un processus inconscient et systémique.
Bion opposait deux modes de fonctionnement pour un groupe, le "Groupe de travail" (Work group), marqué par un objectif rationnel et une volonté de coopération, et les "Mentalités de groupe" (Basic assumption groups), construites sur des états irrationnels et inconscients qui parasitent le groupe, et régis par des angoisses archaïques. Bion en identifiait trois types,
- "Dependence" (recherche d’un leader sauveur).
- "Fight-Flight" ("Attaque-Fuite", rejet de l’ennemi ou du dissident).
- "Pairing" (espoir messianique en un futur sauveur, souvent incarné par un sous-groupe).
Ainsi, dans un groupe en "attaque-fuite" (Group in 'fight-flight' mode), un membre critique peut devenir la cible de projections agressives (Aggressive projections, "C’est lui qui nous empêche d’avancer !"), même si le vrai problème est l’incompétence collective (Collective incompetence).
Le groupe "rend fou" par ses injonctions paradoxales ("Sois libre !" / mais conforme-toi), le déni collectif (le groupe nie sa propre irrationalité en l’attribuant à un seul), et l'altération de la réalité (la victime en vient à intégrer les projections : "Et si j’étais vraiment le problème ?"). Dans les groupes sectaires, ce mécanisme peut conduire à des effondrements psychotiques chez les boucs émissaires ...

Le PARADOXE comme source de perturbations paralysantes dans les systèmes humains (familles, couples, groupes) a été exploré par plusieurs penseurs clés, mais c'est principalement l'École de Palo Alto (années 1950-1960) qui l'a formalisé en thérapie, avant que l'École de Milan (dont Mara Selvini Palazzoli) ne le reprenne et l’approfondisse.
Pourquoi le paradoxe est-il paralysant ? Il crée une impasse logique (toute réponse renforce le problème), il maintient l’homéostasie (équilibre pathologique) du système et empêche la métacommunication (parler de la communication) ...

La "double contrainte" (Double Bind) et Gregory Bateson ("steps to an ecology of mind", Vers une écologie de l'esprit, 1972) ...
Bateson et son équipe (dont Don D. Jackson) ont théorisé la double contrainte comme un schéma de communication familial qui contribue à la schizophrénie (ex. : une mère dit "Sois spontané !" tout en réprimant toute initiative). Ce mécanisme a été associé à la genèse de la schizophrénie dans un contexte familial rigide.
Searles approfondit cette idée en montrant comment ces contradictions peuvent être inconsciemment manipulatoires et pas seulement inadaptées. Paul Watzlawick (Palo Alto) a ensuite théorisé les paradoxes pragmatiques dans "Une logique de la communication" (1967), montrant comment ils bloquent les systèmes relationnels.
Selvini Palazzoli reprendra ces idées mais les applique de façon active en thérapie. Elle observe que les familles dysfonctionnelles sont souvent prisonnières de paradoxes invisibles (ex. : "Change en restant identique"). Son intérêt est d’utiliser des contre-paradoxes thérapeutiques pour briser ces cercles vicieux : "Continuez à vous disputer, c’est vital pour votre équilibre désarme la résistance au changement, renverse les attentes tout en créant une perturbation salutaire dans le système figé...
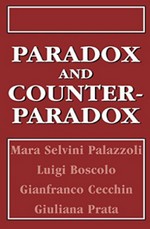
Mara Selvini Palazzoli, "Paradoxe et contre-paradoxe"(1975)
Mara Selvini Palazzoli (1916-1999) était une psychiatre et thérapeute familiale italienne, une figure majeure de la thérapie systémique et une des fondatrices de l'École de Milan (ou approche milanaise), un courant important dans le champ de la thérapie familiale systémique.
Avec son équipe (Luigi Boscolo, Gianfranco Cecchin et Giuliana Prata), elle a développé une approche innovante centrée sur l'analyse des systèmes familiaux et leurs interactions, l'utilisation du paradoxe comme outil thérapeutique et la neutralité du thérapeute et la circularité des questions pour éviter les jugements.
"Paradoxe et contre-paradoxe" (Paradosso e controparadosso: Un nuovo modello nella terapia della famiglia a transazione schizofrenica) a révolutionné la thérapie familiale en proposant une méthode active pour briser les cercles vicieux des familles en crise, notamment dans les cas de schizophrénie. Il introduit des interventions paradoxales (comme prescrire le symptôme) pour déstabiliser les systèmes rigides. C'est un tournant vers une approche systémique rigoureuse, influençant des thérapeutes comme Paul Watzlawick et l'École de Palo Alto.
Sa traduction présentait au public anglophone les premiers résultats d’un plan de recherche élaboré par le Centre milanais d’études sur la famille à la fin de 1971 et mis en pratique au début de 1972. L’ouvrage rapportait le travail thérapeutique effectué par les auteurs auprès de quinze familles, dont cinq auprès d’enfants présentant des troubles psychotiques graves, et dix auprès de jeunes adultes diagnostiqués schizophrènes en phase aiguë.
Partant du rôle central du paradoxe comme source de perturbations paralysantes ainsi que de transformations créatives, les auteurs démontraient qu’il est possible d’intervenir dans une famille en transaction schizophrène en concevant des méthodes originales et paradoxales afin de libérer le schéma d’action de la perturbation à la transformation.
Les contre-paradoxes générés dans ce processus, illustrés par un grand nombre d’exemples, sont rigoureusement analysés selon les modèles conceptuels fournis par la théorie générale des systèmes, par la cybernétique et par la pragmatique de la communication humaine...
Bien que Selvini Palazzoli ait ensuite évolué vers d'autres modèles (comme les jeux psychotiques familiaux), ce livre reste un classique de la thérapie systémique, essentiel pour comprendre les dynamiques familiales pathologiques.
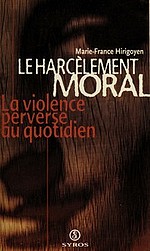
Marie-France Hirigoyen, "Harcèlement moral : La violence perverse au quotidien" (1998)
Marie-France Hirigoyen est une psychiatre, psychanalyste et psychothérapeute française, née en 1949, spécialisée dans l'étude des violences psychologiques et des mécanismes de manipulation perverse. La violence perverse n’est pas seulement physique ou explicite ; elle passe par une destruction systématique de l’estime de soi de la victime, via des mécanismes insidieux (dénigrement, isolement, gaslighting).
"Le contexte socioculturel actuel permet a la perversion de se développer parce qu’elle y est tolérée" : publié en 1998, à une époque où le harcèlement moral n’était pas encore criminalisé en France (la loi de 2002 inspirée en partie par ses travaux), son ouvrage a popularisé les termes de "pervers narcissique" et de "harcèlement moral" et a marqué un tournant dans la reconnaissance des violences invisibles, tant dans la sphère privée que professionnelle. Un ouvrage qui de plus a inspiré des protocoles de prise en charge des victimes (thérapies centrées sur la restauration de l’estime de soi). "Dans ma pratique clinique en tant que sychotherapeute,
j'ai été amenée à entendre la souffrance des victimes et leur impuissance a se défendre. Je montrerai dans ce livre que le premier acte de ces prédateurs consiste à paralyser leurs victimes
pour les empêcher de se défendre. Ensuite, même si elles essaient de comprendre ce qui leur arrive, elles n'ont pas les outils pour le faire. Aussi, en analysant la communication perverse, j'essaierai de démonter le processus qui lie l'agresseur et l'agressé, afin d'aider les victimes ou futures victimes à sortir des filets de leur agresseur..."
"... DE PETITS ACTES PERVERS SONT SI QUOTIDIENS qu’ils paraissent la norme. Cela commence par un simple manque de respect, du mensonge ou de la manipulation. Nous ne trouvons cela insupportable que si nous sommes atteints directement. Puis, si le groupe social dans lequel ces conduites apparaissent ne réagit pas, cela se transforme progressivement en conduites perverses avérées qui ont des conséquences graves sur la santé psychologique des victimes. N’étant pas sûres d’être entendues, celle-ci se taisent et souffrent en silence. Cette destruction morale existe depuis toujours, dans les familles ou elle reste cachée, et dans l'entreprise où l'on s’en accommodait en période de plein emploi car les victimes avaient la possibilité de partir. Aujourd’hui, celles-ci s’accrochent désespèrement à leur poste de travail au détriment de leur santé tant physique que psychique. Quelques-unes se sont révoltées, ont quelquefois intenté des procès; le phénomène commence à être médiatisé et cela amène la société à s’interroger.
Il est courant dans notre pratique psychothérapeutique d’être témoins d’histoires de vie où l'on discerne mal la réalité extérieure de la réalité psychique. Ce qui frappe dans tous ces récits de souffrance, c’est la récurrence. Ce que chacun croyait singulier est en fait partagé par beaucoup d’autres..."
Par rapport aux années 1990, l'analyse reste pertinente, les mécanismes décrits (gaslighting, dénigrement, isolement) sont toujours reconnus comme fondamentaux dans les violences psychologiques, les études récentes confirment que les victimes développent davantage de dépression, TSPT et troubles anxieux (source : INSERM, 2023) et les traits de personnalité narcissique ou perverse sont toujours associés à ces comportements (DSM-5-TR, 2022).
Par contre, aujourd’hui (2025), on préfère parler de "personnalité narcissique pathologique" ou de "comportements manipulateurs" pour éviter les amalgames (le terme "pervers" est jugé trop moralisateur).Les recherches en psychologie sociale (ex. : travaux de Paulhus sur la triade noire, 2020) montrent que ces comportements relèvent souvent d’un spectre (narcissisme & Machiavélisme & psychopathie).
Quant aux victimes, les travaux sur l’emprise (G. Lopez, 2021) et la résilience (B. Cyrulnik) ont affiné les stratégies de reconstruction. L’importance des neurones miroirs (Rizzolatti) explique pourquoi les victimes "absorbent" la toxicité.
En France, la loi de 2002 sur le harcèlement moral au travail, a depuis été élargie en 2022 aux cyberharcèlements et aux violences conjugales psychologiques. Mais les législations contre le harcèlement (moral, sexuel, cyberharcèlement) varient considérablement dans le monde, reflétant des différences culturelles, juridiques et politiques.
La France (loi contre le harcèlement de rue, 2018, avec la Suède (loi contre le harcèlement sexuel incluant le consentement explicite, 2018), le Canada, l'Australie sont parmi les pays avec des législations strictes. Le Royaume-Uni, l'Allemagne, les Etats-Unis ont choisi des des législations modérées. Une très relative harmonisation, mais partielle, existe via des traités internationaux (ex. : Convention d’Istanbul sur les violences faites aux femmes)...
