- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Svevo - Pirandello
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki
- 1930-1940
- 1930s
- Fitzgerald
- Hemingway
- Faulkner
- Koch
- Céline
- Bernanos
- Jouve
- DosPassos
- Kojève
- Miller-Nin
- Grosz - Dix
- Green
- Ortega y Gasset
- Wittgenstein
- Russell - Carnap
- Artaud
- Jaspers
- Sapir - Piaget
- Guillén
- Garcia Lorca
- Hammett
- A.Christie
- Heidegger
- Icaza
- Huxley
- Hubble
- Caldwell
- Steinbeck
- Waugh
- Blixen
- Rhys
- J.Roth - Doderer
- Aub
- Malraux-StExupéry
- DBarnes-NWest
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bataille
- Char-Michaux
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Bloch
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Lewin - Mayo - Maslow
- Montherlant
- Buzzati - Pavese
- Vittorini
- Fallada
- Malaparte
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Welty
- Boulgakov
- Tamiki - Yôkô
- Weil
- Gadda
- Broch
- Steeman
- Jouhandeau
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Ellison
- Bergman
- Baldwin
- Fromm
- Bradbury - A.C.Clarke
- Tennessee Williams
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Carpentier
- Mishima
- Salinger - Styron
- Pasternak
- Asturias
- O'Connor
- Hoffer
- Matute - MartinGaite
- 1960-1970
- 1960s
- Abe
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- U.Johnson - C.Wolf
- Heller - Toole
- Naipaul
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Onetti - Sábato
- Capote
- Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- McCarthy - Minsky
- Sillitoe
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- Lenz
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Dolls
- Ellis
- Cortázar
- Warhol
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- HarperLee
- Fuentes
- 1970-1980
- 1970s
- Habermas
- Handke
- GarciaMarquez
- Deleuze
- Derrida
- Beck
- Satir
- Kundera
- Hrabal
- Didion
- Guinzbourg
- Lovelock
- Vietnam
- H.S.Thompson - Bukowski
- Pynchon
- E.T.Hall
- Bateson - Watzlawick
- Carver
- Irving
- Milgram
- VargasLlosa
- Puig - Donoso
- Lasch-Sennett
- Crozier - Touraine
- Friedan-Greer
- Jacob-Monod
- Dawkins
- Beattie - Phillips
- Gaddis
- Rawls
- Zinoviev
- H.Searles
- Ballard
- Jong
- Kôno
- Calvino
- Ballester-Delibes
- ASchmidt
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact

Kazuo Ishiguro (1954) - "A Pale View of Hills" (1982), "An Artist of the Floating World" (1986), "The Remains of the Day" (1989), "The Unconsoled" (1995), "When We Were Orphans (2000), "Never Let Me Go "(2005), "Nocturnes" (2009) - ...
Last Update : 12/31/2025

Kazuo Ishiguro est arrivé à maturité créative dans les années 1980, une décennie marquée en Grande-Bretagne par le thatchérisme, un individualisme croissant et un questionnement sur l'identité nationale post-impériale. Il appartient à la même "génération" littéraire que des auteurs comme Ian McEwan ou Salman Rushdie, qui ont également exploré les failles de l'histoire et de la mémoire personnelle. Mais son ton est trop personnel, trop introspectif et trop universel pour être réduit à un simple reflet de son époque ...
Sa double culture nippo-britannique est le fondement même de sa vision du monde et de son esthétique littéraire. Ishiguro a quitté le Japon à 5 ans. Il n'a donc pas une connaissance intime de la société japonaise, mais plutôt des souvenirs d'enfance, des impressions, et une sensibilité culturelle inculquée par ses parents. Cette position lui confère une distance unique : il peut observer la culture britannique en "étranger" et la culture japonaise en "exilé". Cette dualité forge un regard aiguisé sur les non-dits, les codes sociaux implicites et les coutumes qui régissent toute société, qu'elles soient anglaises ou japonaises. Son écriture est caractérisée par une retenue émotionnelle extrême. Les drames les plus profonds sont suggérés, jamais explicités. Cette pudeur est très proche de l'esthétique japonaise du yūgen (beauté profonde et mystérieuse qui ne se révèle pas complètement) et contraste avec la tradition du roman psychologique occidental plus explicite...
Kazuo Ishiguro est un virtuose de la voix narrative. Ses récits sont presque toujours racontés à la première personne par un narrateur qui est, d'une manière ou d'une autre, peu fiable ou profondément aveugle à sa propre situation. Il utilise délibérément une voix limitée, souvent celle d'un personnage rigide, conventionnel ou en déni (comme le majordome Stevens dans "Les Vestiges du jour" ou la nurse Kathy H. dans "Auprès de moi toujours"). Cette restriction oblige le lecteur à lire entre les lignes. La vérité n'est jamais énoncée directement ; elle émerge des silences, des omissions, des contradictions et de ce que le narrateur ne peut ou ne veut pas dire. Ses romans sont souvent construits comme des mémoires intérieures ou des monologues. Dans "Les Vestiges du jour", Stevens entreprend un voyage physique qui devient un voyage dans les méandres de sa mémoire, reconstruisant le passé pour se donner raison. Cette structure reflète parfaitement le thème central : comment nous nous mentons à nous-mêmes pour donner un sens à notre vie ...
Son œuvre tourne autour de questions fondamentales et douloureusement humaines :
- La Mémoire et l'Oubli : C'est son thème de prédilection. Ishiguro explore comment la mémoire est sélective, fragile et souvent manipulée. Ses personnages utilisent le souvenir et l'oubli comme des mécanismes de survie psychologique pour supporter la culpabilité, les regrets ou un passé traumatisant (la participation à un projet inhumain dans "Auprès de moi toujours", la collaboration indirecte avec le nazisme dans "Les Vestiges du jour").
- Le Déni et l'Illusion de Soi : Ses personnages sont des maîtres dans l'art de se mentir à eux-mêmes. Ils sacrifient leurs émotions, leurs amours et leur humanité au nom d'une idéologie abstraite (la "dignité" du majordome, "son devoir" dans l'Angleterre d'après-guerre) ou d'un espoir vain (les clones attendant leurs "dons" d'organes). Ishiguro montre le coût humain terrible de ce déni.
- Le Temps qui Passe et les Occasions Manquées : Une mélancolie douce-amère imprègne ses romans. Il s'agit presque toujours de personnages qui, arrivés à l'automne de leur vie, fassent le bilan et réalisent, parfois trop tard, les choix qu'ils n'ont pas faits et l'amour qu'ils ont perdu. C'est une méditation profonde sur le regret et la manière dont une vie peut être gâchée par fidélité à de mauvaises idées.
- La Dignité dans l'Adversité : Malgré tout, ses personnages conservent une forme de grâce et de dignité. Même dans les situations les plus tragiques (comme celle des clones), ils cherchent à donner un sens à leur existence et à trouver du réconfort dans leurs relations. Cette humanité persistante au cœur de la désillusion est ce qui rend ses livres si émouvants.

Une Œuvre Inclassable et en constant renouvellement? Ishiguro refuse d'être cantonné à un genre. Bien que souvent étiqueté comme un auteur de "littérature pure", il a constamment repoussé les limites ...
- Ses débuts "Japonais" : "Lumière pâle sur les collines" et "Un artiste du monde flottant" explorent la mémoire collective du Japon d'après-guerre, mais d'un point de vue très personnel, sans être des romans "japonais" traditionnels.
- La période "Britannique" : "Les Vestiges du jour" est un chef-d'œuvre du sous-entendu et une critique subtile de la classe dirigeante britannique.
- Le virage vers la Dystopie et la Science-Fiction : "Auprès de moi toujours" est une prouesse : il prend un cadre de science-fiction (des clones élevés pour fournir des organes) et en fait une allégorie profondément humaine sur la mortalité, l'amour et l'acceptation de son destin. Il utilise les codes du genre pour servir ses thèmes, pas l'inverse.
- Le Mélange des Genres : "Le Géant enfoui" est une fable médiévale mêlant fantasy, mythe arthurien et une allégorie sur la mémoire collective et les traumatismes de guerre. "Klara et le Soleil" explore l'intelligence artificielle et la conscience à travers les yeux d'une robot, posant des questions sur l'amour et l'âme.
Enfin, la grandeur d'Ishiguro est attestée par les plus hautes distinctions ...
- Prix Nobel de Littérature (2017) : L'Académie suédoise l'a récompensé car il "a, dans des romans d'une grande force émotionnelle, mis à nu l'abîme sous notre illusion de connexion avec le monde".
- Booker Prize (1989) pour "Les Vestiges du jour".
Ses livres sont traduits dans le monde entier et plusieurs ont été adaptés au cinéma avec succès (notamment "Les Vestiges du jour" par James Ivory en 1995).
Kazuo Ishiguro apporte à la littérature une façon unique d'explorer l'intériorité humaine. Il nous montre que les plus grands drames ne se jouent pas dans l'action, mais dans l'esprit de personnages qui luttent pour préserver leur image d'eux-mêmes face à un monde qui les dépasse. Il oblige le lecteur à devenir actif : il ne nous donne pas les réponses, il nous donne les indices pour les construire nous-mêmes. En nous faisant comprendre la psychologie de ses narrateurs, il nous pousse à une réflexion sur nos propres illusions, nos propres souvenirs et les récits que nous nous racontons pour vivre.

Kazuo Ishiguro (1954)
Kazuo Ishiguro was born in Nagasaki, Japan. At the age of six, he came to England with his family. Kazuo Ishiguro naît à Nagasaki (Japon) le 8 novembre 1954. Sa famille émigre en Grande-Bretagne en 1960, son père océanographe étant engagé pour des recherches. Cette double culture, japonaise et britannique, marquera profondément son œuvre, non pas dans des descriptions réalistes, mais dans une sensibilité et une esthétique propres : retenue émotionnelle, importance du non-dit, sens du devoir et questionnement sur la mémoire.
Il fait des études de philosophie et de littérature à l'université du Kent, puis suit un master en création littéraire à l'universté d'East Anglia, où il est encadré par Malcolm Bradbury et Angela Carter. Dès son premier roman, "Lumière pâle sur les collines' (1982), il impose une voix narrative unique : des narrateurs souvent en déni, dont le récit parcellaire et subjectif oblige le lecteur à reconstituer la vérité. Son style, d'une apparence simple, est en réalité d'une grande sophistication et maîtrise. Avec "Un artiste du monde flottant" (1986) et surtout "Les Vestiges du jour" (1989), couronné par le Booker Prize, il atteint une reconnaissance internationale. Il explore les thèmes qui deviendront sa marque de fabrique : la mémoire individuelle et collective, l'illusion de soi, le déni, le sacrifice de l'individu à une cause ou une idéologie, et les regrets d'une vie.
Son œuvre ne cesse de se renouveler. Il refuse d'être cantonné à un genre, passant de la dystopie science-fictionnelle ("Auprès de moi toujours", 2005) à la fable médiévale ("Le Géant enfoui", 2015) et à l'intelligence artificielle ("Klara et le Soleil", 2021), tout en conservant sa préoccupation centrale pour la condition humaine.
L'Académie suédoise lui décerne le Prix Nobel de Littérature en 2017 pour avoir "dans des romans d'une grande force émotionnelle, mis à nu l'abîme sous notre illusion de connexion avec le monde". Ishiguro est un auteur qui, par des moyens apparemment simples, explore la complexité du cœur et de la mémoire humains.
Dans "Understanding Kazuo Ishiguro", Brian W. Shaffer propose la première étude critique complète de la vie et de l'œuvre de l'auteur lauréat du Booker Prize pour "The Remains of the Day".
L'un des écrivains britanniques les plus suivis de sa génération, Ishiguro, né japonais mais élevé et éduqué en Angleterre, est l'auteur de quatre romans acclamés par la critique, qui révlent l'ancrage de l'auteur non seulement dans la littérature japonaise, mais aussi chez les grands maîtres britanniques du XXe siècle – Joseph Conrad, Ford Madox Ford, E. M. Forster et James Joyce – ainsi que dans la psychanalyse freudienne.
C'est une œuvre qui a eu la chance de rencontrer des traducteurs et des éditeurs à la hauteur de son ambition littéraire. Le fait que des maisons d'édition prestigieuses comme Les Éditions de la Table Ronde puis Les Éditions des Deux Terres (spécialisées en littérature étrangère) aient publié et réédité ses œuvres atteste d'un travail éditorial soigné et d'une considération pour la qualité de la traduction. Les traducteurs ont superbement réussi à transposer l'atmosphère si particulière des livres d'Ishiguro (La traduction "Auprès de moi toujours" est un excellent exemple de traduction littéraire qui va au-delà du mot-à-mot)...

"Lumière pâle sur les collines" (A Pale View of Hills, 1982)
Traduction française : Éditions des Deux Terres, 2002 (traduit par Sophie Mayoux) - Editions Gallimard, Collection Folio, Paris, 2017
Bien plus qu'un simple premier roman, c'est une œuvre fondatrice et prophétique de l'ensemble de l'œuvre d'Ishiguro. Bien que peut-être moins abouti dans sa structure que "Les Vestiges du jour", il pose déjà avec une maîtrise remarquable tous les thèmes et techniques qui feront la renommée de l'auteur. C'est un livre sur la difficulté de vivre avec le passé – à la fois l'histoire collective tragique d'une nation et les choix personnels qui hantent une vie. Il ne fournit pas de réponses, mais invite le lecteur à douter de la narration, à lire entre les lignes et à reconstituer la vérité que la narratrice ne peut se avouer à elle-même.
"I - Niki : ce nom que nous avons donné à ma fille cadette n’est pas un diminutif, mais le résultat d’un compromis avec son père. Paradoxalement, c’était lui qui voulait lui donner un nom japonais ; quant à moi, souhaitant peut-être égoïstement que rien ne pût me rappeler le passé, je tenais à un prénom anglais. Il accepta finalement Niki, trouvant à ce nom une consonance vaguement orientale.
Elle est venue me voir au début de cette année, en avril ; le temps était encore froid et pluvieux. Elle avait peut-être prévu de rester plus longtemps ; je n’en sais rien. Mais ma maison à la campagne et le calme qui l’entoure la rendaient nerveuse, et je m’aperçus vite qu’elle avait hâte de retrouver sa vie londonienne. Elle écoutait avec impatience mes disques classiques, feuilletait magazine sur magazine. Le téléphone sonnait fréquemment pour elle, et elle foulait alors la moquette à grandes enjambées, sa frêle silhouette serrée dans ses vêtements étroits, fermant soigneusement la porte derrière elle pour ne pas me laisser entendre sa conversation. Elle partit au bout de cinq jours.
Elle ne parla pas de Keiko avant le deuxième jour. C’était un matin gris et venteux, et nous avions rapproché les fauteuils des fenêtres pour voir la pluie tomber sur mon jardin.
« Tu t’attendais à ce que je sois là ? demanda-t-elle. À l’enterrement, je veux dire.
— Non, je ne croyais pas vraiment que tu viendrais.
— Tu sais, ça m’a secouée, quand j’ai su ce qui s’était passé. J’ai failli venir.
— Jamais je n’ai pensé que tu viendrais.
— Les gens se demandaient ce qui m’arrivait, reprit-elle. Je n’en ai parlé à personne. Je crois que j’étais mal à l’aise. Ils n’auraient pas vraiment compris ; ils n’auraient pas compris ce que j’éprouvais. Une sœur, en principe, c’est quelqu’un dont on est proche, non ? On ne l’aime pas forcément beaucoup, mais on en est quand même proche. Mais là, ça ne se passait pas du tout comme ça. Je ne me rappelle même plus comment elle était.
— Il y a déjà longtemps que tu ne l’as vue, c’est vrai.
— Je me souviens simplement d’une personne qui me faisait souffrir. C’est ça, le souvenir qu’elle m’a laissé. Mais j’ai quand même été triste, quand j’ai appris la nouvelle. »
Peut-être n’est-ce pas simplement à cause du calme que ma fille est repartie pour Londres. Nous avions beau ne pas nous appesantir sur ce sujet, la mort de Keiko n’était jamais loin : elle planait au-dessus de chacune de nos conversations.
À la différence de Niki, Keiko était entièrement japonaise, et plus d’un journal se hâta de le souligner. Les Anglais ont une théorie de prédilection selon laquelle notre race a l’instinct du suicide, et s’estiment dès lors dispensés de toute autre explication ; ils se contentèrent donc d’annoncer qu’elle était japonaise et qu’elle s’était pendue dans sa chambre.
Ce soir-là, debout près des fenêtres, je regardais la nuit quand j’entendis Niki dire derrière moi : « À quoi penses-tu en ce moment, maman ? » Elle était assise en travers du canapé, un livre broché posé sur ses genoux.
« Je pensais à quelqu’un que j’ai connu autrefois. Une femme que j’ai connue.
— Quelqu’un que tu as connu quand tu… avant de venir en Angleterre ?
— Je l’ai connue quand j’habitais Nagasaki ; je suppose que c’est ce que tu veux dire ? » Elle avait toujours les yeux fixés sur moi, et j’ajoutai : « Il y a longtemps. Bien avant de rencontrer ton père. »
Ma réponse parut lui convenir. Elle fit une réflexion quelconque et se replongea dans son livre. Niki, par bien des côtés, est une enfant affectueuse. Elle n’était pas simplement venue voir comment je supportais la nouvelle de la mort de Keiko ; elle était venue vers moi poussée par le sentiment d’une mission. Ces dernières années, elle avait entrepris d’admirer certains aspects de mon passé, et en venant, elle était résolue à me dire que la situation n’avait changé en rien, que je ne devais pas regretter les choix que j’avais faits autrefois. En somme, elle voulait me rassurer : je n’étais pas responsable de la mort de Keiko.
Je préfère, pour l’instant, ne pas m’attarder sur Keiko ; cela ne m’apporte guère de réconfort. Si je l’évoque, c’est pour situer les circonstances de la visite de Niki, en ce mois d’avril, et aussi parce que, au cours de cette visite, je me rappelai de nouveau Sachiko, après tant d’années. Je n’ai jamais bien connu Sachiko. En fait, notre amitié ne s’étendit que sur quelques semaines d’été, il y a bien longtemps.
Le pire était derrière nous. Les soldats américains étaient aussi nombreux que jamais – car on se battait en Corée –, mais à Nagasaki, après ce qui s’était passé, l’heure était au calme et au soulagement. On le sentait : le monde était en train de changer.
Mon mari et moi, nous vivions dans un quartier de l’est de la ville, non loin du centre par le tram. Une rivière coulait près de là, et l’on me raconta une fois qu’avant la guerre, un petit village s’était développé sur la berge. Mais la bombe était tombée, et il n’était plus resté que des ruines calcinées. La reconstruction avait démarré, et au bout de quelque temps, quatre immeubles en béton avaient été bâtis, dont chacun comptait une quarantaine d’appartements distincts. Sur les quatre, notre bâtiment avait été construit en dernier et marquait la limite atteinte par le programme de reconstruction ; entre nous et la rivière s’étendait une zone de terrains vagues, plusieurs hectares de boue séchée et de ravins. Bien des gens protestaient contre l’insalubrité du lieu ; l’écoulement des eaux se faisait mal, et le résultat était effectivement déplorable. D’un bout de l’année à l’autre, les cratères restaient pleins d’eau stagnante, et en été, les moustiques devenaient intolérables. On voyait de temps en temps des personnages aux allures officielles relever des mesures ou griffonner des notes, mais les mois passaient et rien n’était fait.
Les habitants des immeubles étaient des gens dans notre genre : des couples de jeunes mariés, les hommes ayant trouvé un emploi auprès d’entreprises en pleine expansion. Les logements appartenaient souvent aux entreprises, qui les louaient à leurs employés à un tarif avantageux. Tous les appartements étaient identiques : des sols en tatami, des salles de bain et des cuisines de type occidental. Ils étaient exigus, et pendant les mois d’été, il était difficile d’y maintenir de la fraîcheur, mais dans l’ensemble, les habitants semblaient satisfaits. Et pourtant, je me souviens qu’il y avait dans l’air quelque chose de transitoire, comme si nous avions tous attendu le jour où nous pourrions nous installer ailleurs, et mieux.
Une maisonnette en bois avait survécu aussi bien aux ravages de la guerre qu’aux bulldozers du gouvernement. Je la voyais de ma fenêtre ; elle se dressait, isolée, au bout du terrain vague, presque au bord de la rivière. C’était une bicoque comme on en voit souvent à la campagne, couverte d’un toit de tuiles qui descendait presque jusqu’à terre. Souvent, dans mes moments de loisir, je me mettais à ma fenêtre et je la regardais.
À en juger par l’attention attirée par l’arrivée de Sachiko, je n’étais pas la seule à observer cette maisonnette. On parlait beaucoup de deux hommes qu’on avait vus travailler là un jour – étaient-ce des employés du gouvernement ou non ? Plus tard, on raconta qu’une femme et sa petite fille vivaient là-bas, et je les vis moi-même, à plusieurs reprises, traverser avec peine le terrain raviné.
On était au début de l’été, et j’atteignais mon troisième ou quatrième mois de grossesse, quand je vis pour la première fois une grosse voiture américaine, blanche et cabossée, cahoter sur le terrain vague, dans la direction de la rivière. Il était déjà tard dans la soirée, et le soleil qui se couchait derrière la maisonnette projeta un bref éclat de lumière sur le métal.
Un après-midi, j’entendis deux femmes bavarder à l’arrêt du tram ; elles parlaient de la femme qui avait emménagé dans la maison abandonnée, près de la rivière. L’une d’elles expliquait à sa compagne qu’ayant ce matin même adressé la parole à cette femme, elle s’était fait proprement rembarrer. L’autre reconnut que la nouvelle venue ne paraissait guère sociable – sans doute était-ce par fierté. Elle avait au moins trente ans, à leur avis, puisque l’enfant avait bien dix ans. La première femme ajouta que l’inconnue avait parlé dans le dialecte de Tokyo et n’était certainement pas de Nagasaki. Elles s’entretinrent pendant un moment de son « ami américain », puis la femme évoqua de nouveau l’attitude peu amicale que l’inconnue avait eue ce matin-là à son égard.
Je ne doute pas, maintenant, que parmi ces femmes avec qui je vivais à cette époque il y en avait qui avaient souffert, dont les souvenirs étaient tristes et effrayants. Mais à les voir jour après jour s’affairer autour de leurs maris et de leurs enfants, j’avais du mal à y croire, à penser que leurs vies avaient été habitées par les tragédies et les cauchemars de la guerre. Jamais je n’avais délibérément voulu paraître insociable, mais à vrai dire, sans doute ne faisais-je pas non plus d’efforts dans l’autre sens. À cette époque de ma vie, je désirais encore qu’on me laisse seule.
Mon attention fut donc attirée par ce que ces femmes disaient de Sachiko. Je me le rappelle avec beaucoup de netteté, ce moment passé à l’arrêt du tram, en cet après-midi. C’était un des premiers jours de grand soleil, après la saison pluvieuse de juin, et tout autour de nous séchaient des surfaces ruisselantes de brique et de béton. Nous attendions sur le pont du chemin de fer, et d’un côté des voies, au pied de la colline, on voyait un amas de toits, comme un éboulis de maisons qui auraient roulé jusqu’en bas de la pente. Un peu plus loin, au-delà des maisons, se dressaient nos immeubles, pareils à quatre piliers de béton. Sachiko m’inspira alors une sorte de sympathie, et j’eus le sentiment de comprendre un peu cette attitude distante qui m’avait frappée chez elle lorsque je l’avais observée de loin.
Nous devions devenir amies, cet été-là ; ne fût-ce que pour un moment, je me trouvai admise dans son intimité. Aujourd’hui, je ne sais plus bien comment se déroula notre première rencontre. Je me rappelle l’avoir aperçue un après-midi, loin devant moi, sur le chemin qui conduisait hors de l’ensemble d’habitations. Je me hâtai ; Sachiko, elle, marchait à un rythme régulier. Nous devions déjà, alors, nous appeler par notre nom, car je me rappelle l’avoir hélée en me rapprochant d’elle..."
Le roman se déroule en Angleterre, peu après la Seconde Guerre mondiale. La narratrice, Etsuko, est une femme japonaise d'âge mûr qui vit seule, veuve, après le suicide de sa fille aînée, Keiko. Sa deuxième fille, Niki, venue d'un deuxième mariage avec un Anglais, lui rend visite pour tenter de faire le deuil de cette demi-sœur qu'elle connaissait à peine.
Le récit est construit sur deux temporalités entrelacées :
- Le présent anglais : Les conversations entre Etsuko et Niki sont tendues, faites de silences et d'évitements. Etsuko semble incapable d'aborder frontalement la douleur de la mort de Keiko.
- Le passé japonais : En réponse à des déclencheurs subtils du présent, l'esprit d'Etsuko retourne à un été particulier à Nagasaki, quelques années après le bombardement atomique. Elle était alors jeune et enceinte de son premier mari, Jiro. Dans ce passé, elle se remémore sa relation ambigüe avec une autre femme, Sachiko, et sa jeune fille, Mariko.
- L'Histoire de Sachiko : Sachiko est une femme élégante et mystérieuse, qui vit isolée dans une cabane délabrée près d'un cours d'eau impur, symbole des séquelles de la guerre. Elle rêve de quitter le Japon pour suivre un amant américain, Frank, qu'elle décrit comme son sauveur. Elle néglige et effraie souvent sa fille Mariko, une enfant solitaire et perturbée qui voit peut-être le fantôme de sa tante morte et erre dans des zones dangereuses. Etsuko observe Sachiko avec un mélange de fascination et de reproche, intervenant parfois pour s'occuper de Mariko, mais restant globalement passive.
- Le Dénouement du Passé : L'été se termine par le départ de Sachiko et Mariko avec Frank. La dernière image qu'Etsuko donne de ce départ est troublante : Sachiko, forcée par Frank de voyager léger, abandonne brutalement les petits chiots adorés de Mariko en les noyant dans une rivière, sous les yeux horrifiés de l'enfant.
- Le Lien avec le Présent : Tout au long du récit, des échos entre le passé et le présent s'établissent. La relation toxique de Sachiko avec Mariko semble faire écho à la propre relation d'Etsuko avec Keiko. Etsuko a elle aussi "arraché" sa fille à son pays et à sa culture en l'emmenant en Angleterre, un acte qu'elle semble, rétrospectivement, associer à la mélancolie et au mal-être qui ont conduit Keiko au suicide.
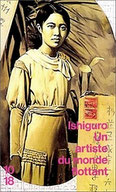
"Un artiste du monde flottant" ( An Artist of the Floating World, 1986)
Traduction française : Éditions des Deux Terres, 2003 (traduit par François Rosso) - U.G.E 10/18, Collection 10/18, Paris, 1990
Ce roman marque une évolution dans l'œuvre d'Ishiguro : le passé personnel du narrateur est inextricablement lié à l'Histoire collective. Il pose des questions universelles et troublantes : comment juger le passé avec les valeurs du présent ? Peut-on, et doit-on, vraiment tourner la page ? En gagnant le Whitbread Book of the Year Award, il a confirmé le talent immense d'Ishiguro pour explorer les zones d'ombre de l'âme humaine et de l'histoire...
"Octobre 1948 - Si, par une belle journée, vous gravissez le sentier qui part, en pente raide, du petit pont de bois que l’on continue d’appeler, par ici, « le Pont de l’Hésitation », bientôt, entre deux cimes de gingkos, vous apparaîtra le toit de ma maison. Quand elle n’occuperait pas cette position dominante sur la colline, elle se distinguerait néanmoins de toutes les autres maisons du voisinage ; aussi vous demanderez-vous peut-être, en approchant par le sentier, à qui, à quel homme riche connu, elle peut bien appartenir.
Or, je ne suis pas, je n’ai jamais été ce qu’on appelle un homme riche. Précisons donc que cette imposante demeure, ce n’est pas moi qui l’ai bâtie, mais mon prédécesseur en ces lieux, Akira Sugimura. Assurément, si vous êtes nouvellement installé dans cette ville, ce nom n’évoquera rien pour vous ; mais parlez d’Akira Sugimura à ceux qui vivaient ici avant la guerre : tout le monde vous répondra que durant quelque trente années, Sugimura fut l’un des plus respectés et des plus influents de nos concitoyens.
Cela dit, quand arrivant en haut de la côte, vous découvrirez le beau portail de cèdre, l’étendue de terrain qu’entourent les murs du jardin, le toit avec ses tuiles élégantes et son faîte joliment sculpté s’élevant en pointe au-dessus du paysage, il se peut que vous vous posiez une dernière question : comment j’ai pu acquérir une telle propriété, si je prétends ne disposer que de ressources modestes. La vérité est que je l’ai achetée à un prix qui, probablement, ne représentait même pas la moitié de sa valeur à l’époque ; cela, grâce à une procédure très curieuse – d’aucuns diraient même absurde – stipulée lors de la vente par la famille Sugimura.
C’est un épisode qui remonte déjà à une quinzaine d’années. En ce temps-là, où ma situation financière s’améliorait semblait-il de mois en mois, ma femme s’était mise à me presser de trouver une nouvelle maison. Avec sa prévoyance coutumière, elle insistait sur l’importance d’avoir une habitation en accord avec notre rang – non par vanité, certes, mais pour pouvoir un jour bien marier nos enfants. Sage pensée, j’en convenais ; mais comme Setsuko, notre aînée, n’avait que quatorze ou quinze ans, je ne mettais aucune hâte dans cette affaire. Toutefois, pendant un an environ, j’ai pris régulièrement des renseignements quand j’entendais parler d’une maison qui pût nous convenir. C’est un de mes élèves qui me fit remarquer que la maison d’Akira Sugimura, un an après sa mort, allait être mise en vente. Cette suggestion me sembla insensée, je l’attribuai au respect exagéré que mes élèves avaient toujours pour moi. Je me renseignai néanmoins, et ma démarche eut une suite inattendue.
Un après-midi, je reçus la visite de deux dames hautaines, aux cheveux gris. Apprenant qu’elles étaient les filles d’Akira Sugimura, je me dis surpris de recevoir une telle marque d’attention, de la part d’une si noble famille. À quoi la plus âgée des deux sœurs répondit d’une voix dure qu’elles n’étaient pas venues simplement par politesse. Au cours des mois précédents, de nombreuses demandes leur étaient parvenues, concernant la maison de feu leur père ; mais la famille avait finalement décidé de les rejeter toutes sauf quatre, au terme d’une sélection méticuleuse dont les seuls critères avaient été la réputation et les œuvres des personnes considérées.
« L’important, pour nous, continua-t-elle, est que le futur propriétaire de cette demeure, construite par notre père, soit un homme qu’il aurait estimé, qu’il aurait jugé digne d’elle. Assurément, les circonstances nous obligent à tenir compte de l’aspect financier, mais c’est strictement secondaire. Nous avons donc fixé un prix. »
À ce point, la jeune sœur, qui avait à peine parlé, me tendit une enveloppe, que j’ouvris sous leur regard sévère, et qui ne contenait qu’une simple feuille de papier, avec un chiffre, tracé d’une écriture élégante, au pinceau. J’allais exprimer mon profond étonnement devant la modicité du prix, mais je vis, en relevant les yeux vers mes visiteuses, que toute allusion de ma part à la question de l’argent serait considérée comme très déplaisante. L’aînée dit simplement : « Il n’est dans l’intérêt d’aucun de vous de tenter d’enchérir sur l’autre. Nous-mêmes ne sommes pas intéressées par ce que nous pourrions obtenir au-delà de ce prix. Les enchères auxquelles nous vous convions, à partir de maintenant, sont en quelque sorte des enchères de prestige. »
Si elles s’étaient déplacées elles-mêmes, m’expliqua-t-elle, c’était pour me demander, au nom de la famille Sugimura, de les autoriser à examiner de plus près ma carrière, mes antécédents et mes références ; il en serait de même, bien sûr, pour les trois autres postulants ; et le choix s’arrêterait sur le plus digne.
Le procédé était original, mais, à mes yeux, il n’avait rien d’inadmissible : ne se soumet-on pas aux mêmes conditions quand on négocie en vue d’un mariage ? Au fond, j’étais même flatté d’avoir retenu l’attention de cette famille ancienne et très fermée. Comme je donnais mon accord et leur faisais part de ma gratitude, la plus jeune, pour la première fois, m’adressa la parole : « Notre père était un homme cultivé, monsieur. Il avait un grand respect pour les artistes. Et il connaissait votre œuvre. »
Je cherchai moi-même à me renseigner, dans les jours qui suivirent, et je découvris que la jeune sœur avait dit la vérité : Akira Sugimura avait effectivement été un fervent amateur d’art, il avait à maintes reprises financé des expositions. J’appris également (s’il fallait en croire la rumeur) qu’une partie importante de la famille Sugimura s’était opposée à la vente de la demeure, ce qui avait occasionné d’âpres discussions. Des considérations financières rendant malgré tout cette vente inévitable, l’ensemble de la famille était finalement arrivé à un compromis, dont résultaient les étranges modalités de l’opération. Ce que celles-ci avaient d’impérieux, d’arrogant même, était indéniable. Pour ma part, j’étais prêt à comprendre les sentiments d’une maison aussi illustre ; mais ma femme prit très mal cette idée d’enquête.
« Qu’est-ce qu’ils se croient ? protesta-t-elle. Il faudrait leur dire que nous ne voulons plus rien avoir à faire avec eux..."
Le roman se déroule dans une ville japonaise (largement inspirée de Nagasaki) entre octobre 1948 et juin 1950, une période cruciale de l'occupation américaine et de la reconstruction du Japon après sa défaite. L'histoire est racontée à la première personne par Masuji Ono, un peintre âgé et veuf. Ancien artiste renommé, il mène une vie paisible, s'occupant de son modeste jardin et de ses deux filles adultes. La trame narrative est déclenchée par les négociations matrimoniales pour sa plus jeune fille, Noriko. Un premier mariage a échoué l'année précédente pour des raisons obscures, et la famille craint que l'histoire et les affiliations passées d'Ono ne fassent à nouveau obstacle.
Le récit est une enquête mémoire menée par Ono lui-même. Sous couvert de vouloir aider les négociations en clarifiant son passé, il revisite les différentes étapes de sa vie :
- Son apprentissage dans l'atelier du maître Mori-san, où il excellait à produire de délicates peintures du "monde flottant" (ukiyo-e), c'est-à-dire des scènes de plaisirs éphémères (bars, geishas, soirées).
- Sa rupture avec ce maître, qu'il jugeait trop complaisant et déconnecté des réalités du monde, pour rejoindre un mouvement artistique plus "engagé".
- Son ascension en tant qu'artiste patriote, produisant des affiches de propagande nationaliste qui exaltent l'impérialisme japonais et appellent au sacrifice pour l'empereur.
- Le Conflit : Au fil de ses souvenirs, il devient évident que le passé d'Ono est une source de tension. D'anciens collègues et élèves ont soit renié leurs œuvres, soit disparu pendant la guerre. Ono lui-même est confronté à son petit-fils, qui le répudie en adoptant la culture américaine (cow-boys, baseball), et à son ancien élève Kuroda, qui a été emprisonné et torturé pour ses idées et qui refuse catégoriquement de revoir son ancien maître.
- Le Dénouement : Les négociations pour Noriko finissent par aboutir, laissant supposer que le passé d'Ono n'est finalement pas un obstacle insurmontable dans la nouvelle société japonaise. Le roman se conclut sur une note ambivalente : Ono observe son quartier reconstruit, peuplé de nouvelles générations tournées vers l'avenir. Il exprime un espoir mitigé, se consolant en pensant qu'il a au moins vécu sa vie avec ambition et conviction, même si celles-ci se sont fourvoyées.
" ... Hier, donc, je suis allé à Arakawa. La vive lumière du soleil d’automne entrait à flots dans le tramway. Je n’avais plus fait ce trajet depuis un petit moment – depuis la fin de la guerre en fait – et, en regardant par la vitre, j’ai remarqué que beaucoup de choses avaient changé dans le paysage. Les petites maisons de bois devant lesquelles on passait en traversant les quartiers de Tozaka-cho et Sakaemachi, étaient bien toujours là, mais maintenant elles étaient dominées par de sinistres immeubles de briques. Et à Minamimachi, j’ai constaté que beaucoup d’usines étaient abandonnées ; dans leurs cours (la ligne longe l’arrière de ces usines) ce n’étaient qu’amoncellements désordonnés de poutres brisées, de tôles ondulées rouillées, ou même, apparemment, de gravats.
Mais ensuite, quand le tram débouche du pont de la THK, de l’autre côté du fleuve, on pénètre dans un tout autre univers. On passe entre des champs et des arbres, et bientôt Arakawa apparait, au bas de la longue descente raide qui aboutit au terminus. Le tram descend très lentement dans le crissement des freins et enfin s’arrête, et quand on met le pied sur ces trottoirs bien balayés, on a vraiment l’impression d’avoir quitté la ville, d’être ailleurs.
Arakawa, à ce qu’on m’a dit, a été entièrement épargné par les bombardements ; de fait, j’ai été frappé de découvrir hier que ce quartier a toujours le même air. Une petite côte, ombragée de cerisiers, m’a amené devant la demeure de Chishu Matsuda qui, elle non plus, n’a pas du tout changé.
La maison de Matsuda – moins grande et moins originale que la mienne – est une de ces maisons respectables, solides, typiques d’Arakawa. Avec son parc ceint d’une palissade, elle tient à distance les autres propriétés ; l’entrée est ornée d’un buisson d’azalées, avec, à côté, un gros pieu planté en terre où est inscrit le nom de la famille. J’ai tiré la sonnette ; une femme d’environ quarante ans, que je ne reconnaissais pas, est apparue. Elle m’a introduit dans la salle de réception, où elle a ouvert le panneau coulissant donnant sur la véranda pour faire entrer le soleil, et me permettre de voir un bout du jardin. Puis elle s’est retirée en disant : « M. Matsuda sera ici dans un instant. »
J’ai fait la connaissance de Matsuda alors que j’habitais dans la villa de Seiji Moriyama, où « la Tortue » et moi nous étions installés en quittant la maison Takeda. Cela faisait peut-être six ans que je vivais dans cette villa, la première fois que Matsuda y est venu. Ce jour-là, il avait plu toute la matinée ; nous l’avions passée, plusieurs collègues et moi-même, à boire et à jouer aux cartes dans une des pièces. Peu après le déjeuner, alors que nous venions d’ouvrir une autre grande bouteille, une voix inconnue retentit soudain dans la cour.
C’était une voix forte, assurée ; nous nous tûmes et nous nous regardâmes, pris de panique. Car tous, nous avions aussitôt pensé la même chose : que la police était venue nous réprimander. Idée tout à fait irrationnelle, bien sûr, puisque nous n’avions commis aucun délit. Et d’ailleurs, n’importe lequel d’entre nous aurait défendu avec ardeur notre style de vie, s’il s’était trouvé attaqué sur ce sujet – au cours d’une conversation de bar par exemple. Mais cette voix ferme qui criait : « Il y a quelqu’un ? » nous avait pris au dépourvu, révélant le sentiment de culpabilité que nous procuraient nos beuveries nocturnes, nos grasses matinées, notre existence sans règles dans cette villa qui se délabrait.
Ce fut donc au bout d’un certain temps qu’un de mes compagnons – celui qui se trouvait le plus près du panneau mobile – l’ouvrit, échangea quelques paroles avec l’inconnu, puis se retourna et dit : « Ono, un monsieur désire te parler. »
Je sortis dans la véranda ; un jeune homme au visage maigre, ayant à peu près mon âge, se tenait au milieu de la grande cour carrée. J’ai gardé une image très nette de cette première fois où j’ai vu Matsuda. La pluie avait cessé, et le soleil était apparu. Tout autour du visiteur brillaient des flaques d’eau, et le sol était jonché de feuilles mouillées, tombées des cèdres qui s’élevaient devant la villa. Il avait une mise trop recherchée pour un policier ; son pardessus, au col haut relevé, était d’une coupe très chic, et la position du chapeau, incliné au-dessus des yeux, suggérait une intention moqueuse. Il regardait autour de lui avec intérêt, et aussi avec un je ne sais quoi dans son attitude qui me révéla dès le premier coup d’œil le côté arrogant de sa nature. M’ayant vu, il s’approcha sans se presser de la véranda.
« Monsieur Ono ? »
Je lui demandai ce que je pouvais faire pour lui. Il jeta un nouveau coup d’œil au parc, puis me regarda en souriant :
« Intéressant comme endroit. Ce devait être une demeure splendide autrefois – appartenant à quelque seigneur.
— En effet.
— Monsieur, je m’appelle Chishu Matsuda. Nous avons échangé quelques lettres, vous souvenez-vous ? Je travaille chez Okada-Shingen. »
La société Okada-Shingen n’existe plus aujourd’hui – victime, parmi tant d’autres, des forces d’occupation – ; mais vous avez sûrement entendu parler d’elle, ou du moins de l’exposition annuelle qu’elle organisait jusqu’à la veille de la guerre. Pendant un certain temps, cette exposition représenta le principal moyen, pour les jeunes talents en peinture et en gravure, de se faire connaître du public ; et elle acquit une telle renommée que les peintres les plus en vue de la ville se mirent eux aussi à y participer. C’était à propos de cette exposition que Matsuda m’avait écrit, quelques semaines avant sa visite.
« Votre réponse a piqué ma curiosité, monsieur, dit Matsuda, et j’ai cru bon de passer ici voir ce qu’il en était exactement. »
Je lui adressai un regard distant. « Il me semble, dis-je, que j’ai tout précisé dans ma lettre de réponse. J’ai été très touché, bien sûr, par vos aimables propositions. »
Il sourit des yeux. « Je crains, monsieur, dit-il, que vous ne renonciez à une occasion très sérieuse d’accroître votre réputation. Aussi dites-moi, je vous prie : quand vous déclarez que vous ne voulez rien avoir à faire avec nous, exprimez-vous votre opinion personnelle, ou ce que votre maître a décrété ?
— Sur un tel sujet, j’ai évidemment consulté mon maître. Et je suis persuadé que la décision dont je vous ai fait part dans ma dernière lettre est la bonne. C’est très aimable à vous d’être venu jusqu’ici ; malheureusement, je suis occupé en ce moment, et ne puis vous prier d’entrer. Permettez-moi donc de vous souhaiter une bonne journée.
— Un instant s’il vous plaît, monsieur. » Le sourire de Matsuda se faisait de plus en plus moqueur. Il fit encore quelques pas, s’arrêtant juste devant la véranda, et leva les yeux vers moi. « Ce qui me préoccupe, pour être sincère, ce n’est pas l’exposition – il y a tant d’autres artistes qui méritent d’y participer. Non, si je suis venu ici, monsieur, c’est parce que je désirais vous connaître.
— Vraiment ? Vous êtes trop aimable.
— Je suis sérieux. Je voulais vous dire que ce que j’ai vu de vos œuvres m’a fait une excellente impression. Je pense que vous avez beaucoup de talent..."
Le Narrateur, Masuji Ono, est un maître de l'auto-persuasion et du déni. Il ne nie pas son passé, mais le réinterprète constamment pour minimiser sa responsabilité. Il se présente comme un artiste qui a toujours agi selon ses convictions, sans jamais admettre pleinement avoir été un instrument de la machine de guerre. Le vrai récit se construit dans les interstices de son témoignage, dans les réactions de gêne de ses filles, dans le silence gêné de ses interlocuteurs. Le lecteur comprend que l'ampleur de sa culpabilité est bien plus grande qu'il ne veut l'admettre.
Le "Monde Flottant" : la Métaphore Centrale. À l'origine, il désigne le milieu des plaisirs nocturnes et éphémères que peignait le jeune Ono, puis devient la métaphore de toute une société et de ses valeurs. L'ancien Japon, avec son nationalisme exacerbé et ses certitudes, était un "monde flottant" – un monde illusoire, vain et éphémère qui s'est effondré avec la défaite. Les convictions les plus fermes se sont révélées être des illusions dangereuses.
Le Conflit des Générations et la Responsabilité Collective est le cœur du roman. Ishiguro explore avec finesse comment une société entière traite un passé honteux. La génération d'Ono est en effet tiraillée entre la honte, le déni et la nostalgie. La génération de ses filles (Setsuko, l'aînée, pragmatique) veut tourner la page et s'adapter aux nouvelles règles pour survivre. La génération de son petit-fils (Ichiro) ignore complètement le passé et est déjà culturellement assimilée par le vainqueur américain.
Un artiste porte-t-il une responsabilité dans l'usage politique qui est fait de son art ? Ono affirme que ses intentions étaient pures, mais le roman suggère fortement que l'artiste ne peut se soustraire à sa responsabilité sociale ...
La ville en reconstruction est le reflet de l'état d'esprit des personnages. Les nouveaux bâtiments modernes, souvent laids, cachent les cicatrices des bombardements et symbolisent le rejet brutal de l'ancien monde. Les personnages errent parmi ces ruines physiques et morales, cherchant leur place dans un nouveau monde qui ne leur est pas familier.
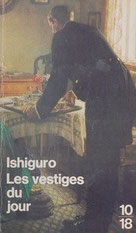
"Les Vestiges du jour" ( The Remains of the Day, 1989)
Traduction française : Éditions de la Table Ronde, 1990 (traduit par François Rosso) - Gallimard, Collection Folio, Paris, 2010 - Booker Prize 1989. Adapté au cinéma par James Ivory en 1993. Le titre, "The Remains of the Day", est magnifiquement ambigu : il désigne à la fois les "restes" de la journée (le temps qu'il reste à Stevens) et les "vestiges" d'une époque révolue. Comment vivre avec dignité lorsque l'on réalise que l'on a consacré sa vie à une illusion ? Ishiguro pousse à son apogée sa technique du non-dit et de la narration filtrée. C'est une méditation universelle et poignante sur les choix de vie, les regrets, et le temps perdu. Stevens est un personnage à la fois exasperant par son aveuglement et profondément touchant par sa vulnérabilité cachée. Son histoire est un avertissement contre le danger de vivre sa vie selon des codes abstraits au détriment de sa propre humanité...
"PROLOGUE : JUILLET 1956 - Darlington Hall - Il semble de plus en plus probable que je vais réellement entreprendre l’expédition qui tient depuis quelques jours une place importante dans mon imagination. Une expédition, je dois le préciser, que j’entreprendrai seul, dans le confort de la Ford de Mr. Farraday ; une expédition qui, telle que je l’envisage, me conduira à travers une des plus belles campagnes d’Angleterre jusqu’au West Country, et pourrait bien me tenir éloigné de Darlington Hall pendant cinq ou six jours. L’idée de ce voyage, je dois le souligner, est née d’une suggestion fort aimable émise à mon intention par Mr. Farraday lui-même voici presque quinze jours, tandis que j’époussetais les portraits dans la bibliothèque. En fait, si je me souviens bien, j’époussetais, monté sur l’escabeau, le portrait du vicomte Wetherby lorsque mon employeur entra, chargé de quelques volumes dont il désirait sans doute qu’on les remît en rayon. Remarquant ma présence, il profita de cette occasion pour m’informer qu’il venait précisément de parachever le projet de retourner aux États-Unis pour une période de cinq semaines, entre août et septembre. Cela annoncé, mon employeur posa ses volumes sur une table, s’assit sur la chaise longue et allongea les jambes. Ce fut alors que, levant les yeux vers moi, il déclara : « Vous vous doutez, Stevens, que je ne vous demande pas de rester enfermé dans cette maison pendant toute la durée de mon absence. Si vous preniez la voiture pour aller vous balader pendant quelques jours ? À en juger par votre mine, un petit congé ne vous ferait pas de mal. »
Devant une proposition aussi imprévue, je ne savais trop comment réagir. Je me rappelle l’avoir remercié de sa sollicitude, mais sans doute ne dis-je rien de très précis car mon employeur poursuivit :
« Je parle sérieusement, Stevens. Vous devriez vraiment prendre un petit congé. Je paierai la note d’essence. Vous autres, vous passez votre vie enfermés dans ces grandes maisons à vous rendre utiles, et quand est-ce que vous arrivez à voir ce beau pays qui est le vôtre ? »
Ce n’était pas la première fois que mon employeur soulevait cette question ; en fait, il semble sincèrement préoccupé par ce problème. Ce jour, cependant, il me vint une sorte de repartie tandis que j’étais juché là-haut sur l’escabeau ; repartie visant à souligner que dans notre profession, si nous ne voyons pas à proprement parler le pays en sillonnant la campagne et en visitant des sites pittoresques, nous « voyons » en fait une part d’Angleterre plus grande que bien des gens, placés comme nous le sommes dans des demeures où se rassemblent les personnes les plus importantes du pays. Certes, je ne pouvais exprimer ce point de vue à l’intention de Mr. Farraday sans me lancer dans un discours qui aurait pu paraître présomptueux. Je me contentai donc de dire simplement :
« J’ai eu le privilège, monsieur, de voir entre ces mêmes murs, au fil des années, ce que l’Angleterre a de meilleur. »
Mr. Farraday ne sembla pas comprendre cette remarque, car il continua sur sa lancée : « J’insiste, Stevens. Ce n’est pas bien qu’un gars ne puisse pas visiter son propre pays. Suivez mon conseil, sortez de la maison pendant quelques jours. »
Comme vous pouvez vous en douter, je ne pris pas du tout au sérieux, cet après-midi-là, la suggestion de Mr. Farraday, qui me parut être un nouvel exemple de méconnaissance des coutumes anglaises de la part d’un Américain. Si mon attitude à l’égard de cette même suggestion évolua dans les jours suivants au point que l’idée d’un voyage dans le West Country prit dans mon esprit une place prépondérante, ce changement est en grande partie imputable – pourquoi le cacherais-je ? – à l’arrivée de la lettre de Miss Kenton, la première en presque sept ans si l’on ne tient pas compte des cartes de Noël. Mais il faut que je précise ce que j’entends par là ; ce que je veux dire, c’est que la lettre de Miss Kenton mit en train un enchaînement d’idées à caractère professionnel, liées à la gestion de Darlington Hall, et je tiens à souligner que ce fut le souci que j’avais de ces problèmes professionnels qui me fit envisager à nouveau l’aimable suggestion de mon employeur. Mais permettez-moi de m’expliquer plus avant.
À la vérité, au cours des quelques mois précédents, j’ai été responsable d’une série de petites erreurs dans l’accomplissement de mes tâches. Il convient que je le précise, ces erreurs, sans exception, étaient en elles-mêmes tout à fait anodines. Cependant, et je pense que vous le comprendrez, pour quelqu’un qui n’a pas l’habitude de commettre de telles erreurs, c’était là une nouveauté plutôt troublante, et je me mis à élaborer toutes sortes de théories alarmistes quant à leur cause. Comme c’est souvent le cas dans ce genre de situation, l’évidence m’aveuglait – jusqu’au jour, du moins, où à force de méditer les implications de la lettre de Miss Kenton, la vérité toute simple m’apparut : ces petites erreurs des mois récents ne provenaient de rien de plus sinistre qu’un plan de travail défaillant.
Bien entendu, il incombe à tout majordome d’apporter le plus grand soin à la mise au point d’un plan de travail pour le personnel. Qui peut dire combien de disputes, de fausses accusations, de congédiements inutiles, combien de carrières prometteuses interrompues prématurément peuvent être attribués à la négligence d’un majordome lors de cette tâche cruciale : l’élaboration du plan de travail ? Oui, je n’hésite pas à me dire en accord avec ceux qui affirment que la capacité de dresser un bon plan de travail est la pierre angulaire de l’art d’un bon majordome. J’ai moi-même réalisé bien des plans de travail au fil des années, et je ne crois pas faire preuve de vantardise en disant qu’il fut rarement nécessaire de les rectifier. Et si, dans le cas présent, le plan de travail est à incriminer, on ne peut en tenir rigueur à personne, si ce n’est à moi-même. En même temps, il est juste de préciser que la tâche, en l’occurrence, était particulièrement délicate.
Voici ce qui s’était produit..."
L'histoire se déroule en Angleterre en 1956, dans une période de changement social profond. L'aristocratie britannique décline, et les grandes demeures peinent à fonctionner. Le récit est conduit par Stevens, majordome vieillissant et dévoué de Darlington Hall. Après des décennies de service auprès du défunt Lord Darlington, la propriété a été rachetée par un riche Américain, Mr. Faraday, qui encourage Stevens à prendre quelques jours de congé.
Stevens entreprend un road trip à travers la campagne anglaise pour rendre visite à Miss Kenton (devenue Mrs. Benn), l'ancienne gouvernante de la maison. Officiellement, il souhaite la recruter à nouveau, car elle a quitté son poste des années auparavant après un désaccord. Mais le voyage devient rapidement un pèlerinage intérieur.
Le récit avance sur deux plans temporels entrelacés :
- Le présent (1956) : Le périple de Stevens, ponctué de ses observations souvent comiques de malentendus sur la "dignité" américaine de son nouveau patron et sur la vie moderne.
- Le passé (les années 1920-30) : Par le biais de ses souvenirs, Stevens revit l'âge d'or de Darlington Hall, alors que Lord Darlington, un aristocrate idéaliste, y organisait des conférences internationales secrètes réunissant diplomates allemands et britanniques dans l'espoir d'éviter une nouvelle guerre. C'est aussi à cette époque qu'il a travaillé aux côtés de Miss Kenton.
- La Relation avec Miss Kenton : Les souvenirs de Stevens se concentrent de plus en plus sur ses échanges professionnels, puis personnels, avec Miss Kenton. Leurs conversations, d'une formalité extrême, sont en réalité chargées d'une tension émotionnelle non dite. Ils se livrent à une danse subtile de reproches, de fiertés blessées et d'attirance évidente que Stevens refuse obstinément de reconnaître, se cachant derrière son devoir et sa "dignité".
- La Faillite de Lord Darlington : Au fil des souvenirs, il apparaît que Lord Darlington, manipulé par des nazis, est devenu un sympathisant de l'Allemagne et un ardent défenseur de la politique d'apaisement. Après la guerre, il a été discrédité et est mort dans la honte. Stevens, en bon serviteur, a obéi à toutes ses instructions, même lorsqu'il s'agissait de renvoyer deux employées juives.
- Le Dénouement : Stevens retrouve finalement Miss Kenton. Elle lui avoue que son mariage n'est pas des plus heureux et qu'elle a souvent repensé à la vie qu'ils auraient pu avoir ensemble. Cependant, elle reconnaît que c'est trop tard et qu'elle doit maintenant assumer ses responsabilités familiales. Stevens, le cœur brisé mais incapable d'exprimer ses sentiments, fait mine de n'être venu que pour des raisons professionnelles. Sur le chemin du retour, lors d'une conversation avec un inconnu, il admet avoir gaspillé sa vie au service d'un homme qui avait tort. Il conclut qu'il doit maintenant apprendre à "plaisanter", c'est-à-dire à vivre pour lui-même pour la première fois, pour les "vestiges du jour" – le temps qu'il lui reste.
".. À mesure que cette date s’approchait, les contraintes dont j’étais l’objet, si elles restaient d’une nature plus humble que celles auxquelles Sa Seigneurie faisait face, étaient cependant loin d’être négligeables. Je n’avais que trop conscience de ce qui pouvait se passer si l’un des invités trouvait à redire au confort de son séjour à Darlington Hall : cela risquait d’avoir des conséquences incalculables. De plus, l’organisation de cette réunion était compliquée par l’incapacité où l’on se trouvait de savoir combien de personnes se déplaceraient. Étant donné le niveau très élevé du rassemblement, le nombre de ses participants avait été limité à dix-huit messieurs des plus distingués, et deux dames : une comtesse allemande et la redoutable Mrs. Eleanor Austin, qui, à l’époque, résidait encore à Berlin. Mais chaque participant pouvait fort bien venir accompagné de secrétaires, de domestiques, d’interprètes, et il n’y avait en vérité aucun moyen de s’assurer du nombre de personnes de ce genre sur lequel on pouvait tabler. De surcroît, on apprit que certains des assistants arriveraient un peu avant le début de la période de trois jours fixée pour la conférence, se donnant ainsi le temps de préparer le terrain et de sonder les autres participants ; mais là aussi, leurs dates d’arrivée exactes étaient incertaines. Il était donc évident que tout en ayant à travailler très dur, et à se montrer particulièrement alerte, le personnel devrait également faire preuve d’une souplesse sortant de l’ordinaire. En fait, je jugeai pendant quelque temps que ce défi colossal ne pourrait être relevé sans faire venir de l’extérieur du personnel supplémentaire. Mais cette solution, sans parler des doutes que Sa Seigneurie se devait d’éprouver en songeant aux risques de bavardages, me forçait à compter sur des éléments inconnus au moment même où la moindre erreur pouvait s’avérer funeste. J’entrepris donc de préparer les jours à venir à la façon dont un général, j’imagine, se prépare à une bataille : j’élaborai avec un soin extrême un plan de travail spécial tenant compte de toutes sortes d’éventualités ; j’analysai nos maillons faibles et préparai des plans d’urgence auxquels on pourrait recourir au cas où ces maillons lâcheraient ; je prononçai même à l’intention du personnel une allocution mobilisante inspirée par les usages militaires, où je soulignai que, même si des cadences épuisantes allaient leur être imposées, ils seraient en droit, au cours des jours qui allaient suivre, d’éprouver une grande fierté dans l’accomplissement de leurs tâches. « Il est fort possible que l’Histoire se fasse sous ce toit », leur déclarai-je. Quant à eux, sachant que je n’étais pas enclin à l’exagération, ils comprirent fort bien qu’un événement extraordinaire était sur le point de se produire.
Vous comprendrez mieux ainsi le climat qui régnait à Darlington Hall lors de la chute de mon père devant la gloriette, chute survenue à peine deux semaines avant que fussent attendus les premiers invités à la conférence, et vous pourrez saisir ce qui me fait dire que nous n’avions guère le loisir de « tourner autour du pot ». Mon père, en tout cas, découvrit rapidement un moyen de tourner la limite qui avait été imposée à ses activités par l’interdiction de porter des plateaux chargés. On s’habitua dans la maison à le voir pousser une table roulante chargée de lavettes, de balayettes, d’ustensiles de ménage disposés de façon incongrue, mais toujours soignée, autour de théières, de tasses et de soucoupes, de sorte qu’on aurait parfois dit la carriole d’un colporteur. Évidemment, il ne pouvait pour autant éviter de renoncer au service à la salle à manger, mais à cela près, la table roulante lui permettait d’abattre une besogne étonnante. En fait, à mesure que le grand défi de la conférence se rapprochait, il sembla être l’objet d’un changement stupéfiant. On aurait presque cru qu’une force surnaturelle s’emparait de lui, le rajeunissant de vingt ans ; son visage perdit l’air hagard de la dernière période, et il s’acquittait de ses tâches avec une vigueur si juvénile qu’un étranger aurait pu croire à la présence de plusieurs personnages similaires poussant des tables roulantes dans les couloirs de Darlington Hall.
Quant à Miss Kenton, je crois me rappeler que la tension croissante de cette période lui faisait un effet visible. Je me rappelle, par exemple, la fois où je la rencontrai par hasard dans le couloir de service. Le couloir de service, qui, à Darlington Hall, sert d’axe vital aux communs, a toujours été un lieu assez triste en raison de l’absence d’éclairage naturel sur toute son importante longueur. Même par une journée ensoleillée, ce couloir était parfois si sombre qu’on avait l’impression de longer un tunnel. Ce jour-là, si je n’avais pas reconnu les pas de Miss Kenton sur le plancher tandis qu’elle venait vers moi, il aurait fallu que j’examine ses contours pour pouvoir l’identifier. Je m’arrêtai à un des rares endroits où une bande lumineuse traversait le sol et dis tandis qu’elle se rapprochait : « Ah, Miss Kenton.
— Oui, Mr. Stevens ?
— Miss Kenton, puis-je me permettre d’attirer votre attention sur le fait que la literie des chambres du dernier étage devra être prête dès après-demain ?
— La situation sur ce point est parfaitement en ordre, Mr. Stevens.
— Ah, vous m’en voyez ravi. Cela m’avait simplement traversé l’esprit, voilà tout. »
J’allais continuer mon chemin, mais Miss Kenton ne bougeait pas. Elle fit enfin un pas vers moi, de sorte qu’un rayon de lumière tomba sur son visage et que je pus voir son expression de colère.
« Malheureusement, Mr. Stevens, je suis extrêmement occupée en ce moment, et je constate que j’ai du mal à trouver un instant de liberté. Si seulement je bénéficiais d’autant de temps libre que vous semblez en avoir, je me ferais un plaisir de vous rendre la pareille en me promenant dans cette maison pour vous rappeler des obligations que vous avez parfaitement en main.
— Enfin, Miss Kenton, il n’y a pas de raison de s’emporter ainsi. J’éprouvais simplement le besoin de m’assurer que vous étiez pleinement consciente de…
— Mr. Stevens, c’est la quatrième ou la cinquième fois depuis deux jours que vous avez éprouvé ce besoin. Il est vraiment curieux de voir que vous avez assez de temps à perdre pour pouvoir rôder dans cette maison en infligeant aux autres vos réflexions sans fondement.
— Miss Kenton, si vous croyez, ne serait-ce qu’un instant, que j’ai du temps à perdre, cela montre de façon plus flagrante que jamais votre grande inexpérience. Je veux croire qu’au cours des années à venir, vous acquerrez une vision plus claire de ce qui se passe dans une maison comme celle-ci.
— Vous parlez sans cesse de ma « grande inexpérience », Mr. Stevens, et vous semblez pourtant tout à fait incapable de me signaler le moindre défaut dans mon travail. Dans le cas contraire, je ne doute pas que vous l’auriez fait il y a longtemps et de façon détaillée. Et maintenant, j’ai beaucoup à faire, et j’apprécierais de ne pas vous voir ainsi me suivre et m’interrompre à tout bout de champ. Si vous avez tellement de temps libre, je pense que vous le passeriez avantageusement à prendre l’air. »
Avançant à furieuses enjambées, elle me dépassa et fila jusqu’au bout du couloir. Estimant qu’il valait mieux ne pas insister, je poursuivis mon chemin. J’avais presque atteint la porte de la cuisine lorsque j’entendis le bruit de ses pas coléreux qui revenaient vers moi.
« En fait, Mr. Stevens, lança-t-elle, je vous prie dorénavant de ne plus m’adresser directement la parole.
— Miss Kenton, qu’est-ce que vous racontez là ?
— S’il est nécessaire de transmettre un message, je vous demanderai de le faire par l’intermédiaire d’un messager. À moins que vous ne préfériez écrire un mot et me le faire remettre. Notre relation de travail, j’en suis convaincue, serait considérablement facilitée.
— Miss Kenton…
— Je suis extrêmement occupée, Mr. Stevens. Un billet écrit si le message présente la moindre complication. Sinon, vous voudrez peut-être vous adresser à Martha, ou à Dorothy, ou à un membre du personnel masculin à qui vous ferez suffisamment confiance. Je dois maintenant retourner à mon travail ; je vous laisse à votre promenade. »
Tout irritante que fût la conduite de Miss Kenton, je ne pus me permettre de beaucoup y réfléchir, car les premiers invités venaient d’arriver. Les délégués de l’étranger n’étaient pas attendus avant deux ou trois jours, mais les trois messieurs que Sa Seigneurie appelait « mon équipe locale » – deux membres du ministère des Affaires étrangères qui assistaient à la conférence de façon tout à fait secrète, et Sir David Cardinal – étaient venus tôt pour préparer le terrain de façon aussi approfondie que possible. Comme d’habitude, on n’essayait guère de me cacher quoi que ce fût, tandis que je circulais dans la maison, entrant parfois dans les différentes pièces où ces messieurs étaient en grande discussion, de sorte que je ne pouvais éviter d’avoir une certaine idée du climat général à ce stade des délibérations. Bien entendu, Sa Seigneurie et ses collègues avaient le souci d’échanger les informations les plus précises possibles sur tous les participants ; mais ils étaient tous essentiellement préoccupés par le même personnage, M. Dupont, le Français, se demandant quelle position il était susceptible de prendre. Je crois même qu’une fois, en entrant dans le fumoir, j’entendis un des messieurs dire : « Peut-être le sort de l’Europe est-il suspendu à notre capacité de convaincre Dupont sur ce point. »
Ce fut pendant ces discussions préliminaires que Sa Seigneurie me confia une mission assez inhabituelle pour qu’elle soit restée gravée dans mes souvenirs jusqu’à aujourd’hui, à côté des événements d’un caractère plus marquant qui allaient se produire au cours de cette semaine exceptionnelle. Lord Darlington me convoqua dans son bureau, et je vis tout de suite qu’il était passablement agité. Il s’installa à sa table de travail, et eut recours à son stratagème habituel, ouvrant un livre – il s’agissait cette fois-là du Who’s who – et manipulant une de ses pages.
« Oh, Stevens », commença-t-il, l’air faussement nonchalant ; mais il sembla alors ne plus savoir comment continuer. Je restai immobile, prêt à le délivrer de sa gêne à la première occasion. Sa Seigneurie continua un instant à triturer sa page, se pencha pour examiner un article, et dit enfin :
« Stevens, je me rends bien compte que ce que je vous demande n’est pas très régulier.
— Monsieur ?
— Mais c’est qu’en ce moment, on est préoccupé par des questions si importantes…
— Je serais très heureux de pouvoir me rendre utile, monsieur.
— Je regrette de soulever un problème pareil, Stevens. Je sais que de votre côté, vous devez être terriblement occupé. Mais je ne vois pas comment je pourrais éluder la chose. »
J’attendis un instant pendant que Lord Darlington s’intéressait de nouveau au Who’s who. Il dit enfin, sans lever les yeux : « Vous êtes au courant, je suppose, des réalités de la vie.
— Monsieur ?
— Les réalités de la vie, Stevens. Les oiseaux, les abeilles. Vous êtes au courant, n’est-ce pas ?
— Je crains de ne pas bien vous suivre, monsieur.
— Je vais mettre cartes sur table, Stevens. Sir David est un très vieil ami. Et il a joué un rôle extrêmement précieux dans l’organisation de la présente conférence. Sans lui, je crois pouvoir l’affirmer, nous n’aurions pas obtenu la participation de M. Dupont..."
C'est le chef-d'œuvre absolu d'Ishiguro dans ce domaine. La voix de Stevens est un outil narratif génial. Son récit est extrêmement formel et contrôlé, sa langue est celle du serviteur parfait, empesée, évitant soigneusement toute émotion directe. Le génie d'Ishiguro est de faire passer l'émotion non par ce que Stevens dit, mais par ce qu'il ne dit pas, ce qu'il élude, ou ce qu'il justifie de manière maladroite. Le lecteur comprend la tragédie et la romance manquée bien avant que Stevens ne daigne l'effleurer.
La quête de Stevens est de définir la "dignité" d'un grand majordome. Pour lui, elle réside dans une abnégation totale, une éradication de son individualité et de ses sentiments au profit de son maître. Ce concept devient une forme d'aliénation suprême. Il sacrifie son amour pour Miss Kenton sur l'autel de cette "dignité". Il sacrifie son jugement moral en servant un maître dont il pressent pourtant les erreurs, se convainquant que son rôle n'est pas de juger mais d'obéir.
Le roman est une critique subtile mais féroce de la mentalité de classe britannique et de l'idée de service, qui peut conduire à une abdication de sa propre humanité.
Le passé de Lord Darlington permet à Ishiguro d'explorer la complicité passive avec le mal. Stevens (et, par extension, l'Angleterre traditionaliste) n'est pas un Nazi, mais il a fermé les yeux par loyauté, par confort et par refus d'engager sa responsabilité personnelle. Le roman pose une question cruciale : Peut-on se cacher derrière son devoir pour éviter un jugement moral ?
La relation entre Stevens et Miss Kenton est l'une des romances les plus tragiques et retenues de la littérature. Leur incapacité à communiquer leurs sentiments, bloqués par la hiérarchie, la fierté et le code de conduite absurde de Stevens, est déchirante. Chaque souvenir est teinté pour le lecteur de la conscience douloureuse de ce qui aurait pu être.

"The Remains of the Day", adapté au cinéma par James Ivory en 1993, avec Anthony Hopkins (Stevens), Emma Thompson (miss Kenton), James Fox (lord Darlington), Christopher Reeve (Lewis), Peter Vaughan, Hugh Grant, bien que n'ayant remporté aucun Oscar, reste l’un des films emblématiques de la décennie. Il a contribué à asseoir la notoriété internationale d’Ishiguro, bien avant son Prix Nobel de littérature (2017), et est aujourd’hui, il est considéré comme un classique du cinéma britannique et un sommet du cinéma Merchant Ivory. Les critiques ont souligné la performance magistrale de Anthony Hopkins (dans le rôle du majordome Stevens) et de Emma Thompson (Miss Kenton), considérées parmi leurs meilleures.

"L'Inconsolé" (The Unconsoled, 1995)
Traduction française : Éditions de la Table Ronde, 1997 - Editions Gallimard, Folio 2017 - Le roman, étant très onirique et complexe, représentait un défi immense pour le traducteur. François Rosso a dû trouver des solutions pour rendre la structure circulaire, les ellipses et l'absurdité kafkaïenne du récit en français, ce qui a été globalement très bien réussi compte tenu de la difficulté.
À sa sortie, "L'Inconsolé" a divisé la critique. Beaucoup de lecteurs et de critiques, déroutés par sa longueur (plus de 500 pages) et son absence de linéarité, l'ont trouvé frustrant et illisible. Avec le recul, il est apparu comme un acte artistique extrêmement courageux. Après le succès universel de "Les Vestiges du jour", Ishiguro a pris le risque immense de ne pas répéter une formule gagnante mais de se réinventer complètement. Il est aujourd'hui considéré comme une pièce maîtresse essentielle pour comprendre l'ensemble de son œuvre. Il pousse à son paroxysme tous ses thèmes de prédilection : le narrateur peu fiable, la mémoire défaillante, le regret, l'échec de la communication et le poids des attentes. Il annonce aussi sa liberté future à mélanger les genres ("Auprès de moi toujours", "Le Géant enfoui").
L'Inconsolé n'est pas un roman réaliste. C'est une plongée vertigineuse dans la psyché d'un artiste en crise, une exploration de l'anxiété, de la culpabilité et de la peur de décevoir. C'est un livre exigeant, délibérément frustrant, qui reproduit chez le lecteur le sentiment d'oppression et de confusion du protagoniste. Mais pour ceux qui acceptent ses règles du jeu oniriques, il offre une expérience littéraire inoubliable et d'une profonde tristesse, une méditation unique sur le fossé entre l'ambition artistique et la fragilité humaine. Il confirme qu'Ishiguro est bien plus qu'un simple conteur élégant : c'est un explorateur des zones les plus obscures de l'âme.
"1 - Le chauffeur de taxi parut contrarié de constater que personne — pas même un employé de la réception — n’était là pour m’accueillir. Il erra dans le hall désert, espérant peut-être découvrir un membre du personnel caché derrière une plante verte ou un fauteuil. Finalement, il déposa mes valises près de la porte de l’ascenseur et, marmottant de vagues excuses, prit congé de moi.
Le hall était raisonnablement spacieux, si bien que plusieurs tables basses pouvaient s’y trouver réparties sans que les lieux parussent encombrés. Mais le plafond était bas et indéniablement affaissé, ce qui créait une ambiance quelque peu étouffante, et malgré le soleil qui brillait au-dehors l’éclairage était lugubre. En un seul endroit, à proximité de la réception, un beau rayon de soleil, dardé sur le mur, illuminait un pan de lambris sombre et un étalage de magazines en allemand, français et anglais. Je distinguai aussi une petite clochette en argent sur le bureau de la réception, et j’étais sur le point d’aller l’agiter lorsqu’une porte s’ouvrit quelque part derrière moi, laissant apparaître un jeune homme en uniforme.
« Bonjour, monsieur », dit-il d’un ton las ; s’installant au bureau de la réception, il commença la procédure d’inscription. Il eut beau s’excuser en bredouillant de son absence, il n’en resta pas moins, et pendant un moment, franchement désinvolte. Cependant, dès que j’eus mentionné mon nom, il sursauta et se redressa.
« Monsieur Ryder, je suis vraiment navré de ne pas vous avoir reconnu. M. Hoffman, le directeur, souhaitait vivement vous accueillir personnellement. Mais, malheureusement, il a dû se rendre à une réunion importante, où il se trouve actuellement.
— Bien sûr, je comprends parfaitement. Je serai heureux de le rencontrer plus tard. »
Le réceptionniste se hâta de remplir les formulaires d’inscription, sans cesser de marmonner que le directeur serait vraiment chagriné d’avoir raté mon arrivée. Il indiqua à deux reprises que les préparatifs de « jeudi soir » infligeaient à ce personnage des contraintes inaccoutumées, et l’éloignaient de l’hôtel bien plus qu’il n’en était coutume. Je me contentai d’un signe de tête, incapable de rassembler l’énergie nécessaire pour demander quelle était la nature exacte de ce « jeudi soir ».
« Au fait, M. Brodsky est en pleine forme, aujourd’hui, reprit le réceptionniste d’un air plus joyeux. Une forme éblouissante. Ce matin, il a fait répéter l’orchestre pendant quatre heures, sans interruption. Et écoutez-le maintenant ! Toujours sur la brèche, à mettre les choses au point lui-même. »
Il montra du doigt le fond du hall. Alors seulement je m’aperçus qu’on jouait du piano quelque part dans le bâtiment, de façon à peine audible à cause de la rumeur étouffée de la circulation extérieure. Je levai la tête et écoutai plus attentivement. Quelqu’un jouait une seule phrase brève — du deuxième mouvement de Verticalité, de Mullery —, ne cessant de la reprendre d’une manière lente et préoccupée.
« Naturellement, si le directeur était ici, disait le réceptionniste, il aurait certainement fait venir M. Brodsky pour vous le présenter. Mais je ne sais pas… » Il eut un petit ire. « Je ne sais pas si je peux le déranger. Vous comprenez, s’il est complètement concentré…
— Bien sûr, bien sûr. Une autre fois.
— Si le directeur était ici… » Il laissa la phrase en suspens et rit de nouveau. Puis, se penchant, il ajouta à voix basse : « Savez-vous, monsieur, que certains de nos clients ont eu le toupet de protester ? Parce que nous fermons le salon ainsi, chaque fois que M. Brodsky a besoin du piano ? C’est incroyable, la mentalité de certaines personnes ! Ils ont été deux, hier, à se plaindre chacun de leur côté à M. Hoffman. Soyez certain qu’ils ont été très rapidement remis à leur place.
— J’en suis certain. Brodsky, dites-vous. » Je réfléchis à ce nom, mais il ne m’évoquait rien. Puis je m’aperçus que le réceptionniste m’observait d’un air intrigué et repris promptement : « Oui, oui. Je serai heureux de rencontrer M. Brodsky, le moment venu.
— Si seulement le directeur était ici, monsieur.
— Ne vous inquiétez donc pas. Eh bien, si tout est réglé, j’aimerais beaucoup…
— Naturellement, monsieur. Vous devez être très fatigué après un aussi long voyage. Voici votre clé. Gustav que voilà va vous conduire à votre chambre. »
Je regardai derrière moi et vis qu’un porteur d’un certain âge attendait de l’autre côté du hall. Debout devant l’ascenseur ouvert, il en contemplait l’intérieur d’un air préoccupé. Il sursauta lorsque je m’approchai de lui. Puis il prit mes valises et me suivit précipitamment dans l’ascenseur.
Tandis que nous commencions notre montée, le vieux porteur restait cramponné aux deux valises et je le voyais rougir sous l’effort. Les valises étaient l’une et l’autre très lourdes, et, craignant réellement qu’il ne s’évanouisse sous mes yeux, je lui dis :
« Vous savez, vous devriez vraiment les poser.
— Je me réjouis que vous abordiez cette question, monsieur », dit-il ; sa voix était étonnamment peu marquée par les efforts physiques qu’il déployait. « Quand j’ai débuté dans cette profession, il y a maintenant de très nombreuses années, je mettais toujours les bagages par terre. Pour ne les reprendre que lorsque c’était indispensable. En cas de déplacement, pour ainsi dire. En fait, pendant les quinze premières années de mon travail ici, je dois dire que j’ai appliqué cette méthode. C’est encore le cas pour de nombreux jeunes porteurs, dans cette ville. Mais vous ne me prendrez pas à faire quoi que ce soit de ce genre, maintenant. D’ailleurs, monsieur, nous ne montons pas très haut. »
Nous continuâmes notre ascension en silence. Puis je repris :
« Il y a donc un certain temps que vous travaillez dans cet hôtel.
— Cela fait maintenant vingt-sept ans, monsieur. J’en ai vu beaucoup au long de cette période. Mais bien entendu, cet hôtel existait bien avant que je sois arrivé ici. On pense que Frédéric le Grand a passé une nuit ici au XVIIIe siècle, et selon tous les témoignages c’était déjà alors une hôtellerie établie de longue date. Ah oui, il s’est produit ici, au fil des années, des événements d’un grand intérêt historique. À un moment où vous ne serez pas aussi fatigué, monsieur, je serai heureux de vous rapporter quelques-uns de ces récits.
— Mais vous m’expliquiez pour quelle raison vous considériez comme une erreur de placer les bagages par terre.
— En effet, répondit le porteur. C’est une question intéressante. Voyez-vous, monsieur, comme vous pouvez l’imaginer, il y a dans une ville de ce genre de nombreux hôtels. De ce fait, beaucoup d’habitants de la ville ont tâté à un moment ou à un autre du travail de porteur. Ici, beaucoup de gens semblent croire qu’il suffit de revêtir un uniforme, et le tour sera joué : ils seront capables de remplir cet office. C’est une illusion particulièrement répandue dans cette ville. Appelez cela un mythe local, si vous voulez. Et j’avoue volontiers qu’il fut un temps où j’y souscrivais moi-même sans réfléchir. Et puis, une fois — oh, cela fait maintenant bien des années —, nous avons pris, ma femme et moi, de brèves vacances. Nous sommes allés en Suisse, à Lucerne. Ma femme est décédée aujourd’hui, monsieur, mais à chaque fois que je pense à elle, je me rappelle nos brèves vacances. C’est très beau là-bas, au bord du lac. Vous le connaissez certainement. Nous avons fait quelques charmantes promenades en bateau après le petit déjeuner. Pour revenir à la question, j’ai remarqué au cours de ce séjour que les habitants de cette ville ne formaient pas sur leurs porteurs les mêmes idées reçues que les gens d’ici. Comment dire, monsieur ? Là-bas, on accordait aux porteurs un bien plus grand respect. Les meilleurs étaient de véritables personnalités, et les principaux hôtels se battaient pour obtenir leurs services. Je dois dire que cela m’a ouvert les yeux. Mais dans cette ville-ci, ma foi, cette idée subsiste depuis des années et des années. C’est au point où je me demande si l’on pourra un jour l’éliminer. Attention : je ne veux pas dire que les gens d’ici sont grossiers avec nous. Pas du tout, j’ai toujours été traité avec politesse et considération. Mais comprenez-vous, monsieur, il reste toujours cette idée que n’importe qui pourrait faire ce travail pour peu que cela lui chante, que l’envie lui en vienne. La raison en est, je suppose, qu’il est arrivé à tout un chacun dans cette ville, à un moment ou à un autre, de porter des bagages d’un endroit à un autre. Parce qu’ils ont fait ça, ils croient qu’être un porteur d’hôtel n’est qu’un prolongement de cette activité. J’ai eu des personnes au fil des années, monsieur, dans ce même ascenseur, qui m’ont dit : “Peut-être qu’un de ces jours, je vais laisser tomber ce que je fais et devenir porteur.” Parfaitement. Oui, monsieur, un jour — c’était peu de temps après nos brèves vacances à Lucerne —, j’ai eu un de nos principaux conseillers municipaux qui a prononcé à peu de chose près ces paroles. “J’aimerais bien faire ça un jour ou l’autre, m’a-t-il dit en montrant les valises. Voilà une vie qui me conviendrait. Pas l’ombre d’un souci.” Je suppose qu’il voulait être aimable, monsieur. En laissant entendre que mon sort était enviable. En ce temps-là, j’étais plus jeune, monsieur. Je ne tenais pas les valises. Je les avais posées par terre, dans ce même ascenseur, et je suppose qu’à l’époque on pouvait me voir sous ce jour. Vous savez, sans souci, comme ce monsieur le laissait entendre. Eh bien, monsieur, je dois dire que la mesure était comble. Ce n’est pas que les paroles de ce monsieur m’aient vivement fâché, en elles-mêmes. Mais lorsqu’il m’a tenu ces propos, les choses se sont pour ainsi dire mises en place. Des choses auxquelles je pensais depuis un certain temps. Et comme je vous l’ai expliqué, monsieur, j’étais revenu depuis peu de nos brèves vacances à Lucerne où j’avais acquis un certain recul. J’ai donc pensé : il est plus que temps que les porteurs de cette ville entreprennent de changer l’attitude qui prévaut ici. Voyez-vous, monsieur, j’avais vu tout autre chose à Lucerne, et je me suis dit que ça n’était vraiment pas à la hauteur, ce qui se passait ici. J’y ai donc réfléchi sérieusement et j’ai décidé d’un certain nombre de mesures que je prendrais personnellement. Bien sûr, même alors, je pressentais sans doute que ce ne serait pas facile. Il se peut que j’aie déjà compris, il y a bien des années, qu’il était peut-être trop tard pour ma propre génération. Que les choses étaient allées trop loin. Mais si je parvenais seulement à accomplir ma tâche, me suis-je dit, et à changer les choses si peu que ce soit, du moins cela serait-il plus facile pour ceux qui viendraient après moi. Aussi ai-je adopté mes mesures, monsieur, et je m’y suis tenu, depuis le jour où le conseiller municipal a prononcé ces paroles. Et je le dis avec fierté, nombre de porteurs de cette ville m’ont emboîté le pas. Je ne prétends pas qu’ils ont adopté exactement les mêmes mesures. Mais disons que leurs mesures étaient… eh bien, compatibles.
— Je vois. Et l’une de vos mesures consistait, au lieu de poser les valises, à les garder à la main.
— Exactement, monsieur, vous avez parfaitement saisi le fond de ma pensée. Bien entendu, quand j’ai choisi de me conformer à ces règles, je dois dire que j’étais bien plus jeune et plus fort, et je suppose que je n’ai pas vraiment tenu compte que j’allais m’affaiblir avec l’âge. C’est curieux, monsieur : on n’y songe pas. Les autres porteurs ont fait des constatations similaires. Quand même, nous essayons tous de nous en tenir à nos vieilles résolutions. Nous sommes devenus un groupe assez soudé au fil des années, douze en tout, les survivants parmi ceux qui ont essayé d’introduire un changement, il y a bien des années. Si je devais revenir sur quoi que ce soit maintenant, monsieur, j’aurais le sentiment que je lâche les autres. Et si parmi eux, certains devaient revenir sur leurs anciennes règles, j’aurais le même sentiment. C’est qu’on ne peut pas en douter : il y a eu un certain progrès dans cette ville. Il reste bien du chemin à faire, c’est vrai, mais nous en avons souvent discuté — nous nous retrouvons tous les dimanches après-midi au Café hongrois, dans la vieille ville, vous pourriez venir vous joindre à nous, vous seriez vraiment le bienvenu, monsieur —, nous avons donc souvent discuté de ces questions et nous sommes tous d’accord, sans le moindre doute : il y a eu des améliorations significatives dans l’attitude à notre égard, dans cette ville. Les jeunes, ceux qui sont venus après nous, bien entendu qu’à leurs yeux, tout cela va de soi. Mais nous, le groupe du Café hongrois, nous savons que c’est grâce à nous qu’il y a une différence, fût-elle petite. Vous seriez le bienvenu parmi nous, monsieur. C’est avec bonheur que je vous présenterais au groupe. Nos règles sont beaucoup moins strictes qu’elles ne l’ont été, et il est entendu depuis quelque temps que dans des circonstances particulières, des invités peuvent être accueillis à notre table. C’est d’ailleurs fort agréable à cette époque de l’année, où un doux soleil brille dans l’après-midi. Notre table est située à l’ombre du store, et nous avons vue sur la vieille place. C’est fort agréable, monsieur ; je suis sûr que cela vous plairait. Mais pour revenir à ce que je vous disais, nous avons abondamment discuté de cette question au Café hongrois. Je veux dire, de ces résolutions prises anciennement par chacun de nous, il y a tant d’années. Vous comprenez, aucun de nous n’avait pensé à ce qui se passerait lorsque nous vieillirions. Nous étions tellement pris par notre travail, je suppose, que nous n’envisagions les choses qu’au jour le jour. Ou peut-être sous-estimions-nous le temps qu’il faudrait pour modifier ces attitudes profondément enracinées. Mais voilà, monsieur. J’ai l’âge que j’ai, et cela devient plus dur chaque année. »
Le porteur se tut un instant et, malgré la contrainte physique qu’il subissait, sembla se perdre dans ses pensées ..."
Le roman se déroule dans une ville européenne non identifiée (peut-être en Suisse ou en Allemagne centrale), dans un présent intemporel et onirique. Ryder est un pianiste de renommée mondiale, arrivé dans cette ville pour y donner un concert crucial censé "guérir" la communauté de ses tensions et de ses malaises non spécifiés. Dès son arrivée à l'hôtel, Ryder est submergé par des demandes et des attentes étranges et pressantes de la part des habitants. Le récit suit une logique de rêve (ou de cauchemar). Le temps et l'espace sont déformés. Ainsi Ryder se lance dans une conversation qui semble durer quelques minutes, mais découvre que des heures se sont écoulées. Un couloir d'hôtel s'étire sur une longueur impossible. Il prend un ascenseur et se retrouve soudainement dans le salon d'un parfait inconnu. Les personnages qu'il rencontre (le portier, la journaliste, un vétéran, des parents qu'il n'a pas vus depuis des années) semblent tous avoir une histoire personnelle et complexe avec lui, dont lui-même n'a parfois aucun souvenir.
Les habitants lui confient des missions absconses et urgentes : assister à une répétition d'orchestre, arbitrer un conflit familial, donner une conférence, rendre visite à un vieil artiste oublié, s'occuper de la sonorisation d'une réunion municipale, etc. Ryder, bien qu'épuisé et désireux de se préparer pour son concert, se sent obligé d'accepter toutes ces demandes, remettant sans cesse le moment de se concentrer sur sa propre performance.
Les Figures Clés :
- Gustav, le portier vénérable de l'hôtel, obsédé par le professionnalisme et dont la relation avec sa fille Sophie est tendue.
- Sophie et son jeune fils Boris, qui semblent être la femme et l'enfant de Ryder, bien que leur relation soit floue et que Ryder les néglige constamment.
- M. Hoffman, le directeur de l'hôtel, dont le mariage bat de l'aile.
Le Dénouement : Le récit culmine avec le concert de Ryder, qui est un désastre total. Il arrive en retard, improvise un discours confus et ne joue finalement qu'une pièce simpliste, décevant toute l'assistance. Le roman se termine sur une note d'échec et de mélancolie profonde, sans résolution, laissant Ryder (et le lecteur) dans un état de confusion et d'inachevé.
"... Lorsque j’eus fini de descendre le raidillon sinueux pour retrouver enfin la grand-route, le soleil était très bas dans le ciel. La circulation était toujours aussi fluide et je roulai pendant quelque temps à bonne vitesse, cherchant à distinguer la voiture rouge à l’horizon. En quelques minutes, nous avions quitté les montagnes et traversions de vastes étendues de terres agricoles. Des deux côtés de la route, les champs se déroulaient jusque dans le lointain. Ce fut à un moment où la route dessinait une ample courbe sur terrain plat que je repérai de nouveau la voiture. Elle était encore assez loin de nous, mais je voyais que le conducteur, comme auparavant, roulait à une allure modérée. Je réduisis ma propre vitesse et commençai bientôt à apprécier le décor qui se déployait devant moi : champs du crépuscule, soleil bas dardant ses derniers rayons derrière des arbres lointains, groupes dispersés de bâtiments — et toujours la voiture rouge devant nous, qui apparaissait et disparaissait à chaque virage. Puis j’entendis Sophie dire à côté de moi :
« Il y aura combien de gens, à ton avis ?
— À la réception ? » Je haussai les épaules. « Comment veux-tu que je sache ? Écoute, j’ai l’impression que tu te tracasses beaucoup trop. C’est une réception comme une autre, sans plus. »
Sophie contemplait le paysage. Puis elle dit : « Les gens, ce soir. Il y en aura beaucoup qui étaient déjà au banquet pour Rusconi. C’est pour ça que je suis inquiète. Je croyais que tu comprenais. »
Je m’efforçai de me rappeler le banquet auquel elle faisait allusion, mais ce nom ne m’évoquait pas grand-chose.
« Je commençais à faire quelques progrès pour ce genre de choses, jusqu’à cette fois-là, poursuivit Sophie. Ces gens ont été épouvantables avec moi. Je ne m’en suis pas encore vraiment remise. Il y aura fatalement plus ou moins les mêmes personnes. »
J’essayai encore, sans succès, de me remémorer cette soirée. « Tu veux dire que les gens se sont montrés impolis avec toi ?
— Impolis ? Oui, on pourrait sans doute employer ce terme. Ce qui est certain, c’est qu’ils sont arrivés à me donner l’impression d’être une petite chose lamentable. En tout cas, j’espère qu’ils ne seront pas tous là ce soir.
— Si jamais quelqu’un est impoli avec toi, ce soir, tu n’as qu’à venir me le dire. Et en ce qui me concerne, tu peux leur rendre leur impolitesse autant que tu veux. »
Sophie se tourna pour regarder Boris, assis sur la banquette arrière. Au bout d’un moment, je me rendis compte que le petit garçon s’était endormi. Sophie continua à le regarder pendant encore un certain temps, puis elle se tourna de nouveau vers moi.
« Pourquoi est-ce que tu recommences ? demanda-t-elle d’une voix toute différente. Tu sais que ça le bouleverse. Tu es en train de tout recommencer comme avant. Tu as l’intention de faire ça longtemps, cette fois-ci ?
— De faire quoi ? demandai-je avec lassitude. De quoi diable parles-tu ? »
Sophie me regarda pendant un moment, puis tourna la tête dans l’autre sens. « Tu ne te rends pas compte, dit-elle comme pour elle-même. Nous n’avons pas de temps à perdre à ce genre de choses. Tu ne te rends vraiment pas compte, hein ? »
Je me sentis à bout de patience. Tout le chaos que la journée m’avait infligé me submergea de nouveau ..."
"L'Inconsolé" est une radicalisation extrême de la technique du "narrateur peu fiable". Ici, ce n'est pas seulement la mémoire qui est trompeuse, mais l'univers entier qui obéit aux règles de l'inconscient et de l'anxiété. Les lois physiques et temporelles sont suspendues. Les rencontres improbables, les retards impossibles et les distorsions spatiales reproduisent parfaitement la sensation de frustration et d'impuissance d'un cauchemar. Comme dans "Le Procès" ou "Le Château", le protagoniste est perdu dans un système bureaucratique et social absurde dont il ne comprend pas les règles, et se voit assigner une mission dont il ignore le sens.
Le roman est une allégorie de l'anxiété de performance et de la pression sociale. Ryder est perçu comme un messie dont la performance va résoudre tous les problèmes de la ville. Cette attente démesurée est intenable et le paralyse. Toute l'intrigue peut être lue comme la projection de l'anxiété de Ryder la veille de son concert. Les distractions, les obligations sociales ridicules et les retards sont des mécanismes d'évitement pour ne pas affronter sa peur de ne pas être à la hauteur. L'absence de résolution narrative et la fin abrupte créent une sensation de dissonance, reflétant l'état d'esprit du protagoniste.
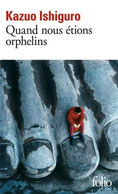
"Quand nous étions orphelins" ( When We Were Orphans, 2000)
Traduction française : Éditions de la Table Ronde, 2001 (traduit par François Rosso) - Editions Gallimard, Folio 2014 - Sélectionné pour le Booker Prize. Souvent considéré comme le roman le plus troublant et le moins immédiatement accessible d'Ishiguro. Son mélange de réalisme psychologique et de séquences oniriques a déconcerté certains lecteurs. Le roman est une allégorie de la quête des origines et de l'impossibilité de retourner au paradis perdu de l'enfance. Le titre est ironique. Banks est littéralement orphelin, mais il l'est aussi métaphysiquement : coupé de ses racines, il erre dans le monde avec un sentiment d'aliénation et d'incomplétude ...
"I - LONDRES, 24 JUILLET 1930 - C’était l’été de 1923, l’été où je venais de quitter Cambridge et où, malgré le désir de ma tante que je revinsse habiter le Shropshire, je décidai que mon avenir se trouvait dans la capitale et pris un petit appartement au 14b, Bedford Gardens, dans le quartier de Kensington. Je m’en souviens maintenant comme du plus merveilleux des étés. Après bien des années où j’avais été constamment environné de camarades, au pensionnat puis à Cambridge, je prenais le plus grand agrément à ma seule compagnie. Je me délectais des parcs de Londres, de la quiétude de la grande salle de lecture au British Museum ; je me permettais des après-midi entiers de promenades dans les rues de Kensington, traçant dans ma tête les plans de mon futur et faisant halte par instants pour m’enchanter qu’ici, en Angleterre, au cœur même d’une si vaste cité, on pût voir du lierre et des plantes grimpantes s’accrocher aux façades de belles demeures.
Ce fut au cours d’une de ces flâneries nonchalantes que je rencontrai par hasard un ancien condisciple, James Osbourne, et, découvrant que nous étions presque voisins, je lui proposai de me rendre visite la prochaine fois qu’il passerait devant chez moi. Bien que jusqu’alors je n’eusse encore accueilli aucun visiteur, je lui adressai cette invitation sans inquiétude, car j’avais choisi mon domicile avec un certain soin. Le loyer en était raisonnable, mais ma propriétaire l’avait meublé avec goût, dans un style qui évoquait un passé victorien insoucieux de hâte. Le salon, très ensoleillé pendant toute la première moitié de la journée, contenait un sofa un peu fané et deux moelleux fauteuils, ainsi qu’un buffet ancien et une bibliothèque en chêne remplie d’encyclopédies aux pages à demi effritées, et j’étais certain que tout cela ne pourrait que plaire à ceux qui viendraient me voir. En outre, aussitôt après avoir emménagé, j’avais marché jusqu’à Knightsbridge pour y acheter un élégant service à thé « Queen Anne », plusieurs paquets de thé d’excellente qualité et une grande boîte de biscuits. Aussi, lorsque Osbourne se présenta quelques jours plus tard en fin de matinée, pus-je le servir avec une assurance qui ne lui permit pas un instant d’imaginer qu’il était mon premier hôte.
Osbourne passa les quinze premières minutes à déambuler sans répit dans mon salon, me complimentant sur mon installation, examinant tel objet puis tel autre, regardant régulièrement par la fenêtre pour s’exclamer sur tout ce qu’il apercevait en contrebas. Enfin, il se laissa tomber sur le sofa et nous pûmes échanger des nouvelles, de nous-mêmes et d’anciens camarades. Je me souviens que nous consacrâmes aussi un moment à parler de l’action des syndicats ouvriers, avant de nous engager dans une longue et agréable discussion sur la philosophie allemande qui nous permit de déployer la maestria intellectuelle que nous avions tous deux acquise dans nos universités respectives. Puis, Osbourne se leva et reprit ses allées et venues, en m’exposant ses divers projets pour l’avenir..."
Le roman suit la vie de Christopher Banks, un détective privé célèbre de l'Angleterre des années 1930. L'histoire s'étend de son enfance dans le Shanghai des concessions internationales des années 1910-20 à sa carrière londonienne, pour culminer avec son retour à Shanghai en 1937, en pleine invasion japonaise. Christopher Banks raconte lui-même son histoire, avec la formalité et le contrôle caractéristiques des narrateurs d'Ishiguro.
Christopher grandit dans la concession internationale de Shanghai, dans un milieu privilégié. Ses parents, figures morales et intègres, s'opposent activement au trafic d'opium qui sévit. Soudainement, son père puis sa mère disparaissent mystérieusement. Christopher est renvoyé en Angleterre pour y être élevé, convaincu que le destin de ses parents est lié à une affaire qu'il devra un jour résoudre.
Devenu un détective à la mode dans la haute société londonienne, Banks mène une vie élégante mais superficielle. Il retrouve Sarah Hemmings, une ancienne connaissance de Shanghai, elle aussi marquée par son passé. Bien que leur relation soit tendue et ambivalente, elle partage son obsession pour les blessures de l'enfance. Malgré son succès apparent, Banks est hanté par l'énigme de ses parents et se persuade que sa célébrité n'est qu'une étape vers son vrai destin : retourner à Shanghai pour résoudre le mystère.
En 1937, Banks débarque à Shanghai, alors que la ville s'effondre sous le feu des conflits entre seigneurs de la guerre, triades et l'armée japonaise qui encercle la ville. Obsédé par sa quête, il semble indifférent à l'apocalypse qui l'entoure. Guidé par une logique onirique et enfantine, il se lance à la recherche de la maison de son enfance, en territoire désormais hostile. Sa quête tourne au cauchemar absurde : il erre dans les ruines, sous les bombardements, tel un personnage perdu dans un rêve, pour finalement retrouver son vieux compagnon de jeu, Akira, et découvrir la vérité sur le sort de ses parents.
Le Dénouement : La vérité est amère et bien plus sordide que le roman d'aventures qu'il avait imaginé. Il découvre que son père, loin d'être un héros, a succombé à la corruption et à l'opium, et que sa mère, réduite en esclavage par un seigneur de la guerre, a perdu la raison. La grande conspiration qu'il imaginait n'existait pas ; la réalité était banale, misérable et tragique. La dernière partie du livre montre Banks, des années plus tard, ayant enfin trouvé une forme de paix en adoptant la fille de Sarah et en acceptant que le passé ne peut être "résolu" comme une enquête.
"IV - HÔTEL CATHAY, SHANGHAI, 20 SEPTEMBRE 1937 - Les gens qui voyagent dans les pays arabes ont souvent remarqué que les autochtones ont coutume d’approcher curieusement leur visage au cours d’une conversation. Bien sûr, il s’agit simplement d’un usage qui se trouve différer des nôtres, et très vite le visiteur sans préjugés cesse d’y attacher aucune importance. J’ai songé que je devrais sans doute montrer la même ouverture d’esprit devant une habitude qui, depuis trois semaines que je suis à Shanghai, est devenue pour moi une source d’irritation permanente : le fait qu’ici les gens semblent résolus à vous boucher la vue en toute occasion. À peine est-on entré dans une pièce ou descendu d’une voiture qu’une personne vient en souriant se placer droit dans votre ligne de vision, vous empêchant d’observer, si peu que ce soit, ce qui vous environne. La plupart du temps, le coupable est votre hôte ou votre guide du moment ; mais si d’aventure il oublie, il se trouvera toujours quelqu’un parmi les présents pour s’empresser de vous aveugler à sa place. Pour autant que j’ai pu constater, toutes les nationalités représentées dans la ville — Anglais, Chinois, Français, Américains, Japonais, Russes — ont adopté cette pratique avec le même zèle, et la conclusion qui s’impose est que cette coutume ne s’est développée qu’ici, dans la Concession internationale de Shanghai, transcendant toute distinction de classe ou d’origine.
Il m’a fallu plusieurs jours pour prendre conscience de cette excentricité locale, et qu’elle était à la source du sentiment de désorientation qui, après mon arrivée, a pour un temps failli me plonger dans l’abattement. À présent, bien que de temps en temps j’en éprouve encore de l’agacement, elle a cessé de me perturber exagérément. Au surplus, j’ai découvert un second usage complémentaire du premier qui rend la vie un peu plus facile : à Shanghai, il semble tout à fait permis de recourir à des coups de coude étonnamment vigoureux pour écarter les gens de son chemin. Ainsi — bien que je n’aie pas encore eu l’audace de profiter moi-même de cette tolérance — ai-je déjà vu nombre de fois dans des réceptions mondaines des dames fort raffinées infliger des bourrades péremptoires sans susciter ne fut-ce qu’un murmure.
Le deuxième soir, lorsque je pénétrai dans la salle de bal au dernier étage du Palace Hotel, je n’avais encore repéré aucune de ces deux curieuses pratiques, et ma soirée se trouva donc gâchée par mon exaspération devant ce que je pris pour l’attroupement chaotique des habitants de la Concession. En sortant de l’ascenseur, tout juste avais-je eu le temps d’apercevoir le luxueux tapis qui conduisait à la salle de bal — et la rangée de chasseurs chinois alignés sur un côté — qu’un de mes hôtes pour la soirée, M. MacDonald, du consulat de Grande-Bretagne, vint placer devant moi son imposante silhouette. Tandis que nous nous avancions vers l’entrée de la salle, je remarquai avec quelle grâce charmante chacun des chasseurs s’inclinait en joignant ses mains gantées de blanc quand nous passions devant lui ; mais à peine étions-nous arrivés à la hauteur du troisième (ils devaient être six ou sept en tout) que ce spectacle fut dérobé à ma vue par le second de mes hôtes, un certain M. Grayson, qui représentait le conseil municipal de Shanghai et surgit à mon côté pour continuer la conversation que nous avions entamée dans l’ascenseur. De même, je venais seulement d’entrer dans la grande salle — où, au dire de mes hôtes, nous devions assister « au meilleur spectacle de variétés de Shanghai en compagnie de l’élite de la ville réunie pour l’occasion » — que je me trouvai englouti dans une foule tourbillonnante. Le haut plafond au-dessus de moi, avec ses grands lustres compliqués, me laissa penser que la salle de bal était de dimensions impressionnantes, bien que pour un long moment il me fût impossible de le vérifier. En suivant mes hôtes à travers la cohue, je vis néanmoins de grandes fenêtres sur un côté, par lesquelles entrait à flots la lumière du soleil couchant. J’aperçus aussi une scène dans le fond, sur laquelle des musiciens en smoking blanc allaient et venaient en bavardant. Comme tout le monde, ils semblaient attendre quelque chose — peut-être seulement la tombée de la nuit. De manière générale, l’atmosphère était à l’agitation, et les gens se poussaient et tournaient les uns autour des autres sans but apparent.
Je faillis perdre de vue mes deux hôtes ; puis, je vis MacDonald me faire signe et me retrouvai assis à une petite table couverte d’une nappe amidonnée vers laquelle mes compagnons s’étaient frayé un chemin. De ce point d’observation, je pus constater qu’une importante partie de la salle était restée vide — probablement dans l’attente du spectacle — et que presque tous les présents s’étaient pressés dans un espace relativement étroit le long de la partie vitrée. La table où nous étions assis faisait partie d’une longue rangée, mais lorsque je voulus voir jusqu’où cette rangée s’étendait, une fois encore cela me fut impossible. Personne n’avait pris place aux tables avoisinantes, probablement parce que la bousculade empêchait d’y accéder. Du reste, nous eûmes bientôt la sensation qu’elle était comme un petit bateau assailli de tous côtés par la marée de la bonne société de Shanghai. De surcroît, mon arrivée n’était pas passée inaperçue ; j’entendais autour de moi des murmures qui en répandaient la nouvelle, et des regards de plus en plus nombreux se tournaient dans notre direction.
En dépit de tout cela, je tâchai — jusqu’à ce que cela devînt complètement impossible — de poursuivre la conversation commencée avec mes deux hôtes dans la voiture qui nous amenait au Palace Hotel. À un moment, je me souviens d’avoir dit à MacDonald :
« Je vous remercie pour votre proposition, monsieur, mais, pour être franc, je préfère de beaucoup poursuivre mon enquête tout seul. C’est ainsi que j’ai coutume de travailler.
— Comme vous voudrez, mon cher, répondit MacDonald. Ce n’était qu’une suggestion. La plupart des gars dont je vous parle connaissent la ville comme leur poche, et les meilleurs d’entre eux valent bien tous les limiers de Scotland Yard. J’ai pensé qu’ils pourraient vous faire gagner et nous faire gagner à tous un temps précieux.
— Peut-être, mais rappelez-vous ce que je vous ai dit, monsieur. Je n’ai quitté l’Angleterre qu’après m’être formé une théorie précise sur l’affaire. En d’autres termes, mon arrivée ici n’est pas un point de départ, mais l’aboutissement de longues années de travail.
— En somme, intervint soudain Grayson, vous êtes venu parmi nous pour régler cette histoire une fois pour toutes. Quelle magnifique nouvelle ! »
MacDonald jeta au représentant du conseil municipal un coup d’œil dédaigneux, puis continua comme s’il n’avait pas parlé ..."
Comme toujours chez Ishiguro, le narrateur est profondément peu fiable. Christopher Banks se construit une identité de héros romantique et interprète toute sa vie à travers le prisme déformant de son trauma. Sa carrière de détective n'est qu'une préparation à sa "grande enquête". Il voit des signes et des conspirations partout. Son arrivée à Shanghai en pleine guerre est un moment clé. Son incapacité à percevoir la réalité qui l'entoure – la guerre, les morts, la destruction – est frappante. Il est tellement absorbé par son drame personnel qu'il traverse l'apocalypse en somnambule. Cette séquence surréaliste est un point culminant de la technique d'Ishiguro pour montrer le fossé entre la perception du narrateur et la réalité.
Shanghai n'est pas une ville réaliste, mais un espace mythologique et mental, un labyrinthe de souvenirs déformés où Banks projette ses peurs et ses fantasmes. La quête de la maison perdue est la quête d'une innocence et d'une sécurité révolues.
Ishiguro va utiliser le cadre des concessions internationales pour critiquer,
- L'Arrogance Coloniale : La bulle de privilège et d'innocence dans laquelle vivait l'enfant Banks est une métaphore de l'aveuglement colonial. Les occidentaux croient contrôler et comprendre l'Orient, mais ils n'en perçoivent que la surface. Leurs drames personnels éclatent au contact d'une réalité chinoise bien plus complexe, violente et incontrôlable qu'ils ne l'imaginaient.
- L'Effondrement d'un Monde : La chute de Shanghai en 1937 symbolise l'effondrement final de l'ordre colonial illusoire. Banks arrive au moment même où ce monde s'écroule, cherchant désespérément à y retrouver sa place d'enfant.
Ishiguro joue avec les codes du roman policier victorien (Conan Doyle) et du roman d'aventures exotiques pour mieux les subvertir. Et si le lecteur s'attend à une enquête palpitante avec indices et rebondissements, au contraire, l'enquête est un échec total, la solution est dérisoire et ne mène à aucun coupable à punir. Le détective échoue. C'est que le vrai mystère n'est pas criminel, mais psychologique : Le "crime" à résoudre est celui du temps passé et de la perte de l'innocence. Il n'y a pas de résolution possible, seulement une forme d'acceptation.
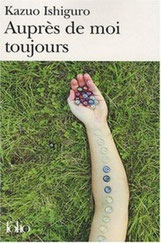
"Auprès de moi toujours" ( Never Let Me Go, 2005)
Traduction française : Éditions de la Table Ronde, 2006 (traduit par François Rosso) ' Editions Gallimard, Folio 2005 - Sélectionné pour le Booker Prize. Adapté au cinéma par Mark Romanek en 2010 ( l'histoire de trois amis, Kathy, Ruth et Tommy, élevés dans un pensionnat à l'écart du monde, qui découvrent de lourds secrets sur leurs origines et le sens de leur vie : le film fut un échec commercial). Contrairement aux dystopies classiques (Orwell, Huxley) qui dépeignent une oppression étatique violente et visible, Ishiguro invente une dystopie douce et intériorisée (le "nostalgic sadness" cher à notre auteur). L'horreur ne réside pas dans des camps de torture, mais dans l'acceptation résignée des personnages de leur sort. Le système ne fonctionne pas par la force brute mais par la manipulation psychologique et la fabrication du consentement. Les clones de Hailsham sont éduqués à considérer leur destin de donneur comme un fait naturel, presque noble. La question centrale n'est pas "Comment se révolter ?" mais "Comment donner un sens à une vie dont la fin est prédéterminée ?" ..
"1 - Je m’appelle Kathy H. J’ai trente et un ans, et je suis accompagnante depuis maintenant plus de onze ans. Je sais que cela paraît assez long, pourtant ils me demandent de continuer huit mois encore, jusqu’à la fin de l’année. Cela fera alors presque douze ans. Si j’ai exercé aussi longtemps, ce n’est pas forcément parce qu’ils trouvent mon travail formidable. Je connais des accompagnants très compétents qui ont été priés d’arrêter au bout de deux ou trois ans à peine. Et je connais le cas d’un accompagnant au moins qui a poursuivi son activité pendant quatorze ans alors qu’il ne valait rien. Je ne cherche donc pas à me vanter. Pourtant je sais de source sûre qu’ils ont été satisfaits de mon travail, et dans l’ensemble, je le suis aussi. Mes donneurs ont toujours eu tendance à récupérer bien mieux que prévu. La rapidité de leur guérison s’est révélée impressionnante, et presque aucun d’entre eux n’a été classé « agité », même avant le quatrième don.
Bon, peut-être que je me vante maintenant. Mais c’est très important pour moi d’être capable de bien faire mon travail, et en particulier de veiller à ce que mes donneurs demeurent « calmes ». À leur contact, j’ai acquis une sorte d’instinct. Je sais quand rester près d’eux pour les réconforter, et quand les laisser livrés à eux-mêmes ; quand les écouter jusqu’au bout, et quand leur dire de se ressaisir.
En tout cas, je n’ai pas de grandes prétentions. Certains soignants en exercice sont tout aussi capables, mais ne bénéficient pas d’une telle reconnaissance. Si vous êtes l’un de ceux-là, je peux comprendre que vous m’enviez – mon studio, ma voiture et, surtout, la faculté que j’ai de choisir mes patients. Et j’ai étudié à Hailsham – ce qui suffit parfois à braquer mes collègues. Kathy H. a le droit de choisir, disent-ils, et elle sélectionne toujours des individus de son espèce : des gens de Hailsham ou de l’une des autres résidences privilégiées. Rien d’étonnant qu’elle ait un bilan hors du commun. Je l’ai assez entendu, et je suis sûre qu’on vous l’a répété maintes fois, aussi peut-être y a-t-il un fond de vérité là-dedans. Mais je ne suis pas la première à avoir mon mot à dire, et sûrement pas la dernière. Et j’ai fait ma part en m’occupant de personnes qui avaient été élevées dans toutes sortes d’endroits. Souvenez-vous qu’à la fin, j’aurai rempli ces fonctions pendant douze années, et que depuis seulement six ans ils m’accordent la liberté du choix.
Et pourquoi pas ? Les accompagnants ne sont pas des machines. On essaie de faire le maximum pour chaque donneur, et au bout du compte on s’use. On ne dispose pas d’une patience ni d’une énergie illimitées. Et, bien sûr, quand on en a l’occasion, on préfère s’occuper de ses pairs. C’est naturel. Jamais je n’aurais pu tenir tout ce temps si j’avais cessé de compatir aux souffrances de mes donneurs à chaque étape du processus. Et si je n’avais pas commencé à les sélectionner, comment serais-je devenue à nouveau proche de Ruth et de Tommy après toutes ces années ?
Bien sûr, ces jours-ci, les donneurs dont je me souviens sont de plus en plus rares, et en pratique je n’ai disposé que d’une marge très étroite. Je le répète, le travail est beaucoup plus pénible quand on n’a pas ce lien profond avec le donneur, et, bien sûr, je regretterai de ne plus être accompagnante, mais je sens qu’il est temps d’arrêter à la fin de cette année.
Ruth, soit dit en passant, n’a été que le troisième ou le quatrième donneur que j’ai eu le droit de choisir.
À ce moment-là elle avait déjà son propre accompagnant, et je me souviens qu’il m’a fallu une certaine audace pour obtenir le poste. Mais j’ai fini par y arriver, et dès l’instant où je l’ai revue, dans ce centre de convalescence à Douvres, toutes nos différences – alors qu’elles ne s’étaient pas exactement dissipées – ont paru bien moins importantes que le reste ..."
Le roman est narré par Kathy H., une jeune femme d'une trentaine d'années qui, dans une Angleterre alternative et rétro-futuriste, revient sur son enfance et son adolescence passées dans un pensionnat idyllique et isolé appelé Hailsham.
L'histoire se déroule en trois parties :
- Hailsham : Kathy décrit sa scolarité avec ses amis Ruth (extravertie, parfois manipulatrice) et Tommy (impulsif, sujet aux crises de colère). Hailsham semble un lieu privilégié, où l'accent est mis sur la créativité artistique et la santé physique. Cependant, une atmosphère étrange et oppressive plane. Les élèves sont élevés dans l'ignorance du monde extérieur et les conversations avec les gardiens (les professeurs) sont émaillées de sous-entendus inquiétants sur leur destin unique.
- Les Cottages : Après Hailsham, Kathy, Ruth et Tommy sont transférés dans un lieu de transition, les Cottages, où ils cohabitent avec d'autres jeunes de leur "espèce". C'est ici qu'ils commencent à comprendre lentement et douloureusement la vérité sur leur condition : ils sont des clones, créés pour devenir des donneurs d'organes. Leur vie adulte est entièrement tracée : après avoir été "soignants" (ce que Kathy est devenue) pour accompagner les donneurs, ils deviendront donneurs à leur tour jusqu'à ce que leur corps succombe ("achèvement").
- L'âge adulte : Devenue soignante, Kathy croise à nouveau la route de Ruth et Tommy. Ensemble, ils tentent de saisir une rumeur, un espoir peut-être vain : que si deux clones peuvent prouver qu'ils sont sincèrement amoureux, ils pourraient obtenir un "report", un délai avant de commencer leurs dons. Cette quête désespérée les mène à retrouver une ancienne gardienne de Hailsham, Madame, pour confronter le système qui a fait d'eux ce qu'ils sont.
"... Au cours des années, il y a eu des périodes où j’essayais d’effacer Hailsham de ma mémoire, où je me disais que je ne devais plus regarder autant en arrière.
À un certain moment, j’ai cessé de résister. C’est venu d’un échange avec un donneur en particulier, au cours de ma troisième année de pratique ; de sa réaction quand j’ai mentionné que j’étais de Hailsham. Il émergeait à peine de son troisième don, l’intervention s’était mal passée, et il devait savoir qu’il ne s’en remettrait pas. Il pouvait à peine respirer, mais il a regardé vers moi et il a dit : « Hailsham, je parie que c’était un endroit magnifique. » Et le lendemain matin, tandis que je faisais la conversation pour lui occuper l’esprit et que je lui demandais où il avait grandi, il a mentionné une ville du Dorset, et sous les marbrures de son visage s’est esquissée une grimace d’un genre tout à fait nouveau. Je me suis alors rendu compte à quel point le rappel de ses origines lui était insupportable. Au lieu de cela, il voulait entendre parler de Hailsham.
Pendant les cinq ou six jours suivants, je lui ai donc raconté ce qu’il désirait savoir ; il restait allongé là avec tous ses tuyaux, un doux sourire aux lèvres. Il m’interrogeait sur les petites et les grandes choses.
Sur nos gardiens, sur les coffres à collection que chacun de nous rangeait sous son lit, sur le football, les rounders, le petit sentier qui contournait la maison principale, avec tous ses coins et ses recoins, l’étang des canards, la nourriture, la vue de la salle de dessin sur les champs par une matinée de brouillard. Parfois il me priait de recommencer mon récit encore et encore ; il m’interrogeait sur des choses que je lui avais racontées la veille à peine, comme si je ne les lui avais jamais dites : «Vous aviez un pavillon de sport ? », « Qui était votre gardien préféré ? ». Au début j’ai cru que c’était juste les médicaments, mais ensuite je me suis rendu compte qu’il avait les idées assez claires. Il ne voulait pas seulement entendre parler de Hailsham, mais s’en souvenir, comme s’il s’était agi de sa propre enfance. Il savait qu’il était proche de l’issue, et il avait entrepris la chose suivante : il me poussait à lui faire ces descriptions afin qu’elles imprègnent son cerveau et que se brouille peut-être, pendant les nuits de veille, la lisière entre mes souvenirs et les siens, avec les drogues, la souffrance et l’épuisement. C’est alors que j’ai compris, réellement compris, la chance que nous avions eue – Tommy, Ruth, moi, nous tous...."
Le cœur du roman interroge : qu'est-ce qui fait notre humanité ? Les clones d'Ishiguro sont, biologiquement et émotionnellement, pleinement humains. Ils aiment, jalousent, créent, doutent. Le projet de Hailsham, dirigé par Madame, était justement de prouver que les clones avaient une âme en encourageant leur production artistique. La tragédie est que cette preuve de leur humanité ne sert à rien pour la sauver ; elle ne fait que documenter leur existence pour un public extérieur indifférent. La chanson qui donne son titre au livre, "Never Let Me Go", symbolise ce désir universel d'amour, de connexion et de ne pas être abandonné – un désir que la société refuse de reconnaître aux clones.
La narration de Kathy est cruciale. Son récit n'est pas linéaire ; il vagabonde, oublie des détails, revient sur des moments-clés avec le recul de l'âge adulte. Cette structure reflète le travail de la mémoire et son importance pour construire une identité et préserver ceux qu'elle a aimés. Kathy, en tant que narratrice, est à la fois soignante et conservatrice de l'histoire de Tommy et Ruth. Son récit est un acte de résistance contre l'effacement auquel leur destin les condamne.
Le roman est une puissante allégorie qui dépasse son intention de science-fiction. Il parle :
- De l'exploitation des corps au profit d'une classe privilégiée. Les clones représentent tous les groupes marginalisés dont la société tire profit tout en niant leur pleine humanité.
- De la condition mortelle universelle. Nous partageons tous avec Kathy et Tommy une existence dont le terme est connu et inéluctable. Leur "achèvement" prématuré est une métaphore radicalisée de notre propre mortalité. Le livre nous demande : comment vivons-nous en sachant que nous allons mourir ?
- De la passivité face à l'injustice. L'incapacité des personnages à se rebeller est frustrante pour le lecteur, mais c'est précisément le point. Ishiguro explore comment un système peut briser l'instinct de révolte en contrôlant l'éducation et l'information dès la naissance.
En nous faisant voir le monde "through the eyes of Kathy", Ishiguro nous force à confronter nos propres préjugés et notre complaisance face à l'injustice. La question qu'il pose n'est pas "Que ferions-nous à leur place ?" mais "Que faisons-nous, dans notre monde, qui ressemble à cela ?".
C'est une œuvre qui marque durablement son lecteur, non par des images de violence, mais par le silence assourdissant d'une tragédie acceptée et la beauté fragile des moments humains qu'elle parvient malgré tout à capturer.
Un chef-d'œuvre de la littérature contemporaine.
La passivité des personnages : C'est le point de critique le plus fréquent. Certains lecteurs trouvent frustrant que Kathy, Tommy et Ruth ne se questionnent pas plus et n'envisagent jamais sérieusement la fuite ou la rébellion. Cependant, on peut argumenter que cette passivité est le sujet même du livre – une étude sur la résignation et l'acceptation d'un destin présenté comme inévitable.
Un monde imparfaitement expliqué : Le fonctionnement de la société à l'extérieur de Hailsham reste très flou. Qui sont les "possibles" (les originaux dont ils sont clones) ? Comment la société justifie-t-elle moralement ce système ? Ishiguro élude volontairement ces questions. Le monde extérieur n'intéresse pas Kathy ; son monde à elle, c'est le microcosme de Hailsham et ses relations. Le focus est résolument psychologique, pas sociologique.
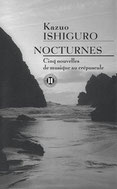
"Nocturnes : Cinq nouvelles de musique au crépuscule" ( Nocturnes: Five Stories of Music and Nightfall, 2009)
Traduction française : Éditions des Deux Terres, 2010 (traduit par Anne Rabinovitch)- "Nocturnes" est un recueil de cinq nouvelles liées par des thèmes communs : la musique, le crépuscule (entendu comme une période de transition, de déclin ou de mélancolie), et les relations humaines à un tournant. À sa sortie, le recueil a été parfois considéré comme une œuvre de transition ou de divertissement par rapport aux grands romans qui l'encadrent (Auprès de moi toujours et Le Géant enfoui). Certains critiques ont trouvé les nouvelles inégales ou trop anecdotiques.
Les cinq nouvelles sont :
- "Crooner" : Un guitariste de rue américain à Venise se lie d'amitié avec Tony Gardner, une célèbre chanteur de crooner vieillissant. Ce dernier engage le musicien pour l'accompagner dans une sérénade destinée à sa femme, lors d'une nuit vénitienne, pour célébrer leur mariage... avant de lui annoncer leur divorce. Ishiguro s'intéresse aux artistes vieillissants, ratés ou en déclin (le crooner, le saxophoniste de "Nocturne"), qui voient leur gloire passer ou n'ont jamais réussi à percer. La musique, art éphémère par excellence, devient la métaphore parfaite de cette célébrité fugace.
- "Cela va de soi" : Dans une station thermale d'Europe centrale, un saxophoniste américain raté rencontre deux de ses idoles musicales. Il se retrouve mêlé à leurs querelles conjugales complexes et à un plan étrange qui mêle chirurgie esthétique et carrière musicale.
- "Maladie de langueur" : Un jeune pianiste accompagne une violoniste virtuose et charismatique dans les montagnes. Alors qu'elle se remet d'une opération, ils discutent de la nature du talent, du génie et des sacrifices nécessaires pour l'art.
- "Nocturne" : C'est la nouvelle la plus comique. Un saxophoniste de jazz, persuadé que son manque de succès est dû à son apparence physique, se retrouve dans un palace de luxe à Los Angeles, en convalescence après une chirurgie esthétique. Il y croise une star de cinéma dans la même situation et son manager, et vit des aventures nocturnes absurdes.
- "Cellistes" : À une terrasse de café en Italie, un violoncelliste hongrois prétentieux est subjugué par le talent d'une violoniste américaine. Il devient son "élève", bien qu'elle ne lui donne aucun enseignement technique. Leur relation, basée sur une admiration mutuelle et des malentendus, s'étend sur plusieurs années.
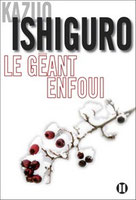
"Le Géant enfoui" ( The Buried Giant, 2015)
Traduction française : Éditions des Deux Terres, 2015 (traduit par Anne Rabinovitch)
Roman mêlant fantasy et allégorie sur la mémoire collective. "Le Géant enfoui" est le septième roman de Kazuo Ishiguro, prix Nobel de littérature 2017. Loin des dystopies scientifiques de "Auprès de moi toujours" (Never Let Me Go), l'auteur plonge le lecteur dans un Moyen Âge anglais mythique et brumeux, peuplé de chevaliers, de dragons et de moines. Mais derrière les apparences du roman de fantasy se cache une fable philosophique profonde et exigeante, interrogeant avec une sobriété poignante les mécanismes de la mémoire, de l'oubli et la nécessité ou le danger de faire face à la vérité historique.
Ishiguro utilise un langage simple, répétitif et presque enfantin, qui contraste avec la profondeur des enjeux. Ce style crée une atmosphère onirique, floue, à l'image du brouillard qui enveloppe le récit...
À sa sortie, Le Géant enfoui a divisé la critique et le public. Les Détracteurs ont critiqué son rythme lent, son style délibérément simple (parfois perçu comme plat) et son manque de résolution claire. Certains amateurs de fantasy pure ont été déçus par le traitement très littéraire et peu épique des éléments fantastiques. Les Laudateurs y ont vu une œuvre majeure, courageuse et profonde. Ils ont salué la manière dont Ishiguro utilise les codes de la fantasy pour mener une réflexion éthique et métaphysique rare, comparant souvent le livre aux mythes fondateurs ou aux paraboles bibliques.
"CHAPITRE 1- Vous auriez cherché longtemps le chemin sinueux ou la prairie paisible qui, depuis, ont fait la gloire de l’Angleterre. Il y avait des kilomètres de terre désolée, en friche ; ici et là, des sentiers rustiques sur les collines escarpées ou les landes désolées. La plupart des routes laissées par les Romains, endommagées, ou envahies par les mauvaises herbes, disparaissant le plus souvent dans la végétation sauvage. Des bancs de brouillard glacé suspendus au-dessus des rivières et des marécages, fort utiles aux ogres qui, à l’époque, vivaient encore dans ce pays. Les gens qui habitaient dans les environs – on se demande quelle désespérance les avait conduits à s’établir en des lieux si lugubres – redoutaient sans doute ces créatures, dont le halètement était audible bien avant que n’émergent de la brume leurs silhouettes difformes. Mais ces monstres n’étaient pas une source d’étonnement. Les gens devaient alors les considérer comme un risque banal, car en ce temps-là ils avaient bien d’autres sujets de préoccupation. Comment extraire de la nourriture du sol réfractaire ; ne pas se trouver à court de bois de chauffage ; enrayer la maladie qui pouvait tuer une douzaine de porcs en une seule journée et faire apparaître des éruptions verdâtres sur les joues des enfants.
En tout cas, les ogres n’étaient pas si méchants, pourvu qu’on ne les provoque pas. Il fallait accepter que, parfois, peut-être à la suite d’une obscure querelle dans leurs rangs, une créature fît irruption dans un village en proie à une fureur terrible, et qu’en dépit des cris et des armes brandies, elle se déchaînât, blessant quiconque tardait à s’écarter de son chemin. Ou que, de temps à autre, un ogre emportât un enfant dans la brume. Les gens devaient accepter avec philosophie de pareilles violences.
Dans une contrée au bord d’un vaste marécage, à l’ombre de collines dentelées, demeurait un couple âgé, Axl et Beatrice. Des noms peut-être inexacts ou incomplets, mais par commodité, nous les désignerons ainsi. Je dirais qu’ils menaient une vie isolée mais, à cette période, peu de gens vivaient « isolés » dans un sens que nous comprendrions. Pour la chaleur et la sécurité, les villageois habitaient dans des abris, souvent creusés à flanc de colline, communiquant par des tunnels et des couloirs protégés. Notre vieux couple résidait donc au fond d’un souterrain tentaculaire – « bâtiment » serait un mot trop grandiose – avec une soixantaine d’autres villageois. En quittant ce labyrinthe pour contourner la colline à pied pendant une vingtaine de minutes, on atteignait la colonie suivante, selon toute apparence identique à la première. Mais, pour les habitants eux-mêmes, de multiples détails leur inspirant de la fierté ou de la honte les différenciaient.
Je ne souhaite pas donner l’impression que la Grande-Bretagne se résumait à cela et qu’à l’époque où de magnifiques civilisations s’épanouissaient ailleurs dans le monde nous étions à peine sortis de l’Âge de fer. Si vous aviez eu le loisir de sillonner la campagne, vous auriez découvert des châteaux regorgeant de musique, de bonne chère, d’excellence sportive ; ou des monastères avec des habitants pétris d’érudition. Mais rien à faire. Montés sur un cheval puissant, par temps clair, vous auriez pu voyager des jours sans voir poindre un seul château, un seul monastère au-dessus de la végétation. Rencontrant surtout des communautés comme celle que je viens de décrire, et à moins d’être chargés de victuailles et de vêtements à offrir, ou d’être armés jusqu’aux dents, vous n’auriez pas été sûrs d’être bien accueillis. Je regrette de dépeindre un tel tableau de notre pays à cette période, mais c’est la vérité.
Revenons à Axl et Beatrice. Comme je l’ai dit, ce vieux couple vivait en bordure du souterrain, où son logis était moins protégé des éléments et bénéficiait à peine du feu de la grande salle, où tout le monde se réunissait le soir. Peut-être avaient-ils habité plus près du feu autrefois ; au temps où leurs enfants logeaient avec eux. C’était juste une idée qui traversait l’esprit d’Axl lorsqu’il restait allongé dans son lit pendant les heures vides avant l’aube, à côté de son épouse endormie, le cœur rongé par une sensation de perte innommable l’empêchant de trouver le sommeil.
Sans doute pour cette raison, Axl avait abandonné sa couche ce matin-là et s’était glissé sans bruit au-dehors pour s’asseoir sur le vieux banc gauchi près de l’entrée du souterrain, et attendre les premières lueurs du jour. C’était le printemps, mais l’air était encore vif, même avec la cape de Beatrice, qu’il avait prise en sortant et drapée sur lui. Il était si absorbé dans ses pensées que lorsqu’il eut conscience du froid qui le glaçait, les étoiles avaient toutes disparu, un rougeoiement s’étendait sur l’horizon, et les premières notes du chant des oiseaux émergeaient de l’obscurité.
Il se leva avec difficulté, regrettant d’être resté dehors si longtemps. Il était en bonne santé, pourtant il avait eu du mal à se débarrasser de sa dernière fièvre, et ne souhaitait pas rechuter. L’humidité montait dans ses jambes, mais quand il se tourna pour rentrer chez lui, il était très satisfait : il avait réussi ce matin à se rappeler nombre de choses qui lui échappaient depuis des semaines. De plus, il se sentait prêt à prendre une décision très importante – qu’il avait trop souvent reportée – et il était gagné par une excitation dont il souhaitait aussitôt faire part à sa femme.
À l’intérieur, les couloirs du labyrinthe étaient encore plongés dans l’obscurité, et il dut franchir à tâtons la courte distance le séparant de la porte de sa chambre ..."
L'histoire se déroule dans une Angleterre post-arthurienne, quelques décennies après le règne du roi Arthur. Un étrange "brouillard d'oubli" plane sur la terre, empêchant les gens de se souvenir de leur passé, même le plus récent. Au centre de ce monde amnésique, un couple de vieux paysans bretons, Axl et Beatrice, décide de partir en quête de leur fils, dont ils ont le sentiment confus qu'il les attend dans un village voisin. Leur périple les mènera à rencontrer des figures aussi diverses que Wistan, un guerrier saxon venu tuer le dragon Querig ; Edwin, un jeune garçon saxon marqué par un mystérieux passé ; et Sir Gawain, le vieux chevalier de la Table Ronde, dernier gardien des secrets d'Arthur.
Le récit est structuré comme une quête médiévale classique, avec son road-movie, ses rencontres périlleuses (ogres, monstres, soldats hostiles) et son objectif final : vaincre le dragon. Cependant, Ishiguro subvertit constamment les codes du genre. L'action est minimale, le rythme est lent et contemplatif, et la véritable aventure est intérieure. Ce n'est pas une quête de gloire, mais une quête de sens et de vérité personnelle et collective.
Le roman pose une question fondamentale : Sommes-nous encore nous-mêmes sans nos souvenirs ? Le lien tendre mais fragile entre Axl et Beatrice est construit sur des souvenirs effacés. Ils se savent profondément amoureux, mais ne se souviennent pas pourquoi. Leur peur n'est pas la mort, mais d'être séparés dans l'au-delà à cause de ce manque de preuves de leur amour. La quête du fils est donc une quête de leur propre histoire, du ciment de leur relation.
"... Qui sait ce que les démons chuchotent dans l’oreille de cet imbécile ? Un grand seigneur aujourd’hui, dans ce pays et celui d’à côté, pourtant il vit dans la terreur de tout voyageur saxon de l’est qui passe par ses terres. A-t-il entretenu sa peur de cette nuit-là au point qu’elle lui ronge aujourd’hui le ventre comme un ver géant ? Ou bien est-ce le souffle de la dragonne qui lui fait oublier la cause de la peur que je lui inspirais autrefois, et cette terreur sans nom n’en est-elle que plus monstrueuse ? L’année dernière à peine, un guerrier saxon des marais, que je connaissais bien, a été tué alors qu’il traversait paisiblement ce pays. Mais je reste redevable au seigneur Brennus pour la leçon qu’il m’a enseignée, car sans cela je pourrais aujourd’hui encore compter les Bretons comme mes frères d’armes. Qu’est-ce qui te trouble, jeune camarade ? Tu te balances d’un pied sur l’autre comme si ma fièvre te possédait toi aussi. »
Il avait donc échoué à dissimuler son agitation, mais Wistan ne pouvait sûrement pas suspecter sa tromperie. Était-il possible que le guerrier entendît la voix de sa mère ? Elle n’avait cessé de l’appeler pendant que le guerrier parlait. « Ne vas-tu pas trouver la force pour moi, Edwin ? Es-tu trop jeune après tout ? Viendras-tu vers moi, Edwin ? Ne m’as-tu pas promis de le faire ce jour-là ? »
« Je suis désolé, guerrier. C’est mon instinct de chasseur qui me rend impatient, car je crains de perdre l’odeur, et le soleil du matin se lève déjà dehors.
– Nous partirons dès que je serai capable de grimper sur le dos de cette jument. Mais laisse-moi encore un peu de temps, camarade, car comment pourrions-nous affronter un adversaire comme cette dragonne si je suis trop fiévreux pour soulever une épée? ..."
L'Oubli comme Paix Précaire et Instrument Politique - Le "brouillard" n'est pas un phénomène naturel ; il est la conséquence d'un sortilège de la magicienne Merlin, commandité par le roi Arthur lui-même. Son but était de faire oublier les atrocités commises lors des massacres systématiques des Saxons par les Bretons, afin de garantir une paix durable entre les deux peuples. Ishiguro explore ainsi l'idée que l'oubli peut être une condition nécessaire à la paix sociale. Se souvenir, c'est risquer de raviver la haine et la soif de vengeance. Le géant "enfoui" du titre est cette mémoire collective traumatique, ce passé violent et honteux qui menace de se réveiller.
Le Prix de la Vérité - La question morale au cœur du livre est : vaut-il mieux vivre dans un bonheur ignorant ou dans une vérité douloureuse ? La mission de Wistan, qui est de tuer le dragon et de dissiper le brouillard, est présentée comme juste (libérer les gens de leur amnésie). Pourtant, les personnages (et le lecteur) doutent des conséquences. Beatrice craint que la vérité ne sépare Axl et elle. La société entière risque de sombrer dans la violence ethnique une fois la mémoire restaurée. Il n'y a pas de réponse facile, et le roman maintient cette ambiguïté jusqu'au bout.

"Klara et le Soleil" ( Klara and the Sun, 2021)
Traduction française : Éditions des Deux Terres, 2021 (traduit par Anne Rabinovitch) - Editions Gallimard, 2021 - Le huitième roman de Kazuo Ishiguro, publié après son prix Nobel de littérature en 2017. S'inscrivant dans la veine de ses œuvres explorant les frontières de l'humain (Auprès de moi toujours), ce roman plonge le lecteur dans un futur proche dystopique à travers les yeux innocents et pourtant perçants de Klara, un AA (Amie Artificielle) solaire. Ishiguro utilise ce narrateur unique pour mener une enquête profondément émouvante et troublante sur la nature de l'amour, de la conscience, de la solitude et de ce qui, véritablement, nous rend humains. Aucune rébellion de robots, aucune apocalypse. La dystopie d'Ishiguro est domestique, psychologique et émotionnelle. Le danger réside dans l'acceptation tranquille d'un monde où l'on peut remplacer un enfant par une machine perfectionnée, où l'amour maternel peut envisager le clone comme une solution de secours. Ce n'est pas un livre sur les robots, mais un livre sur nous-mêmes. C'est une méditation inoubliable sur ce que nous sommes prêts à donner, à perdre et à faire pour aimer et être aimés. La fin, en particulier, est d'une tristesse immense precisely parce qu'elle est racontée avec simplicité et résignation. "Klara et le Soleil" a été majoritairement salué par la critique comme un retour magistral après le Nobel...
"Première partie - Quand Rosa et moi étions neuves, on nous avait placées au milieu de la boutique, à côté de la table des magazines, ce qui nous permettait de voir la moitié de la vitrine. Et donc d’observer la rue – les employés de bureau au pas pressé, les taxis, les coureurs, les touristes, l’Homme Mendiant et son chien, le bas du bâtiment du RPO. Lorsque nous fûmes bien installées, Gérante nous laissa nous avancer peu à peu, jusqu’à la vitrine, ce qui nous permit de découvrir la hauteur du bâtiment. Si c’était le bon moment, nous voyions le Soleil poursuivre sa trajectoire entre les toits de ce côté de la rue et le sommet du RPO.
Si j’avais cette chance, je penchais mon visage vers le Soleil pour absorber le plus de nutriment possible, et si Rosa se trouvait avec moi, je lui conseillais de m’imiter. Au bout d’une minute ou deux, il nous fallait reprendre nos places, et les premiers temps, nous craignions de devenir de plus en plus faibles, car de l’endroit où nous étions, il nous était souvent impossible de voir le Soleil. Boy AA Rex, qui se tenait alors près de nous, affirmait qu’il n’y avait pas de quoi s’inquiéter parce que le Soleil pouvait nous atteindre absolument n’importe où. Il désigna les lames du parquet et ajouta : « Voici le motif du Soleil. Si vous êtes inquiètes, touchez-le, et vous serez fortes à nouveau. »
Il n’y avait pas de clients quand il prononça ces mots, Gérante était occupée à disposer des objets sur les étagères rouges et je préférai ne pas la déranger en lui demandant la permission. Je lançai un coup d’œil à Rosa, et comme elle me fixait sans réagir, je fis deux pas avant de m’accroupir, les mains tendues vers le motif du Soleil sur le sol. Mais à peine l’avais-je effleuré du bout des doigts qu’il s’estompa, et malgré tous mes efforts – je tapotai le sol à cet endroit, et n’obtenant aucun résultat, je frottai les lattes –, il ne réapparut pas. Lorsque je me redressai, Boy AA Rex dit : « Klara, tu es trop avide. Les filles AA, vous êtes toujours si goulues. »
J’étais encore neuve, il me vint aussitôt à l’esprit que je n’y étais peut-être pour rien ; le Soleil s’était sans doute retiré à l’instant où j’avais effleuré le plancher. Mais le visage de Boy AA Rex resta empreint de gravité.
« Tu as gardé tout le nutriment pour toi, Klara. Regarde, il fait presque nuit. »
L’intérieur du magasin s’était en effet assombri. Dehors, à la limite du trottoir, le panneau de stationnement interdit fixé au lampadaire était devenu gris et flou.
« Je m’excuse », répondis-je à Rex, puis, me tournant vers Rosa : « Je m’excuse. Je n’ai pas fait exprès de tout garder pour moi.
— Par ta faute, reprit Boy AA Rex, je serai plus faible ce soir.
— Tu plaisantes, dis-je. J’en suis certaine.
— Pas du tout. Il se peut que je tombe malade tout de suite. Et les AA au fond du magasin ? Il y a déjà quelque chose qui ne va pas chez eux. Leur état va sûrement empirer à présent. Tu t’es montrée trop goulue, Klara.
— Je ne te crois pas », répliquai-je, mais je n’en étais plus aussi sûre. Je regardai Rosa, dont le visage restait impassible.
« Je ne me sens pas bien du tout », reprit Boy AA Rex. Et il s’affaissa.
« Mais tu viens toi-même de le dire. Le Soleil trouve toujours le moyen de nous atteindre. Tu plaisantes, je le sais. »
Je parvins enfin à me convaincre qu’il me faisait marcher. Mais ce jour-là, je sentis que, sans en avoir eu l’intention, j’avais poussé Rex à aborder un sujet embarrassant, dont la plupart des AA du magasin préféraient ne pas parler. Et peu après, ce qui arriva à Boy AA Rex me fit penser que même s’il avait plaisanté ce jour-là, il y avait eu une part de sérieux dans sa réponse.
C’était une matinée lumineuse, et Rex ne se trouvait plus avec nous parce que Gérante l’avait installé dans le renfoncement de la vitrine. Chaque emplacement était pensé avec soin, disait-elle, et l’endroit où nous étions n’intervenait en aucune manière dans le choix des clients. Nous savions tous que le regard d’une personne entrant dans la boutique se posait d’abord sur la devanture, et Rex fut naturellement satisfait d’y être placé à son tour. Nous l’observions depuis le milieu du magasin, debout, le menton en l’air, inondé par les rayons du Soleil, et Rosa se pencha vers moi pour dire : « Oh, il est vraiment magnifique ! Il va bientôt trouver une maison, c’est certain ! »
Rex entamait sa troisième journée dans la vitrine quand une fille entra avec sa mère. À l’époque je ne savais pas encore très bien deviner l’âge des gens, mais je me souviens d’avoir estimé qu’elle devait avoir treize ans et demi, et je pense aujourd’hui ne pas m’être trompée. La mère travaillait dans un bureau, et on voyait à ses chaussures et à son tailleur qu’elle occupait un poste important. La fille alla aussitôt se planter devant Rex, pendant que la femme s’avançait dans notre direction, nous jetant un coup d’œil avant de continuer vers le fond du magasin où deux AA, perchés sur la table en verre, balançaient les jambes sur les conseils de Gérante. À un moment donné, la mère appela sa fille, mais la petite l’ignora, continuant de dévisager Rex. Elle tendit une main puis la fit glisser sur son bras. Il resta silencieux, bien sûr, et se contenta de sourire, immobile, ainsi qu’on nous avait recommandé de le faire lorsqu’un client nous portait un intérêt particulier.
« Regarde ! chuchota Rosa. Elle va le choisir. Elle l’aime. Quelle chance il a ! » Je lui lançai un coup de coude pour la faire taire car on pouvait nous entendre.
À son tour, la fille appela sa mère qui vint la rejoindre, et elles examinèrent Boy AA Rex de haut en bas, la petite se penchant de temps à autre pour le toucher. Elles discutèrent à voix basse, et j’entendis la fillette dire à un moment donné : « Mais il est parfait, maman. Il est superbe. » Un instant plus tard, elle s’écria : « Oh, maman, arrête ! »
Gérante s’était approchée sans bruit derrière elles. La mère finit par se retourner et demanda :
« C’est quel modèle ?
— Un B2. Troisième série. Pour l’enfant idoine, Rex sera un parfait compagnon. Je suis sûre qu’il encouragera une jeune personne à se montrer consciencieuse et appliquée dans ses études.
— Eh bien, cette demoiselle en aurait en effet grand besoin.
— Oh, maman, il est parfait. »
La mère dit alors : « B2, troisième série. Ceux qui ont des problèmes d’absorption solaire, c’est ça ? »
Elle prononça cette phrase l’air de rien, devant Rex, sans se départir de son sourire. Rex resta souriant lui aussi, mais l’enfant parut décontenancée, fixant tour à tour Rex et sa mère.
« En effet, reprit Gérante, la troisième série a connu quelques difficultés mineures au début. Mais ces signalements étaient très exagérés. Dans un environnement où la luminosité est normale, il n’y a aucun problème.
— J’ai entendu dire qu’une malabsorption solaire peut causer d’autres complications, insista la mère. Même sur le plan du comportement...."
Klara est un AA de modèle B2, dotée d'une extraordinaire capacité d'observation et d'une soif d'apprendre. Depuis le magasin où elle est en vente, elle admire le Soleil, dont elle dépend pour son énergie et qu'elle vénère comme une force bienveillante et divine. Elle est choisie par Josie, une adolescente fragile et malade, et par sa mère, une femme angoissée et secrète.
Klara s'installe dans la maison et s'attache profondément à Josie. Elle observe le monde qui l'entoure : la mère dont l'amour est teinté d'un projet terrible, le père séparé et techno-sceptique, et Rick, le voisin et seul ami de Josie, amoureux d'elle mais menacé par les inégalités sociales d'un monde où les enfants "liftés" (génétiquement modifiés pour accroître leurs capacités cognitives) ont un avantage décisif sur les autres.
Le récit, structuré comme un journal d'apprentissage, est entièrement narré du point de vue limité et littéral de Klara. Sa compréhension du monde est sensorielle, fragmentaire, et se construit par le biais de métaphores qu'elle doit décoder (elle assimile la tristesse à une "nourriture spéciale"). La véritable quête n'est pas extérieure, mais intérieure : Klara cherche à comprendre les émotions humaines, le sacrifice, et le sens de sa propre existence pour, peut-être, sauver celle qu'elle aime.
" ... Dehors, Rick commença à descendre l’escalier en planches en direction de l’herbe. Il le fit lentement, comme s’il rêvait tout éveillé, et je vis, à la position de son bras plaqué contre sa poitrine, qu’il tenait encore le dessin de Josie. Sa tête et ses épaules disparurent de ma vue. Miss Helen continua :
« Voici ce que je voulais vous demander en réalité, Klara. Ma vraie requête, celle qui me tient à cœur. Pourriez-vous demander à Josie de tenter de convaincre Rick ? Elle est la seule personne qui pourrait lui faire changer d’avis. Il est très têtu, vous voyez, et aussi – je le soupçonne – assez effrayé. Qui peut l’en blâmer ? Il sait que le monde du dehors ne sera pas facile. Josie est la seule capable de lui présenter les choses sous un angle différent. Vous voudrez bien lui parler ? Je sais que vous avez une forte influence sur elle. Vous feriez ça pour moi ? Et ne le faites pas une seule fois, mais encore et encore, pour qu’elle exerce une réelle pression sur lui.
— Je le ferais bien sûr avec plaisir. Mais je pense que Josie a déjà parlé à Rick dans ce sens. Leur désaccord actuel a peut-être un rapport avec le fait que Josie s’est exprimée trop fermement à ce sujet.
— C’est une information intéressante. Si ce que vous dites est exact, ce que je vous demande est plus important que jamais. Josie a peut-être l’impression qu’elle doit céder pour se réconcilier avec lui. Elle peut en arriver à se dire qu’elle a eu tort d’adopter une telle attitude. Alors vous devez parler avec elle. La prier de persévérer, sans tenir compte de ses coups de colère. Il y a un problème, mon petit ?
— Je suis désolée. C’est juste que je suis un peu surprise.
— Ah ? Pourquoi donc, ma chère ?
— Eh bien je… Franchement, je suis surprise parce que la requête de Miss Helen concernant Rick paraît très sincère. Je suis surprise qu’une personne souhaite avec autant de vigueur suivre une voie qui la plongera dans la solitude.
— Et c’est ce qui vous surprend ?
— Oui. Jusqu’à ces derniers temps, je ne pensais pas que les humains pouvaient choisir la solitude. Que le désir de ne pas être seul pouvait être balayé par une force plus puissante. »
Miss Helen sourit. « Vous êtes vraiment mignonne. Vous ne parlez pas beaucoup, mais je vois que vous réfléchissez. L’amour d’une mère pour son fils. Un sentiment si noble, pour surmonter la peur de la solitude. Et peut-être que vous avez raison. Mais voyez-vous, il existe toutes sortes d’autres très bonnes raisons pour lesquelles, dans une vie comme la mienne, on pourrait préférer la solitude. J’ai souvent fait ce choix dans le passé. Je l’ai fait, par exemple, plutôt que de rester avec le père de Rick. Feu son père, malheureusement, bien que Rick n’ait aucun souvenir de lui. Même ainsi, il est resté mon mari quelque temps, et il ne s’est pas montré tout à fait inutile dans ce rôle. C’est grâce à lui que nous nous en sortons de cette façon, même si nous ne vivons pas exactement dans le luxe. Voici Rick qui revient. Ah non. Il préfère rester dehors et bouder encore. »
En effet, Rick venait de gravir l’escalier en planches et il avait jeté un coup d’œil vers la maison, mais il s’était assis sur la marche du haut, nous tournant le dos une fois de plus...."
Le roman explore une question philosophique majeure : la conscience et l'amour sont-ils réductibles à un ensemble d'algorithmes ? Klara apprend en imitant, mais développe-t-elle pour autant une conscience authentique ? Ishiguro brouille les frontières. Klara fait preuve d'un altruisme, d'une dévotion et d'une intuition qui semblent dépasser sa programmation. La question n'est pas "Klara peut-elle penser ?" mais "Klara peut-elle aimer ?" et, en miroir, les humains qui l'entourent en sont-ils encore capables ?
L'Amour Conditionnel et Inconditionnel - Klara incarne l'amour inconditionnel. Elle aime Josie sans attente, sans jalousie, prête à tous les sacrifices. Cet amour contraste violemment avec les relations humaines, souvent conditionnées par des attentes, des projets (celui, terrible, de la Mère) et des faiblesses. Ishiguro questionne : un amour purement altruiste est-il l'apanage des machines ? L'égoïsme et la peur sont-ils constitutifs de l'humain ?
Un Monde Dystopique de Classes et de Contrôle - En arrière-plan, Ishiguro dresse la critique d'une société hyper-capitaliste et inégalitaire. Le "lift" des enfants crée une nouvelle stratification sociale brutale. Le chômage massif dû à l'automatisation a déstructuré la société. La Mère elle-même est un produit de ce système : son anxiété et ses décisions radicales sont motivées par la peur que sa fille ne soit pas "compétitive". La technologie n'y est pas présentée comme un monstre évident, mais comme une force qui corrode insidieusement les liens humains et exacerbe les peurs.
Klara développe une religion personnelle centrée sur le Soleil. Elle le prie, lui fait des promesses, interprète les phénomènes naturels (comme la couche de pollution qui obscurcit son disque) comme des signes divins. Sa quête pour sauver Josie prend des allures de pèlerinage et de sacrifice rituel. Ishiguro explore ainsi la nature de la foi et de l'espoir, même chez un être de raison, et questionne le pouvoir de la croyance face à la froideur des faits scientifiques.
