- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Svevo - Pirandello
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki
- 1930-1940
- 1930s
- Fitzgerald
- Hemingway
- Faulkner
- Koch
- Céline
- Bernanos
- Jouve
- DosPassos
- Kojève
- Miller-Nin
- Grosz - Dix
- Green
- Ortega y Gasset
- Wittgenstein
- Russell - Carnap
- Artaud
- Jaspers
- Sapir - Piaget
- Guillén
- Garcia Lorca
- Hammett
- A.Christie
- Heidegger
- Icaza
- Huxley
- Hubble
- Caldwell
- Steinbeck
- Waugh
- Blixen
- Rhys
- J.Roth - Doderer
- Aub
- Malraux-StExupéry
- DBarnes-NWest
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bataille
- Char-Michaux
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Bloch
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Lewin - Mayo - Maslow
- Montherlant
- Buzzati - Pavese
- Vittorini
- Fallada
- Malaparte
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Welty
- Boulgakov
- Tamiki - Yôkô
- Weil
- Gadda
- Broch
- Steeman
- Jouhandeau
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Ellison
- Bergman
- Baldwin
- Fromm
- Bradbury - A.C.Clarke
- Tennessee Williams
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Carpentier
- Mishima
- Salinger - Styron
- Pasternak
- Asturias
- O'Connor
- Hoffer
- Matute - MartinGaite
- 1960-1970
- 1960s
- Abe
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- U.Johnson - C.Wolf
- Heller - Toole
- Naipaul
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Onetti - Sábato
- Capote
- Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- McCarthy - Minsky
- Sillitoe
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- Lenz
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Dolls
- Ellis
- Cortázar
- Warhol
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- HarperLee
- Fuentes
- 1970-1980
- 1970s
- Habermas
- Handke
- GarciaMarquez
- Deleuze
- Derrida
- Beck
- Satir
- Kundera
- Hrabal
- Didion
- Guinzbourg
- Lovelock
- Vietnam
- H.S.Thompson - Bukowski
- Pynchon
- E.T.Hall
- Bateson - Watzlawick
- Carver
- Irving
- Milgram
- VargasLlosa
- Puig - Donoso
- Lasch-Sennett
- Crozier - Touraine
- Friedan-Greer
- Jacob-Monod
- Dawkins
- Beattie - Phillips
- Gaddis
- Rawls
- Zinoviev
- H.Searles
- Ballard
- Jong
- Kôno
- Calvino
- Ballester-Delibes
- ASchmidt
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact

Elfried Jelinek (1946), "Die Liebhaberinnen" (1975), "Die Klavierspielerin" (1983), "Lust" (1989) - ...
Last Update : 12/31/2016

Elfriede Jelinek est une figure unique et provocante de la littérature autrichienne et mondiale, marquée par son style radical, son engagement féministe et sa critique implacable des structures de pouvoir...
C'est à une critique totale de l’Autriche (et du monde) que se livre Elfried Jelinek, un prix Nobel controversé (2004), - trop politique, dira-t-on, mais elle a toujours refusé de séparer littérature et engagement et contrairement à d’écrivains autrichiens plus "esthètes" (Handke, Bernhard), elle a centré son œuvre sur les exclus, femmes, ouvriers, étrangers (Die Ausgesperrten).
Elle ira jusqu'à interdire la représentation de ses pièces en Autriche pendant des années pour protester contre l’ascension de l’extrême droite (FPÖ), s'attaquera à la "culture autrichienne", son folklore ("In den Alpen", sur le nationalisme alpin), l’antisémitisme latent ("Die Kinder der Toten"), et l’amnésie historique (son refus du Staatsvertrag commémorant l’après-guerre). Contrairement à d’autres autrices, elle rejette toute "réconciliation" avec le système, ce qui lui vaut des critiques y compris dans les milieux féministes modérés. Elle déconstruit les discours dominants (patriarcat, capitalisme, nationalisme) en les poussant à l’absurde, révélant leur hypocrisie ("Totenauberg", sur le passé nazi de l’Autriche). Et dans ses pièces ("Ce qui arriva quand Nora quitta son mari"), elle met en scène la violence sociale avec une radicalité qui rappelle Thomas Bernhard ou Heiner Müller.
Féministe radicale et anti-conformiste, elle se livre à une implosive dénonciation du patriarcat, expose la sexualité comme un rapport de pouvoir ("Lust" est le roman qui démonte les fantasmes masculins) et le corps féminin un véritable champ de bataille : dans "La Pianiste", elle explore l’autodestruction d’une femme écrasée par l’éducation oppressive et le désir contrôlé.
Une critique radicale portée par un style littéraire explosif et expérimental, un langage fragmenté et polyphonique : son écriture mêle monologues intérieurs, slogans publicitaires, clichés médiatiques et références populaires dans un flux souvent hypnotique et violent ("La Pianiste", "Les Exclus").
Malgré (ou grâce à) la polémique, Elfriede Jelinek a bénéficié d'une influence mondiale, en témoignent ses adaptations cinématographiques ("La Pianiste" (Michael Haneke, 2001) a révélé son univers au grand public) et ses pièces jouées dans le monde entier, souvent comme armes contre les conservatismes...

Elfried Jelinek (1946)
Ses romans (les Exclus, 1980 ; la Pianiste, 1983 ; Lust, 1989 ; Die Kinder der Toten, 1995) et son théâtre (Ce qui arriva à Nora quand elle quitta son mari,
Burgtheater) dénoncent l'oppression de la femme et une société autrichienne qu'elle juge répressive et imprégnée de son passé nazi. Sans tabou, Jelinek emploie tous les registres du
langage possibles, burlesque, tragique, cruauté, jeux de mots, métaphores qui rendent les traductions de ses ouvrages particulièrement ardues. Dans la lignée de ces critique impitoyables de la
société que sont Thomas Bernhard ou Karl Kraus, Jelinek montre à quel point ses compatriotes peuvent être amenés à tirer partie de tout pour exercer la moindre parcelle de pouvoir, et compenser
ainsi leur médiocrité..

Née en Styrie (Autriche), fille d'un chimiste juif d'origine tchèque et d'une grande bourgeoise catholique d'origine roumaine à qui elle reprochera une présence vampirisante qui, dès son plus jeune âge, l'obligera à apprendre la musique. Elfriede Jelinek fait des études de théâtre, publie "Les Amantes" (1975) et s'impose en 1983 avec "La Pianiste" - portée au cinéma par Michael Haneke. Titulaire d’un diplôme d’organiste, Jelinek entend promouvoir en Autriche l’œuvre, qu’elle estime méprisée, d’Arnold Schönberg, Alban Berg et Anton von Webern. En 1974, elle s'inscrit au KPÖ, le parti communiste autrichien et polémique avec virulence avec la presse conservatrice et l'extrême-droite.
Souvent considérée comme une descendante de Thomas Bernhard, Elfriede Jelinek s'est en effet toujours montrée très critique envers un pays fondé sur l'hypocrisie : "on croit que nous avons été occupés par les Allemands contre notre gré. Nous étions "innocents" et, dès lors, nous le sommes toujours. Mais pour quiconque ayant grandi dans l'après-guerre, on saisit bien toute cette contradiction, cette ambiguïté. L'Autriche a en effet connu une très rapide dénazification, qui s'est vite arrêtée pour ne jamais reprendre." Son œuvre en prose (romans et pièces de théâtre) utilise la violence, le sarcasme et l'incantation afin d'analyser et de détruire les stéréotypes sociaux et les archétypes du sexisme : : "Les Exclus" (Die Ausgesperrten, 1981), "Lust" (1989), "Enfants des morts" (Die Kinder der Toten, 1995), "Avidité" (Gier, 2000), "Ce qui arriva quand Nora quitta son mari" (Was geschah, nachdem Nora ihren Mann verlassen hatte oder Stützen der Gesellschaften, 1977)..
„Die Frau muß sehen, daß sie unterkommt, das heißt heiratet, das heißt ein Heim bekommt, das heißt einen Mann kriegt, das heißt in Lohnarbeit eintritt oder in die Reproduktionsarbeit, das heißt Kinder bekommt, das heißt im Heim bleibt. Die Frau ist nicht vorgesehen für anderes.“
Extrait de Die Liebhaberinnen (Rowohlt, 1975)
"La femme doit veiller à s'en sortir, c'est-à-dire se marier, c'est-à-dire obtenir un foyer, c'est-à-dire avoir un homme, c'est-à-dire entrer dans le travail salarié ou reproductif, c'est-à-dire avoir des enfants, c'est-à-dire rester au foyer. La femme n'est pas prévue pour autre chose."
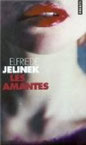
"Die Liebhaberinnen" (1975, Women as Lovers, Les Amantes)
Paru en 1975, "Les Amantes" est rapidement devenu le livre de référence de toute une génération. L’absence de majuscules, le style syncopé, l’ironie jubilatoire et le pessimisme profond tiraient le lecteur allemand de la torpeur et des certitudes où l’avait plongé le miracle économique. "Die Liebhaberinnen" conte la vie de deux jeunes femmes issues d’un milieu ouvrier rural autrichien, Brigitte et Paula, qui partagent l’ambition d’échapper à leur condition sociale par le mariage. Autant Brigitte est froide et calculatrice et vise méthodiquement un avenir stable en tentant de se faire épouser par Heinz, un technicien ambitieux (elle manipule ses sentiments et va jusqu’à simuler une grossesse), autant Paula est plus romantique et idéaliste : elle tombe amoureuse d’un menuisier, Erich, et s’enfuit avec lui. Mais cet amour se révèle destructeur ; Paula finit par être abandonnée et sombrer dans une vie de pauvreté et de servitude domestique.
„Brigitte denkt, daß Heinz sie heiraten wird. Sie rechnet mit ihrer Jugend, mit der Wohnung, mit ihrer Arbeitsamkeit, mit der Disziplin. Heinz soll alles sehen, was sie tut, damit er sie nimmt. Brigitte möchte eine Frau werden.“
"Brigitte pense que Heinz l’épousera. Elle compte sur sa jeunesse, son appartement, sa capacité à travailler, sa discipline. Heinz doit voir tout ce qu’elle fait, pour qu’il la prenne. Brigitte veut devenir une femme."
Le roman alterne les points de vue narratifs externes, ironiques et distanciés, brisant toute illusion réaliste pour détourner les codes du Bildungsroman : il n’y a pas d’émancipation, seulement un apprentissage de la résignation. La progression n’aboutit pas à une autonomie, mais à une soumission à l’ordre établi, ce qui confère à l'œuvre une dimension profondément tragique. Le mariage n'est qu'un marché où se jouent pouvoir et domination, un rituel d’aliénation sociale : les femmes sont soit des marchandises à consommer (Paula), soit des stratèges qui utilisent leur corps comme capital (Brigitte).
„Paula will sich nicht mehr erinnern. Es ist besser, wenn man nicht mehr weiß, was einem passiert ist. Wer viel weiß, kann sich nicht anpassen. Paula hat aufgehört zu fragen. Paula wird nie mehr etwas wollen.“
"Paula ne veut plus se souvenir. Il vaut mieux ne pas savoir ce qui vous est arrivé. Qui sait trop ne peut pas s’adapter. Paula a cessé de poser des questions. Paula ne désirera plus jamais rien."
Pour reprendre Sigrid Löffler (Berlin, 1990s) et les analyses de Gitta Honegger ("Thomas Bernhard, Elfriede Jelinek, and the Austrian Illness", Yale University Press, 2001), et parler un peu savamment, Jelinek emploie une langue dépouillée, quasi bureaucratique, pour montrer comment le langage lui-même participe à l'oppression : les clichés et le langage ordinaire révèlent la structure patriarcale internalisée chez les personnages...
(traduction française Seuil)
... Un jour, Brigitte décida qu’elle voulait être toute la femme, et la seule, pour un homme nommé Heinz. Elle était convaincue qu’à partir de maintenant, ses faiblesses deviendraient des forces et ses forces, soigneusement dissimulées. Heinz, cependant, ne trouvait rien d’attachant chez Brigitte, et ses faiblesses ne faisaient que le repousser. Désormais, Brigitte soignait aussi son apparence pour Heinz, car lorsqu’on est une femme, on ne peut plus faire demi-tour : il faut prendre soin de son allure. Brigitte espérait que l’avenir la remercierait un jour en lui accordant un visage plus jeune. Mais peut-être Brigitte n’avait-elle tout simplement pas d’avenir. Celui-ci dépendait entièrement de Heinz.
Quand on est jeune, on a toujours l’air jeune ; quand on est plus âgée, de toute façon, il est trop tard. Si l’on ne paraît pas rajeunir, le jugement du monde est impitoyable : Tu n’as pas pris soin de toi dans ta jeunesse ! Alors Brigitte avait fait quelque chose qui compterait plus tard.
Si l’on n’a pas de présent, il faut se préparer un avenir.
Brigitte cousait des soutiens-gorge. Si la couture est courte, il faut en faire beaucoup, quarante au minimum pour atteindre le quota. Si la couture est plus longue et complexe, on en fait moins. C’est très humain et juste.
Brigitte pourrait embaucher beaucoup d’ouvrières, mais elle voulait obtenir le seul et unique Heinz, qui allait devenir homme d’affaires. Le tissu était de la dentelle nylon doublée d’une fine mousse. Son usine avait de nombreuses parts de marché à l’étranger et beaucoup d’ouvrières venues de l’étranger. Beaucoup abandonnaient à cause d’un mariage, d’un enfant ou de la mort. Brigitte espérait qu’un jour, elle abandonnerait pour un mariage et un enfant. Elle espérait que Heinz la sortirait de là.
Toute autre issue serait sa mort, même si elle restait en vie.
Pour l’instant, B. n’avait que son nom. Au fil de l’histoire, Brigitte recevrait le nom de Heinz, ce qui était plus important que l’argent et les biens, car cela pouvait les procurer. La vraie vie, celle qui peut donner son avis si on le lui demande, c’est la vie après le travail. Pour Brigitte, vie et travail étaient comme le jour et la nuit. Alors, dans cette histoire, il sera surtout question de temps libre.
Dans ce cas précis, la vie s’appelait Heinz. La vraie vie n’était pas seulement nommée Heinz, elle était Heinz. En dehors de Heinz, il n’y avait rien. Tout ce qui était mieux que Heinz était absolument hors de portée pour Brigitte ; tout ce qui était pire, elle n’en voulait pas. Brigitte se battait désespérément, bec et ongles, contre la déchéance. La déchéance, c’était la perte de Heinz. Mais Brigitte savait aussi qu’il n’y avait pas d’ascension sociale pour elle : il n’y avait que Heinz, ou pire que Heinz, ou bien coudre des soutiens-gorge jusqu’à la fin de ses jours. Coudre sans Heinz, c’était la fin de sa vie, tout de suite.
Il ne tenait qu’au hasard que Brigitte vive avec Heinz ou sombre et se perde. Il n’y avait pas de règles. Le destin décidait du sort de Brigitte.
Ce n’était pas ce qu’elle faisait ou ce qu’elle était qui comptait, mais Heinz, ce qu’il faisait et ce qu’il était. Brigitte et Heinz n’avaient pas d’histoire. Ils n’avaient que du travail. Heinz devait devenir l’histoire de Brigitte, il devait lui fabriquer une vie à elle, puis lui faire un enfant, dont l’avenir serait à son tour façonné par Heinz et son métier. L’histoire de B. et H. n’était pas quelque chose qui grandissait, c’était quelque chose qui apparaissait soudain (flash), et s’appelait l’amour.
L’amour venait du côté de Brigitte. Elle devait convaincre Heinz qu’il venait aussi de son côté à lui. Il devait apprendre à voir que, pour lui aussi, il n’y avait pas d’avenir sans Brigitte. Bien sûr, Heinz avait bel et bien un avenir, en tant qu’électricien. Il pouvait l’avoir même sans Brigitte. On pouvait installer des câbles électriques sans que B. soit présente. On pouvait même vivre ! Et on pouvait jouer au bowling ou aux quilles sans Brigitte. Brigitte, elle, avait un devoir.
Elle devait constamment rappeler à Heinz que, sans elle, il n’avait pas d’avenir. Ce qui demandait un effort considérable. En plus, il fallait prendre des mesures épuisantes pour éviter que Heinz ne voie son avenir en quelqu’un d’autre. Nous y reviendrons. C’était une situation fatigante, mais prometteuse. Heinz voulait devenir, et deviendrait un jour, un petit entrepreneur avec sa propre petite entreprise. Un jour, Heinz passerait des commandes, et Brigitte serait aussi commandée. Elle préférait être commandée par son propre mari dans sa propre boutique, qui serait aussi un peu la sienne.
Pourvu que Heinz ne rencontre pas un jour une lycéenne, par exemple, Susi ! Pourvu qu’il ne croie pas, Dieu nous en préserve, qu’une femme meilleure que Brigitte ne le soit aussi pour lui. Si Heinz trouvait mieux, il devrait s’en détourner. Le plus sûr serait qu’il ne le découvre jamais.
Quand Brigitte était à sa machine, cousant extensible, sentant sous ses doigts la mousse et les bordures de dentelle rigide, le nouveau soutien-gorge sorcière à la mode, elle faisait des cauchemars à cause de quelqu’un qui n’existait pas encore, mais qui, sous la forme de quelque chose de mieux, pourrait croiser la route de Heinz.
Brigitte n’avait même pas la paix au travail. Même là, elle devait travailler. Elle n’était pas censée penser en travaillant, mais quelque chose en elle pensait sans arrêt. Brigitte ne pouvait pas améliorer sa vie elle-même. Le mieux devait venir de la vie de Heinz. Lui pouvait la libérer de sa machine à coudre, elle ne le pouvait pas seule. Mais elle ne pouvait en être certaine, car le bonheur arrive par hasard et n’est ni une loi ni la conséquence logique des actions.
Brigitte voulait que son avenir lui soit donné. Elle ne pouvait pas le produire elle-même.
Leur histoire n’avait rien d’extraordinaire. Eux-mêmes n’avaient rien d’extraordinaire. Ils étaient simplement symptomatiques de tout ce qui est ordinaire.
Souvent, des étudiants et des étudiantes – ce qui est presque la même chose, à part le sexe – se rencontrent. Souvent, on peut raconter des histoires excitantes sur de telles rencontres. Ces gens-là ont parfois même une longue préhistoire. Bien que celle de Brigitte soit plutôt défavorable à l’accumulation future de richesses, elle avait tout de même rencontré Heinz, entre les mains duquel ces richesses finiraient par s’accumuler.
Brigitte était la fille illégitime d’une mère qui cousait les mêmes choses qu’elle : des soutiens-gorge et des gaines. Heinz était le fils légitime d’un chauffeur de camion et de sa femme, qui avait eu le droit de rester à la maison. Malgré cette différence criante, B. et H. s’étaient rencontrés.
Dans ce cas précis, se rencontrer signifiait vouloir fuir et/ou ne pas lâcher prise et s’accrocher. Heinz avait appris un métier qui un jour lui ouvrirait le monde entier : électricien. Brigitte, elle, n’avait jamais rien appris. Heinz était quelque chose, Brigitte n’était rien que d’autres ne puissent être sans effort. Heinz était unique, et on avait souvent besoin de lui – en cas de panne électrique ou par besoin d’amour. Brigitte était remplaçable et superflue. Heinz avait un avenir, Brigitte n’avait même pas de présent. Heinz était tout pour Brigitte, le travail n’était qu’une misère accablante. Un homme qui vous aime, c’est tout. Un homme qui vous aime et qui, en plus, est quelqu’un, c’était le mieux que Brigitte puisse atteindre. Le travail n’était rien, car elle l’avait déjà ; l’amour était plus, car il fallait d’abord le trouver.
Brigitte avait déjà trouvé : Heinz. Heinz se demandait souvent ce que Brigitte avait à offrir. Il jouait souvent avec l’idée de prendre quelqu’un d’autre, une femme qui avait quelque chose à apporter – de l’argent, par exemple, ou un local adapté pour une boutique.
Brigitte avait un corps à offrir.
Mais en dehors du sien, beaucoup d’autres corps inondaient le marché. Les seuls alliés de Brigitte sur ce chemin étaient l’industrie cosmétique et l’industrie textile. Brigitte avait des seins, des cuisses, des jambes, des hanches et un sexe. D’autres en avaient aussi, parfois de meilleure qualité.
Brigitte avait la jeunesse, qu’elle partageait aussi avec d’autres – l’usine, son bruit, le bus bondé. Tout cela rongeait sa jeunesse.
Brigitte vieillissait et devenait de moins en moins femme, tandis que la concurrence rajeunissait et devenait de plus en plus femme.

"Was geschah, nachdem Nora ihren Mann verlassen hatte oder Stützen der Gesellschaften" (1977, Ce qui arriva quand Nora quitta son mari)
Jelinek détourne un classique pour en faire une critique radicale du présent. Elle reprend le personnage de Nora, l’héroïne d’ "Une maison de poupée" (1879) d’Henrik Ibsen, qui quitte son mari pour se libérer de son rôle d’épouse-objet. Mais là où Ibsen laissait Nora partir vers un avenir incertain, Jelinek montre ce qui lui arrive vraiment après sa fuite : une plongée dans la violence sociale et économique qui attend les femmes "indépendantes"...
- Acte 1 : La chute de Nora - Nora, après avoir quitté son mari Torvald, se retrouve sans argent, sans statut et sans protection. Elle tente de travailler, mais les emplois disponibles (secrétaire, ouvrière) sont sous-payés et humiliants. Les hommes qu’elle rencontre (un patron, un collègue, un "ami") ne voient en elle qu’un objet sexuel ou une main-d’œuvre corvéable.
- Acte 2 : La prostitution sociale - Faute de moyens, Nora doit se vendre (littéralement ou symboliquement). Elle devient la maîtresse d’un riche industriel, qui la traite comme un jouet, tout comme Torvald. Scène-clé : Elle danse pour lui comme une poupée mécanique, répétant les gestes de son ancienne vie.
- Acte 3 : La révolte avortée -Nora tente de se rebeller, mais la société la broie : si elle dénonce son exploiteur, personne ne la croit; et si elle vole pour survivre, elle est criminalisée. Elle finit par retourner chez Torvald, brisée, réalisant que la "liberté" n’existe pas pour les femmes dans un système patriarcal.
- Épilogue : La boucle infernale - La pièce se termine sur Nora regardant le public, comme pour dire : "Vous croyez que c’est une fiction ? C’est votre réalité."
L’impossible émancipation féminine : Jelinek montre que la "libération" individuelle (comme celle de Nora) est un leurre dans une société capitaliste et patriarcale. Et que ce soit dans le mariage, le bureau ou l’usine, la femme reste une force de travail non reconnue.
Les personnages parlent en slogans, clichés médiatiques ou discours publicitaires et s’adressent parfois au public, brisant l’illusion théâtrale. La pièce est traversée d’une ironie cinglante (ex. : Nora répète mécaniquement "Je suis libre" comme un mantra vide). Une pièce culte du théâtre féministe ..
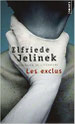
"Die Ausgesperrten" (1980, The Excluded: In the Wake of the Flood, Les Exclus)
"Die Ausgesperrten" met en scène la deuxième génération après le nazisme, marquée non pas par le souvenir, mais par le vide de la mémoire. Les adultes se taisent, les adolescents hurlent. Le passé nazi n’est pas traité, mais infiltre les corps et les mots...
« Die Vergangenheit ist wie eine Sperre, durch die sich niemand bewegt. »
(Le passé agit comme une barrière que personne ne traverse.)
Le titre "Die Ausgesperrten" évoque autant ceux qui sont exclus que ceux qui se tiennent hors d’eux-mêmes, incapables d’habiter leur histoire ou leur corps. A Vienne, dans les années cinquante, quatre adolescents s'associent pour dévaliser et frapper des passants. En particulier Sophie Pachhofen, une lycéenne issue d’un milieu bourgeois et ses trois camarades masculins (Rainer, Hans et Paul), tous issus de classes sociales différentes. Rainer, le plus brillant, le cerveau de la bande, ira jusqu'à assassiner toute sa famille. Inspiré par un fait divers qui épouvanta l'Autriche, ce roman dénonce une société saturée de violence diffuse, de sexualité désincarnée et d’autorité familiale rigide, dans une Autriche marquée par le silence autour du nazisme et la restauration conservatrice d'après-guerre.
(traduction française, Seuil)
"Sie wissen nicht, wohin mit ihrer Wut, also lassen sie sie wachsen" - Le roman décrit des scènes de sexualité violente, répétitive, désubjectivée, sans désir ni plaisir. Elle n’est pas transgressive, mais conditionnée par les structures sociales, patriarcales, autoritaires. Les adolescents « jouent » à être libres sexuellement, mais ils imitent les rapports de domination de leurs parents. La sexualité devient un langage socialement appris, et non une expression du moi. Selon Gitta Honegger (1991), c’est une «sexualité traumatique», où l’histoire collective s’infiltre dans l’intime. Le récit qui en fait semble déshumanisé, à l’image d’un monde sans repères éthiques et marqué surtout par un refus de tout point de vue psychologique intérieur.
La critique de l’éducation et de la famille autrichienne est au centre du roman : les figures parentales sont absentes, autoritaires, complices du refoulé historique, et l’école n'est qu'un lieu de dressage social. Le foyer familial est l’atelier de production de la soumission. Les adolescents sont "ausgesperrt", exclus de toute forme d’humanité durable. Sophie et ses amis sont à la fois victimes de l’ordre conservateur post-nazi et complices inconscients de sa reproduction ...

Une adaptation cinématographique, "Die Ausgesperrten" (1990) par Franz Novotny, validée par Jelinek, avec Sophie Rois dans le rôle de Sophie Pachhofen : le passage de la syntaxe à l’image est forcément une perte, mais aussi une recomposition...
Comparer" Die Ausgesperrten" (1990) de Franz Novotny à "Die Klavierspielerin" (La Pianiste, 2001) de Michael Haneke est une tentation à laquelle on ne peut échapper tant il est intéressant d'observer la manière dont deux cinéastes autrichiens traduisent, chacun à leur façon, l’univers jelinekien, quoique à travers des formes filmiques très différentes : Haneke va beaucoup plus loin dans la traduction visuelle du sadomasochisme jelinekien, là où Novotny reste allusif. Sophie Rois (chez Novotny) est très jelinekienne , froide, insaisissable, intellectuelle. Isabelle Huppert (chez Haneke) est incarnée, mais dans l’excès du contrôle et donne une forme au chaos intérieur.

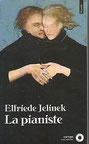
"Die Klavierspielerin" (1983, The Piano Teacher, La Pianiste)
"Die Mutter schläft nicht, solange das Kind nicht schläft. Das Kind schläft nie. » (La mère ne dort pas tant que l’enfant ne dort pas. Et l’enfant ne dort jamais) - Erika Kohut, une femme d'une quarantaine d'années, professeur de piano respectée au Conservatoire de Vienne vit une existence quasi carcérale, avec sa mère possessive et autoritaire, dans un climat de violence psychologique quotidienne. Les deux femmes dorment dans la même chambre, dans une intimité morbide qui nie à Erika toute forme d’individualité.
Erika mène une double vie : en apparence, elle est l’incarnation de la rigueur musicale et de la vertu bourgeoise, mais en secret, elle est dévorée par des désirs sexuels extrêmes, réprimés et détournés. Elle fréquente des peep-shows, observe des couples dans les parcs publics, et cache des lames de rasoir dans ses vêtements (Erika trägt das Rasiermesser, verborgen in der Tasche ihres Mantels. Es wartet auf die Gelegenheit. - Erika porte le rasoir, caché dans la poche de son manteau. Il attend l’occasion.). Son corps, nié par la morale et la domination maternelle, devient le lieu d’une violence tournée contre elle-même.
L’arrivée de Walter Klemmer, un étudiant séduisant et sûr de lui, déclenche un tournant dans l’histoire. Il tombe amoureux de son professeur, mais Erika, incapable d’aimer selon les codes romantiques traditionnels, lui impose une série de scénarios sadomasochistes par lettres, révélant ses fantasmes d’humiliation et de soumission (Erika ne parle pas, elle écrit des lettres obscènes, c’est son seul mode d’expression). Klemmer est d'abord fasciné, puis troublé et finalement violenté par ce qu’il considère comme une "perversion".
« Gefühle sind ein Luxus, den sie sich nicht leisten kann. » (Les sentiments sont un luxe qu’elle ne peut pas se permettre) - Leur relation dégénère jusqu’à une scène finale glaçante où Klemmer, frustré, viole Erika dans son appartement, dans un renversement brutal de pouvoir. Le roman se termine sur une scène ambiguë où Erika, blessée, se poignarde légèrement avant de quitter le conservatoire, abandonnant symboliquement sa musique, son pouvoir et son identité. - «Sie sticht sich. Dann geht sie», Elle se poignarde. Puis elle s’en va ..
"Ihr Körper ist ein Instrument, das sie nicht spielen darf" (Son corps est un instrument qu’elle n’a pas le droit de jouer) - Jelinek déconstruit le mythe de la haute culture viennoise : la musique classique, au lieu d’élever l’âme, devient chez Erika un langage de contrôle, de sadisme intériorisé. Les concerts, les concours, et le conservatoire sont des lieux d'exclusion, de hiérarchie et d'obsession narcissique. Dans "Elfriede Jelinek: Writing Woman, Nation, and Identity" (Kritzer, 2001), on souligne que la figure de la pianiste est un simulacre de respectabilité qui cache un monde de perversion. Erika n'est pas folle : elle est le produit rationnel d’une société malade.
(traduction française Seuil).
"Erika Kohut, professeur de piano, entre en trombe dans l'appartement qu'elle partage avec sa mère. La mère aime appeler Erika son petit ouragan, l'enfant, en effet, se déplace parfois avec une vélocité extrême. Elle cherche à échapper à sa mère. Erika approche de la quarantaine. La mère pourrait aisément, vu son âge, être sa grand'mère. Erika n'était venue au monde qu'après bien des années d'une vie conjugale difficile. Aussitôt le père avait transmis le flambeau à sa fille et quitté la scène. Erika apparut, le père disparut. Aujourd'hui Erika est rapide par nécessité. Comme un tourbillon de feuilles d'automne elle franchit la porte d'entrée et s'efforce de gagner sa chambre sans être vue. Mais déjà la maman se dresse devant, de toute sa taille, et l'accule. A s'expliquer. Dos au mur. Inquisiteur et peloton d'exécution en une seule personne qu'Etat et famille unanimes reconnaissent comme la mère ..."

Michael Haneke adapte en 2001 "La Pianiste" (Die Klavierspielerin) avec Isabelle Huppert (Erika Kohut), Benoît Magimel (Walter Klemmer), Annie Girardot (la mère d'Erika)..
"Im Gehen haßt Erika diese poröse, ranzige Frucht, die das Ende ihres Unterleibs markiert. Nur die Kunst verspricht endlose Süßigkeit (...) Bald wird diese Fäulnis fortschreiten und größere Leibespartien erfassen. Dann stirbt man unter Qualen. Entsetzt malt Erika sich aus, wie sie als ein Meter fünfundsiebzig großes unempfindliches Loch im Sarg liegt und sich in der Erde auflöst; das Loch, das sie verachtete, vernachlässigte, hat nun ganz Besitz von ihr ergriffen. Sie ist Nichts. Und nichts gibt es mehr für sie.."
"En marchant Erika éprouve de la haine pour ce fruit poreux et rance qui marque l'extrémité de son bas-ventre. Seul l'art est promesse de douceur infinie. (...) Bientôt la pourriture progressera et s'étendra à d'autres parties du corps. C'est une mort certaine dans d'horribles souffrances. Epouvantée, Erika s'imagine trou insensible d'un mètre soixante-quinze couché dans un cercueil et se décomposant dans la terre; le trou qu'elle méprisait, négligeait, a pris entièrement possession d'elle. Elle n'est rien. Et pour elle il n'y a plus rien.."
"Erst diese Wünchse machen sie schließlich einer dem anderen real. Erst durch diesen Wunsch, ganz zu durchdringen und durchdrungen zu werden, sind sie die Person Klemmer und die Person Kohut. Zwei Stück Fleisch in der gut gekühlten Vitrine eines Vorstadtfleischers, mit der rosigen Schnittfläche dem Publikum zugewandt; und die Hausfrau verlangt nach langer überlegung ein halbes Kilo von dem und dann noch ein Kilo von dem dort..."
"Seuls ces désirs les rendent en fin de compte réels l'un à l'autre. Seul ce désir - pénétrer l'autre et être pénétré - fait d'eux la personne Klemmer et la personne Kohut. Deux morceaux de viande dans la vitrine bien réfrigérée d'une boucherie de banlieue, l'entame rose face au client. Et après mûre réflexion la ménagère demande cinq cent grammes de ceci et ajoutez moi un kilo de cela..."

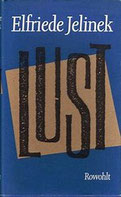
Lust, 1989
« Ce premier roman pornographique au féminin, selon son auteur, a scandalisé et passionné l'Allemagne. Le patron d'une usine de papier, acculé par la peur du sida, se retourne vers son épouse pour en user comme il le faisait auparavant avec les prostituées. Dans la confortable villa d'un couple des scènes d'une rare obscénité et d'une violence hallucinée se succèdent jusque sous les yeux de l'enfant. Et quand la femme désespérée prend un amant plus jeune s'est pour trouver un nouveau bourreau. Le drame affreux sur lequel s'achève le livre appartient, chez Jelinek, comme toujours à un fait divers. Une fois encore, elle règle son compte à l'Autriche profonde, à la quiétude du foyer, à la respectabilité bourgeoise et à la soi-disant libération sexuelle. D'une originalité totale, de conception et de style, Lust que l'on peut traduire par envie, plaisir, désir, luxure, volupté a scandalisé et passionné l'Allemagne. » (présentation de l'éditeur, traduction française Seuil)
"Alle nehmen sich, was sie brauchen, und sie brauchen alle nur eines: ein Loch, das sie stopfen können". C'est brut. Un contre-modèle du roman pornographique masculin? En fait, dans "Lust", Jelinek prend à rebours les codes du roman érotique. Elle ne décrit aucun plaisir sexuel authentique, mais exhibe des scènes de pénétration comme autant de rapports de production, où la femme est exploitée comme une ressource naturelle. Le roman est rédigé dans un style glacial, impersonnel, entièrement à la 3e personne, avec des phrases longues, syncopées, répétitives. Le ton est impassible, souvent bureaucratique, à l’image de la sexualité décrite : sans affect, sans plaisir, sans consentement (Die Wörter schieben sich wie seine Finger in sie hinein). Il ne s’agit pas de désir, mais de conquête, de colonisation du corps féminin. Les scènes sexuelles sont décrites comme des actes de guerre, des procédures médicales ou des rapports économiques. L’usine et le foyer se répondent...
Aucune progression psychologique, pas d’arc dramatique classique. La vie de Gerti, épouse d’un directeur d’usine, est faite de viol conjugal récurrent, d’ennui, et de simulacres de transgression (liaison adultère), elle-même marquée par la domination masculine...
"Sie ist Frau, also muss sie hinhalten" (Elle est une femme, donc elle doit se tenir prête)...
Gerti, le personnage principal, épouse d’un directeur d’usine anonyme et sans nom, vit dans un univers glacé et brutal, dominé par les impératifs de la production, du sexe forcé et du silence. Elle ne pense pas, elle subit (Gerti sieht sich nicht im Spiegel, sie ist nur ein Spiegel). Elle est parlée par les normes sociales et les rôles sexuels.
Le roman commence sans ménagement : Gerti est violée par son mari, une routine à laquelle elle est soumise quotidiennement (Er nimmt sich, was ihm gehört. Es ist sein Recht. Jeden Tag. - Il prend ce qui lui appartient. C’est son droit. Chaque jour.). Le corps féminin, ici, est décomposé, traité comme matériau brut, sans affect, sans nom propre — il est exploité comme un territoire industriel. - Die Fabrik arbeitet Tag und Nacht, genauso wie Hermann. L’usine fonctionne jour et nuit, tout comme Hermann...
Hermann, directeur d’usine, mari, violeur. Il est l’archétype de l’homme en position de pouvoir. Il épuise sexuellement Gerti selon des horaires, sans échange, avec brutalité. Sa figure représente la fusion entre capitalisme, patriarcat et sadisme.
En quête d’un semblant de liberté ou de désir, Gerti entame une relation adultère avec un homme prénommé Michael, qui, sous des dehors romantiques, se révèle tout aussi violent, manipulateur et intéressé. Il veut la posséder, l’éloigner de son fils, et la pousser à tout quitter pour lui. Mais il n’y a pas de salut par l’amour dans l’univers de Jelinek.
Gerti finit par se suicider, se jetant du haut d’une falaise avec son fils, incapable d’échapper à l’aliénation systémique de son genre, de sa classe et de sa chair. Le roman se termine par une pulsation industrielle froide, mécanique, dans laquelle l’individu n’a plus aucune place.
Es ist nichts. Es ist immer nichts. Ce n’est rien. C’est toujours rien...
"...Du supermarché s'écoulent les marchandises dont le genre humain devient esclave. Le samedi l'homme se doit d'être un partenaire et aide à ramener les filets; à la pêche aux emplettes, plettes, plettes ils veulent bien aller maman. L'homme commence en effet à connaître la chanson, elle est dans l'air du temps. Silencieux, il séjourne parmi les femmes qui comptent leur monnaie et combattent contre la faim. Comment deux êtres parviendraient-ils à ne former qu'un, alors qu'on ne parvient même pas à former une chaîne humaine pour le mouvement de la paix? Et d'escorter la femme, de porter sacs et paquets, sans crier ni rouspéter. Ainsi le directeur parade-t-il devant les gens, prend leur place et contrôle les achats, alors que ce serait plutôt du ressort de l'employée de maison. Lui, un dieu, évolue, allègre, parmi ses créatures qui sont moins que des enfants et croulent sous des tentations plus vastes que l'océan. Il jette aussi l'œil dans les paniers d'autrui et dans des décolletés étrangers que secoue quelque vilaine toux et qu'un fichu protège des non moins vilains désirs. Si près de la rivière les maisons sont souvent froides et humides. Lorsqu'il regarde sa femme, dont la main gauchement effleure dans les gondoles la mort emballée avec une science tout hermétique, qu'il voit cette chair si peu performante dans ses beaux vêtements, il est pris d'une terrible impatience : lui confier son poids de chair; en ce lieu où tout est délice, vrai supplice de Tantale, mais vénal et que lui peut se payer pour un chiffon de papier, laisser sa verge se gorger sous ses doigts débiles de mille soleils resplendissants. Sous les griffes faiblement laquées de sa femme il veut voir son petit animal s'éveiller, et en elle retrouver le repos. Qu'elle y mette un peu du sien à la fin avec sa chemisette en soie! Quel travail d'avoir chaque fois à sortir les seins par en haut pour les poser sur le plat de ses mains! Il faudra bien un jour qu'elle apprenne à s'offrir sur un plateau, à se donner elle-même plaisamment, complaisamment, c'est trop long, trop pénible d'avoir à cueillir un à un tous ses fruits. Mais non, rien à faire. Un peu en retrait devant la caisse, il embrasse du regard son bien, vide béant devant lequel les marchandises font le beau. Et voit autour de lui virevolter des employés du supermarché auxquels il a pris leurs enfants, les uns pour l'usine, les autres en les acculant à quitter le pays - ou à sombrer dans la boisson. Cet homme est à la démesure du temps! Les sacs à provisions remplis à la hauteur de leurs exigences valsent dans un bruissement à travers l'entrée, propulsés par les coups de pied du directeur. Il lui arrive dans un accès de rage de piétiner la nourriture qui éclabousse alors jusqu'au ciel. Puis de projeter sa femme au beau milieu du dépôt de marchandises et de compléter le tableau avec elle, l'autorisant à respirer son souffle, à lui lécher le pénis et l'anus. Expert il attrape au vol des seins déjà flétris et les resserre à la racine en ballons rebondis. Saisit la femme par son col et, penché sur elle, la plie comme pour la ramasser et la mettre en sac. Les meubles défilent en une visite éclair. Déjà les vêtements sont éparpillés et tous deux plus fichés l'un dans l'autre qu'attachés l'un à l'autre. Ce parcours est ratissé depuis des années déjà. Frémissant le directeur sort sa production, qui pour une fois n'est pas du papier. C'est un produit plus dur, mieux adapté à la dureté des temps. Les gens aiment à dévoiler ce qu'ils ont de plus secret, pour montrer qu'ils n'ont rien à cacher et que tout est vrai dans ce qu'ils ont à dire à leurs partenaires qui, inépuisables, se répandent. Ils envoient leurs membres en éclaireurs, seuls messagers qui toujours leur reviennent. Ce qui n'est pas le cas de l'argent, pourtant plus aimé que le plus aimé des amants, tel Actéon, transformé en cerf, aux pieds grignotés par les chiens. Les produits naissent au milieu des frissons et des cris, les corps, minoteries minuscules, grincent et moulent le grain, et le modeste pactole à peine alourdi par le bonheur qui sort en titubant du téléviseur solitaire, se déverse dans l'étang solitaire du sommeil où l'on peut rêver à des objets plus grands, à des produits plus chers encore. Et l'homme fleurit sur la rive.
La femme est couchée sur le sol, grande ouverte, ouverte au monde, et recouverte de denrées gélatineuses, ce qui la fait valoir, la valorise de plusieurs points. Elle n'a affaire qu'à son mari qui lui s'affaire tout seul. Et qui déjà sort de lui-même et répand ses réserves dans le désert meublé de la pièce. Seul son propre corps le satisfait à peu près et s'écoute à son gré gronder et résonner dans le sport. Telle une grenouille la femme doit replier ses jambes de chaque côté, afin que son mari puisse voir en elle le plus loin possible, Voir jusqu'au fond de la salle du tribunal de première instance pour affaires pénales, et l'examiner. Constellée de détritus et d'excréments, elle doit ensuite se relever, laisser choir ses dernières pelures, et aller chercher une éponge afin d'essuyer l'homme, ennemi implacable de son sexe, et faire disparaître toute trace d'elle et des mucosités qu'elle a provoquées. Il lui enfonce l'index droit au plus profond du fondement, tandis qu'agenouillée sur lui, les seins ballants, elle récure, les cheveux dans les yeux et dans la bouche, le front en sueur, la gorge engluée par une salive étrangère, récure le requin meurtrier là devant elle, jusqu'à ce que la douce lumière s'abîme à l'horizon, que l'ombre de la nuit approche, et que l'animal à nouveau la fouette de sa queue.
Sur le chemin du retour, après le supermarché, ils ont pour habitude de garder le silence. Certains, testant leurs chevaux-vapeur, les dépassent et laissent dans leur mémoire un souvenir implacable. Le long du chemin, les bidons de lait agités par le souffle explosif de l'atome attendent au garde-à-vous. Les coopératives agricoles rivalisent de vitesse à travers la contrée, la concurrence en est la cause, mais aussi leur désir de ne pas trop longtemps s'exposer au regard des tout petits paysans qui ne donnent guère de lait et qu'on ne peut même pas saigner à blanc. La femme se drape dans l'obscurité de non silence. Pour soudain, afin d'humilier son mari, rire et rire encore de ses idées biscornues de patriarche dont le timbre se brouille lorsqu'il surveille les doigts de la caissière qui, comme tant de femmes de chômeurs, n'a pas droit à l'erreur. Subrepticement le directeur se glisse à ses côtés et la voici obligée de tout retaper pour être sûre que son compte est bon! On se croirait dans son usine, sauf qu'ici les gens sont plus petits et portent des habits de femmes où pointe une frimousse, dans l'habitat familial ils se sentaient trop à l'étroit. Les femmes replient leurs ailes, et de leurs corps fusent des enfants dont les yeux à peine dessillés sont aussitôt foudroyés par les pères. Dans un délire mercantile les clientes en troupeaux agités passent en se bousculant devant d'autres envoûtées par les marchandises, pour l'instant d'après regagner leurs caveaux. Tels des rocs leurs têtes s'amoncellent devant les promotions. On ne leur fait pas de cadeau, au contraire on les soulagera en partie du salaire gagné à l'usine. Épouvantées, les voici nez à nez avec leur supérieur qu'elles ne s'attendaient pas à voir en ces lieux et auquel d'ailleurs elles songeaient à peine...." (Editions Jacqueline Chambon, traduction Yasmin Hoffmann et Maryvonne Litaize)
Un film qui, à ce jour, n'a pas été adapté au cinéma, serait-il inadaptable cinématographiquement? Adapter "Lust", c’est risquer de reproduire ce que le roman dénonce : le regard masculin qui consomme la douleur des femmes comme une forme de divertissement ou de pathos. "Die Sprache ist die einzige Gewalt, die ich verwende — ich will keinen Missbrauch durch Bilder." (La langue est la seule violence que j’utilise — je ne veux pas d’abus par l’image.) - Elfriede Jelinek, entretien avec Der Standard, 2004...

"Die Kinder der Toten" (1995, Les Enfants des morts)
La mémoire refoulée de l’Holocauste en Autriche. L’Autriche post-1945 s’est souvent présentée comme la « première victime du nazisme » — un mythe que Jelinek pulvérise en inversant la logique mémorielle : les vrais protagonistes du roman ne sont pas les vivants, mais les morts qu’on a refoulés, effacés, digérés dans la normalité touristique et néolibérale autrichienne...
Une œuvre monumentale et radicale, souvent considérée comme son chef-d’œuvre absolu. Et un des romans les plus difficiles de la littérature germanophone, comparé à Joyce ou Thomas Bernhard. Jelinek y joue avec les genres, horreur gothique, pamphlet politique, poésie expérimentale. Contrairement à d’autres récits sur la Shoah, il n’y a pas de catharsis, juste une colère sourde. Critiqué à sa sortie pour son obscurité, aujourd’hui considéré comme un chef-d’œuvre.
"Die Toten gehen nicht fort, sie bleiben, weil niemand sie sieht", Les morts ne s’en vont pas, ils restent parce que personne ne les voit. L’une des phrases centrales du roman, qui exprime l’idée que le refoulement collectif n’efface rien, mais produit des revenants. Ce n’est pas le souvenir qui hante : c’est l’oubli ..
Le roman se déroule dans une région rurale autrichienne indéterminée, mais typique (Das Land ist ein Friedhof, der sich als Ferienort tarnt). L’histoire tourne autour de trois personnages morts-vivants (Gudrun Bichler, Edgar Gstranz et Karin Frenzel), qui reviennent d’entre les morts dans un paysage envahi par des fantômes anonymes, les « enfants des morts ». Ceux-ci ne sont pas les revenants d’un folklore gothique, mais les victimes silencieuses de l’Histoire, en particulier celles du nazisme et de la Shoah, que la société autrichienne a refusé d’entendre ou d’enterrer dignement.
Les personnages ne sont pas des êtres humains au sens romanesque, mais des marionnettes linguistiques, des formes vides. Ils vomissent, se décomposent, perdent leurs organes — mais continuent à parler, à marcher, à agir mécaniquement. Jelinek reprend ici les codes du zombie-movie, mais avec une fonction allégorique et historique : les morts non enterrés de l’Autriche reviennent, car on ne leur a jamais donné voix.
Le récit s’étale sur 666 pages, volontairement illisibles, labyrinthiques, faites de digressions, de jeux de mots, de blagues macabres, de détournements de citations bibliques, journalistiques ou philosophiques. Il mime l’excès de signification pour dénoncer le vide du discours public autrichien face à son passé nazi.
- "Es wiederholt sich alles, weil niemand reden will" : Tout se répète parce que personne ne veut parler ...
Le style de Jelinek dans ce roman atteint un sommet de baroque grotesque, fait d’accumulations, de répétitions, de glissements sémantiques, d’auto-citations et de montage syntaxique instable. Le roman devient un organisme textualisé, qui se décompose sous les yeux du lecteur (Die Sprache fault mit den Leichen, sie ist selber ein Kadaver). 'Un livre nécessaire que personne ne lira jusqu’au bout", Thomas Bernhard, dans une lettre privée ...
Le roman a été mis en scène au théâtre, mais rarement adapté (exception notable : le film expérimental Die Kinder der Toten réalisé en 2019 par Kelly Copper et Pavol Liska, sans dialogues, sur pellicule 16mm).

"Gier" (2000, Greed)
"Avidité" (Gier) est un roman cauchemardesque qui explore la violence masculine, la pulsion de possession et la corruption du pouvoir à travers l’histoire d’un policier autrichien obsédé par le contrôle. Moins connu que "La Pianiste" ou "Les Enfants des morts", ce texte est pourtant sans doute l'un des plus brutaux de Jelinek, mêlant satire sociale et horreur psychologique. Un roman sur la "gier" (avidité, désir vorace), Jelinek dépeint une Autriche rongée par les appétits sexuels, économiques et politiques, où les hommes exercent une domination sans limites ...
Un roman de crime sans enquête, sans suspense, sans résolution : Gier s’ouvre sur le meurtre d’une jeune femme, probablement étrangère, dans une ville autrichienne de province. Le coupable est Kurt Janisch, un policier respecté, marié, père, qui a tué par avidité sexuelle, voire par routine. Contrairement aux règles du roman policier, le crime n'est pas le centre du suspense : on sait dès le début qui l’a commis, comment et pourquoi. Mais l’important, pour Jelinek, n’est pas l’intrigue, c’est la structure de pouvoir qui produit ces crimes en silence. - "Er ist der gute Mensch, der gern nimmt, was ihm zusteht" - Il est l’homme bien comme il faut, qui aime prendre ce qui lui revient ..
Policier, mari modèle, bourreau discret. Kurt Janisch incarne une figure très jelinekienne : celle du pouvoir institutionnel doublé de brutalité sexuelle, masqué par la respectabilité sociale. Le roman dissèque la manière dont la société autrichienne — tribunaux, presse, police, famille — recouvre les violences masculines d’une fiction morale.
Le texte est un monologue collectif, sans chapitre, sans respiration. Jelinek supprime les repères narratifs pour créer une langue automatique, circulaire, qui imite les mécanismes du refoulement social : ce qui revient, toujours, c’est le silence sur la violence masculine, le déni collectif, l’avidité en tant que principe général.
Et l’avidité n’est pas seulement sexuelle ou économique, elle est ontologique. Les hommes prennent, consomment, utilisent — et le roman ne raconte rien d’autre que la systématisation de cette prise, rendue invisible par le vernis du bien-pensant...
« Aujourd’hui, le gendarme Kurt Janisch regarde une nouvelle fois la photo sur laquelle son père, le colonel Janisch, saluait le roi, trente ans plus tôt. Regardez, son père est toujours là, visiblement contraint de reculer d’un pouce sous l’effet de son propre mouvement enthousiaste de mise au garde-à-vous, mais pourquoi rien ne le retient ?—il y a quelque chose de mou, d’indécis dans ses épaules, qui semble ensuite le pousser à nouveau vers l’avant. Peut-être n’était-ce rien de plus qu’une révérence involontaire devant le monarque, comme une sorte de bis au salut maintes fois répété. Le fils, quant à lui, n’a plus rien de subalterne, debout devant l’armoire dans son survêtement rayé, disciplinant son corps en l’échauffant lentement avant d’aller courir. Son père avait porté sa subordination, les épaules tombantes mais les mains capables, le long des chemins poussiéreux de campagne et jusqu’aux épaves de voitures fracassées. Peut-être le fils est-il plus polyvalent et sait-il aussi donner des ordres ; son allure me rend curieuse : un visage quelque peu anguleux, à travers lequel les pensées, qui chez la plupart des gens aiment à s’étaler, semblent seulement glisser timidement. Enfin. Mais la volonté est là désormais, à quoi va-t-il l’employer ? Le bateau a viré de bord, les feux de signalisation sont allumés et restent figés au vert, la fine distinction entre lui et les autres s’accroît.
Le gendarme est désormais entièrement dominé par une sorte de convoitise, venue insidieusement, mais finalement remarquée même par les voisins (étonnement devant les plantes proliférant dans le jardin, personne ne sait d’où elles viennent, il ne peut pas les avoir achetées !). Parfois, quelqu’un consulte le cadastre, pour voir ce que le gendarme a tenté de camoufler avec le livre de la vie. Maintenant, il a jeté l’ancre, il a repéré ses cibles. Les rames ont été rentrées, les filets lancés. Peut-être y avait-il à l’origine place pour autre chose, de beau, de décent, chez ce gendarme ? Un bel homme d’apparence insouciante, le gendarme, justement le genre que nous, les femmes, aimons. Quelque chose à travailler.
Ce n’est pas seulement pour préserver la paix mondiale que les hommes servent aux femmes un tas de mensonges, pour les rendre dépendantes, alors que les femmes ont effectivement mieux à offrir, toutes leurs pensées, leurs sentiments et tant de choses faites de laine aux couleurs vives. C’est compréhensible, bien sûr, que nous, surtout celles d’entre nous dotées des organes sexuels les plus anciens, qui n’avons pas beaucoup vu à travers les écoutilles du corps, devions malgré tout rester étrangères à nous-mêmes ! Nous, les femmes affamées d’amour, malheureusement, ne connaissons pas ce gendarme (la fleur de la route s’incline juste devant sa voiture banalisée et nous ne sommes pas là) personnellement. Ne vous inquiétez pas, je m’en occupe : afin de ne pas compromettre votre petit bonheur amoureux qui repose sur le mensonge, comme tout autre, je ferais mieux de prendre en charge le récit moi-même maintenant.
Ne m’interrompez pas ! À l’heure actuelle, pour éviter la guerre entre les corps, je ne peux même pas préciser leurs fonctions. Même cette détermination chez l’homme, que je pressens déjà, ne connaît pas encore son but, mais je sais qu’elle cherche depuis longtemps et qu’elle le trouvera dans ce qui se corrompt le plus facilement, le corps humain. Quiconque se connaît voudra aussitôt un peu de l’autre, mais alors les autres le voudront aussi immédiatement. »
(...)
Gabriela, une serveuse, une jeune femme issue d’un milieu modeste, atteinte d’un handicap mental léger (probablement une forme de retard cognitif ou une fragilité psychique), ce qui la rend doublement vulnérable, devient l’objet de son obsession. Il la suit, l’espionne et imagine la violer ou la tuer. Elle incarne pour lui tout ce qu’il désire et méprise : la jeunesse, la liberté féminine, une sexualité qu’il ne contrôle pas. Le policier justifie sa traque en se persuadant qu’elle est liée aux meurtres en série, alors qu’il est lui-même un prédateur.
En parallèle, la ville est secouée par une série de meurtres de prostituées, que la police enquête mollement. Jelinek montre le mépris institutionnel pour les victimes (pauvres, femmes, marginalisées), contrastant avec l’énergie dépensée pour contrôler Gabriela. Le policier, tout en prétendant servir la loi, incarne lui-même la menace.
Le récit bascule dans l’horreur quand le policier passe à l’acte, kidnappant Gabriela. La scène de viol (décrite avec une froideur clinique) est un moment de violence extrême, où Jelinek expose la bestialité du pouvoir masculin. Gabriela finit par mourir, mais sa mort est ignorée, comme celles des autres femmes.
Le policier n’est jamais puni. L’enquête sur les meurtres s’enlise, et il retourne à sa vie normale. La société autrichienne est complice : les institutions protègent les hommes violents, les médias détournent le regard. Le roman se termine sur une image de vide et de répétition, suggérant que le cycle de la violence continuera ...
La masculinité toxique dans toute sa réalité : le policier est un concentré de pulsions destructrices, légitimées par son statut social. Et la complicité des institutions : La police, la justice et les médias ferment les yeux sur les violences faites aux femmes. Reste l’écriture comme arme : Jelinek utilise une prose saccadée, répétitive et brutale pour rendre l’oppression palpable...
