- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Svevo - Pirandello
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki
- 1930-1940
- 1930s
- Fitzgerald
- Hemingway
- Faulkner
- Koch
- Céline
- Bernanos
- Jouve
- DosPassos
- Kojève
- Miller-Nin
- Grosz - Dix
- Green
- Ortega y Gasset
- Wittgenstein
- Russell - Carnap
- Artaud
- Jaspers
- Sapir - Piaget
- Guillén
- Garcia Lorca
- Hammett
- A.Christie
- Heidegger
- Icaza
- Huxley
- Hubble
- Caldwell
- Steinbeck
- Waugh
- Blixen
- Rhys
- J.Roth - Doderer
- Aub
- Malraux-StExupéry
- DBarnes-NWest
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bataille - Michaux
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Bloch
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Montherlant
- Lewin - Mayo - Maslow
- Buzzati - Pavese
- Vittorini
- Fallada
- Malaparte
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Welty
- Boulgakov
- Tamiki - Yôkô
- Weil
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Ellison
- Bergman
- Baldwin
- Fromm
- Bradbury - A.C.Clarke
- Tennessee Williams
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Carpentier
- Mishima
- Salinger - Styron
- Pasternak
- Asturias
- O'Connor
- 1960-1970
- 1960s
- Abe
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- U.Johnson - C.Wolf
- Heller - Toole
- Naipaul
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Capote - Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- Onetti - Sábato
- Sillitoe
- McCarthy - Minsky
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Cortázar
- Warhol
- Dolls
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- Ellis
- HarperLee
- 1970-1980
- 1970s
- Habermas
- Handke
- GarciaMarquez
- Deleuze
- Derrida
- Beck
- Satir
- Kundera
- Hrabal
- Didion
- Guinzbourg
- Lovelock
- Vietnam
- H.S.Thompson - Bukowski
- Pynchon
- E.T.Hall
- Bateson - Watzlawick
- Carver
- Irving
- Milgram
- VargasLlosa
- Puig - Donoso
- Lasch-Sennett
- Crozier - Touraine
- Friedan-Greer
- Jacob-Monod
- Dawkins
- Beattie - Phillips
- Gaddis
- Rawls
- Zinoviev
- H.Searles
- Ballard
- Jong
- Kôno
- Calvino
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact

John Updike (1932-2009), (The Rabbit Angstrom Series) "Rabbit, Run" (1960), "Pigeon Feathers" (1962), "The Centaur" (1963), "Couples" (1968), "Rabbit Redux" (1971), "The Coup" (1978), "Rabbit Is Rich" (1981), "The Witches of Eastwick" (1984), "Roger's Version" (1986), "Rabbit at Rest" (1990), "Rabbit Remembered" (2000), "Villages" (2004) - Robert Coover (1932), "Gerald 's Party" (1985) - .....
Last Update : 09/09/2017

Dans "Americana", Don De Lillo écrit : "La télévision est venue en Amérique à bord du Mayflower", la culture américaine, pour une part importante, préfère laisser en arrière le "moi" le plus ancien, par trop chaotique s'il n'est pas suffisamment contraint par une bonne et édifiante chronologie, au prit d'un "moi" rêvé : les médias ont cette immense faculté de nous permettre de rattraper cette image de soi qui fait signe, un peu plus loin .. Et nombre d'écrivains américains mènent ainsi une intrigue autobiographique qui se veut à la fois privée et nationale : se raconter est aussi raconter l'Amérique, l'un est l'autre sont irrémédiablement liés, l'Amérique au travers de son histoire comme de son actualité est en prise directe sur le vécu de l'individu et son évolution. La petite ville américaine (the town) est cet espace intermédiaire, premier entre tous, à mi-chemin de la corruption du monde urbain et de la sauvagerie de la campagne. Et si le sentiment d'enlisement devient une propriété constante de l'existence, s'ouvre à tout moment cet espace sans monde à qui décide de prendre une route sans fin, gagner la côte ouest ou le paysage désertique du Texas, à moins que plus modestement le registre érotique offre ses dérives au plus loin des abruptes falaises du vide. Mais dans tous les cas, deux horloges semblent rythmer le cours du temps, le tempo des émois, intellectuels ou sensuels, de chacun des protagonistes, personnages ou auteurs, et celui d'une société entièrement soumise aux évolutions technologiques et aux aléas des moeurs...
<andrew wyeth>
Une épigraphe de Karl Barth, «Heaven is the creation inconceivable to man, earth the creation conceivable to him» (Le ciel est la création inconcevable pour l’homme, la terre la création concevable pour lui) dans "The Centaur" (1963) révèle à quel point tous les personnages principaux de John Updike habitent cette frontière entre le ciel et la terre, entre l’intensité de la vie et l’inéluctabilité de la mort, entre les rêves de liberté et le confort d’un environnement de banlieue compromis. “I feel to be a person is to be in a situation of tension” (e sens qu’être une personne, c’est être dans une situation de tension), et qui ne l'est pas ne pas être une "personne".
Ainsi des personnages comme George Caldwell (Le Centaure), Harry Angstrom (dans les quatre romans, Rabbit, Run (1960), Rabbit Redux (1971), Rabbit is Rich (1981), Rabbit at Rest (1990), Piet Hanoma (Couples (1968), Henry Bech (Bech : A Book (1970), Bech is Back (1982)), tous accomplissent et poursuivent leurs maladresses dans ce qu’on appelle, dans "Couples", «a universe of timing» (un univers de synchronisation). Dans "Couples", Piet Hanoma souffre d’une « impression vertigineuse de gaspillage » (a dizzying impression of waste) et d’un « sentiment de déconnexion entre les phénomènes et les sentiments » (a sense of unconnection among phenomena and of feeling).
En tant qu’enseignant de l’évolution, Caldwell peut réfléchir sur une époque où « la conscience n’était qu’un simple pollen dérivant dans l’obscurité » (when consciousness was a mere pollen drifting in darkness) et sur son propre anéantissement : de rien et à rien. Et contre cette crainte du vide, se fixe la possibilité de l’amour. « Un homme amoureux cesse de craindre la mort » (A man in love ceases to fear death), observe Updike dans un de ses essais. « Notre anxiété fondamentale est que nous n’existons pas – ou cesserons d’exister. Ce n’est qu’en étant aimés que nous trouvons une corroboration externe de la très haute valeur que chaque ego se donne secrètement. » (Our fundamental anxiety is that we do not exist – or will cease to exist. Only in being loved do we find external corroboration of the supremely high valuation each ego secretly assigns itself). Il y a aussi le confort de la coutume et de la routine, mais ce vide terrifiant peut être aussi libérateur : les structures des maisons, les banlieues, la routine suburbaine, peuvent être réconfortantes mais elles peuvent aussi être claustrophobes....
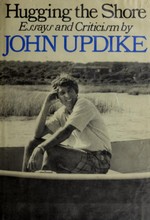
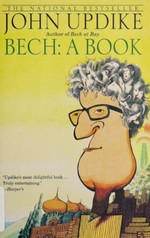

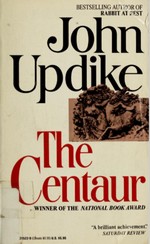
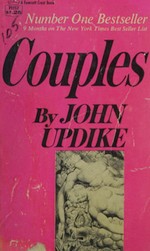
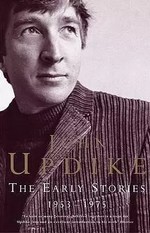




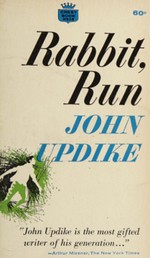


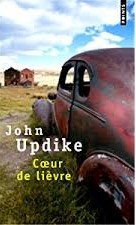
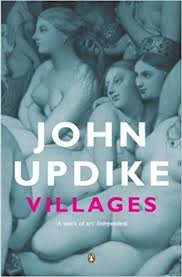

John Updike (1932)
My heroes “oscillate in their moods between an enjoyment of the comforts of domesticity and the familial life, and a sense that their essential identity is a solitary one — to be found in flight and loneliness and even adversity. This seems to be my feeling of what being a male human being involves.” Et comme beaucoup d'écrivains américains, Updike écrit une autobiographie qui est à la fois privée et nationale...
Né à Shillington, près de Reading (Pennsylvanie), luthérien allemand par sa mère, qui écrivait, calviniste presbytérien par son père, qui enseignait les mathématiques, il s'installe avec sa famille à Plowville, en 1945, en pleine campagne, enfant roi dont le monde familier implose. En 1950, il obtient une bourse pour Havard, devient rédacteur en chef du Harvard Lampoon, périodique humoristique fondé par des étudiants de l'université Harvard, épouse Mary Pennington, fille de pasteur unitarien, et en 1954 vend sa première nouvelle au New Yorker. C'est le démarrage de sa carrière. Il s'impose par ses nouvelles, "The Same Door" (1959), "Pigeon Feathers" (1962), "The Music School" (1966) et sa fameuse chronologie de Harry Angstrom, dit "Rabbit" : “Rabbit, Run,” 1960; “Rabbit Redux,” 1971; “Rabbit Is Rich,” 1981; and “Rabbit at Rest,” 1990, "Rabbit Remembered" (2001). Son personnage, "an high school basketball star who turned car salesman, householder and errant husband" tente tant bien que mal de surmonter les divers séismes qui frappent en quatre décennies le "everyday mysteries of love and faith and domesticity " de toute une génération de mâles de la fameuse "American middle class" peuplant les villes moyennes de cette deuxième moitité du 20e siècle, jusque dans leur attititudes et sentiments les plus profonds : "a suburban adultery unable to resist the 60’s promise of sex without consequences", "big cars and wide lawns", "radios and hi-fi sets", "feminism", "counterculture", "antiwar protests" des 70’s et 80’s, en fond d'une Amérique qui se cherche, avec son narcissisme aveugle et ses doutes refoulés tant bien que mal. Le personnage de Henry Bech constitue un deuxième cycle, hanté par la figure de l'écrivain Vladimir Nabokov, au travers de "Bech, a Book" (1970), "Bech Is Back " (1982), "Bech at Bay" (1998) : Bech est ici un écrivain solitaire et vaniteux, un “recherché but amiable Jewish novelist afflicted with acute writer’s block", mais plus profondément l'alter ego du jeune Updike qui, derrière cette chronique amère de la vie quotienne américaine, s'est très tôt ressenti “a fleck of dust condemned to know it is a fleck of dust.." John Updike est aussi l'auteur d'une très abondante production d'essais critiques (de Proust à Alain Robbe-Grillet, en passant par Joyce, Drieu la Rochelle, Albert Camus, Queneau, Nabokov, mais aussi des contemporains comme Saul Bellow et Norman Mailer) ou humoristiques.

"The Maples Stories" (Too Far to Go, 1956–94)
Un des fils des Maples, Joan, réagit ainsi à l’annonce par son père (Richard) de la séparation du couple : "Why didn’t you tell us?", «Pourquoi ne nous l’avez-vous pas dit?», demanda-t-il d’une voix claire et posée, contrairement à celle de son père. « Vous auriez dû nous dire que vous ne vous entendiez pas» (You should have told us you weren’t getting along). Richard, au bord des larmes, tentent de s'expliquer, «Nous nous entendons bien», (We do get along, that’s the trouble, so it doesn’t show even to us), mais c'est Joan qui termine la phrase, «Et nous avons toujours, surtout, aimé nos enfants» (And we’ve always, especially, loved our children), et ne tarde pas à renchérir, est-ce que réellement vous êtes souciés de nous, «We’re just little things you had». «Nobody belongs to us, except in memory», écrira plus loin John Updike...
"The Maples Stories" est donc un recueil de dix-huit contes écrits entre 1956 et 1994 sur un couple marié, puis divorcé, nommé Joan et Richard Maples, qui peut sembler trop modeste pour l'évoquer tant l'oeuvre de John Updike abonde en ouvrages de ce genre, mais ces nouvelles offrent des clichés audacieux, voire astucieux et parfois poignants de la vie domestique américaine par ailleurs si tumultueuse, on y perçoit condensées intimité fugace, atmosphère de regret amoureux, et incertitude émotionnelle. Dans son avant-propos, Updike écrit : «A tribe segregated in a valley develops an accent, then a dialect, and then a language all its own; so does a couple», et le paysage commun d’un mariage a sans doute rarement été aussi affectueusement représenté. Les titres à eux seuls suggèrent le passage des Maples du bonheur des jeunes mariés à la parentalité, à la dépendance, à la routine, à la désillusion et à l’éloignement : « Snowing in Greenwich Village », « Wife-Wooing », « Giving Blood », « Twin Beds in Rome », « Your Lover Just Called », « Plumbing », « Sublimating ». « Séparation ».

"Rabbit Run" (1960, Coeur de lièvre)
Installé à Ipswich (Massachusetts), John Updike publie en 1960 le premier volet de la série Rabbit Angstrom, "Rabbit, Run" (Cœur de lièvre), et c'est en 1963, avec "The Centaur" (Le Centaure) que sa carrière d'écrivain est définitivement lancée. Suit en 1968, le scandaleux "Couples", dont le thème est l'adultère, et qui lui vaudra la couverture de Time (Apr. 26, 1968, "The adulterous society"). Rabbit a vingt-six ans, nous sommes en 1959, et l'ancien champion de basket-ball, devenu démonstrateur d'articles ménagers, se sent enlisé dans sa vie conjugale. Mme McGregor apparaît, le temps d'une petite fugue.
1 BO
YS are playing basketball around a telephone pole with a backboard bolted to it. Legs, shouts. The scrape and snap of Keds on loose alley pebbles seems to catapult their voices high into the moist March air blue above the wires. Rabbit Angstrom, coming up the alley in a business suit, stops and watches, though he’s twenty-six and six three. So tall, he seems an unlikely rabbit, but the breadth of white face, the pallor of his blue irises, and a nervous flutter under his brief nose as he stabs a cigarette into his mouth partially explain the nickname, which was given to him when he too was a boy. He stands there thinking, the kids keep coming, they keep crowding you up.
His standing there makes the real boys feel strange. Eyeballs slide. They’re doing this for their own pleasure, not as a demonstration for some adult walking around town in a double-breasted cocoa suit. It seems funny to them, an adult walking up the alley at all. Where’s his car? The cigarette makes it more sinister still. Is this one of those going to offer them cigarettes or money to go out in back of the ice plant with him? They’ve heard of such things but are not too frightened; there are six of them and one of him.
The ball, rocketing off the crotch of the rim, leaps over the heads of the six and lands at the feet of the one. He catches it on the short bounce with a quickness that startles them. As they stare hushed he sights squinting through blue clouds of weed smoke, a suddenly dark silhouette like a smokestack in the afternoon spring sky, setting his feet with care, wiggling the ball with nervousness in front of his chest, one widespread pale hand on top of the ball and the other underneath, jiggling it patiently to get some adjustment in air itself. The moons on his fingernails are big. Then the ball seems to ride up the right lapel of his coat and comes off his shoulder as his knees dip down, and it appears the ball is not going toward the backboard. It was not aimed there. It drops into the circle of the rim, whipping the net with a ladylike whisper. “Hey!” he shouts in pride.
“Luck,” one of the kids says.
“Skill,” he answers, and asks, “Hey. O.K. if I play?”
There is no response, just puzzled silly looks swapped. Rabbit takes off his coat, folds it nicely, and rests it on a clean ashcan lid. Behind him the dungarees begin to scuffle again. He goes into the scrimmaging thick of them for the ball, flips it from two weak white hands, has it in his own. That old stretched leather feeling makes his whole body go taut, gives his arms wings. It feels like he’s reaching down through years to touch this tautness. His arms lift of their own and the rubber ball floats toward the basket from the top of his head. It feels so right he blinks when the ball drops short, and for a second wonders if it went through the hoop without riffling the net. He asks, “Hey whose side am I on?”
In a wordless shuffle two boys are delegated to be his. They stand the other four. Though from the start Rabbit handicaps himself by staying ten feet out from the basket, it is still unfair. Nobody bothers to keep score. The surly silence bothers him. The kids call monosyllables to each other but to him they don’t dare a word. As the game goes on he can feel them at his legs, getting hot and mad, trying to trip him, but their tongues are still held. He doesn’t want this respect, he wants to tell them there’s nothing to getting old, it takes nothing. In ten minutes another boy goes to the other side, so it’s just Rabbit Angstrom and one kid standing five. This boy, still midget but already diffident with a kind of rangy ease, is the best of the six; he wears a knitted cap with a green pompom well down over his ears and level with his eyebrows, giving his head a cretinous look. He’s a natural. The way he moves sideways without taking any steps, gliding on a blessing: you can tell. The way be waits before he moves. With luck he’ll become in time a crack athlete in the high school; Rabbit knows the way. You climb up through the little grades and then get to the top and everybody cheers; with the sweat in your eyebrows you can’t see very well and the noise swirls around you and lifts you up, and then you’re out, not forgotten at first, just out, and it feels good and cool and free. You’re out, and sort of melt, and keep lifting, until you become like to these kids just one more piece of the sky of adults that hangs over them in the town, a piece that for some queer reason has clouded and visited them. They’ve not forgotten him; worse,
(..)
Harry Angstrom est probablement la plus grande création de John Updike : un homme d’affaires de banlieue et ancien athlète ordinaire mais avec le potentiel, celui d'un personnage qui rêve de succès et d’épanouissement personnel qui ne seront jamais tout à fait réalisés, un homme qui aspire à une autre vie, meilleure, mais apprend juste à exister. « Le personnage de Harry Angstrom, a expliqué Updike, était pour moi un moyen d’entrer – un billet pour l’Amérique tout autour de moi » (The character of Harry Angstrom was for me a way in – a ticket to the America all around me), une porte d'entrée, un moyen d’atteindre « une immersion sans jugement » ( a nonjudgmental immersion) dans la vie de sa propre création. La vie de Harry se déroule devant nous (« dans le la façon dont un film se produit devant nous », a suggéré Updike), les quatre romans de Rabbit – chacun composé à la fin d’une décennie et publié au début de la suivante – offrent « une sorte de rapport courant sur l’état de mon héros et de la nation » ( a kind of running report on the state of my hero and the nation), habitant un territoire frontalier entre désir et déception. Et que le plus souvent, ce soit la déception qui l'emporte, sa croyance en lui-même et en l’Amérique reste intacte, sa conviction que « tout cela est le pays le plus heureux que le monde ait jamais vu » (all in all this is the happiest fucking country the world has ever seen) survit malgré toutes les preuves du contraire – et malgré ses soupçons que son corps et la nation se détériorent et s’affaiblissant insensiblement. Et nous verrons notre héros persévérer à courir, - “he runs. Ah: runs. Runs” -... A propos de Rabbit, Run, Norman Mailer, qui n’a jamais été un grand admirateur d’Updike, a pu écrire : « Updike ne sait pas comment terminer » un roman, c'est un peu court, l’indécision est une constant de la littérature américaine, quête ou vagabondage, comment vivre et poursuivre son chemin entre deux routes, le vie comme une course, une série de commencements....

"Pigeon Feathers and other stories" (1962, Les Plumes du Pigeon)
Recueil de 17 nouvelles, dont "Walter Briggs", "The Persistence of Desire", "Still Life", "A Sense of Shelter", "Dear Alexandros", "Wife-Wooing", "Pigeon Feathers", "Home", "Archangel", "You'll Never Know, Dear, How Much I Love You", "The Astronomer", "A&P", "The Doctor's Wife", "Lifeguard", "The Crow in the Woods", "The Blessed Man of Boston, My Grandmother's Thimble, and Fanning Island", "Blocked dirt, creeperslaying, My sword's Hilt, and Nether Island", "Packed Dirt, Churchgoing, A Dying Cat, A Traded Car"..
"..Dansant à une soirée avec une femme qui n'était pas la mienne, il me parut opportun de prendre sa main dans la mienne et de poser un baiser au creux de sa paume. Depuis quelque- temps ses cuisses frôlaient les miennes et, entre les danses. elle avait pris un tic bizarre: perchée sur la pointe des pieds, elle vacillait contre moi en frottant ses seins contre mon avant-bras replié sur ma poitrine pendant que je tenais une cigarette. Ma première pensée fut que je risquais de la brûler; ma seconde, que la Nature, avec son amour maternel bourru, m'avait offert une occasion, comme ma mère, lorsque j'étais enfant, décidait soudain d'organiser un goûter pour mon anniversaire ou pour la Toussaint. Docilement je baissai la tête et baisai la paume moite de mon amie. En se retirant, ses doigts au passage caressèrent mon menton de ce geste distrait de quelqu'un qui tâte le museau d'un chien importun. Cet échange de bons procédés nous fit passer à un niveau supérieur; c'était« à peine si j'entendais ma propre voix, notre danse perdit tout contact avec la musique, et ma main se mit à explorer son épine dorsale. Son dos semblait mystérieusement dur et tendu; le corps d'une femme qu'on ne connaît pas conserve davantage de son contenu minéral, que la familiarité n'a pas encore transmué en pure émotion. Nous nous arrêtâmes de danser pour bavarder dans un coin de la pièce et ce dont je me souviens distinctement, c'est de la façon dont ses mains, sous le regard approbateur de ses yeux, cherchaient les miennes à l'aveuglette, s'en emparaient et se cramponnaient doucement, avec un instinct infantile, à mes pouces. Elle ne me tenait que les pouces et, tandis que nous parlions, elle les tournait dans une direction ou dans l'autre. et c'était comme si elle me gouvernait. Quand je fermais les yeux, les ténèbres rouges derrière mes paupières tremblaient, et quand j'allai rejoindre ma femme pour la faire danser, elle me demanda: « Pourquoi es-tu essouflé ? ». Nous rentrâmes å la maison, passâmes l'inspection des quatre enfants, lûmes au lit quelques pages que la patine des Martinis rendait intolérablement brillantes, puis éteignîmes l'électricité et elle me surprit en'ne me tournant pas le dos. L'alcool détend plus profondément les femmes que les hommes ; ou peut-être comme une paire de fourchettes qu'on met en contact, avais-je déclenché chez elle des vibrations. lrrités par Dieu sait quelles stimulations illicites, chacun de nous s'en prit å l'autre. A mon regret, je dépassai la béatitude naturelle de la satiété - où chaque muscle est comme un pétale douillettement recourbé dans une corolle de bénédiction -- et je me trouvai projeté sur le territoire sec et sans vie de l'insomnie. Cette étreinte douce et angoissée qui me serrait les pouces me tourmentait dans vingt postures différentes. J'avais l'estomac retourné par l'amour de cette femme; j'avais peur d'être physiquement malade et j'étais là, inconfortablement allongé sur le dos en essayant de me calmer avec la caresse des phares qui, de stries brillantes sur le mur, s'épanouissaient en vastes éventails sur le plafond avant de disparaître; ce phénomène, avec ce qu'il sous-entendait d'une existence au-delà de moi, m'avait réconforté dans ma petite enfance les nuits où je ne dormais pas. A l'Ecole du dimanche, j'avais été frappé par le passage où Jésus dit que désirer une femme en pensée est aussi grave que commettre l'adultère. Je me trouvais maintenant désespérément cramponné å la conviction que ce sont les âmes et non pas les faits que l'on juge. Eprouver un péché, c'était le commettre; toucher le bord, c'était être au fond du gouffre. L'univers qui me permettait si facilement de commettre l'adultère devenait, par étapes logiques dont chacune descendait de façon plus abrupte que celle d'au-dessus, un univers qui me permettrait facilement de mourir. Les immensités de l'espace cosmique, l'affolante distension du temps, les massacres oubliés de l'histoire, l'enfant étouffé dans la glacière mise en rebut, la récente cassure de la spirale moléculaire, la preuve de la racine physiologique de la pensée, la présence parmi nous d'idiots, d'Eichmanns, d'animaux et de bactéries, toutes ces preuves s'amassaient et il me semblait déjà être oublié pour l'éternité. L'obscurité vibrante de ma chambre me paraissait la poussière de ma tombe ; la poussière se soulevait, se soulevait, je priais, je priais, je priais qu'on m'envoie un signe, une lueur, une faille microscopique, une lacune dans la chaîne des preuves, et je n'en voyais aucune..."

"The Centaur" (1963, Le Centaure)
On retrouve l'influence d'un Joyce, si décisive pour nombre d'écrivains. Récit couvrant trois jours de la vie du jeune Peter Caldwell, en janvier 1947 : il a treize ans et demi, taraudé par la puberté, habite une ferme en Pennsylvanie, et se demande si son père va mourir. Ce jour-là, alors que comme chaque matin, ils prennent la vieille voiture pour gagner l'école secondaire où son père enseigne les sciences, ils sont bloqués par la neige et ne rentreront que deux jours plus tard...
"Hummel’s Garage adjoined the Olinger High School property, a little irregular river of asphalt separating them. Its association with the school was not merely territorial. Hummel had for many years, though not now, served on the school board, and his young red haired wife, Vera, was the girls’ physical education instructor. The garage got much trade from the high school. Boys brought their derelict jalopies here to be xed, and younger boys pumped up basketballs with the free air. In the front part of the building, in the large room where Hummel kept his accounts and his tattered, blackened library of spare-parts catalogues and where two wooden desks side by side each supported a nibbled foliation of papers and pads and spindles skewering up to the rusted tip u y stacks of pink receipts, here a cloudy glass case, its cracked top repaired with a lightning-shaped line of tire tape, kept candy in crackling wrappers waiting for children’s pennies. Here, on a brief row of greasy folding chairs overlooking a ve-foot cement pit whose oor was ush with the alley outside, the male teachers sometimes—more of old than recently—sat at noon and smoked and ate Fifth Avenues and Reese’s Peanut Butter Cups and Essick’s Coughdrops and put their tightly laced and polished feet up on the railing and let their martyred nerves uncurl while, in the three-sided pit below, an automobile like an immense metal baby was washed and changed by Hummel’s swarthy men.
"..Le garage Hummel n'était séparé des terrains du lycée d'Olinger que par un petit ruban d'asphalte qui serpentait entre les deux propriétés, irrégulier comme une rivière. Ses liens avec l'établissement scolaire ne se limitaient pas à cet aspect purement territorial. Pendant de longues années, Hummel, bien qu'il n'en fit plus partie maintenant, avait siégé au conseil d'administration du lycée, et sa jeune femme, une rousse du nom de Vera, y était encore monitrice d'éducation physique pour les filles. Un commerce actif existait entre le garage et l'établissement scolaire. La garçons venaient y faire réparer leurs vieux tacots, et les plus jeunes d'entre eux regonflaient leurs ballons de basket gratuitement à la pompe. Sur le devant de la bâtisse, dans une grande pièce où Hummel gardait ses comptes et sa collection noircie, déchiquetée, de catalogues de pièces de rechange, à côté de deux bureaux qui supportaient, empilés comme les strates d'un dépôt géologique, des papiers écornés, des blocs et des paquets de reçus roses pelucheux, il y avait une vitrine poussiéreuse, dont le verre fêlé, comme par un éclair, avait été réparé avec des rustines. Des bonbons y attendaient, dans leurs emballages bruissants, la menue monnaie des enfants. Quelquefois, et de plus en plus fréquemment depuis quelque temps, on y trouvait à l'heure du déjeuner les professeurs qui, installés sur une petite rangée de chaises pliantes graisseuses dominant une fosse de ciment de deux mètres de profondeur environ, dont le fond était de plain-pied avec l'allée, venaient là détendre leurs nerfs martyrisés, leurs pieds étroitement lacés dans des chaussures bien cirées posés sur la balustrade, en fumant, ou en mangeant des Fifth Avenues, des Peanut Butter Cups de Reese, ou des pastilles pectorales d'Essick, cependant qu'en bas, dans la fosse triangulaire, les assistants basanés de Hummel nettoyaient une voiture, comme on laverait et langerait un énorme bébé de métal.
The main and greater part of the garage was approached on an asphalt ramp as rough, streaked, gouged, ecked, and bubbled as a hardened volcanic ow. In the wide green door opened to admit motored vehicles, there was a little man-sized door with KEEP CLOSED
dribblingly dabbed in blue touch-up paint below the latch. Caldwell lifted the latch and entered. His hurt leg cursed the turn needed to close the door behind him.
A deep warm darkness was lit by sparks. The oor of the grotto was waxed black by oil drippings. At the far side of the long workbench, two shapeless men in goggles caressed a great downward-drooping fan of ame broken into dry drops. Another man, staring upward out of round eyesockets white in a black face, rolled by on his back and disappeared beneath the body of a car. His eyes adjusting to the gloom, Caldwell saw heaped about him overturned fragments of automobiles, fragile and phantasmal, fenders like corpses of turtles, bristling engines like disembodied hearts. Hisses and angry thumps lived in the mottled air. Near where Caldwell stood, an old potbellied coal stove bent brilliant pink through its seams. He hesitated to leave its radius of warmth, though the thing in his ankle was thawing, and his stomach assuming an unsettled utter.
Hummel himself appeared in the doorway of the workshop. As they walked toward each other, Caldwell experienced a mocking sensation of walking toward a mirror, for Hummel also limped. One of his legs was smaller than the other, due to a childhood fall. He looked hunched, pale, weathered; the recent years had diminished the master mechanic. The Esso and Mobilgas chains had both built service stations a few blocks away along the pike, and now that the war was over, and everybody could buy new cars with their war work money, the demand for repairs had plummeted.
On accédait à la partie principale, la plus vaste, du garage, par une rampe d'asphalte, aussi raboteuse, érodée, bosselée et boursouflée qu'une coulée de lave durcie. Dans la grande porte verte que I'on ouvrait pour laisser passer les véhicules à moteur, était pratiquée une porte plus petite, à taille d'homme, sur laquelle on avait peint au badigeon bleu. juste sous le loquet, "Prière de refermer". Caldwell souleva le loquet et entra. Sa cheville blessée lui fit maudire l'obligation de le retourner pour fermer la porte. L'obscurité chaude était traversée d'étincelles. Les coulées d'huile avaient noirci le sol de cette sorte de grotte. A l'autre bout d'un long établi, deux hommes informes, protégés par de grosses lunettes, maniaient avec des gestes caressants un grand jet de flamme dirigé vers le sol, où l'éventail de feu, en se desséchant, se brisait en gouttelettes. Un autre homme, fixant le plafond avec des yeux cernés de blanc dans un visage tout noir, roula, couché sur le dos , sous la carrosserie d'une voiture. Au fur et à mesure que ses yeux s'habituaient aux ténèbres, Caldwell distinguait, entassés autour de lui, des fragments d'automobiles, sens dessus dessous, fragiles et fantomatiques, des pare-chocs semblables à des cadavres de tortues, des moteurs dont la carcasse hérissée faisait penser à un cœur mis à nu. L'air poisseux vibrait de sifflements et de cognements rageurs. Près de Caldwell, un vieux poêle à charbon irradiait un rose éclatant à travers les fentes de sa panse bombée. Caldwell hésita à sortir du cercle de rayonnement de cette chaleur, bien qu'il eût l'impression de sentir fondre le projectile fiché dans sa cheville, et que son estomac recommençât à frémir d'inquiétude.
Hummel apparut au seuil de l'atelier. Tandis qu'ils avançaient l'un vers l'autre, Caldwell eut l'impression irritante de se diriger vers son reflet narquois dans un miroir, car Hummel, lui aussi, boitait. Une de ses jambes était plus courte que l'autre..."

"Couples" (1968, Couples)
«– Quel mal faisons-nous? demanda Frank...
– Il leur cria à tous : – Faisons ça tous dans la même pièce! Couvrez ma brebis blanche, je veux la voir hennir!
Harold poussa du nez un soupir délicat.
– Tu vois, dit-il à Janet. Tu as rendu ton mari fou avec ta frigidité. Je commence à avoir la migraine.
– Humanisons-nous les uns les autres, supplia Frank.»
C'est le livre sensation de l'année, le portrait de cette "Société adultère" dont l'intrigue se déroule à l'automne 1963 au moment de l'assassinat de John Kennedy. Le monde traverse une énorme crise spirituelle, et si le désespoir existentiel n'a pas disparu de la nature humaine, c'est désormais la description la plus explicite de l'acte sexuel qui fait évoluer les moeurs et donc la société. Deux personnages, le dentiste Freddy Thorne, qui organise les rencontres et les avortements, et Piet Hanema, l'entrepreneur de construction qui ne résout sa crise d'angoisse en s'abandonnant à Foxy, au détriment de sa femme Angela par trop peu compréhensive. (Gallimard, traduction anglaise Anne-Marie Soulac).
Welcome to Tarbox
''What did you make of the new couple?"
The Hanemas, Piet and Angela, were undressing. Their bedchamber was a low-ceilinged colonial room whose woodwork was painted the shade of off-white commercially called eggshell. A spring midnight pressed on the cold windows.
"Oh," Angela answered vaguely, "they seemed young." She was a fair soft brown-haired woman, thirty-four, going heavy in her haunches and waist yet with a girl's fine hard ankles and a girl's tentative questing way of moving, as if the pure air were loosely packed with obstructing cloths. Age had touched only the softened line of her jaw and her hands, their stringy backs and reddened fingertips.
"How young, exactly?"
"Oh, I don't know. He's thirty trying to be forty. She's younger. Twenty-eight? Twenty-nine? Are you thinking of taking a census?"
He grudgingly laughed. Piet had red hair and a close-set body; no taller than Angela, he was denser. His flattish Dutch features, inherited, were pricked from underneath by an acquired American something-a guilty humorous greed, a wordless question.
His wife's languid unexpectedness, a diffident freshness born of aristocratic self-possession, still fascinated him. He thought of himself as coarse and saw her as fine, so fair and fine her every gesture seemed transparently informed by a graciousness and honesty beyond him. When he had met her, Angela Hamilton, she had been a young woman past first bloom, her radiance growing lazy, with an affecting slow mannerism of looking away, the side of her neck bared, an inexplicably unscarred beauty playing at schoolteaching and living with her parents in Nun's Bay, and he had been laboring for her father, in partnership with an army friend, one of their first jobs, constructing a pergola in view of the ocean and the great chocolate-dark rock that suggested, from a slightly other angle, a female profile and the folds of a wimple. There had been a cliff, an ample green lawn, and bushes trimmed to the flatness of tables. In the house there had been many clocks, grandfather's and ship's clocks, clocks finished in ormolu or black lacquer, fine-spun clocks in silver cases, with four balls as pendulum. Their courtship passed as something inVtantly forgotten, like an enchantment, or a mistake. Time came unstuck. All the clocks hurried their ticking, hurried them past doubts, around sharp corners and knobbed walnut newels. Her father, a wise-smiling man in a tailored gray suit, failed to disapprove. She had been one of those daughters so favored that spinsterhood alone might dare to claim her. Fertility at all costs.
He threw business his son-in-law's way. The Hanemas' first child, a daughter, was born nine months after the wedding night. Nine years later Piet still felt, with Angela, a superior power seeking through her to employ him. He spoke as if in selfdefense: "I was just wondering at what stage they are. He seemed rather brittle and detached."
"You're hoping they're at our stage?"
Her cool thin tone, assumed at the moment when he had believed their intimacy, in this well-lit safe room encircled by the April dark, to be gathering poignant force enough to vault them over their inhibitions, angered him. He felt like a fool. He said, "That's right. The seventh circle of bliss."
"Is that what we're in?" She sounded, remotely, ready to believe it.
"- Comment as-tu trouvé les nouveaux?
Les Hanema : Piet et Angela, étaient en train de se déshabiller. Leur chambre était une pièce de style colonial au plafond bas, aux boiseries peintes en blanc, le blanc crème connu en décoration sous l'appellation de "coquille d'œuf". Une nuit de printemps se pressait aux fenêtres froides.
-- Oh! répondit distraitement Angela, ils m'ont paru jeunes.
Angela était une belle brune douce, de trente-quatre ans, dont la taille et les hanches s'alourdissaient mais qui avait gardé les chevilles fines et nettes d'une jeune fille et aussi cette démarche inquiète, indécise, qui semble se frayer un chemin au milieu d'un entassement de draperies gênantes. L'âge ne se trahissait qu'à l'amollissement du dessin de la mâchoire, aux tendons apparents sur le dos des mains, et aux doigts aux bouts rougís.
- Quel âge exactement?
-- Oh! je ne sais pas. Il a trente ans et voudrait en paraître quarante. Elle, est plus jeune : vingt-huit? Vingt-neuf? Tu as l'intention de faire un recensement?
Piet se mit à rire un peu à contrecœur. Il avait, les cheveux roux et un corps compact; il n'était pas plus grand qu'Angela, mais plus dense. Les traits hollandais, un peu écrasés, qu'il tenait de ses ancêtres étaient relevés par on ne savait quoi d'américain acquis : une avidité coupable et non sans humour, une question inexprimée. Ce que sa femme avait de fantasque et d'alangui à la fois, cette fraîcheur sans assurance née d'une réserve aristocratique le fascinaient encore. Il se trouvait grossier et la voyait fine, si belle et si fine que chacun de ses gestes paraissait animé de manière transparente par une grâce et une honnêteté qui le dépassaient. Quand il avait rencontré Angela Hamilton, c'était une jeune femme déjà épanouie, à l'éclat devenu paresseux qui avait une façon touchante de détourner lentement la tête, dévoilant son cou dénudé, une beauté inexplicablement intacte, qui jouait à la maîtresse d'école et vivait chez ses parents à Nun's Bay; lui travaillait pour le père d'Angela, avec son partenaire, un ami de l'armée, à un de leurs premiers chantiers, une pergola qu'ils construisaient avec vue sur l'océan et le grand rocher chocolat qui sous un angle un peu différent évoquait un profil de femme et les plis d'un voile. Il y avait une falaise, une vaste pelouse verte, et des buissons taillés, plats comme des tables. Dans la maison s'étalait une profusion de pendules : grandes horloges anciennes et horloges de marine, pendules en or moulu ou en laque noire, délicates pendules dans leurs boîtes d'argent, où quatre boules jouaient le rôle de balancier. La cour qu'il fit ne lui laissa pas plus de souvenirs qu'un enchantement ou une erreur. Le temps se dérégla. Toutes les pendules pressèrent leur mouvement, laissant derrière elles les doutes, les angles aigus et les boules de noyer des rampes d'escalier. Le père d'Angela, avec son costume gris et son sourire sage, ne marqua pas de désapprobation. Elle avait été une de ces filles si chéries qu'il était à craindre qu'aucun homme n'osât l'approcher. Fertilité à tout prix. Il procura des affaires à son gendre. Le premier enfant des Hanema, une fille, naquit neuf mois après la nuit des noces. Neuf ans plus tard Piet pressentait toujours en Angela une puissance supérieure cherchant à se servir de lui à travers elle. Il parla comme pour se défendre:
- Je me demandais à quel stade ils en étaient. Il m'a paru plutôt fragile et détaché.
- Tu espères qu'ils en sont à notre stade à nous?
Le ton froid et grêle qu'elle prenait au moment où, dans cette pièce bien éclairée encerclée par les ténèbres d'avril, il avait cru qu'il y avait une puissance d'émotion suffisante dans leur intimité pour les porter au-delà de leurs inhibition, le mit en colère. Il eut l'impression d'être un imbécile. .
- C'est ça, dit-il. Le septième cercle de la béatitude.
- Est-ce là que nous en sommes?
Elle avait l'air vaguement prête à le croire.
They each stood before a closet door, on opposite sides of an unused fireplace framed in pine paneling and plaster painted azure. The house was a graceful eighteenth-century farmhouse of eight rooms. A barn and a good square yard and a high lilac hedge came with the property. The previous owners, who had had adolescent boys, had attached a basketball hoop to one side of the barn and laid down a small asphalt court. At another corner of the two acres stood an arc of woods tangent to a neighboring orchard. Beyond this was a dairy farm. Seven miles further along the road, an unseen presence, was the town of Nun's Bay; and twenty miles more, to the north, Boston. Piet was by profession a builder, in love with snug right-angled things, and he had grown to love this house, its rectangular low rooms, its baseboards and chair rails molded and beaded by hand, the slender mullions of the windows whose older panes were flecked with oblong bubbles and tinged with lavender, the swept worn brick of the fireplace hearths like entryways into a sooty upward core of time, the attic he had lined with silver insulation paper so it seemed now a vaulted jewel box or an Aladdin's cave, the solid freshly poured basement that had been a cellar floored with dirt when they had moved in five years ago. He loved how this house welcomed into itself in every season lemony flecked rhomboids of sun whose slow sliding revolved it with the day, like the cabin of a ship on a curving course. All houses, all things that enclosed, pleased Piet, but his modest Dutch sense of how much of the world he was permitted to mark off and hold was precisely satisfied by this flat lot two hundred feet back from the road, a mile from the center of town, four miles distant from the sea.
(...)
Ils se tenaient chacun devant une porte de penderie, de part et d'autre d'une cheminée condamnée encadrée de lambris de pin et de moulures peintes en bleu ciel. La maison était une élégante construction du XVIIIe siècle, une ferme de huit pièces. La propriété comprenait aussi une grande cour carrée et une haute haie de lilas. Les précédents propriétaires qui avaient des fils adolescents avaient fixé un panier de basket-ball à l'un des murs de la grange et fait goudroner un petit emplacement. Dans un autre coin de l'hectare de terrain un arc de bois était tangent à un verger voisin. Au-delà se trouvait une vacherie. Dix kilomètres plus loin sur la route, présence invisible, c'était la ville de Nun's Bay. Et à trente kilomètres de là, vers le nord, Boston. Piet, dont la profession était de construire, était épris de contours nets, d'angles droits; et il en était venu à aimer cette maison avec ses pièces basses rectangulaires, ses plinthes et ses antébois façonnés et appliqués à la main, les meneaux élancés des fenêtres dont les vitres anciennes teintées de bleu lavande étaient parsemées de longues bulles, les âtres aux briques usées et bien balayées ressemblant à des accès à quelque noyau céleste du temps, noir de suie, le grenier qu'il avait revêtu de papier isolant argenté si bien qu'il avait pris lfapparence d'un coffret à bijoux voûté ou d'une caverne d'Aladin, au fond le sous-sol de béton, frais coulé, qui n'était qu'une cave au fond de terre battue quand ils avaient emménagé cinq ans plus tôt. Il aimait la manière dont cette maison accueillait en elle, en toute saison, des losanges mouchetés de soleil, d'un jaune acide, dont la course lente l'entraînait en une révolution qui faisait d'elle la cabine d'un bateau effectuant une course circulaire. Toutes les maisons, tous les espaces clos, plaisaient à Piet, mais la modestie hollandaise, qui imposait des limites à ce qu'il aurait pu s'approprier du monde, se contentait exactement de ce terrain plat, à cent mètres en retrait de la route, à quinze cents mètres du centre de la ville et à six kilomètres de la mer.."

"Couples" est un roman provocateur qui évoque sans la moindre retenue les mœurs sexuelles et les tensions sociales d’une petite communauté bourgeoise de la Nouvelle-Angleterre dans les années 1960 (Tarbox, une petite ville fictive du Massachusetts). À travers les infidélités, les jalousies et les crises existentielles de dix couples, Updike peint une satire acide de l’Amérique libérée mais moralement désorientée de l’ère post-Kennedy.
On y voit l’adultère comme religion moderne, la mort de Dieu et la quête de sens à travers le sexe, et le conflit entre puritanisme et hédonisme.
On y rencontre notamment,
- Piet Hanema (entrepreneur en rénovation, d’origine hollandaise) – Le protagoniste, déchiré entre sa femme et ses maîtresses.
- Angela Hanema (femme de Piet, belle et mélancolique) – Incarne la grâce fragile et l’ancienne morale.
- Foxy Whitman (jeune femme enceinte, intellectuelle) – Maîtresse de Piet, symbole du désir et de la culpabilité.
- Freddy Thorne (dentiste cynique) – Le "diable" du groupe, qui orchestre les liaisons.
- Georgene Thorne (femme de Freddy) – Ancienne maîtresse de Piet, désabusée.
Chapitre par chapitre, on peut évoquer quelques des scènes clés ..
- Partie 1 : L’Équilibre - Le jeu des couples : Les époux de Tarbox organisent des dîners où l’alcool et les flirts mènent à des échanges de partenaires. Piet entame une liaison avec Georgene Thorne. L’arrivée de Foxy : Foxy Whitman et son mari Ken s’installent en ville. Elle tombe enceinte, ce qui attise le désir de Piet.
- Partie 2 : La Chute - L’adultère Piet/Foxy : Après une tempête qui isole les deux lors d’un dîner, ils couchent ensemble. Leur passion devient le cœur secret du roman. La mort de la fille des Hanema : La fille de Piet et Angela, Nancy, est accidentellement brûlée (symbolisant la destruction de la famille).
- Partie 3 : Le Jugement - Foxy avorte : Avec l’aide de Freddy Thorne (qui exige en échange une nuit avec Angela), Foxy subit un avortement clandestin. Piet est rongé par la honte.
L’effondrement des couples : Les mensonges éclatent. Angela quitte Piet, Ken Whitman découvre tout et quitte Foxy.
- Épilogue : La Nouvelle Vie - Piet épouse Foxy et quitte Tarbox pour une autre ville. Le cercle des couples se disloque, certains divorcent, d’autres sombrent dans l’alcool.
Best-seller en 1968, le livre a choqué par son explicite, mais fut salué pour sa profondeur psychologique : sous les corps entrelacés, Updike montre une génération perdue, cherchant désespérément du sacré dans le sexe...
Un document historique sur l’hypocrisie de la révolution sexuelle....
1960–1990 - 'The Rabbit Quartet"
"Rabbit, Run" (1960), "Rabbit Redux" (1971), "Rabbit is Rich" (1981), "Rabbit at Rest" (1990)
Ces quatre romans racontent l'histoire de Harry "Rabbit" Angstrom, un américain, mâle. Nous le rencontrons pour la première fois à l'âge de vingt-six ans, ancien joueur de basket-ball marié à Janice qu'il abandonne, enceinte, pour Ruth. Les femmes de Rabbit - sa femme, sa mère, sa belle-mère, sa sœur, sa belle-fille et ses diverses maîtresses et rencontres - débordent de vie dans la moindre parcelle de leur corps , tout comme l'organe de Rabbit lui-même qui mène une vie pratiquement indépendante, entraînant Rabbit dans des infidélités et des trahisons qui ne laissent jamais enrepos. La vie avec Janice dans ces circonstances reste toujours assez difficile à démêler et reflète l'époque - la guerre du Vietnam, les relations raciales, une société en ébullition sur tous les fronts. Les écarts de conduite de Rabbit et de Nelson, le fils de Janice, font écho à tout ce qui s'est passé auparavant et, au fur et à mesure que leur vie progresse, le sexe appliqué à outrance et mal utilisé devient une analogie mordante, toujours explicite, de la désintégration des États-Unis sous un tir de barrage de drogues, de guerres, de malbouffe et de télévision ; prédisant étrangement aussi les aventures clintonesques à venir....
Updike est un écrivain irrésistiblement drôle, au style faussement facile. Son sens de la comédie et ses contemplations philosophiques excentriques traversent ce quatuor, un classique américain contemporain. Chaque roman peut être lu séparément, mais lisez-les tous ; chacun semble encore meilleur que le précédent...

"Rabbit Redux" (1971, Rabbit rattrapé)
Considéré comme le meilleur de la série, Updike retrace quatre mois de la vie de Rabbit, alors à 36 ans ouvrier typographe linotypiste, de mai 1969, date de la bataille d'Hamburger Hill, symbole de l'inanité de la guerre du Vietnam, à octobre 1969, date de la manifestation contre le Pentagone. Au passage, un mois de juillet qui voit l'envol vers la Lune. Dix ans ont passé depuis le temps où "Rabbit" Angstrom, le héros chimérique de Cœur de Lièvre, tentait désespérément de fuir le monde irrespirable et quotidien des responsabilités adultes. L'athlète ailé a pris du ventre, a acquis un métier, trouvé un équilibre précaire dans la résignation. Il en est venu à admirer cette force qui l'a brisé : l'Amérique. Mais le monde change autour de lui. Sa petite ville de stuc et de béton se dégrade en même temps que se défont les règles auxquelles il avait tant bien que mal plié sa vie. Son métier est périmé, sa femme le trompe, ses certitudes n'étaient que masques. Alors pourquoi ne pas se mettre à l'unisson du dérèglement universel, de l'érotisme et de la drogue? Rabbit se laisse glisser jusqu'à ce que la cruauté du monde vienne le rappeler à l'ordre... (Gallimard, traduction anglaise de Georges Magnane).
"Janice turns and choppily runs into the house, up the three steps, into the house with apple-green aluminum clapboards. Rabbit puts the mower back in the garage and enters by the side door into the kitchen. She is there, slamming pots around, making their dinner.
He asks her, “Shall we go out to eat for a change? I know a nifty little Greek restaurant on Quince Street.”
“That was just coincidence he showed up. I admit it was Charlie who recommended it, is there anything wrong with that? And you were certainly rude to him. You were incredible.”
“I wasn’t rude, we had a political discussion. I like Charlie. He’s an O.K. guy, for a left-wing mealy-mouthed wop.”
“You are really very strange lately, Harry. I think your mother’s sickness is getting to you.”
“In the restaurant, you seemed to know your way around the menu. Sure he doesn’t take you there for lunch? Or on some of those late-work nights? You been working a lot of nights, and don’t seem to get much done.”
“You know nothing about what has to be done.”
“I know your old man and Mildred Kroust used to do it themselves without all this overtime.”
“Having the Toyota franchise is a whole new dimension. It’s endless bills of lading, import taxes, customs forms.” More fending words occur to Janice; it is like when she was little, making snow dams in the gutter. “Anyway, Charlie has lots of girls, he can have girls any time, single girls younger than me. They all go to bed now without even being asked, everybody’s on the Pill, they just assume it.” One sentence too many.
“How do you know?”
“He tells me.”
“So you are chummy.”
“Not very. Just now and then, when he’s hung or needing a little mothering or something.”
“Right—maybe he’s scared of these hot young tits, maybe he likes older women, mamma mia and all that. These slick Mediterranean types need a lot of mothering.”
It’s fascinating to her, to see him circling in; she fights the rising in her of a wifely wish to collaborate, to help him nd the truth that sits so large in her own mind she can hardly choose the words that go around it.
“Anyway,” he goes on, “those girls aren’t the boss’s daughter.”
Yes, that is what he’d think, it was what she thought those first times, those first pats as she was standing tangled in a net of numbers she didn’t understand, those first sandwich lunches they would arrange when Daddy was out on the lot, those first five o’clock whisky sours in the Atlas Bar down the street, those first kisses in the car, always a different car, one they had borrowed from the lot, with a smell of new car like a protective skin their touches were burning through. That was what she thought until he convinced her it was her, funny old clumsy her, Janice Angstrom née Springer; it was her flesh being licked like ice cream, her time being stolen in moments compressed as diamonds, her nerves caught up in an exchange of pleasure that oscillated between them in tightening swift circles until it seemed a kind of frenzied sleep, a hypnosis so intense that later in her own bed she could not sleep at all, as if she had napped that afternoon. His apartment, they discovered, was only twelve minutes distant, if you drove the back way, by the old farmers’ market that was now just a set of empty tin-roofed sheds.
"...Elle est là, en train de bousculer la vaisselle; elle prépare leur dîner. Il lui demande : - Si nous allions dîner dehors, pour changer? Je connais un fameux petit restaurant grec du côté de Plum Street. - C'est une simple coïncidence qu'il soit venu. Je reconnais que c'est Charlie qui me l'avait recommandé, quel mal y a-t-il à cela ? Et tu as été vraiment grossier avec lui. C'était inconcevable. - Je n'aí pas été grossier, nous avons eu une discussion politique. Charlie ne me déplaît pas du tout. Il est très bien, pour un métèque mielleux et gauchisant. - Tu es vraiment bizarre depuis quelque temps, Harry. Tu dois être obsédé par la maladie de ta mère. - Au restaurant, il m'a semblé que le menu t'était bien familier. Tu es sûre qu'il ne t'emmène pas là-bas à l'heure du déjeuner ? Ou bien le soir quand tu travailles si tard ? Tu as beaucoup travaillé le soir, et il ne semble pas qu'il y ait grand-chose de fait. - Tu ne sais absolument pas ce qu'il y a à faire. - Je sais que ton père et Mildred Kroust le faisaient eux-mêmes sans heures supplémentaires. - Être concessionnaire de Toyota donne à l'affaire une dimension nouvelle. Nous sommes submergés par les connaissements, les taxes d'importation et les feuilles de douane.
Toutes sortes d'arguments défensifs se présentent à l'esprit de Janice; cela lui rappelle les digues de neige qu'elle construisait dans le ruisseau, étant enfant. - De toute façon, Charlie a des tas de filles, il n'est pas en peine de trouver des filles, n'importe quand, et qui sont célibataires et plus jeunes que moi. Toutes les filles couchent, maintenant, sans même qu'on le leur demande, elles prennent la pilule et elles trouvent ça tout naturel.
Une phrase de trop.
- Comment le sais-tu ? - Il me l'a dit. - En somme, vous êtes copain-copain. - Pas tellement. Seulement de temps à autre, quand il est déprimé, qu'il a besoin d'être un peu dorloté ou autre chose. - Oui, mais peut-être qu'il a peur de tous ces nichons trop ardents, peut-être qu'il préfère les femmes plus âgées, le genre mamma mia et tout ça. Ces Méditerranéens onctueux sont toujours en reste d'affection maternelle.
C'est fascinant pour elle de le voir se rapprocher en spirale; elle doit lutter contre le réflexe de l'épouse qui est de collaborer, contre l'envie de l'aider à découvrir la vérité qui, pour elle, s'étale si énorme qu'elle a du mal à trouver les mots qui lui permettent de la contourner.
- Et puis, poursuit Harry, ces gamines ne sont pas la fille du patron.
Oui, c'était bien le genre de choses qu'Harry pouvait supposer, c'était ce qu'elle avait pensé les premières fois: ces premières petites tapes d'encouragement alors qu'elle était perdue dans des chiffres auxquels elle ne comprenait rien, ces premiers déjeuners de sandwiches qu'ils organisaient quand papa n'était pas là, ces premiers whiskys sours de cinq heures à l'Atlas Bar, en bas de la rue, ces premiers baisers dans la voiture, jamais la même, une voiture qu'ils empruntaient au stand d'exposition et qui avait toujours une odeur de neuf, l'odeur du vernis transparent où chacun de leurs gestes faisait une déchirure. C'était ce qu'elle pensait jusqu'à ce qu'il l'ait convaincue que c'était elle, elle, cette drôle de petite bonne femme gauche et pas jeune, elle, Janice Angstrom née Springer, redevenue Springer, redevenue jeune fille, qu'il voulait. C'était sa chair qu'il léchait comme une crème glacée, son temps qu'il volait en des moments qui avaient la densité du diamant, ses nerfs à elle, Janice, qui se trouvaient pris dans un mécanisme de plaisir fin comme les ressorts d'une montre, qui oscillait entre eux puis se resserrait en cercles rapides jusqu'au moment où ils plongeaient tous deux dans une sorte de sommeil ravi, d'hypnose si intense que plus tard chez elle, dans son lit, elle ne pouvait s'endormir, comme si elle avait fait la sieste l'après-midi. L'appartement de Charlie, ils l'avaient découvert, n'était qu'à douze minutes du bureau en passant par les petites rues, par le vieux marché aux légumes qui n'était plus aujourd'hui qu'un ensemble de toitures métalliques désaffectées.
“What good would my being the boss’s daughter do him?”
“It’d make him feel he was climbing. All these Greeks or Polacks or whatever are on the make.”
“I’d never realized, Harry, how full of racial prejudice you are.”
“Yes or no about you and Stavros.”
“No.” But lying she felt, as when a child watching the snow dams melt, that the truth must push through, it was too big, too constant: though she was terri ed and would scream, it was something she must have, her confession like a baby. She felt so proud.
“You dumb bitch,” he says. He hits her not in the face but on the shoulder, like a man trying to knock open a stuck door.
She hits him back, clumsily, on the side of the neck, as high as she can reach. Harry feels a ash of pleasure: sunlight in a tunnel. He hits her three, four, five times, unable to stop, boring his way to that sunlight, not as hard as he can hit, but hard enough for her to whimper; she doubles over so that his last punches are thrown hammerwise down into her neck and back, an angle he doesn’t see her from that much—the chalk-white parting, the candle-white nape, the bra strap showing through the fabric of the back of the blouse. Her sobbing arises muffed and, astonished by a beauty in her abasement, by a face that shines through her reduction to this craven faceless posture, he pauses. Janice senses that he will not hit her anymore. She abandons her huddle, ops over to her side, and lets herself cry out loud—high-pitched, a startled noise pinched between sieges of windy gasping. Her face is red, wrinkled, newborn; in curiosity he drops to his knees to examine her. Her black eyes ash at this and she spits up at his face, but misjudges; the saliva falls back into her own face. For him there is only the faintest kiss of spray. Flecked with her own spit Janice cries, “I do, I do sleep with Charlie!”
“Ah, shit,” Rabbit says softly, “of course you do,” and bows his head into her chest, to protect himself from her scratching, while he half-pummels her sides, half-tries to embrace her and lift her.
“I love him. Damn you, Harry. We make love all the time.”
“Good,” he moans, mourning the receding of that light, that ecstasy of his hitting her, of knocking her open. Now she will become again a cripple he must take care of. “Good for you.”
“It’s been going on for months,” she insists, writhing and trying to get free to spit again, furious at his response. He pins her arms, which would claw, at her sides and squeezes her hard. She stares into his face. Her face is wild, still, frozen. She is seeking what will hurt him most. “I do things for him,” she says, “I never do for you.”
“Sure you do,” he murmurs, wanting to have a hand free to stroke her forehead, to re-enclose her. He sees the gloss of her forehead and the gloss of the kitchen linoleum. Her hair wriggles outward into the spilled wriggles of the marbled linoleum pattern, worn where she stands at the sink. A faint rotten smell here, of the sluggish sink tie-in. Janice abandons herself to crying and limp relief, and he has no trouble lifting her and carrying her in to the living-room sofa. He has zombie-strength: his shins shiver, his palm sore from the clipper handles is a stiff crescent
- A quoi ça pourrait bien lui être utile, que je sois la fille du patron ? - Ça lui donnerait l'impression de s'élever socialement. Tous ces gens, ces Polonais et ces je-ne-sais-quoi, ça guette les occasions. - Je ne m'étais jamais rendu compte, Harry, que tu avais autant de préjugés racistes. - Toi et Stavros, c'est oui ou non? - Non.
Mais, tandis qu'elle ment, elle sent, comme un enfant regardant fondre la digue de neige, que la vérité va faire irruption, elle est trop énorme, trop insistante. Bien qu'elle soit terrifiée et sur le point de hurler, Janice attend quelque chose, il lui faut sa confession, comme à un bébé. Au fond, elle est si fière.
- Stupide garce, dit-il.
Il la frappe, non au visage mais à l'épaule, comme un homme qui essaie d'ouvrir d'une poussée une porte coincée. Elle le frappe à son tour, maladroitement, sur le côté du cou, aussi haut qu'elle peut l'atteindre. Harry ressent un éclair de plaisir : un rayon de soleil dans un tunnel. Il la frappe trois, quatre, cinq fois, incapable de s'arrêter, se frayant un chemin vers cette lumière; il ne tape pas aussi fort qu'il le pourrait mais cependant assez pour qu'elle pleurniche; elle se plie en deux et les derniers coups d'Harry l'atteignent comme des coups de marteau, de haut en bas, sur le cou et le dos ; il ne la voit pas souvent sous cet angle : l'espace blanc entre ses omoplates, sa nuque d'une blancheur de cire, l'élastique de son soutien-gorge apparent sous le tissu de sa blouse. Les sanglots de Janice montent, étouffés et, saisi par la beauté de cette attitude humiliée, par le rayonnement d'un visage qu'il imagine car elle est réduite dans cette posture accablée à n'avoir pas de visage, il s'arrête. Janice devine qu'il ne va plus la frapper. Elle cesse de se tasser sur elle-même, se laisse aller sur le côté, donne libre cours à ses larmes - des gémissements aigus, saccadés, coincés entre des phases de grands halètements. Son visage est rouge, plissé, un visage de nouveau-né; Harry, par curiosité, tombe à genoux pour l'observer. Elle s'en aperçoit et ses yeux lancent des éclairs, elle lui crache à la figure mais elle vise mal : sa salive lui retombe sur le visage. Lui ne reçoit que la caresse d'un infime embrun. Barbouillée de sa propre salive, Janice crie :
- Oui, oui, je couche avec Charlie!
- Ah, merde, dit doucement Rabbit, bien sûr que tu couches avec lui.
Et il baisse la tête contre la poitrine de Janice pour l'empêcher de le griffer, et tantôt il la cogne sur les flancs, et tantôt il essaie de la prendre dans ses bras et de la soulever.
- Je l'aime. Va te faire foutre, Harry. Nous faisons l'amour tout le temps.
- Tant mieux, gémit-il, regrettant de sentir s'éloigner cette lumière, cette volupté de la battre, de la forcer à s'ouvrir.
Maintenant, elle va devenir une estropiée de plus, dont il faudra prendre soin.
- Tant mieux pour toi.
- Ça dure depuis des mois, précise-t-elle en se tortillant.
Elle essaie de se libérer pour lui cracher encore au visage; elle est furieuse de sa réaction. Il lui immobilise les bras pour l'empêcher de griffer en les lui plaquant contre les flancs, et il serre. Elle le dévisage. Elle a une expression égarée, immobile, figée. Elle cherche ce qui pourrait lui faire le plus de mal :
- Je lui fais des choses, dit-elle, que je ne t'ai jamais faites à toi.
- Bien sûr, murmure-t-il en s'efforçant de libérer l'un de ses bras pour pouvoir lui caresser le front, essayer de la reprendre en main. Il voit les reflets sur son front et les reflets sur le linoléum de la cuisine. Les cheveux de Janice s'éparpillent en tous sens et se mêlent aux tortillons du linoléum marbré usé devant l'évier. Une légère odeur douceâtre monte jusqu'à eux de la vidange encrassée. Elle s'abandonne aux larmes, toute molle, soulagée, il n'a aucune difficulté à la soulever et à l'emporter sur le canapé de la salle de séjour. Il a une force surnaturelle : un frisson parcourt le devant de ses tibias, la douleur de ses paumes, due aux poignées des cisailles, est un croissant de bronze.
She sinks lost into the sofa’s breadth.
He prompts her, “He makes better love than me,” to keep her confession flowing, as a physician moistens a boil.
She bites her tongue, trying to think, surveying her ruins with an eye toward salvage. Impure desires—to save her skin, to be kind, to be exact—pollute her primary fear and anger. “He’s different,” she says. “I’m more exciting to him than to you. I’m sure it’s just mostly our not being married.”
“Where do you do it?”
Worlds whirl past and cloud her eyes—car seats, rugs, tree undersides seen through windshields, the beigy-gray carpeting in the narrow space between the three green steel desks and the safe and the Toyota cutout, motel rooms with their cardboard panelling
and scratchy bedspreads, his dour bachelor’s apartment stuffed with heavy furniture and tinted relatives in silver frames. “Different places.”
“Do you want to marry him?”
“No. No.” Why does she say this? The possibility opens an abyss.
She would not have known this. A gate she had always assumed gave onto a garden gave onto emptiness. She tries to drag Harry down closer to her; she is lying on the sofa, one shoe off , her bruises just beginning to smart, while he kneels on the carpet, having carried her here. He remains stiff when she pulls at him, he is dead, she has killed him.
He asks, “Was I so lousy to you?”
“Oh sweetie, no. You were good to me. You came back. You work in that dirty place. I don’t know what got into me, Harry, I honestly don’t.”
“Whatever it was,” he tells her, “it must be still there.” He looks like Nelson, saying this, a mulling discontented hurt look, puzzling to pry something open, to get something out. She sees she will have to make love to him. A conflicted tide moves within her—desire for
this pale and hairless stranger, abhorrence of this desire, fascination with the levels of betrayal possible.
Elle s'enfonce telle qu'il l'a posée, en travers du divan. Harry insiste :
- Il fait l'amour mieux que moi?
pour l'inciter à poursuivre sa confession, comme un médecin humidifie un furoncle. Elle se mord la langue, essayant de réfléchir, observant le désastre avec l'idée de le réparer. Des désirs entremêlés - sauver sa peau, être gentille, ne pas exagérer - corrompent sa peur et sa colère primitives.
- Il est différent, dit-elle. Je l'excite davantage. Je suis sûre que c'est surtout parce que nous ne sommes pas mariés.
- Où faites-vous ça ?
Des mondes tourbillonnent et obscurcissent les yeux de Janice : des banquettes de voitures, des tapis, des arbres vus par en dessous à travers des pare-brise de voitures, la carpette gris beige dans l'espace étroit compris entre les trois bureaux métalliques verts et le coffre-fort avec la silhouette en carton de la Toyota, des chambres de motels avec leurs fausses boiseries et leurs dessus-de-lits râpeux, le sombre appartement de célibataire encombré d'un lourd mobilier et de photos de famille en couleurs dans des cadres d'argent.
- Dans toutes sortes d'endroits.
- Tu as l'intention de l'épouser ?
- Non. Non.
Pourquoi dit-elle cela? Cette suggestion ouvre un abîme. Elle ne l'aurait pas cru. Une porte qu'elle avait toujours cru donner sur un jardin ouvre sur le vide. Elle fait un geste pour se rapprocher d'Harry, pour l'attirer vers elle; elle est allongée sur le divan, elle a perdu un soulier, ses meurtrissures commencent à cuire; lui est resté à genoux sur le tapis depuis qu'il l'a déposée là. Il demeure inerte quand elle le tire, il est mort, elle l'a tué. Il demande :
- Ai-je donc été si dégueulasse avec toi?
- Oh, chéri, non. Tu as été gentil. Tu es revenu. Tu travailles dans cet atelier crasseux. Je ne sais pas ce qui m'a prise, Harry, honnêtement, je ne sais pas.
- Quoi que ce soit, ça ne doit pas t'avoir déjà passé.
Il ressemble à Nelson en disant cela, il a cet air de mécontentement méditatif, comme s'il se demandait s'il doit ouvrir quelque chose pour voir ce qu'il y a dedans. Elle comprend qu'il va falloir faire l'amour avec lui. Une marée de sentiments contradictoires s'agite en elle, désir pour cet étranger à la peau blanche et sans poils, horreur de ce désir, fascination devant les différentes profondeurs de trahison possibles..."

"Problems and other stories" (1972-1979, La concubine de saint Augustin et autres nouvelles)
Comment aimer des parents et des enfants qui vous déchirent le cœur chaque fois qu'ils affirment leur identité? Comment aimer Dieu sans être sûr que Dieu vous aime? Comment aspirer sincèrement à la santé si la lèpre est notre meilleure source d”inspiration? Comment guérir de la nostalgie de l'enfance, de nos passés fabuleux, de nos bonheurs gâchés, du passage inexorable du temps? Comment louvoyer entre tant de publicités, de visions fugitives, d'épouses revendicatrices? Comment aimer une femme et une autre en même temps? Comment aimer l'Amérique et la quitter en même temps? Tels sont les problèmes qu'aborde John Updike dans ce recueil de nouvelles où se retrouve le grand talent de l'écrivain, à la fois tendre et amer, ironique et - surtout quand il parle du couple - d'un humour savoureux. (Gallimard)
"... Quand il revint, joues luisantes, les reins en émoi, elle remarqua son excitation et, d'un geste rapide et furtif, sortit de quelque part (d'une de ses bottes?) un préservatif dont elle coiffa promptement sa demi-érection ; puis elle s`étendit sur le dos, jambes écartées. Bien qu'il fût encore assez raide pour la pénétrer et pût se dire un instant "Je suis en train de baiser cette femme", le pincement du caoutchouc, un certain manque d'élasticité dans la fille, quelque chose chez lui d'irrésolu et de rancunier - sa pensée suivante fut : "elle est complètement indifférente" -, tout cela se combina pour le ratatiner. Ses quelques mornes coups de reins furent comme des explosions à blanc à la lumière desquelles se révéla toute l'étendue de leur commune humiliation.
D'un air d'excuse, il se retira, tirailla sur la capote anglaise pour l`enlever et, ne sachant sur quelle surface plane de la chambre il pouvait la déposer sans enfreindre les rigides règles d'hygiène de sa compagne, garda à la main la flasque petite seconde peau pendante lorsqu'il s'allongea tristement à côté de la forme féminine inefficace. Que faire ? Ann gardait le silence, mais l'idée vint à Ed d'une fissure à la surface de sa déconvenue, d'une saillie à laquelle il pourrait peut-être s'accrocher. De sa main libre (l'autre bras était replié derrière sa tête, de sorte que le préservatif pendait proprement par-dessus le bord du lit), il caressa la longue courbe froide de la hanche d'Ann qu'éclairait la fenêtre. Il dit : "Tu es superbe." Comme si c'était un équivalent, elle demanda: "Tu es marié ? - Bien sûr." Sans doute avait-elle pensé que là enfin était la porte de la confiante intimité dont, elle devait maintenant s'en rendre compte, il avait besoin. Mais cette porte ouvrait sur un cul-de-sac : la sorte de mariage qui les avait amenés dans cette chambre ; ils étaient là, enfermés dans la spécificité sexuelle de l'épouse comme dans un donjon capitonné et verrouillé.
Ed aurait pu tenter de faire partager à Ann cette façon de voir les choses, mais essaya, plus simplement, de répondre a la bienveillance qu'elle semblait disposée à lui accorder - peut-être seulement par crainte de ne pouvoir se débarrasser de lui. Il demanda : "Quel âge as-tu ? - Vingt-deux ans." Un ton nouveau, amer. Songeait-elle, sa vie si tôt ruinée ? Son profil crochu, incolore, se souleva au-dessus de lui, dans l'espace rectangulaire de lumière que projetait la fenêtre. "Et toi ? - La quarantaine. - La fleur de l'âge. - Ça dépend." Il frotta ses lèvres contre les bouts de seins d'Ann, puis ses joues, et demanda : "C'est assez lisse ? - C'est mieux. - Ça te plaît ? Je veux dire, en temps ordinaire, ça ne te fait rien, ça te refroidit, ou quoi ?" Elle ne répondit pas ; il venait d'enfreindre, il s'en rendit compte, une autre des clauses secrètes de leur contrat: son plaisir à elle n'était pas en jeu. Incapable de rien faire de bien, et donc de mal, il fit glisser son visage des seins au ventre d`Ann et, comme elle était couchée sur le dos, de son ventre à ses cuisses.
Il appuya là sa tête. Il déposa le préservatif sur le drap, près de la taille d`Ann, et, des deux mains lui écarta les cuisses ; elle se laissa faire, sans plus. Le bord d'une des bottes lui racla l'oreille lorsqu'il recula la tête comme on fait pour mieux voir quand on consulte l'annuaire du téléphone. Entre ses jambes, il faisait noir. Il caressa son mont de Vénus et, de chaque côté, les creux tendineux et velus ; il promena son pouce sur toute la longueur des petites lèvres, les écarta, enfonça son pouce dans la fente où, contrairement à toutes les règles de la bienséance et de la raison, suintait une légère humidité. Il retira son pouce et inséra à la place son majeur, cependant que son pouce s'insinuait dans l'anus. La lumière diffuse lui arrivait maintenant dans les yeux et il voyait la surface argentée de l'intérieur de la cuisse face à la fenêtre, et la même lumière glissait sur son propre avant-bras mince et sur son poignet en mouvement, éclairait les deux demi-cercles brillants des fesses, la pâle prairie du ventre nu en raccourci, les deux petites collines des seins et le lointain dessous du menton. D'après l'angle que formait ce menton, elle regardait par la fenêtre l'étrange ciel nocturne de N... qui ne ressemblait au ciel d`aucune autre ville, brun et or, sans étoiles, saturé par l'électricité statique du grisou.
A travers les gauchissements et les brouillages de l'alcool, la configuration interne du sexe d'Ann, ses parois granuleuses et bourgeonnantes, au centre une dureté aux contours incertains et glissants, commençaient à former une image dans l'esprit d'Ed, à lui donner la satisfaction intense et précise de contempler un joyau. Elle parla. Sa voix parvint à Ed, rauque, par-dessus le paysage argenté de ce corps frais, de ce corps de vingt-deux ans. Elle dit quelque chose de très surprenant : "T`es-tu jamais, demanda-t-elle, hésitant à finir sa phrase, servi de ta langue ? - Bien sûr." En penchant son visage vers la vulve d`Ann, il sentit souffler dans son crâne la respiration de tous ceux qui avaient emprunté ce chemin avant lui. Pourtant, bien que sans doute cet endroit eût été maintes fois inondé de sperme et que ni les vomissures ni la merde n'eussent été épargnées à ce corps par des inconnus qui se démenaient pour se sentir en vie, le con d'Ann ne gardait aucun relent de tout cela ; il était plus ferme que celui d'une mère de famille et exempt de toute odeur, même de parfum ; ses contours poilus au contact de brosse douce avaient l`innocence hérissée de cheveux d'enfant fraîchement coupés ou d'une fourrure de jeune animal nocturne comme le raton laveur.
Il regretta que, par suite de la position qu`il avait prise, sa bouche ne fût pas placée en sens inverse mais, assez malaisément, de face ; son corps traînait entre les jambes d'Ann et bien au-delà, comme une lourde et inutilisable queue de cerf-volant, et son cou plié en arrière lui faisait mal. L'effort de sa langue qui cherchait à pénétrer lui raidissait toute la colonne vertébrale. Ouvrant les yeux, il vit une profusion confuse de filaments frappés par la lumière, qui auraient pu être une végétation de la planète Mars ou du mildiou vu au microscope. Miracle: il lui sembla qu'elle bougeait. En réponse. Elle bougeait..."

"A Month of Sundays" (1975, Un mois de dimanches)
Après des années d'un ministère édifiant, le Révérend Thomas Marshfield se retrouve, à quarante ans, en proie au démon de midi. Pêcheur d'âmes devenu simple pécheur, il accumule les «folles négligences» entre les bras de ses paroissiennes. Le scandale arrache Thomas à son Paradis trop terrestre. Pour échapper aux sanctions dont le menace son évêque, il se résigne à passer un mois dans une maison de repos pour ecclésiastiques en rupture de banc, loin des tentations de la chair. La durée de la cure - 31 jours, un mois de dimanches - et la forme de la thérapie - écrire ad libitum tous les matins - conditionnent la structure de cette œuvre : 31 chapitres dont le fil conducteur est la confession des «errements» du pasteur déchu, le récit des expériences qui lui ont révélé, en même temps que sa vraie nature, les joies et les limites de sa virilité longtemps ignorée.
Ce livre-journal est aussi, comme Bech voyage, un livre-miroir. Dans la glace de sa chambre, dans les yeux de ses femmes, Thomas Marshfield se contemple et se juge sans complaisance. Il déplore la faiblesse qui fait de lui un être égoïste et casanier, tiraillé entre les pulsions de sa libido et les exigences d'un univers aseptique et figé. Il juge les autres également - sa mère disparue, son père sénile, son épouse, ses maîtresses, son vicaire -, comme lui prisonniers de leurs habitudes et des conventions. (Editions Gallimard, traduction de l'anglais par Maurice Rambaud)
"FORGIVE ME my denomination and my town; I am a Christian minister, and an American. I write these pages at some point in the time of Richard Nixon’s unravelling. Though the yielding is mine, the temptation belongs to others: my keepers have set before me a sheaf of blank sheets—a month’s worth, in their estimation. Sullying them is to be my sole therapy.
My bishop, bless his miter, has ordered (or, rather, offered as the alternative to the frolicsome rite of defrocking) me brought here to the desert, far from the green and crowded land where my parish, as the French so nicely put it, locates itself. The month is to be one of recuperation—as I think of it, “retraction,” my condition being officially diagnosed as one of “distraction.” Perhaps the opposite of “dis” is not “re” but the absence of any prefix, by which construal I am spiritual brother to those broken-boned athletes who must spend a blank month, amid white dunes and midnight dosages, in “traction.” I doubt (verily, my name is Thomas) it will work. In my diagnosis I suffer from nothing less virulent than the human condition, and so would preach it. Though the malady is magnificent, I should in honest modesty add that my own case is scarcely feverish, and pustular only if we cross-examine the bed linen. Masturbation! Thou saving gracenote upon the baffled chord of self! Paeans to St. Onan, later. I feel myself warming to this, which is not my intent. Let my distraction remain intractable. No old prestidigitator amid the tilted mirrors of sympathetic counselling will let himself be pulled squeaking from this glossy, last-resort, false-bottomed topper..."

"Marry Me" (1977, Épouse-moi)
Après des années de vie conjugale conventionnelle, deux couples au seuil de la trentaine, les Conant et les Mathias, vont frôler le drame et connaître leur moment de vérité. Jerry Conant et Sally Mathias passent quelques nuits ensemble et y prennent un tel plaisir qu'insoucieux de ce qui les sépare ils veulent s'épouser. Leur flamme brûlera le temps d'un été, pour bientôt vaciller puis s'éteindre piteusement à l'automne. En contre-point se déroule en secret l'aventure très raisonnable de Richard et de Ruth, quelque temps rapprochés par l'ennui et l'indifférence de leurs conjoints. Quatre personnages en quête d'eux-mêmes et d'amour, qui cherchent à tâtons leur voie dans le «crépuscule de la vieille morale» à son déclin. (Editions Gallimard, traduction de l'anglais de Maurice Rambaud)
1 - Warm Wine
Along this overused coast of Connecticut, the beach was a relatively obscure one, reached by a narrow asphalt road kept in only fair repair and full of unexplained forks and windings and turnings-off. At most of the ambiguous turns, little weathered wooden arrows bearing the long Indian name of the beach indicated the way, but some of these signs had fallen into the grass, and the first time – an idyllic, unseasonably mild day in March – that the couple agreed to meet here, Jerry got lost and was half an hour late.
Today, too, Sally had arrived ahead of him. He had been delayed by the purchase of a bottle of wine and an attempt, unsuccessful, to buy a corkscrew. Her graphite-grey Saab sat in a far corner of the parking lot, by itself. He slithered his own car, an old Mercury convertible, close to it, hoping to see her sitting waiting at the wheel, for ‘Born to Lose’, as sung by Ray Charles, had come onto his car radio.
Every dream
Has only brought me pain!…
She brimmed in this song for him; he had even framed the words he would use to call her into his car to listen with him: ‘Hey. Hi. Come quick and hear a neat record.’ He had grown to affect with her an adolescent manner of speech, mixed of hip slang and calf-love monosyllables. Songs on the radio were rich with new meaning for him, as he drove to one of their trysts. He wanted to share them with her, but they were rarely in the same car together, and as week succeeded week that spring the songs like mayflies died from the air.
Her Saab was empty; Sally was not in sight. She must be up in the dunes. The beach was unusually shaped: an arc of flat washed sand perhaps half a mile long was bounded at both ends by congregations of great streaked yellowish rocks, and up from the nearer sets of rocks a high terrain of dunes and beach scruff and wandering paths held like a vast natural hotel hundreds of private patches of sand. This realm of hollows and ridges was deceptively complex. Each time, they were unable to find the exact place, the perfect place, where they had been before.
Un portrait habilement satirique de la vie et de l’amour dans une ville de banlieue comme seul Updike peut le peindre. Le huitième roman d’Updike, sous-titré « A Romance » parce que, dit-il, « People don’t act like any more », se concentre sur l’histoire d’amour d’un couple marié dans le Connecticut de 1962. Malheureusement, il s’agit d’un couple dont les membres sont mariés à d’autres personnes. L’infidélité des banlieues est maintenant un territoire familier, mais personne ne le connaît aussi bien qu’Updike, et le livre est écrit avec la sensibilité poétique caractéristique de l’auteur et l’esprit rusé....

"Too Far to Go" (1979, Trop loin : Les Maple)
Ensemble de nouvelles centrées sur une même famille, celle de Joan and Richard Maple, décrivant de façon impitoyable, sur deux décennies, la difficile complicité du mariage moderne, et l'empreinte laissée sur le temps et l'âge de relations qui se créent et se dissolvent (Gallimard, traduction par Georges Magnane et Suzanne V.Mayoux).
Un recueil de 17 nouvelles écrites entre 1956 et 1979, (époque de mutations sociales, féminisme, libération sexuelle) dédiées à l’évolution du mariage de Richard et Joan Maple, un couple bourgeois de la Nouvelle-Angleterre. Ces histoires, d'abord publiées dans The New Yorker, forment une chronique minutieuse des joies, des tensions et de la dissolution progressive d’une union : l’amour qui s’effrite sous le poids de la routine, la communication (ou son absence) dans le couple, l'adultère comme tentation et piège.
Les personnages principaux ...
- Richard Maple : Narrateur récurrent, intellectuel, tantôt tendre, tantôt égoïste.
- Joan Maple : Son épouse, d’abord soumise, puis de plus en plus indépendante.
- Leurs enfants (Judith, Richard Jr., etc.) : Témoins involontaires des conflits parentaux.
On suit, par ordre chronologique dans la vie des Maple ...
1. "Snowing in Greenwich Village" (1956)
Première rencontre : Richard et Joan, jeunes mariés, reçoivent un ami séducteur.
Richard jalouse les attentions de l’ami envers Joan, préfigurant leurs futures crises.
2. "Wife-Wooing" (1960)
Richard observe Joan nourrir leurs enfants, mélangeant désir et irritation.
3. "Giving Blood" (1963)
Métaphore du couple : Les Maple donnent leur sang ensemble, geste d’amour qui révèle leur fatigue mutuelle.
4. "Twin Beds in Rome" (1964)
Voyage en Italie : Leurs lits jumeaux symbolisent la distance croissante. Richard flirte avec une inconnue.
5. "The Taste of Metal" (1966)
Crise : Joan découvre une infidélité de Richard. Leur dispute est décrite avec une précision chirurgicale.
6. "Your Lover Just Called" (1967)
Rôle inversé : Joan a un amant, et Richard, humilié, doit répondre au téléphone.
7. "Separating" (1974)
Scène déchirante : Richard annonce à leurs enfants leur divorce. Le fils demande : "Pourquoi ?" – aucune réponse n’est donnée.
8. "Here Come the Maples" (1976)
Divorce : La procédure légale est décrite avec une ironie douce-amère.
9. "Grandparenting" (1979)
Épilogue : Richard et Joan, divorcés, se retrouvent autour de leurs petits-enfants. Une trêve fragile s’installe.

"Rabbit Is Rich" (1981, Rabbit est riche)
Nous sommes en 1979, Carter est président, Rabbit a quarante-six ans et prend la succession de son beau-père comme concessionnaire Toyota : il sent alors que la mort est en train de prendre ses mesures. "Rabbit est riche, troisième volet du triptyque de « Rabbit », ou les heurs, et malheurs de Harry Angstrom et du rêve américain. Comme dans Cœur de lièvre (1960) et dans Rabbit rattrapé (1971), Harry, malgré ses quarante-six ans, s'obstine à courir, non plus après la gloire ni les certitudes précaires de l'amour et du plaisir, mais après les fantômes de sa jeunesse enfuie et de ses espoirs déçus. Repu et nanti, enlisé dans ses problèmes domestiques, le confort et la respectabilité, il a perdu tout esprit de révolte et se borne à lutter, avec un relatif succès, contre l'ennui, la peur de la vieillesse et de la mort. En même temps que ses rêves, s'effrite le rêve d'une Amérique forte, fidèle aux mythes de son passé et de ses valeurs traditionnelles. Ce troisième épisode de la saga de Harry Angstrom complète le portrait d'un héros cher à la littérature américaine. Rabbit quadragénaire s'inscrit dans la lignée du Babbitt de Sinclair Lewis, dont il partage le conditionnement psychologique, les goûts, les travers, les vertus et les vices.
Aussi, comme toujours chez Updike, ce roman d'analyse est-il également un roman de mœurs, centré sur un contexte social précis, une petite ville à la Sherwood Anderson, microcosme idéal pour l'observation des êtres, avec, en toile de fond, l'Amérique des années soixante-dix, la crise de l'énergie, l'enlisement américain en Iran, les aberrations de la société d'abondance. Updike, qui se définit lui-même comme un libéral démocrate, allergique à tout engagement, poursuit son examen lucide et sans concession d'un pays «dur et cruel, mais aussi pieux et plein d'espoir» et sa satire des mentalités et des comportements.
D'où les divers courants qui irriguent ce roman de la maturité: un calvinisme discret en perpétuel conflit avec les appétits de la chair exacerbés par l'âge, une spiritualité sans cesse menacée par les tentations d'une époque décadente et d'un matérialisme source de dérèglements et de perversité. Au service de cette entreprise de démystification, la verve d'un auteur dont le comique, la truculence à la limite de la « pornographie douce» et le penchant pour le libertinage affleurent sous la gangue puritaine." (Editions Gallimard)
".. Il freine sur le gin et les repas. Il nage, écoute Ma Springer égrener ses souvenirs à l'heure du café matinal, et tous les jours descend avec Janice faire les courses au village. Le soir, ils disputent à trois une partie de pinochle à la lumière crue des lampes de bridge, une lumière qui lui paraît dure car lors de ses premiers séjours, on se servait des lampes à pétrole, avec sous les verres, de fragiles petits cônes de cendres rougeoyantes, et on se mettait au lit sitôt la nuit tombée, tandis que palpitait le chœur des grillons. Il n'aime pas la pêche, pas plus qu'il n'aime beaucoup jouer au tennis avec Janice contre les autres couples qui ont accès au court que se partage la petite communauté du lac, un rectangle d'argile serti au milieu des pins, à la lisière capitonnée d'aiguilles sombres et à la clôture de grillage affaissée comme du linge trempé. Janice, elle, joue tous les jours au Flying Eagle et à côté de sa grâce efficace, il se sent lourdaud et hors du coup. La balle bondit vers lui avec une fureur, que sa raquette est impuissante à contrer. Sur le maillot noir de Janice, une inscription fanée en trois dimensions proclame "Phillies"; ce maillot, il l'a offert à Nelson à l'occasion d'une de leurs virées au Veteran Stadium; le gosse n'a pas jugé bon de l'emporter quand il est parti pour Kent, Janice l'a déniché dans l'entrain de sa maturité, et l'a adopté. Typique de la façon dont les choses ont tourné, la croissance de leur fils a été pour lui une menace et une tragédie, et pour elle un prétexte pour faucher un maillot.
Non qu'il serait encore à la taille de Nelson. Il lui va bien, à elle; avec sa silhouette bronzée et épaissie par les années, ses cheveux courts et sa frange folle, il la sent, là près de lui, la devine plus agile et plus libre. Alors que sa raquette renvoie la balle en arcs réguliers, lui cogne trop fort, ou encore quand suivant ses conseils il essaie de la « caresser », il l'expédie piteusement dans le filet.
- Harry, n'essaie pas de la guider,dit-elle. Garde les genoux pliés. Hanche perpendiculaire au filet.
Elle a pris des tas de leçons. Les dix années qui viennent de s'écouler lui ont appris davantage de choses qu'à lui. Qu'a-t-il accompli, se demande-t-il, tendu pour contrer la balle de service, alors que sa vie est plus qu'à moitié écoulée ? Il a toujours été un bon petit garçon, avec sa mère, avec ses copains du basket, un bon petit garçon avec Tothero son vieil entraîneur qui pensait que Rabbit avait des dons. Et Ruth elle aussi lui avait trouvé quelque chose de spécial, quelque chose qu'elle avait vu vaciller et s'éteindre. Un certain temps, Harry avait gigoté pour ne pas mourir, puis il avait renoncé et s'était attelé au travail. Maintenant les morts sont si nombreux qu'il voue aux vivants qui l'entourent la camaraderie que se vouent les rescapés. Ces gens qui sont là avec lui, enfermés entre les lignes du terrain de tennis, il les aime. Ed et Loretta ; Ed dirige une entreprise d'électricité à Easton et se spécialise dans l'installation des ordinateurs. Harry aime la cime des arbres au-dessus de leurs têtes, et plus haut encore, le bleu du mois d'août.. Que sait-il ? Jamais il ne lit un livre, rien d'autre que le journal pour avoir quelque chose à dire et encore, surtout les nouvelles qui offrent un intérêt humain, par exemple les spéculations sur la prochaine étape du Shah et l'évolution de sa maladie, ou cette histoire du médecin de Baltimore. Il aime la Nature, mais il ignore le nom de presque tout ce qu'elle contient. Ces arbres ? Des pins, des épicéas ou des sapins ? Il aime l'argent, bien qu'il ne comprenne pas pourquoi il en gagne tellement ni pourquoi il lui file si vite entre les doigts. Il aime les hommes qui ne se plaignent pas de leurs bedaines ni des rides de leurs nuques rougeaudes, et qui se sentent gênés pour trouver un sujet de conversation une fois le jeu fini, quel qu'il soit. A quelle chose miteuse ne réduisons-nous pas la vie ! Pourtant, quelle chose merveilleuse que l'esprit, impossible de fabriquer une machine à son image, même si certains de ces ordinateurs dont parlait Ed remplissent des pièces entières; et le corps, le corps est capable de faire des milliers de choses dont pas une usine au monde ne peut reproduire le mouvement. Il adorait baiser autrefois, bien que de plus en plus il se contente d'y penser et de laisser les jeunes batifoler à ce jeu, dans leurs bars ou leurs voitures, stupéfait de constater combien ils sont nombreux, au point que quand il se promène dans la rue ou fait la queue à la porte d'un cinéma, il a souvent l'impression d'être le plus vieux. La nuit, quand il est avec Janice, Janice qui a toujours besoin d'un petit coup de bitte pour l'aider à s'endormir, il essaie de s'imaginer ce qui pourrait le faire bander, et constate que sa collection d'images s'épuise; la dernière qui marche encore, c'est celle d'une femme à quatre pattes qui taille une pipe à un type, pendant qu'un second la prend en levrette. Et il n'est pas très clair dans l'image si c'est Harry qui baise ou s'il se fait sucer, il les contemple tous les trois de l'extérieur, comme projetés sur l'écran d'un de ces cinémas tout en haut de Weiser, avec à l'affiche des titres comme "Les Filles du harem" et "Jusqu'au bout", et les sensations de la femme lui paraissent plus familières que celles de l'homme, la bitte qu'il suce pareille à une petite courgette ramollie, sans oublier l'autre, ailleurs, qui entre et ressort, entre et ressort, une sorte de pénitence au tréfonds de son être. Parfois la nuit, il dit un bout de prière, mais il semble qu'une sorte de trêve pesante se soit instaurée entre lui et Dieu.
Il se met à courir. Dans les bois, le long des vieilles routes forestières et pistes cavalières, il se hâte lourdement, d'abord en chaussures de tennis, orange de poussière d'argile, puis en Nikes bleu et or achetées tout exprès dans un magasin de sports de Stroudsburg, des chaussures de course aux semelles renforcées au talon et aux orteils, des semelles dont les petits cercles souples pareils à des crampons aplatis le propulsent sans effort tandis que, de plus en plus léger, raide et calme, il court. Tout d'abord son poids, pareil à un fardeau meurtrier, lui emmaillote le cœur et les poumons, et le matin, les muscles de ses cuisses lui font tellement mal qu'il titube au sortir du lit et s'esclaffe de surprise. Mais, tandis qu'au fil des jours, à force de courir après dîner dans la fraîcheur du jour déclinant alors que toute la lumière n'a pas encore reflué de la forêt, il habitue son corps à cette exigence nouvelle, ses jambes s'endurcissent, son poids lui paraît s'alléger, sa poitrine accueille davantage d'air, comme elles-mêmes dotées d'ailes, les brindilles frôlent ses oreilles et il augmente la distance pour finir par couvrir en un demi-sablier le mille et demi qui le sépare de l'endroit où le portail d'une vieille propriété barre le chemin. Carbon Castle, comme les gens du coin appellent le domaine, bâti par un roi du charbon de Scranton et rarement utilisé maintenant par ses rares descendants, la piscine vidée, des terrains de tennis envahis de mauvaises herbes, l'électricité coupée. Dans le pavillon de chasse, les .yeux de verre des cerfs empaillés luisent sous les toiles d'araignées; la maison principale aux toits d'ardoise en pente raide et aux fenêtres à losanges est condamnée par des planches, bien que, il y aura bientôt dix ans, un des petits-fils ait tenté de la transformer en une commune, de hippies à en croire les habitants du village. Les jeunes gens ont saccagé les lieux, dit la légende, et vendu tout ce qu'ils ont pu déménager, y compris les deux brontosaures de bronze qui gardaient l'entrée principale, emblèmes de l'Age du Charbon. Le lourd portail de fer de Carbon Castle est barricadé par une double chaîne pourvue d'un cadenas; Rabbit effleure de la main le métal rébarbatif, reprend haleine le temps d'une paisible seconde, tandis que le monde semble encore se précipiter, se déverser dans le tremblement de ses jambes, puis fait demi-tour et rebrousse chemin au petit trot projetant au loin son esprit, jusqu'à perdre conscience de son corps pantelant..."

Updike peint l’Amérique des années 1980 : Crise pétrolière, matérialisme, illusions. "Rabbit Is Rich" est souvent considéré comme le sommet de la tétralogie – moins désespéré que "Rabbit at Rest", mais plus féroce dans sa critique sociale. Si vous ne deviez en lire qu’un, ce serait celui-là, dit-on souvent ...
Alors que Janice (la femme de Rabbit) gagne en indépendance, Cindy incarne un idéal inaccessible, une Vénus des suburbs des années 1980, une voisine bourgeoise, membre du cercle des couples aisés que Rabbit fréquente grâce à sa nouvelle richesse (via le concessionnaire Toyota) : un personnage clé qui incarne à la fois le fantasme et la frustration de Rabbit, reflétant ses obsessions sexuelles et son malaise social. Voici que Rabbit tombe par hasard dans leur chambre sur des clichés de Cindy posant pour son mari, Webb Murkett, photographe pornographique amateur...
"... Pour la photo suivante, Webb a eu l’idée d’utiliser un miroir ; il se tient de profil, l’appareil masquant carrément son visage, et le visage chéri de Cindy comme empalé, tandis que, nue et à genoux, elle se penche sur cette perche qui pointe toujours à dix heures. De profil, elle a le nez épaté et ses bouts de seins saillent, roides. La petite garce, le vieux salaud a fini par la brancher, avec ses trucs. Mais qu’elle paraît donc vaillante, avec sa petite tête ronde, plantée sur la vilaine bite comme une pomme candi.
Harry a envie, sur la photo suivante, de lui voir le visage barbouillé de foutre, comme avec du dentifrice, comme dans les films pornos, mais Webb l’a de nouveau retournée et la baise par-derrière, bite enfouie invisible dans la cambrure blême de la croupe, tandis que de sa main libre il la maintient en place, pouce enfoncé jusqu’à la garde là où doit être le trou du cul ; ses nichons en poire pendent sous l’effet de leur poids et, contre celles de Webb, ses jambes paraissent courtaudes. Pour elle aussi, le temps passe. Elle finira par être grosse. Par devenir laide. Elle regarde la glace et elle rit. Peut-être à cause de la difficulté pour garder l’équilibre pendant que d’une seule main Webb actionne l’obturateur, Cindy est partie à cet instant d’un grand rire rouge, comme un modèle d’affiche, avec cette bite jaune enfoncée par-derrière dans son ventre. Sans doute ce jour-là dans la chambre, la lumière baissait-elle, car la chair des deux Murkett paraît dorée, et les meubles que reflète le miroir sont indistincts, ombrés de bleu comme sous l’eau. Cette photo est la dernière ; il y en avait huit, et ce genre d’appareil en prend dix par film. Le Bulletin du Consommateur a donné un tas de détails sur le SX-70 il y a quelque temps, mais sans jamais expliquer à quoi servait le SX. Harry le sait maintenant. Ses yeux le brûlent.
En bas, le brouhaha baisse, peut-être guettent-ils un bruit en provenance du premier, en se demandant ce qu’il peut bien fabriquer. Prestement, il remet les polaroïds dans le tiroir, images en dessous, dos noirs en dessus, et refermant le tiroir, s’efforce de le laisser tel qu’il l’a trouvé. Pour le reste, la chambre est intacte ; le miroir effacera sur-le-champ son image. Un seul indice subsiste encore, l’immense érection qu’il s’est offerte et qui le torture. Impossible de redescendre dans cet état ..."

"Bech Is Back" (1982, Bech est de retour)
Bech est de retour. Comme Bech voyage, à la fois livre-miroir et livre-masque, cette chronique fantasque complète et précise le portrait du romancier juif américain, désormais menacé par l'âge et la stérilité. Après une série de trois «illuminations», l'auteur sillonne le Tiers-Monde en ambassadeur de la culture américaine, savoure sa notoriété au Canada et en Australie, se marie, visite en compagnie de son épouse protestante Israël et l'Écosse, écrit enfin son livre - et divorce. La lucidité de ces sketchs incisifs, mais tendres, donne une dimension nouvelle au personnage narcissique, velléitaire de Bech. Derrière le masque se devine le sérieux d'une méditation sur les thèmes favoris d'Updike, l'illusion et la réalité, la fidélité à soi-même et à autrui, assortie d'une réflexion désabusée sur le métier et le rôle de l'écrivain dans un monde mercantile et décadent. En filigrane, la remise en cause de la culture dominante et des valeurs qu'elle véhicule, le contraste entre l'inflation idéologique de l'après-Vietnam et la déconfiture blasée des années soixante-dix, ainsi que les doutes esthétiques et les intuitions existentielles de l'auteur riches d'enseignements sur le calvaire de l'intellectuel et sur notre époque. (Editions Gallimard, traduction de l'anglais par Maurice Rambaud)
"The Complete Henry Bech (Everyman’s Library)" publié en 1993, de sa naissance en 1923 à sa paternité tardive et à son apothéose publique en tant que septuagénaire particulièrement vif en 1999, Bech s’éloigne, parcourant le monde en compagnie de dignitaires étrangers un jour et traînant dans des tweeds en lambeaux sur le circuit de conférences du collège le lendemain. Tour à tour cynique et naïf, ironique et véhément, et toujours amoureux, il est la confection la plus attachante d’Updike, une icône littéraire séduisante. "The Complete Henry Bech" est un portrait de la vie littéraire d’un écrivain américain incomparable. Depuis que les récits de ses exploits ont commencé à paraître dans The New Yorker il y a plus de trente ans, Henry Bech, l’alter-ego irrévérencieux et ludique de John Updike, a charmé les lecteurs avec ses hésitations esthétiques et sa libido apparemment inépuisable....

"The Witches of Eastwick" (1984, Les sorcières d'Eastwick)
L'Amérique des années soixante-dix, époque d'aspirations confuses, mal affranchie des tabous religieux, de la morale et du sexe. A Eastwick, une petite ville de province, trois femmes divorcées, adeptes des pratiques occultes, trois sorcières, exercent sur les hommes et leurs concurrentes le pouvoir que leur confèrent et leur charme, et leur liberté, et leur perversité. L'arrivée de Van Horne, incarnation du Malin, déclenchera une tragédie. Par goût du pouvoir absolu, Jane, Alexandra et Sukie en appelleront en effet aux forces maléfiques pour se débarrasser de Jenny, leur disciple devenue leur rivale et, donc, leur victime de prédilection. "Les sorcières d'Eastwick" se démarque très nettement des écrits de John Updike et l'écrivain plaide ici, à sa façon, pour l'émancipation de la femme. L'ensemble "Eastwick books" comporte "The Witches of Eastwick" et "The Widows of Eastwick" (2008) qui, trente ans après, nous restitue Alexandra, Jane et Sukie, désormais veuves de leurs seconds maris et privées de leur jeunesse de femmes émancipées et de leurs pouvoirs, aussi bien de sorcières que de séduction. Elles tenteront de racheter leurs péchés passés tout en étant confrontées à la sorcellerie vengeresse d’une ancienne connaissance...
"Un homme vient d'acheter la propriété Lenox, ni femme, ni enfant ..."Comme dans une boule de cristal, elle voyait qu'elle était destinée à faire la rencontre et à tomber amoureuse de cet homme, et qu'en fait, il n'en résulterait rien de bon. "Il n'avait pas de nom, cet homme? demanda Alexandra. - Justement si, c'est ça le plus stupide, dit Jane Smart. Marge l'a dit à Sukie, et Sukie me l'a dit, mais aussitôt il m'est sorti de l'esprit, comme littéralement pris de panique. Un de ces noms assortis d'un « van », ou « von », ou « de ».
- Mais, c'est très chic, s'extasia Alexandra, qui déjà se dilatait, s'épanouissait pour se laisser envahir. Un Européen grand et ténébreux, dépossédé du vénérable et noble patrimoine de ses ancêtres, courant le monde en proie à une malédiction...
« Et quand est-il censé s'installer?
- Selon Sukie, bientôt, à ce qu'il dit. Qui sait s'il n'est pas déjà arrivé!
La voix de Jane paraissait inquiète. Alexandra se représenta l'autre femme, ses sourcils plutôt trop fournis pour le reste de son visage aigu, et arqués en demi-cercles au-dessus de ses yeux sombres et rancuniers, dont le brun était toujours d'un ton plus pâle que dans le souvenir qu'on en gardait. Si Alexandra était une sorcière du genre substantiel et instable, encline par nature à se gaspiller pour s'offrir aux influences et se fondre dans le paysage, et au tréfonds de son cœur plutôt paresseuse et d'un détachement quelque peu entropique, Jane était bouillante, trapue, concentrée comme une pointe de crayon, et Sukie Rougemont, qui à longueur de journée se dépensait en ville à recueillir cancans et nouvelles et dispenser sourires et salutations, avait une essence oscillante. Ainsi réfléchissait Alexandra, en raccrochant. Les choses s'organisent par trois. Et tout autour de nous opère la magie à mesure que la nature cherche et trouve les formes inévitables, les choses, cristallines et organiques, s'agençant selon des angles de soixante degrés, la structure mère étant le triangle isocèle. Elle se remit à remplir de sauce à spaghetti ses bocaux, plus de sauce et pour plus de spaghetti qu'elle-même et ses enfants ne pourraient en consommer même si, un siècle durant, ils se trouvaient piégés par magie dans un conte de fées italien, des bocaux qu'un à un elle extirpait fumants du stérilisateur bleu à mouchetures blanches pour les déposer sur l'égouttoir rond qui frémissait et chantait. C'était là, elle en avait vaguement conscience, une forme de grotesque hommage à son amant du moment, un entrepreneur de plomberie, de souche italienne. Sa recette ne nécessitait pas d'oignons, mais deux gousses d'ail hachées menu et revenues pendant trois minutes (ni plus, ni moins; la touche de magie) dans de l'huile chaude, amplement additionnée de sucre pour neutraliser l'acidité, d'une seule et unique carotte râpée, de davantage de poivre que de sel; sans oublier la cuillerée de basilic pilé, gage de virilité, et le soupçon de belladone pour provoquer le déclic faute duquel la virilité n'est qu'une barbare turgescence. Ingrédients qui tous devaient s'ajouter à ses propres tomates, cueillies et emmagasinées sur les rebords de ses fenêtres depuis des semaines, et maintenant coupées en tranches et passées au mixeur: depuis que, deux étés déjà auparavant, Joe Marino avait commencé à se glisser dans son lit, une fécondité absurde s'était emparée des plants, accrochés à leurs tuteurs là-bas dans le jardin qui flanquait la maison et où, à longueur d'après-midi, le soleil du sud-ouest filtrait oblique à travers l'écran des saules. Les petites branches tordues des tomates, pulpeuses et pâles, comme faites de mauvais papier vert, se brisaient sous le poids de ces fruits innombrables; elle avait, cette fertilité, quelque chose de frénétique, d'avide, l'avidité des enfants emportés par la frénésie de plaire. De toutes les plantes, les tomates semblaient les plus humaines, impatientes, fragiles et vulnérables à la pourriture. Quand elle cueillait leurs globes rouge-orange saturés d'eau, Alexandra avait la sensation de nicher dans le creux de sa main les testicules d'un amant géant. Tout en s'activant dans sa cuisine, elle s'avouait que l'opération avait quelque chose de tristement menstruel, cette sauce rouge sang destinée à être répandue à la louche sur les spaghetti blancs. Les petits filaments blancs et gras alimenteraient la graisse blanche de son propre corps. Cette lutte, typiquement féminine, pour vaincre son poids: à trente-huit ans, elle lui paraissait de plus en plus contre nature. Devait-elle, sous prétexte d'attirer l'amour, frustrer son propre corps, comme un de ces saints névrosés d'antan? La nature, tel est l'index et le contexte de la santé, et si la nature nous a dotés d'un appétit, c'est pour nous inviter à le satisfaire, satisfaisant du même coup l'ordre cosmique. Pourtant il lui arrivait de se mépriser, se reprochant d'avoir par paresse pris un amant d'une race célèbre pour sa coupable indulgence à l'égard de l'embonpoint.
Au cours de la poignée d'années écoulées depuis son divorce, Alexandra avait eu tendance à prendre pour amants une collection disparate de maris négligés par les femmes dont ils étaient la propriété. Son ex-mari à elle, Oswald Spofford, reposait dans la cuisine, sur un des rayons du haut, enfermé dans un bocal au couvercle solidement vissé, réduit à une poussière multicolore., Elle avait opéré cette réduction à mesure que se révélaient peu à peu ses pouvoirs magiques, après leur départ de Norwich, Connecticut, pour Eastwick. Génial spécialiste en chrome, Ozzie avait plaqué une usine d'accessoires implantée dans cette cité aux rues abruptes et surabondamment pourvue d'églises blanches aux murs lépreux, pour une entreprise rivale, une usine de parpaings longue de huit cents mètres située au sud de Providence, au milieu de l'étrange immensité industrielle de ce petit État. Leur installation remontait à sept ans. Ici à Rhode Island, les pouvoirs d'Alexandra s'étaient dilatés comme un gaz dans le vide, et tandis que le cher Ozzie continuait sa navette quotidienne pour se rendre à son travail et rentrer le soir à la maison-, par la Nationale 4, elle l'avait tout d'abord réduit à la taille d'un homme ordinaire, son armure de patriarche protecteur s'effritant sous l'effet de la beauté maternelle d'Eastwick et de la corrosion de l'air marin, puis à la taille d'un enfant, à mesure que ses besoins chroniques et son acceptation tout aussi chronique des solutions qu'elle prônait pour les satisfaire le faisaient paraître pitoyable, facile à manipuler..."

Si l'adaptation faite en 1970 de "Rabbit, Run" fut un échec, "The Witches of Eastwick" remporta un certain succès au cinéma en 1987, réalisé par George Miller, avec Jack Nicholson (Daryl Van Horne), Cher (Alexandra Medford), Susan Sarandon (Jane Spofford), et Michelle Pfeiffer (Sukie Ridgemont) ....

"Roger's Version" (1986, Ce que pensait Roger)
"I have been happy at the Divinity School. The hours are bearable, the surroundings handsome, my colleagues harmless and witty, habituated as they are to the shadows. To master a few dead languages, to parade sequential moments of the obdurately enigmatic early history of Christianity before classrooms of the hopeful, the deluded, and the docile—there are more fraudulent ways to earn a living. I consider my years spent in the active ministry, before meeting and marrying Esther fourteen years ago, if not exactly wasted, as a kind of pre-existence, the thought of which depresses me..." - Dans le décor anonyme d'une petite ville universitaire de la Nouvelle-Angleterre, Roger Lambert, ex-ministre du culte et professeur de théologie, vit tiraillé entre le scepticisme et le démon de midi. Autour de ce pêcheur d'âmes devenu, comme le révérend Marshfield d'Un mois -de dimanches, simple pêcheur, gravitent Edna, sa seconde épouse, Verne, son équivoque demi-nièce, et Dale Kohler, un jeune chercheur féru d'informatique et de religion. Quatre personnages en quête d'une identité qu'en marge des sentiers battus ils cherchent dans l'assouvissement de leurs fantasmes et les plaisirs de la chair. En filigrane le tableau très impressionniste de l'Amérique nonchalante et blasée au crépuscule de l'ère Reagan, dont l'auteur observe et souligne avec réalisme et sans concession, mais aussi avec détachement, les conflits et les paradoxes, l'envers du rêve américain.
Ce douzième roman illustre avec éclat la mission que John Updike assigne à l'écrivain contemporain: «penser grand ››, dépoussiérer le roman en renouvelant ses sources d'inspiration. Sur la trame de la tragi-comédie bourgeoise se greffe une interrogation d'ordre essentiel et existentiel sur la naissance de l'univers, les origines de la vie et le devenir de l'homme. Aux antipodes du roman académique ou expérimental des années 60 et 70, en marge des niches et chapelles littéraires, ni livre-miroir ni livre-masque, Ce que pensait Roger est un roman à tiroirs et à facettes multiples dont la double optique à la fois macro- et microcosmique offre, selon l'ambition de son auteur, "une fenêtre ouverte sur l'univers et la vie". John Updike réussit brillamment la synthèse entre le profane et le sacré, le sexe et la religion, «les deux formes suprêmes de résistance à la peur de la mort ». (Gallimard, traduit de l'anglais par Maurice Rambaud).
"..D'une voix retentissante Esther expliquait à Dale : - "Bien sûr, si l'on a le moindre bout de jardin, il est absolument impossible de s'absenter plus de quelques jours d'affilée, quel que soit le moment, du moins avant la fin août; ridicule, je sais, d'être à ce point esclave de ces fichues fleurs, mais je crois sincèrement, oui, je sais vous allez me juger absurde, que les plantes ont besoin qu'on leur parle. Elles ont besoin d'être aimées." - De sa main qui ne tenait pas la fourchette à dessert, elle ne cessait de repousser d'un geste machinal quelques mèches rebelles. Ce faisant, sa main frêle visiblement tremblait. Je voyais, sans pour autant oublier Verna là, près de moi, par yeux de Dale : une impression de couleur brusquement vivante, de réglage de son sur le canal UHF. Elle débordait de charme et d'éclat, son velours vert chatoyant dans la lumière au déclin de ce jour de fête, ses cheveux cuivrés scintillant en une multitude de petits points brillants, son front bombé et intelligent luisant, ses yeux globuleux passant de l'ironie à la coquetterie avec une rapidité électronique, ses lèvres blasées, débordantes aujourd'hui de rouge sur un bon millimètre comme pour donner à son petit visage espiègle, presque une frimousse, une touche barbouillée cocassement chiffonnée. L'auréole d'ennui avait été estompée.
Verna mangeait, pensive, mâchant à peine.
- J 'ai idée que c'est plutôt ringard, dit-elle. Peut-être ça n'en vaut-il pas le coup.
- Bien sûr ça en vaut le coup, m'obstinai-je. Ça élimine le problème des études secondaires, et tu peux te mettre à faire des plans pour t'inscrire à l'université. Ou dans une école de secrétariat. Ou de mannequins, bref un truc qui te plairait. Tu n'as que dix-neuf ans, tu as une foule de possibilités.
L'éternel conseiller en moi, galvanisé, ne se sentait plus.
- En sciences humaines, je suis foutrement nulle, dit-elle.
- L'équilibre des pouvoirs et la Constitution, tout de même, tu sais ce que c'est, et puis tous les trucs dont parlent les journaux.
- Non, justement pas. D'ailleurs je lis pas les journaux.
- Tu écoutes la radio. On donne des nouvelles à la radio.
- Pas les stations que j'écoute, dit-elle. Y a rien que de la musique.
- ... elles me sont un tel réconfort, disait Esther à l'autre bout de la table, les fleurs, sur quoi elle tourna la tête.
Je la vis en gros plan, par les yeux de Dale, la traînée de rouge et les filaments diaphanes du duvet sur sa lèvre supérieure, les petits frémissements paisibles des muscles de cette même lèvre pensive, et je sentis entre mes cuisses une bouffée de désir, un soupçon de roideur provoqué par la certitude instinctive en lui, tout pieux et saturé de savoir qu'il fût, que cette femme, au lit, du moment où elle aurait pris la décision de s'y fourrer, serait capable de tout. Cette désinvolture en elle, la fragilité souple et provocante de la charpente d'Esther, le vert avide de ses yeux à la protubérance discrètement hyper-thyroïdienne, tout le lui disait.
Tout.
- Je sais rien de rien, Tonton, geignit Verna.
-- Tu sais beaucoup plus de choses que tu ne le crois, fis-je non sans impatience.
J'avais l'impression d'être devenu une voix inopportune sur les ondes d'une chaîne musicale.
Esther intervint :
- Qu'est-ce qu'il cherche à te faire, Verna? C'est quoi cette histoire de test ?
- J'ai pas envie d'en parler, fit la jeune femme, d'une voix misérable. J'ai trop honte.
- Le test de niveau d'études secondaires, fit Dale, ça fait un an que je la tarabuste avec ça. Alors tu vas le passer, mais c'est formidable.
- Pas du tout. On discutait, sans plus.
- Je parie que c'est facile, intervint Richie, émergeant de sa maussaderie. Bien plus facile que d'aller en classe tous les jours.
- Le professeur Lambert pourrait t'aider en littérature et en grammaire, dit Dale, moi, je peux te remettre dans le coup en maths et en sciences.
- Oh mais non, protesta Esther, en posant une longue main fuselée sur celle de Dale, sa grosse main noueuse aux phalanges rougeaudes. Vous, vous êtes déjà embauché pour donner des leçons à Richie.
- Te dégonfle pas, Verna! s'écria Richie, en cherchant le ton juste.
- Allez vous faire foutre, implora Verna. Pourquoi vous mêlez-vous tous de mon problème?
Suivit un silence, que Paula mit à profit pour lâcher un rot et essayer de téter son autre main, qui elle n'était pas souillée de citrouille écrasée.
- Mais, ma chérie, annonça enfin Esther, parce que nous vous aimons beaucoup.
Dans la cuisine, tandis qu'ensemble nous vidions les assiettes et préparions le café pour le prendre au coin du feu (le feu qui, grâce aux bons soins de Richie, avait fini par s'éteindre), ma femme me dit, d'un ton cassant :
- Ma parole, nous voici tous les deux dans l'enseignement.
- Moi j'y suis en permanence, répliquai-je exaspéré de voir qu'elle semblait insister (comme ces vieillards en toge, poussière verbeuse, qui étaient mon gagne-pain) pour que soient rigoureusement explicitées des choses dont il valait mieux préserver l'ambiguïté.
- Comme tout le monde, sans doute, concéda Esther avec un soupir, en portant une main distraite à ses cheveux à demi défaits, tandis qu'un nuage mélancolique passait sur ses lèvres gonflées, lui donnant un petit quelque chose d'un peu fou et de tout à fait ravissant...."

“S.” (1988)
Régulièrement, John Updike s'est laissé aller à quelques charges, souvent très crues, à l'encontre du féminisme dans sa "Scarlet Letter Trilogy" : "A Month of Sundays" (1975, Un mois de dimanche), qui conte les penchants charnels d'un prêtre, "Roger's Version" (1986) et "S" (1988). "S", treizième roman de John Updike – du nom de l'héroïne Sara, ou Sare, mais aussi S comme Serpent, sexe, sensualité, comme sagesse (orientale) et science (occulte), et enfin comme sanscrit –, se déroule sur fond de yoga dans un ashram transplanté d'Inde en Arizona et régenté par un pseudo-gourou, l'Arhat. Loin de l'habituel microcosme d'une petite ville de Nouvelle-Angleterre et malgré leurs masques, les personnages sont dénués d'exotisme et marqués par les valeurs et travers d'une époque et d'une société qui, comme toujours, suscitent l'ironie et la causticité de l'auteur. «À quoi bon vivre, demande un des personnages, si l'on ne peut faire peau neuve?» Changer de rôle, de vie, de milieu, telle est l'aspiration de Sara P. Worth, moderne Hester Prynne dont la généalogie est un discret hommage à Nathaniel Hawthorne. En rupture de ban conjugal et social, fascinée par l'aura médiatique de l'Arhat, Sara se fait «sannyasin» pour, rebaptisée Kundalini et sous la férule spirituelle et charnelle du Maître, dompter son ego et parvenir à «moksha», le salut par le rejet de toutes illusions. Accablée d'humiliations, Sara/Kundalini secoue son joug et quitte l'ashram pour vivre son nirvana au soleil des Caraïbes, en marge de ses amours mortes et de ses illusions évanouies. Ce roman, composé de lettres et de bandes pour la plupart dues à Sara, se double d'une comédie d'illusions et de désillusions, acide et doucement amère, contée par la bouche d'une femme à la fois trahie et traîtresse, dans la lignée des héroïnes de Couples, Épouse-moi et Les sorcières d'Eastwick. Une fois encore, Updike se montre tiraillé entre l'ange et la bête, la religiosité et la chair. En quête de sa vérité, Sara/Kundalini, comme ses aînées, cherche à tâtons sa voie au «crépuscule de la vieille morale», parmi les méandres de la philosophie orientale et de l' érotisme. (Editions Gallimard, traduction de l'anglais par Maurice Rambaud)

"Self-Consciousness: Memoirs" (1989)
Les mémoires de John Updike se composent de six essais emersoniens qui retracent ensemble la forme intérieure de la vie, jusqu’à l’âge de cinquante-cinq ans, d’un homme américain relativement fortuné. L’auteur a tenté, dans son avant-propos, « de traiter cette vie, cette donnée massive qui se trouve être la mienne, comme une vie de spécimen, représentative dans son étrangement unique de toutes les vies bizarrement uniques dans ce monde ». Au service de cet effort métaphysique, il s’est montré honnête, incroyablement précis et plein d’humour. Il prend le lecteur au-delà de la conscience de soi, et au-delà de l’importance de soi, dans l’émerveillement pur au miracle de l’existence.
Publié entre Rabbit Is Rich (1981) et Rabbit at Rest (1990), ce livre révèle les angoisses, les doutes et les obsessions qui ont nourri son œuvre...
- "A Soft Spring Night in Shillington" - Updike retourne dans sa ville natale de Shillington (Pennsylvanie) et réfléchit à son enfance, marquée par le psoriasis et une relation complexe avec sa mère (aspirante écrivaine).
- "At War with My Skin" - Updike décrit son psoriasis, une maladie de peau qui l’a hanté toute sa vie, générant honte et obsession de son corps.
- "Getting the Words Out" : il raconte son bégaiement dans sa jeunesse et comment l’écriture est devenue son exutoire.
- "On Not Being a Dove" : Updike explique pourquoi il n’a pas rejoint le mouvement anti-guerre du Vietnam, contrairement à beaucoup d’intellectuels des années 1960. Son conservatisme modéré et son rejet du conformisme progressiste...
- "A Letter to My Grandsons": Une lettre adressée à ses petits-enfants sur la foi chrétienne, qu’il défend malgré son déclin dans la société moderne. La religion comme pilier face à la mort.
- "On Being a Self Forever" : méditation sur la mortalité, l’identité et le désir de laisser une trace à travers l’art.

"Rabbit at Rest" (1991, Rabbit en paix)
Harry Angstrom a pris sa retraite en Floride. Rabbit en paix, ou «Requiem pour Rabbit», 39e livre de John Updike, clôt la tétralogie de Harry «Rabbit» Angstrom dont, depuis trois décennies, les heurs et malheurs jalonnent l'œuvre de l'auteur. Si dans "Cœur de lièvre", "Rabbit rattrapé" et "Rabbit est riche" Harry Angstrom s'obstine à courir après la gloire, l'argent, et les illusions de l'amour, il se borne, dans cet ultime épisode, à lutter contre l'oisiveté, l'ennui, les fantômes de sa jeunesse et de ses espoirs déçus, et la peur de la mort. À cinquante-cinq ans, repu et nanti, empêtré dans les liens du sang et du mariage, affligé d'«un cœur américain typique», il voit sa vie comme «une chose absurde qu'il sera soulagé de rejeter un jour». "Rabbit en paix" est avant tout un roman fresque qui englobe, au fil de l'errance du héros, de multiples fragments du kaléidoscope ethnique et culturel de l'Amérique ; une Amérique dont Updike souligne les paradoxes, les aberrations et la vitalité, au gré de ses mutations de style, de mode et de langage.Ce roman témoigne d'une invention, d'une verve et d'un humour qu'illustrent une langue encyclopédique et un style débridé. (Editions Gallimard, traduction anglaise de Maurice Rambaud).
Des quatre romans qui composent la série, Rabbit, Run (1960), Rabbit Redux (1971), Rabbit Is Rich (1981) – Prix Pulitzer en 1982, et Rabbit at Rest (1990) – Prix Pulitzer en 1991, le dernier) est souvent considéré comme le plus abouti, couronné par un deuxième Pulitzer. Il clôt magistralement la saga.
On y assiste au déclin physique et moral de Rabbit,
- Harry souffre d’obésité et de problèmes cardiaques, symbolisant son autodestruction.
- Il entame une relation ambiguë avec sa belle-fille, Pru, révélant son incapacité à vieillir avec dignité.
à des tensions familiales,
- Son fils Nelson, accro à la cocaïne, détourne de l’argent de l’entreprise familiale (Springer Motors) : et le père immature doit enfin jouer l’autorité, mais échoue une fois de plus.
- Janice, sa femme, plus indépendante, le délaisse progressivement.
et à sa mort imminente, marquée par une rédemption partielle
- après une crise cardiaque, Rabbit opère un bref retour en grâce en s’occupant de son petit-fils.
- puis il meurt d’une ultime crise cardiaque lors d’un match de basket, ironiquement en jouant au sport de sa jeunesse. Enough. Maybe. Enough, trois mots résumant toute son existence de fuite et d’insatisfaction...
"Rabbit at Rest" est un roman où chaque scène compte, tissant la fin d’une épopée petite-bourgeoise devenue mythique, on y lit une critique acerbe des années 1980, la surconsommation, la crise des valeurs et le déclin de la classe moyenne blanche, et des passages mémorables (comme la scène de la mort de Rabbit)...

"Memories of the Ford Administration" (1992, La Parfaite épouse)
Ce sont ses «impressions et souvenirs» des années Ford (1974-1977) que nous livre ici Alfred Clayton, modeste professeur d'histoire dans un collège du New Hampshire. L'Amérique connaissait alors l'apogée de la libération sexuelle. Clayton, tout à la rédaction de sa biographie de James Buchanan, président des États-Unis de 1856 à 1861, dont les compromis débouchèrent sur la guerre de Sécession, rêvait d'échapper à la pesante réalité de son mariage à la «Reine du Désordre» en découvrant la «Parfaite Épouse». Lorsqu'il rencontra Genevieve, brune érudite mariée à un ami du couple et mère de famille, il crut au coup de foudre... S'efforçant dans ses travaux de magnifier le réalisme rassis du président, Clayton s'abandonne sans frein dans sa vie à ses propres chimères. Une double chronique, sarcastique et joyeuse, de ces périodes d'innocence heureuse d'avant la crise. (Editions Gallimard, traduction Rémy Lambrechts).

"In the Beauty of the Lilies" (1996, Dans la splendeur des lis)
Saga familiale qui s'étend sur quatre générations et quatre-vingts ans, de 1910 à 1990, au travers de laquelle Updike interroge nos aspirations tant religieuses qu'existentielles, et montre comment les rêves, les habitudes et les prédilections peuvent être transmise de génération en génération.Le fondateur de la lignée, Clarence Wilmot, pasteur presbytérien du New Jersey, perd la foi le jour où D. W. Griffith tourne, non loin de chez lui, sans argent ni espoir, il s’abrutira des outrances burlesques du cinéma du cinéma muet. Marqué par ce drame, son fils ne jure que par la modestie et la stabilité de son travail de facteur dans le Delaware. Sa petite-fille mettra toute son énergie à quitter cet univers provincial pour entrer dans le monde scintillant du cinéma, qui deviendra son unique réalité.Et son arrière petit-fils, le fils de la star, perdu dans un Hollywood suffoquant sous la pléthore de ses images, s’accrochera au premier qui lui proposera quelque chose ressemblant, de très loin, à la foi. La boucle n’est pas bouclée. Elle tourbillonne en une spirale qui avale les aspirations les plus contradictoires des États-Unis. Updike enserre tout – des grèves des ouvriers du textile au succès de la Columbia, de la rigueur intellectuelle d’un pasteur aux folies sanguinaires d’un gourou de l’influence de Darwin à celle des séries télévisées. (Editions du Seuil)

"Villages" (2004, Villages)
Owen Mackenzie est un Américain ordinaire - informaticien à la retraite, marié deux fois, père de quatre enfants. Pourtant sa vie est loin d'être paisible: son passé l'aide à combler le vide absurde creusé par la vieillesse, mais lui pèse aussi. Que reste-t-il? Les villages dans lesquels il a vécu, les femmes qu'il a rencontrées, épouses et maîtresses, ces amours crus et tendres dont il s'est nourri. (Editions du Seuil, traduit par Michèle Hechter).
"Longtemps, sa femme s'est réveillée tôt, à cinq heures, cinq heures et demie du matin. Le rythme biologique de Julia, parfois en désaccord avec celui d'Owen, la laisse, quand elle rouvre les yeux, pleine d'affection pour celui qui l'accompagne dans l'immobile voyage du lit où se traverse une nuit au sommeil imparfait. Elle l'étreint et, malgré ses protestations - il dort encore -, elle l'assure d'une voix douce mais implacable qu'elle l'aime tant, qu'elle est si contente de leur couple. "Je suis si heureuse avec toi." Et cela après vingt-cinq ans de vie commune. Il a soixante-dix ans, elle, soixante-cinq ; il trouve un peu insultant qu'elle estime nécessaire de lui faire cette déclaration: comment pourrait-il en être autrement?
Après toute la peine qu'ils ont faite aux autres, toutes ces épreuves qu'ils ont traversées, ils se retrouvent maintenant de l'autre côté. Elle le tiraille, lui tourne la tête pour l'embrasser sur la bouche. Mais ses lèvres sont gonflées, engourdies de sommeil, ses nerfs désalignés, anesthésiés, et il a l'impression qu'elle veut l'étouffer. Ça le prend à rebrousse-poil, comme on disait autrefois. Après quelques minutes de lutte amoureuse pendant lesquelles il s'obstine à ne pas réagir, se laissant la possibilité de revenir à son précieux rêve, Julia finit par céder et se lever, alors Owen reconnaissant s'étale sur le côté vide, et se rendort une heure ou deux.
Un matin, lors de cette dernière heure volée, il rêve que, dans une maison qu'il ne connaît pas (elle a l'aspect miteux d'un quelconque établissement public, pension de famille ou hôpital), des fonctionnaires sans visage le guident vers une pièce où, sur un grand lit comme le leur - deux lits d'une personne accolés -, un homme assez jeune, au vu de son corps blond et lisse aux fesses rebondies, est étendu sur sa femme comme s'il voulait la ranimer ou (ce qui est très différent) la dissimuler. Quand, obéissant à l'ordre muet des fonctionnaires, l'inconnu se relève, le corps allongé de la femme d'Owen apparaît nu : le ventre blanc, détendu, les seins aplatis par la gravité, son cher sexe familier, enfoui dans son duvet de fourrure floconneuse. Elle est morte, suicidée. Elle a fui ses tourments. Owen pense : si je n'étais pas entre dans sa vie, elle serait encore là. Il brûle de la prendre dans ses bras, de la ranimer et de sucer le poison que son existence a répandu dans la sienne.
Puis, lentement, à contrecœur, comme on abandonne un puzzle non résolu, il se réveille. Bien sûr, elle n'est pas morte, elle est en bas, avec l'odeur du café et le bourdonnement des premières nouvelles du matin : des voix malicieuses, masculines et féminines. La circulation, la météo, Julia adore ça, ces chroniques des aléas du quotidien, jamais elle ne s'en désintéresse bien qu'elle ait cessé depuis trois ans de faire l'aller-retour pour Boston. Il entend claquer dans la cuisine ses tongs en gomme bleue qu'elle persiste à porter comme si, éternellement jeune, elle s'était habillée pour la plage, du réfrigérateur au plan de travail, de la table à l`évier, du vide-ordures à la machine à laver la vaisselle, puis dans la salle à manger où elle va arroser les plantes. Son amour des plantes procède peut-être du même siège de l'émotion que son amour de la météo. Le bruit de ses tongs, dangereuses quand elle se déplace (elle glisse tout le temps dans l'escalier), l'irrite mais il aime voir ses orteils un peu écartés, comme ceux des Asiatiques dures à la tâche, agrippés à la semelle, leurs fines articulations toutes blanches, à force de crispation. Julia est une petite brune compacte dont la peau prend au soleil, contrairement à sa première femme, un joli hâle uniforme.
Parfois, à demi réveillé, il arrive à se rendormir en évoquant le souvenir d'une des femmes (Alissa ou Vanessa ou Karen ou Faye) qui vivaient comme lui à Middle Falls, une ville du Connecticut, dans les années soixante et soixante-dix. Serrant dans sa main sa queue assoupie, il se remémore le corps féminin sous lui, à côté, au-dessus, rejetant ses cheveux en arrière ou baissant la tête vers son nœud gonflé dont tous les nerfs réclament le contact humide, connu. Mais ce jour n'est pas de ceux-là. Le revigorant soleil de printemps brille, blanc et brutal, sous le store de la fenêtre. Le monde réel, un tigre que son rêve n'a pas blessé, attend. Il est temps de se lever, de porter cet aujourd'hui, tout semblable à hier, une journée que son optimisme animal pose comme la première d'une séquence étirée dans le futur à l'infini mais que son cerveau (hypertrophié chez l'espèce Homo sapiens) sait puisée - une de plus - dans une réserve finie qui va en diminuant.
Le village (appelons-le ainsi) de Haskells Crossing se réveille autour de leur colline privée; le tournoiement régulier et monotone de la circulation encercle les murs en plâtre et en bois de pin de la maison et la forêt protectrice alentour. Les journaux (le Boston Globe pour lui, le New York Times pour elle) sont déjà arrivés. Les oiseaux s'affairent depuis longtemps, les rouges-gorges ramassent les vers, les corneilles trouent la pelouse en quête de punaises des céréales, les hirondelles happent les moustiques dans l'air, l'espèce appelle l'espèce, suivant les joyeux codes de ses cervelles en petits pois.
" - Bonjour Julia", crie-t-il sur le palier, en allant vers la salle de bains.
Son cri lui répond : "Owen ! Tu es levé ! - Bien sûr chérie que je suis levé ! Bon Dieu, il est sept heures."
Plus ils vieillissent, plus ils parlent comme des enfants. Sa voix monte, un peu querelleuse, à demi-taquine.
" - Tu dors toujours jusqu'à huit heures depuis que tu n'as plus de train à attraper.
" - Chérie, quelle menteuse tu fais ! Je ne dors jamais après sept heures. Mais j'aimerais bien, poursuit-il en se demandant si elle s'est éloignée du bas de l'escalier, si elle l'entend encore. Se réveiller avec les oiseaux, c'est un des trucs de la vieillesse. Attends qu'elle t'atteigne, toi !"
Niaiserie conjugale : papotage de cervelles en petits pois. Si le jour était un ordinateur, pense-t-il, c'est ainsi qu'il se rallumerait, en rechargeant sa mémoire dure. En fait Julia dort moins que lui (comme sa première femme, Phyllis), mais qu'elle ait cinq ans de moins que lui a toujours été une source de fierté et un stimulus sexuel, comme la vue de ses orteils sur les semelles bleues de ses tongs. Il aime aussi regarder, sous son peignoir, ses talons roses qui s'éloignent, les lignes verticales de ses tendons d'Achille se dessinant alternativement quand elle marche à pas fermes et rapides, les pieds tournés en dehors, comme souvent les femmes.
La conversation a eu lieu pendant qu'il se tenait, la vessie douloureuse, devant la porte de sa salle de bains, à côté de l'escalier descendant à la cuisine. L'image de sa Julia bien-aimée, gisant, morte et nue, dans son rêve, ainsi que le sentiment de culpabilité qui transformait son suicide en un assassinat commis par lui demeurent plus vifs que les faits de l'éveil - le papier mural avec ses roses sépia et son sourd éclat métallique, le nouveau tapis du couloir, en laine beige toute propre, sur l'épaisse moquette moelleuse, la perspective de la journée, de ses heures à grimper comme les barreaux fendillés d'une vieille et dangereuse échelle. Quand Owen se rase devant le miroir accroché à côté de la fenêtre où son vieux visage bouffi, abîmé par le soleil, cruellement grossi, reçoit frontalement l'impitoyable lumière, il entend l'oiseau moqueur, juché sur sa branche favorite au faîte du plus haut cèdre, se lancer dans une longue et saisissante criaillerie à propos de ceci ou cela - quelque petit problème chronique de procédure. Tous ces développements régionaux de la Vie (les oiseaux, les insectes, les fleurs, la faune furtive des tamias au pelage rayé et de mannottes, se jetant dans ou hors de leurs trous comme si un imminent coup de fusil allait les faire exploser) ont leurs propres problèmes, leurs propres réseaux de communication ; pour eux, le monde humain n'est qu'agitation marginale, insondable immuabilité, interférence occasionnelle et rarement mortelle, sans rapport perceptible avec la prodigalité organique (les ordures, les jardins) que l'espèce humaine met sur la table de la Nature. Ils nous dédaignent, pense Owen. Nous devrions être des dieux pour eux..."

"Seek my face" (2002, Tu chercheras mon visage)
Vingtième roman de John Updike dont le titre est inspiré du Psaume 27, "You speak in my heart, and say 'Seek my face'. Your face, Lord, will I seek." et qui s'entend comme la tentative d'interrogation des motivations spirituelles les plus intimes de l'expressionnisme abstrait américain : "every painting was a wrestle with God. Self - self and beauty, beauty and self." Mais c'est bien l'ambition humaine qui au fond se donne dans la création artistique, et interroger l'art sur l'art s'épuise rapidement dans notre quotidien surchargé de tâches quotidiennes et charnelles. L'intrigue est centrée sur un dialogue-à-clef qui se noue entre une femme peintre, Hope Chafetz, à la fin de sa vie (78 ans), et une jeune journaliste new-yorkaise, Kathryn D'Angelo, venue l'interviewer dans sa maison du Vermont. Au cours d'une journée passée en huis clos, Hope, alter-ego de l'écrivain, rassemble les fils épars de toute une vie, une vie de femme peintre et femme de trois hommes de peinture qui ont marqué l'art moderne américain dans les années quarante-soixante : Zack McCoy, alias Jackson Pollock, le génial enfant terrible de l'expressionnisme abstrait, Guy Holloway, star du pop art, hybride de Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Jasper Johns, Robert Rauschenberg , enfin Jerry Chafetz, homme d'affaires et collectionneur d'art. Hope Chafetz est elle-même une synthèse de Lee Krasner, femme de Pollock, et des peintres Helen Frankenthaler (1928-2011) et Grace Hartigan (1922-2008). En retraçant avec une tendresse nostalgique cette grande époque révolue et les décennies qui suivirent, John Updike s'illustre à la fois comme critique d'art provocateur et comme critique éblouissant de la condition humaine. (Editions du Seuil, traduction par Claude Démanuelli).
Richard Estes (1932)
Natif de Kewanee (Illinois), Richard Estes est un représentant de l'hyperréalisme s'adonnant exclusivement des scènes urbaines avec une exactitude minutieuse, souvent rapproché de ces artistes qui émergent dans les années 1960-1970 comme Chuck Close et Duane Hanson, qui travaillent eux-aussi à partir de photographies. Edgar Degas, Edward Hopper, Thomas Eakins constituent pour lui autant de références. En fait, l'exactitude de la repésentation n'est pas le terme qui convient, Estes donne en effet à voir plus de détails picturaux que l'œil n'est capable de saisir : "Cabinas telefónicas" (1967, Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid), "The Candy Store" (1969, Whitney Museum of American Art, New York), "Drugstore" (1970, Art Institute of Chicago), "Supreme Hardware" (1974), "Central Savings" (1975, Nelson-Atkins Museum of Art, Kansas City), "Baby Doll Lounge" (1978, Currier Museum of Art), "The Plaza” (1991)...

Robert Coover (1932)
Né à Charles City dans l'Iowa, professeur de littérature à l'Université Brown, Robert Coover peut être apparenté à cette génération d'écrivains - Thomas Pynchon (1937), William Gass (1924), Donald Barthelme (1931), John Barth (1930) .. - qui ne peut écrire une fiction sans faire ressentir à son lecteur que c'est bien dans une fiction que celui-ci s'engage. Fiction et réalité semblent indémêlables, et l'introspection de l'écrivain ne peut être séparée d'une attitude ironique de part en part et sur soi-même et sur des personnages qui se savent sans existence réelle. Nous ne sommes plus dans la parodie, la satire, l’absurde, le grotesque, mais dans une mise en scène sans distanciation possible, si ce n'est à prendre en l'état sans le moindre point d'ancrage possible dans une réalité ou un sens de la fiction qui nous seraient familiers.
Après un passage dans la marine pendant la guerre de Corée, Coover débute sa carrière littéraire au début des années 1960 en écrivant dans cette fameuse Evergreen Review, fondée par Barney Rosset et éditée par Grove Press, qui publia tant des auteurs européens (Jean-Paul Sartre, Samuel Beckett) que ces nouveaux talents de la nouvelle expérimentation littéraire qu'étaient William Burroughs, Henry Miller, Hubert Selby Jr ou Donald Barthelme. En 1966, Coover publie son premier roman, "The Origin of the Brunists", - qui traite de la montée d'un culte religieux porté par le survivant d'une catastrophe minière et qui entend illustrer notre besoin à construire de la fiction pour survivre dans notre réalité. Son second ouvrage, "The Universal Baseball Association, Inc., J. Henry Waugh, Prop." (1968), montre comment un jeu de baseball construit par fiction peut s'imposer comme une réalité non contestable. Mais c'est avec un premier recueil de nouvelles, "Pricksongs & Descants" (La Flûte de Pan) en 1969 qu'il acquiert une notoriété, confirmée par son oeuvre la plus connue, "The Public Burning" (1977). Suivent "Spanking the Maid" (1982), "Gerald's Party" (1986), "Briar Rose" (1996)...

The Public Burning (1977, Le bûcher de Times Square)
Fidèle à une conception du roman qui entremêle réalité et fiction, pornographie, cinéma, réflexion esthétique et philosophique, Robert Coover se joue de l'Histoire en mettant en scène des personnages tels que Nixon, les Rosenberg, Eisenhower et tant d’autres qui, campés dans leur propre rôle se retrouvent dans une Récit entièrement fabriqué, ou peut-être pas. L'Oncle Sam lutte contre un imaginaire Spectre, allégorie du communisme international, et fabrique de multiples histoires dans lesquelles Richard Nixon tentent de reconstituer un peu de réalité. La grande démocratie américaine a son versant obscur, dont les heures les plus sombres furent les délires et les persécutions du Maccarthysme avec, en point d'orgue, l'exécution des époux Rosenberg. C'est ce point noir de la conscience américaine que Robert Coover revisite avec une audace débridée : par la puissance de l'imagination et de l'intuition, il se fait rouvrir les dossiers secrets du FBI, dévoile les magouilles sous-jacentes à la guerre froide, et plonge le lecteur dans un monde pourri en quête d'une fausse pureté. Tout comme il faut parfois prêcher le faux pour obtenir le vrai, il peut arriver que certaines vérités profondes de l'histoire d'un pays n'apparaissent jamais aussi clairement que dans les déformations, exagérations et divagations de la fiction. (Editions du Seuil)

"Briar Rose" (1996, Rose)
« Elle sent l’aneth, la citronnelle, la lavande et la menthe, auxquels s’ajoutent la poussière et des odeurs moins plaisantes, et elle reconnaît l’odeur de l’enfance : les ajoncs mêlés d’herbes aromatiques qui jonchaient le sol du grand hall, où elle était souvent restée à jouer sous les tables à tréteaux pendant que les adultes mangeaient. Qu’elle entend à présent au-dessus d’elle, riant à gorge déployée. Elle ouvre les yeux et voit le singe debout sur sa poitrine, entre ses seins, il lui fait une grimace de sous la couronne miniature retenue sous le menton par un lien. Il pince un mamelon rose avec ses doigts minces et osseux, le soulève et le secoue comme une cloche, tandis que ses lèvres s’écartent en une grimace sardonique, et elle en ressent les ondes jusqu’au plus profond de son ventre, où réside une douleur sourde et lancinante. Sa mère et son père et tous leurs amis et leurs chevaliers et les domestiques du château sont rassemblés autour d’elle, ils dominent le spectacle, le plaisir se lit sur leurs visages graisseux, ils s’esclaffent et rient et se tapent les cuisses. » Sur le thème éternel de la princesse endormie, la Belle au Bois dormant, Robert Coover brode de subtiles variations langagières, selon un principe qui présidait déjà à l’élaboration de La Bonne et son maître (1984) : tout manquement au rituel (ou à la rhapsodie) appelle une punition répétée, le désir est un champ d’aubépines, les caresses de l’élue impliquent toiles d’araignée et ossements cliquetants – et le rêve, peuplé de singes, de sorcières et de pères incestueux, est peut-être un viol. (Editions du Seuil, traduit de I'américain par Bernard Hoepffner)

"Whatever Happened to Gloomy Gus of the Chicago Bears" (1986, Une Éducation en Illinois)
Montre un autre Nixon, un amateur de football et de sexe, qui y fait preuve du même acharnement que dans la réalité pour asseoir son succès politique. C’est vers la fin des années trente, à Chicago, que Robert Coover situe l’action de son nouveau livre. Dans une Amérique minée par les luttes sociales, le chômage endémique, les manifestations violemment réprimées, le feu anticommuniste qu’on ne cesse d’attiser. Le héros est un pauvre type, un certain Gus, dit Gloomy, c’est-à-dire « le Lugubre », qui vient de se faire descendre à l’issue d’une grève plus dure que les autres. Ses copains évoquent la carrière de super-champion de Gloomy Gus, qui, l’espace d’une saison, a porté aux sommets son équipe des Chicago Bears, grâce à une tactique stupéfiante qui faisait de Gus le joueur à la fois le plus rapide et le plus rusé, le plus imprévisible à coup sûr. La mise en condition de notre héros reposait en fait sur une recette simple : à tel signal (un mot, un chiffre),Gloomy Gus savait qu’il devait effectuer telle feinte, tel bond en avant, partir en flèche, etc. Et comme il se doit, l’Amérique exigeant de ses « boys » qu’ils soient aussi fameux au lit qu’ils sont des dieux sur les stades, il avait été mis sur pied (si l’on peut dire) une recette similaire qui prévoyait tous les cas de figures amoureuses où sa gloire de joueur projetait le pauvre Gloomy Gus.On imagine alors ce qui pouvait se passer quand notre héros se mit un jour à mélanger les deux séries de tactiques, c’est-à-dire quand, par exemple, amoureusement enlacé, il se croyait victime d’une contre-attaque de l’équipe d’en face. Ça devait forcément mal finir. (Editions du Seuil, traduit de l’américain par Robert Pépin).

"Gerald 's Party" (1985, Gerald reçoit)
Gerald reçoit. Gerald et sa femme reçoivent leurs amis. Le roman tout entier est le récit de cette soirée (beuverie et rigolade, sexe et chahut) qui paraît une illustration en bonne et due forme des règles de la tragédie antique: unité de lieu, c'est un huis-clos, personne ne sortira avant la fin de l'action, avant la fin de la nuit ; unité de temps, le temps de la réception; unité d'action, mais c'est ici que cela se complique et que l`art de l'auteur s'épanouit, au rythme d'une nuit follement mouvementée, qui commence par la découverte du cadavre de la jolie Ros (sorte d'idole érotique, figure de déesse-mère). Le récit s’ouvre donc alors que la soirée donnée par Gerald et son épouse bat son plein, et lorsqu’est découvert le corps sans vie et mutilé de Ros au milieu des invités. Le texte semble nous acheminer lentement vers la résolution d’une enquête au cours de laquelle tous les événements de la soirée vont être littéralement "rejoués". "all these violent displacements, this strange light, these shocked and bloodied faces—it was as though we’d all been dislodged somehow, pushed out of the frame, dropped into some kind of empty dimensionless gap like that between film cuts, between acts…" Les buveurs s'affolent, on appelle la police, l'inspecteur Pardew enquête. On prend des photos, on tourne des vidéos, on parle de théâtre. Le remue-ménage s`accélère: les conversations se croisent vertigineusement, l'érotisme emballe hommes et femmes, amants ou couples défaits, enfants et jeunes filles vierges. D'autres cadavres sont découverts, le sang est projeté partout et, comme dans une bacchanale, on est tribade ou fou, diable, clown ou squelette, satyre en érection, masque. On pense à I'Ange exterminateur de Buñuel. Dans cet effarant huis-clos tout est spectacle et sono, et les rituels les plus archaïques (sous couvert de constantes références au théâtre et à ses succédanés: mime, mascarades, cirque, porno, etc.) refont surface : veillée funèbre, rites orgiaques, contes pour enfants, histoires de corps de garde, alternent en une sorte de ronde burlesque qui trouvera son apogée avec l'entrée en scène d'une troupe d'acteurs, les anciens partenaires de Ros, qui vont transformer la soirée en carnaval funéraire. Peut-on imaginer Euripide au milieu d'un tel chahut de paroles et de sperme ? Un charivari, sorti tout droit d'un rituel préhistorique, mettant à mal une soirée chic, genre Rotary Club, dans une ville de province ? Des flics, des cadavres, des scènes de copulation frénétique, tandis qu'un plombier flegmatique s'en vient déboucher tranquillement les cabinets engorgés? (Editions du Seuil, traduit de l'américain par Brice Matthieussent).
"Pour commencer, aucun de nous ne remarqua le corps. Pas avant que Roger n'arrivât afin de demander si nous avions vu Ros. Nous tenions encore presque tous à la verticale - sauf Knud qui, parti regarder les derniers résultats sportifs à la télé, s'était écroulé sur le divan -, mais notre attention n'était plus ce qu'elle avait été. J 'étais dans le salon, à resservir à boire, une bouteille de vermouth blanc destiné à Alison dans une main (Vic m'avait délesté du bourbon), un pichet d'old-fashioned dans l'autre, et sans raison particulière je pensais à une fille que j'avais autrefois connue dans une station balnéaire italienne. Le vermouth peut-être, ou la lumière douce qui baignait la pièce, ma relative ébriété. Le babil des conversations. Ou encore un sentiment d'imminence. Ma femme circulait dans la pièce voisine avec un plateau de canapés; elle faisait se rencontrer les gens, présentait les nouveaux arrivants, éliminait serviettes et cure-dents usagés, m'adressait parfois un signe de loin quand elle remarquait un verre vide dans une main. Bizarre, pensai-je. Ce soir-là en Italie, ma seule idée fixe avait été de manœuvrer cette fille pour me retrouver au lit avec elle, toute mon attention tendue vers l'aboutissement d'un orgasme parfaitement partagé (à l'époque j'étais encore en plein dans ma phase technique expérimentale); j'avais sans doute atteint mon but, mais ce lit et cet orgasme inoubliables avaient été totalement oubliés - je ne me rappelais même pas son visage! - et tout ce que j'avais retenu de cette nuit était l'image de la lueur concentrée d'une bougie à travers une tulipe jaune sur notre table de restaurant (une tulipe ? était-ce possible ?), les éclats suraigus d'une inextricable querelle de famille dans une venelle où les couleurs de multiples lessives ondoyaient comme autant de pavois, le goût de cette fille pour les anchois et l'ouzo, enfin mon sentiment exaltant de l'infinie nouveauté du monde. Pas grand-chose sans doute, mais je savais que sans l'amour cela aussi eût été perdu. Et maintenant je circulais parmi les invités avec ma bouteille et mon pichet, partageant révélations et commentaires familiers, demandes pressantes et passions antagonistes, laissant mon esprit régresser vers cette époque plus verte et plus légère où un orgasme techniquement bien exécuté me paraissait amplement suffire; me sentant agréablement habité - non pas tant par le souvenir que par les harmoniques du souvenir -, je me frayais un chemin à travers la foule compacte ("Elle était formidable dans la Maison de la pucelle", fit remarquer quelqu'un, et un autre rétorqua en riant : "Ah ouais ! L'histoire de la veuve et du pic?" Non, me dis-je, ça c'était Jours enfuis...) en direction d'une jeune femme nommée Alison : non seulement, fait rare, elle aimait le vermouth - d'où la bouteille que j'avais à la main -, mais elle était pour ainsi dire l'unique cause et raison d'être de cette fête. Alison. Son prénom, encore nouveau pour moi, agaçait plaisamment le bout de ma langue tandis que je servais des old-fashioneds aux autres (pas un pic d'ailleurs, mais -) :
- Encore un peu?
- Merci, Gerry! Tu sais que tu es le seul homme que je connaisse qui se rappelle encore la recette de ce cocktail!
- Ah, rien de tel que les vieilles recettes, ma chérie.
- Tu parles, du poison, oui. Suivez mon conseil, tenez-vous-en à la bière.
- Il y en a encore dans le frigo, Dolph, sers-toi. Naomi -?
- Quoi? Ah oui, merci - qu'est-ce que c'est ?
Comme je remplissais les verres, mon regard traversa la pièce surpeuplée en direction d'Alison dont la silhouette se détachait maintenant du flot de lumière diffusé derrière elle par les suspensions - tel un halo, une aura - et je sus que, création de l'amour, cette lueur m'accompagnerait toujours, même si je devais perdre tout le reste, cette soirée, ces amis, voire Alison elle-même, son profil délicat, ses doux cheveux auburn ("Aïe, Dolph! Arrête!"), les beaux anneaux d'or qui pendaient à ses petites oreilles -
- Hé, ho! Ça suffit!
- Hou, désolé, Naomi... !
- Bougez pas! s'écria Charley Trainer, qui arrivait ventre à terre pour lécher la main mouillée de Naomi. Miam!
- Cest quoi, un nouveau jeu de société ?
- Ha ha! J'suis deuze, Ger!
J'entendis retentir la sonnette, puis les paroles de bienvenue de ma femme dans l'entrée. Sans doute Fats et Brenda, mais le va-et-vient des gens sur le seuil m'empêchait de voir : Kitty, la femme de Knud, embrassa Dickie (il en profita pour lui glisser les mains entre les jambes en riant), Yvonne qui semblait songeuse, son mari Woody serrant la main d'un vieillard qui disait :
- A Babylone, voyez, on noyait les gus qui vendaient pas la bière assez cher - on les a visitées, les fosses où qu'on les plongeait!
- J 'adore cette cravate bouffante, Gerry! Très chicl ! Cyril et Peg sont arrivés ?
- Oui, je crois. Peut-être dans la salle à manger. C'est de l'old-fashioned, toi?
- Non, moi je suis plutôt le genre planteur. .
- Oh hé, tu veux rire ? intervint quelqu'un, qui arrivait derrière moi.
- Je peux vous montrer des photos.
- Essaie voir!
Des éclats de rire s'élevèrent, légers, au-dessus du brouhaha de la musique et des conversations, puis refluèrent, telle la palpitation régulière d'un battement de cœur, tandis que les groupes se formaient, se séparaient, se retrouvaient encore avec des mouvements fluides, presque hypnotiques, comme sous l'effet (pensai-je sous l'effet de l'alcool et le charme du moment) d'une compulsion atavique et rêveuse. Cédant moi-même à la fascination, je contournai un groupe de sérieux amateurs de whisky qui entreprenaient une rousse fardée, avec des nattes de gamine (Ginger : une copine de Dickie), fis comme si je ne voyais pas leurs regards déçus rivés à la bouteille de vermouth que j'avais à la main, et me frayai un chemin vers Alison (Kitty, heureuse et allumée, me croisa sur la gauche au moment où Patrick, en vert immaculé, passait sur ma droite; quelqu'un chantait "Rien de plus normal" sur la chaîne hi-fi), sentant l'excitation monter en moi à mesure que j'approchais d'elle.
La lumière, le profil étaient maintenant différents, mais comme surimposés par l'image d'elle que j'avais découverte un peu plus tôt. Et aussi par ce premier tête-à-tête dans le théâtre où la lumière déclinait. Nous nous étions rencontrés quelques semaines plus tôt au bar pendant l'entracte. Des amis d'amis. Echangeant quelques propos à bâtons rompus sur la pièce, Alison et moi nous étions découverts si intimement accordés l'un à l'autre que nous avions soudain cessé de parler, cligné des yeux, puis très vite, comme gênés, avions changé de sujet. Son mari m'avait donné sa carte de visite, ma femme avait vaguement suggéré d'organiser une soirée, j'avais dit que je leur téléphonerais. Alors que nous regagnions nos places et descendions des travées parallèles, Alison et moi avions échangé des regards furtifs qui m'avaient troublé au point que la pièce était déjà achevée quand je remarquai que je n'avais ni vu ni entendu le dernier acte : c'était seulement en demandant à ma femme ce qu'elle en pensait que j'en avais appris le dénouement. Le regard d'Alison, alors qu'enfin à ses côtés je remplissais maintenant son verre de vermouth, était tout sauf furtif, malgré la présence autour de nous de plusieurs personnes qui nous observaient, attendant que je les servisse : elle me souriait franchement, ses yeux (telle fut l'impression qu'ils me firent alors) pareils à de profondes flaques marron de pur désir...
- Curieux, dis-je d'une voix pensive, soutenant son regard, cherchant le fil susceptible de nous relier à ce moment privilégié au théâtre, j'ai l'impression que tout cela est déjà arrivé...
- C'est une illusion, Gerald", répondit-elle; sa voix était douce, ronde, presque une étreinte, mon nom dans sa bouche comme une cerise. Elle plongea la main dans le pichet d'old-fashioned à la recherche d'un cube de glace, sans me quitter de ses yeux marron. Sa posture révélait un équilibre particulier, étudié, qui me fit songer aux filles des publicités sur le pont de yachts lancés à pleine vitesse, nues jusqu'à la ceinture, les embruns scintillant sur leurs seins bronzés, les cheveux dénoués, les jambes largement écartées, raidies dans leur jean blanc moulant comme des ressorts tendus - même si ce soir elle portait en fait une robe en soie "charmeuse" vert et or d'une douceur presque incroyable. La particularité de l'amour, pensai-je en plongeant mon regard dans les deux grands yeux liquides d'Alison qui, reflétant les miens, leur faisaient pourtant signe, ce regard réfléchi étant lui-même un reflet de ce premier échange splendide et paralysant (ce soir-là au théâtre elle portait un costume Renaissance en velours de panne cannelle avec un corsage blanc bouffant, les ruches froncées de ses poignets pareilles à un feuillage d'où jaillissait la floraison expressive de ses mains, ses cheveux auburn, maintenant dénoués, alors réunis sur sa nuque par une barrette ambrée), c'est qu'on est submergé par un vague désir avant de savoir ce que l'on désire - voilà pourquoi l'acte lui-même, bien que semblable à n'importe quel autre, paraît toujours étrange et nouveau, comme une découverte, une exploration, pourquoi l'on doit s'en approcher en silence, sans raison ni paroles, à tâtons... "Vous savez, je parie que vous êtes le genre d'homme", dit-elle comme si elle venait de prendre une sorte de décision, sa voix gantée d'intimité et, oui, d'une sorte de terreur (sentant cela, je m'approchai encore), "qui a cru, autrefois, que tous les cons du monde étaient miraculeusement différents les uns des autres.
- Oui - euh, oui, en effet!
Mes yeux s'élevèrent, quittant son regard : nous étions seuls. Nos cuisses se touchaient. "La chaude quoi?" beugla quelqu'un derrière moi, et je me dis que tout compte fait la situation n'allait peut-être pas évoluer comme je l'avais imaginé. Dans la pièce voisine, ma femme, la main brandie très haut, me montrait le verre vide de Tania. Celle-ci, qui m'adressait un large sourire par-dessus les visages qui nous séparaient, le tenait comme une pancarte.
- Oui, c'est ça... Chacun est une... aventure unique." Alison léchait le cube de glace avant de le laisser tomber dans son verre de vermouth, et à la regarder je crus me rappeler les camions de glace qui s'arrêtaient jadis devant la maison de ma grand-mère, les lourds blocs cristallisés qu'il fallait casser (souvenir apaisant), les éclats de glace sur la plate-forme du camion, la petite voisine... " Mais j'étais jeune à l'époque..
- Ah, mais c'est vrai, Gerald, vous savez!" Elle sourit en suçotant timidement son glaçon. Il scintillait, telle une grosse pierre précieuse, entre ses lèvres. Elle le laissa glisser doucement comme une lente naissance, puis tomber - plouf! - dans son vermouth.
- "Chacun est unique, vous savez...
A ce moment précis, Roger arriva et interrompit tout le monde en demandant si nous avions vu Ros. Je comprenais l'angoisse de Roger, je l'avais maintes fois constatée. Il aimait désespérément Ros - l'aimait sans doute davantage qu'aucun de nous n'aimait quoi que ce fût, si le terme d'amour convient - et à son grand désespoir il était follement jaloux d'elle.
Comme dans un conte de fées, il l'avait découverte dans la troupe d'un cabaret, jolie blonde nantie d'une belle paire de jambes et de seins splendides, au comportement insouciant et naturel, le sourire avenant (et plus que cela cependant : nous avions tous été attirés par elle, sans doute par son innocence presque succulente et une sorte de majesté sans prétention qui vous plongeait dans une folle terreur, même dans l'intimité - pendant les moments que j'avais passés avec elle, je m'étais surpris à l'appeler Princesse), et il avait béni sa bonne étoile quand elle lui avait permis de coucher avec elle le soir même de leur rencontre. Qu'il ne fût pas le seul à bénéficier de l'aubaine, il avait peine à y croire; il faisait en fait des pieds et des mains pour ne pas en croire un mot, et ces efforts marquèrent le début de ses souffrances. Il la poursuivit alors avec la passion implacable de qui se sent investi d'une mission, se débrouillant tant bien que mal pour occuper toutes ses soirées afin d'en chasser ses rivaux, la suppliant de l'épouser, et parce qu'on pouvait finalement la convaincre de faire quasiment n'importe quoi, elle céda. Et continua de vivre comme elle l'avait toujours fait, remarquant à peine qu'elle avait changé d'adresse. Pauvre Roger. Elle l'aimait, bien sûr : elle aimait tous les hommes..."

"Ghost Town" (1998, Ville fantôme)
Un homme sans nom marche dans le désert américain. Il va successivement croiser un pianiste chauve dans un saloon où claquent les coups de revolver, une tribu indienne se livrant à des sacrifices humaines, ou encore la fascinante reine des bandits, toute vêtue de noir, qui l’entraînera dans une course folle en diligence. Quant à l’amour, il faudra choisir entre la chanteuse de bar aux cheveux orange, aux seins outrageusement exhibés, et l’institutrice austère au chignon serré. Parfois tout se brouille et ces figures disparaissent, tout comme cette ville fantôme qui ne cesse d’apparaître, de le rattraper puis et de se diluer dans le morne horizon. Série de mirages, hallucinations ? Peut-être que l’objet de la quête n’est pas là où on l’attend. Robert Coover revisite le genre du western pour en repousser très loin les limites, dans une langue débordante d’inventions et avec l’humour qu’on lui connaît. (Editions du Seuil, traduit de l’anglais par Bernard Hoepffner)

"A Night at the Movies or, You Must Remember This" (1987, Demandez le programme)
Le recueil contient la nouvelle "You Must Remember This», à propos de Casablanca et qui décrit de manière explicite ce que Rick et Ilsa font quand la caméra n'est pas sur eux. Demandez le programme! «Notre aimable clientèle peut en toute confiance fréquenter cette salle où ne sont jamais projetés de films susceptibles de la choquer.» La promesse est incluse dans le prix du billet. Et pourtant, cinéphiles, méfiez-vous! Chaque soir, «le visiteur de minuit» revient brouiller dans votre tête son jeu d'images. Du haut-de-forme d'un danseur au melon d'un certain Charlie, des jupons d'une ingénue au fourreau de Gilda, d'un duo de Casablanca à un duel dans l'Ouest américain, tout «ça doit vous rappeler quelque chose». L'« effondrement des frontières» entre les genres a certes «quelque chose de corrompu, peut-être de dangereux, mais c'est également une libération qui accroît de façon exponentielle "notre" cinémathèque». Dans la salle désertée où le projectionniste superpose les rubans de celluloïd, la rébellion gronde «entre les cadres». Accompagnant les ébats érotiques de l'« espace masculin» et du «temps féminin», notre mémoire-musée rejoue avec ces bouts de pellicule et les pyrotechnies d'une fiction savante la grande scène triangulaire des boulevards. «Le fantôme du cinéma» vous convie à des projections privées dont nul magnétoscope ne permet de rêver. Palais du cinéma, palais des glaces, palais des horreurs... Demandez le programme! (Editions du Seuil, traduit de l’anglais par Bernard Hoepffner)

"Noir" (2010, Noir)
Phil M. Noir, détective privé, est le rejeton le plus désaxé de New London. Trench-coat défraîchi, menton mal rasé et clope au bec, il écume les ruelles les plus glauques de la ville pour élucider les affaires troubles de ses clients, telle celle de cette veuve en voilette noire et toute en jambes dont le mari s’est fait tuer dans un règlement de comptes. De bar en bar et d’informateur en informateur, il glane des tuyaux pour coincer le meurtrier. Lorsque la veuve se fait refroidir et que le corps est dérobé à la morgue, Noir refuse de lâcher l’affaire, malgré les exhortations de sa très efficace assistante, Blanche, et tous les passages à tabac que truands et policiers lui font subir. Coover utilise tous les poncifs du genre pour mieux les renverser. Car le polar à sa façon n’a rien d’une ligne droite conduisant à l’identité de l’assassin. C’est un récit qui tangue, qui titube comme Noir à la sortie du Loui’s, une boîte interlope… Un roman subtilement décalé, ébouriffant et souvent très drôle, à l’atmosphère enivrante. (Editions du Seuil, traduit de l’anglais par Bernard Hoepffner)

"The Adventures of Lucky Pierre" (2002, Les Aventures de Lucky Pierre)
Lucky Pierre, star du porno à Cinécity, est l'objet de toutes les convoitises et sa vie semble n'être faite que de sexe. Mais derrière cet apparent triomphe se cache une âme fragile et sensible, qui n'a de cesse de vouloir fuir la véritable dictature imposée par la responsable de la ville, grande maîtresse du sado-masochisme, secondée par d'efficaces et implacables milices. Cette tyrannie, bien sûr, suscite ses dissidents, pour lesquels Lucky Pierre éprouve des sentiments ambivalents. Mais la prison sous forme d'écran n'a pas de limite ni de fin, et lorsqu'on retrouve Lucky Pierre courant nu et en érection dans la ville hivernale, se croyant enfin sauvé, c'est pour réaliser que tout ceci est illusion, sa fugue faisant partie du scénario. Roman cinématographique, Les Aventures de Lucky Pierre sont aussi une réflexion ironique sur les débordements de la fiction. Recourant aux techniques du burlesque, de la satire, de l'humour, de la répétition et de la variation, Robert Coover nous invite dans un univers où le réel semble supplanté par sa représentation, dans un jeu vertigineux qui est aussi un terrible miroir de nos propres fantasmes et de nos névroses. (Editions du Seuil, traduit de l’anglais par Bernard Hoepffner)









