- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Svevo - Pirandello
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki
- 1930-1940
- 1930s
- Fitzgerald
- Hemingway
- Faulkner
- Koch
- Céline
- Bernanos
- Jouve
- DosPassos
- Kojève
- Miller-Nin
- Grosz - Dix
- Green
- Ortega y Gasset
- Wittgenstein
- Russell - Carnap
- Artaud
- Jaspers
- Sapir - Piaget
- Guillén
- Garcia Lorca
- Hammett
- A.Christie
- Heidegger
- Icaza
- Huxley
- Hubble
- Caldwell
- Steinbeck
- Waugh
- Blixen
- Rhys
- J.Roth - Doderer
- Aub
- Malraux-StExupéry
- DBarnes-NWest
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bataille
- Char-Michaux
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Bloch
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Lewin - Mayo - Maslow
- Montherlant
- Buzzati - Pavese
- Vittorini
- Fallada
- Malaparte
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Welty
- Boulgakov
- Tamiki - Yôkô
- Weil
- Gadda
- Broch
- Steeman
- Jouhandeau
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Ellison
- Bergman
- Baldwin
- Fromm
- Bradbury - A.C.Clarke
- Tennessee Williams
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Carpentier
- Mishima
- Salinger - Styron
- Pasternak
- Asturias
- O'Connor
- Hoffer
- Matute - MartinGaite
- 1960-1970
- 1960s
- Abe
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- U.Johnson - C.Wolf
- Heller - Toole
- Naipaul
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Onetti - Sábato
- Capote
- Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- McCarthy - Minsky
- Sillitoe
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- Lenz
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Dolls
- Ellis
- Cortázar
- Warhol
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- HarperLee
- Fuentes
- 1970-1980
- 1970s
- Habermas
- Handke
- GarciaMarquez
- Deleuze
- Derrida
- Beck
- Satir
- Kundera
- Hrabal
- Didion
- Guinzbourg
- Lovelock
- Vietnam
- H.S.Thompson - Bukowski
- Pynchon
- E.T.Hall
- Bateson - Watzlawick
- Carver
- Irving
- Milgram
- VargasLlosa
- Puig - Donoso
- Lasch-Sennett
- Crozier - Touraine
- Friedan-Greer
- Jacob-Monod
- Dawkins
- Beattie - Phillips
- Gaddis
- Rawls
- Zinoviev
- H.Searles
- Ballard
- Jong
- Kôno
- Calvino
- Ballester-Delibes
- ASchmidt
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact

Consumerism - Gary Cross, "An All-Consuming Century: Why Commercialism Won in Modern America" (2000) - Thomas Frank, "The Conquest of Cool" (1997) - Juliet Schor, "The Overspent American" (1998) - Lizabeth Cohen, "A Consumers’ Republic" (2003) - William Leach, "Land of Desire" (1993) - ...
Last update : 2024/11/11

Dans les années 1990, le "consumerism" s'impose comme une grille d’interprétation du monde, des relations, de soi-même. Autrement dit, une idéologie vécue intérieurement, non pas simplement un comportement externe...
Avant les années 1990, la "Consommation" se donnait comme "pratique", il s'agissait d'acquérir des biens pour satisfaire des besoins, montrer un statut, accéder à un confort matériel. La consommation pouvait être extérieurement massive, mais intérieurement négociée (tensions morales, collectives, religieuses, politiques). Lizabeth Cohen (A Consumers’ Republic) montre comment, dans les années 1940-70, la consommation était inscrite dans un projet civique : on consommait pour soutenir l’économie nationale, exercer sa citoyenneté. Mais cela restait encadré par des discours publics, des syndicats, l’État providence. La consommation était une pratique encadrée, négociée...
Juliet Schor (The Overspent American) souligne qu’à partir des années 1980-90, le cadre de comparaison change : on ne se compare plus à ses voisins, mais à des modèles médiatiques idéalisés. Les désirs sont déconnectés des ressources réelles. La consommation devient une source d’angoisse identitaire et de dette symbolique. La consommation devient intériorisée comme un impératif existentiel : « je suis ce que j’achète ou n’arrive pas à acheter ».
Thomas Frank (The Conquest of Cool) montrera que la critique de la société de consommation elle-même est récupérée par le marché : l’anti-conformisme devient un style de marketing. À partir des années 1960, mais surtout dans les années 1990, le marché ne vend plus des produits, mais des valeurs, des rébellions, des identités "cool". Le consommateur ne fait plus que posséder : il exprime son individualité en consommant. La consommation devient performative...
À partir des années 1990, le consumérisme devient un cadre mental : on se pense, se projette, s’évalue à travers ce que l’on achète ou désire. L’identité se forge à travers les marques, les styles de vie, les "choix". Le consommateur devient le sujet central de la vie sociale, remplaçant le citoyen, le travailleur ou le croyant. Le "consumerism" devient alors ce que certains appellent une "infrastructure émotionnelle" (Zygmunt Bauman, Consuming Life, 2007).
Kit Yarrow (Decoding the New Consumer Mind) décrira la consommation post-2008 comme émotionnelle, compulsive, anxieuse. Le consommateur contemporain cherche à se calmer, se rassurer, se gratifier. L’achat devient thérapeutique, presque neurologique. La consommation devient un langage intime et affectif, enraciné dans le self : elle n’est plus seulement sociale ou statutaire, mais psychique. Eva Illouz (Cold Intimacies / Consuming the Romantic Utopia) montrera que même l’amour et les émotions sont reconfigurés par la logique de consommation : on choisit un partenaire comme un produit, via des plateformes, des listes de critères...
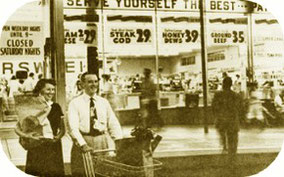
Pourquoi la société de consommation s'est-elle imposée et a-t-elle survécu à toutes les crises du XXe siècle, sans véritable partage ou remise en question décisive?
Pour Gary Cross, elle a triomphé non pas en dépit des angoisses modernes, mais parce qu’elle les a absorbées, normalisées, et reconfigurées en désirs gérables. Idéologie dominante du monde post-1945, le consumérisme n’a pas triomphé par accident ou par une simple stratégie commerciale, mais parce qu’il a su s'adapter aux désirs profonds, aux anxiétés, et aux besoins identitaires des Américains.
Contrairement aux théories critiques classiques qui dénoncent la consommation comme aliénation, Gary Cross propose une lecture nuancée et empirique : lorsque les premières parlent d'aliénation, de manipulation, et de conformisme, il répondra en termes d'adaptation, de ritualisation et de désir légitime, et constate, malgré tous les efforts intellectuels d'idéalisation des alternatives, le total effondrement des idéologies concurrentes.

La société de consommation s'est imposée comme la solution économique au capitalisme industriel de masse ...
Après 1929 et surtout après 1945, les économies occidentales doivent écouler des surplus de production massifs. Le salariat de masse, les gains de productivité, la standardisation fordiste exigent un marché de masse élargi. Cohen parle de "Consumers’ Republic" : consommer devient un acte civique, justifiant les politiques de croissance, de crédit et d’aménagement du territoire (banlieues, supermarchés, publicité). Le consumérisme est ainsi institutionnalisé : État, entreprises, syndicats s’accordent sur un modèle où consommer soutient l’économie et la paix sociale.
Le compromis keynésien et l’idéologie démocratique ...
La société de consommation a aussi permis d’intégrer les classes populaires à la démocratie libérale : accès à l’électroménager, au crédit, à la voiture, à la télévision… En échange de la renonciation à la révolution, le citoyen devient consommateur.
La consommation devient une forme de participation pacifiée, où les inégalités sont maquillées par l’accès au confort matériel.
Face aux crises les plus diverses, cette société de consommation montrera une résistance à toute épreuve ..
- Adaptabilité, financiarisation et individualisation ..
Face aux crises (chocs pétroliers, désindustrialisation, crise de 2008), le système a reconfiguré les formes de consommation : crédit à la consommation, cartes de crédit, micro-finance : on consomme même sans revenus stables. Personnalisation des biens, segmentation des marchés : on consomme même en étant exclu des circuits traditionnels. Le numérique enfin démultipliera l’accès aux biens et aux marques sans propriété réelle (streaming, location, achats in-app).
Pour Bauman, la consommation est devenue notre devoir moral, et l’identité s’est fondue dans ce que nous consommons..
- Toute critique de la consommation est rapidement absorbée par elle ..
La mode "anti-mode" devient une ligne Zara. L’écologie devient une campagne marketing (greenwashing). L’authenticité devient un style de pub. L’anti-capitalisme devient une marque (cf. Che Guevara sur des T-shirts vendus chez H&M). Pour citer Thomas Frank, "la rébellion est devenue la stratégie publicitaire dominante...
C'est un type de société qui ne peut plus être véritablement remis en cause ..
- La "Naturalisation de la consommation" ...
La consommation est perçue non plus comme une construction sociale ou politique, mais comme naturelle, les gens n'ont-ils pas toujours voulu s’habiller, se divertir, s’exprimer. Et pour reprendre Baudrillard, la consommation est un système de signes, non de besoins.
- La Fragmentation des classes sociales et des récits collectifs ..
Depuis les années 1980, la désintégration des classes populaires organisées, la crise des syndicats, la chute des idéologies collectives (socialisme, catholicisme social) ont privé les sociétés occidentales de cadres alternatifs. À la place, l’individu est sommé de se "réaliser" par ses choix de consommation. Même les luttes sociales ou identitaires (genre, race, climat) sont souvent canalisées dans des formes de consommation engagée, sans transformation structurelle. On connaît la célèbre phrase de Fredric Jameson, selon laquelle il est plus facile d’imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme.
- Le rêve consumériste constitue un vaste horizon d’universalité ...
Même les pays du Sud global ont été intégrés à ce modèle par la promesse de développement via la consommation.

Une consommation qui parvient à masquer les inégalités réelles derrière l’illusion du choix (le “menu capitaliste”) : on peut consommer un Coca ou un Pepsi, même en vivant dans la précarité...
Thomas Frank ("The Conquest of Cool: Business Culture, Counterculture, and the Rise of Hip Consumerism", 1997) démontrera que même les critiques culturelles du capitalisme ont été récupérées pour vendre une illusion de liberté par la consommation. Il analysera en effet comment la culture « hip » et le marketing des années 1960 ont utilisé les idées de liberté, de choix et de rébellion pour vendre davantage… tout en masquant les réalités sociales et économiques des consommateurs.
Juliet B. Schor ("The Overspent American: Why We Want What We Don’t Need", 1998) montre comment les mécanismes de la consommation créent une illusion de liberté et de choix, alors qu’en réalité ils masquent, reproduisent et aggravent les inégalités sociales. L’un des arguments clés du livre est que les individus, en particulier les classes moyennes, se comparent à des normes de consommation socialement élevées (souvent issues des classes supérieures), ce qui crée une spirale d’endettement et d’aliénation économique.
Son livre démontre que la pluralité des biens offerts (voitures, vêtements, gadgets) donne le sentiment d’un accès égalitaire à la société de consommation, alors que ces choix restent profondément structurés par le capital économique, culturel et social. Schor parle d’une fausse égalité par le choix, qui masque les inégalités d'accès, de temps et de revenus.
Elizabeth Currid-Halkett, "The Sum of Small Things: A Theory of the Aspirational Class" (2017)observe que les nouvelles élites ("Aspirational Class") consomment moins de biens ostentatoires que dans le passé, mais plus de services coûteux, discrets, liés à l’éducation, au bien-être, à l’alimentation bio, à la parentalité intensive, à la culture et au développement personnel. Cette consommation est invisible ou perçue comme “intelligente”. Le problème (ce n'est pas un véritable problème pour nombre de privilégiés et une grande partie de la classe politique ou dite dirigeante, on s'en doute) est qu'elle reproduit et renforce les inégalités sociales : elle repose en effet sur des capitaux difficilement imitables (temps libre, savoir-faire, réseaux, langage). On parle de "inconspicuous consumption" (consommation discrète) ...

Les années 1990 semblent avoir marqué ce basculement décisif ..
La Fin des grandes idéologies collectives (mais non pas fa fin des idéologies), mais la Chute du mur de Berlin (1989) symbolise l'épuisement des récits alternatifs au capitalisme, et la mort lente des utopies révolutionnaires, religieuses, syndicales. La seule promesse qui semble rester encore crédible pour le plus grand nombre est celle du bonheur individuel par l’achat, l’expérience, le choix personnalisé.
L'explosion des technologies culturelles a conforté cette tendance, si elle ne l'a pas créée : généralisation de la publicité ciblée, de la télévision par câble, puis du web (1995–2000), multiplication des niches de consommation identitaire (tout devient une tribu, un lifestyle) et premiers pas vers le consumérisme algorithmique (cf. Zuboff, Surveillance Capitalism).
La grande mutation du capitalisme, de la production au désir, est en marche depuis les années 1970 avec un capitalisme post-fordien qui ne repose non plus sur la production de biens, mais sur la mise en scène du désir, de l’émotion, de la singularité. Le marché vend désormais de l’expérience subjective (cf. Pine & Gilmore, "The Experience Economy", 1999).
Le "consumérisme" est devenu un langage intérieur : on pense son avenir en termes de choix de consommation (carrière, image, sexualité, corps, statut social) ...
Zygmunt Bauman ("Consuming Life", 2007) a montré que le consommateur moderne n’existe que s’il consomme sans cesse (il est à la fois produit et moteur du système), Colin Campbell ("The Romantic Ethic and the Spirit of Modern Consumerism", 1987), que le consommateur postmoderne vit dans une imaginaire perpétuel de désir, d’auto-fabrication, d’irréalité active, Adam Arvidsson ("Brands: Meaning and Value in Media Culture", 2006), qu les marques ne vendent plus des objets mais des formes d’engagement personnel, émotionnel, symbolique, Shoshana Zuboff ("The Age of Surveillance Capitalism", 2019), que les choix de consommation deviennent intégralement prédictibles et manipulables (le consumérisme algorithmisé), Naomi Klein ("No Logo", 1999) , que le branding des années 1990 marque une hégémonie des marques sur la culture, au-delà du simple produit....
Le "consumerism" est alors intériorisé comme une seconde nature - au point qu’il devient presque invisible. Et c’est cette invisibilité mentale qui le rend si profondément ancré et difficile à remettre en cause ...
Vers une rupture?
Au XXIe siècle, des économistes, - Jason Hickel, "Less is More: How Degrowth Will Save the World" (2020) - Kate Raworth, "Doughnut Economics" (2017) - démontreront que la poursuite infinie de la consommation dans un monde fini est physiquement impossible ...

Le consumérisme n’est ni purement américain, ni totalement universel ...
C’est un système culturel et économique né aux États-Unis, qui s’est mondialisé sous des formes multiples et conflictuelles. Les interprétations critiques de la mondialisation du consumérisme souligneront que le modèle américain circule, mais est "traduit", hybridé, détourné dans chaque contexte local (Globalisation with friction / Tsing, Appadurai, 2000s) et que si le désir de consommer s'est imposé au monde entier, ses objets et codes restent culturellement spécifiques (Baudrillard, Featherstone)...
Gary Cross, Lizabeth Cohen ou William Leach ont montré que les États-Unis ont imposé une structure symbolique du désir et de la réussite sociale, via la consommation. Et si les États-Unis furent en effet le laboratoire mondial du consumérisme, doit-on l'attribuer à des éléments tels que l'articulation production de masse (Fordisme) / publicité de masse / pouvoir d’achat élevé, mais aussi au fameux Mythe de l’American Way of Life exporté après 1945, son Leadership économique et culturel global (Hollywood, Coca-Cola, Levi’s, etc.), et la Guerre froide culturelle qui impose la consommation comme une arme "douce" contre le communisme (cf. Kitchen Debate, 1959)...
L'Europe de l’Ouest (années 1950–70) va imiter le Modèle américain mais en le tempérant par l’État-providence et une culture plus critique du marché. La France, l’Allemagne ou l’Italie adoptent la société de consommation (cf. Lipovetsky, de Grazia), mais avec une certaine réticence vis-à-vis de l’hyperindividualisme, des traditions esthétiques et intellectuelles plus sceptiques. Victoria de Grazia, dans "Irresistible Empire" (2005) montre des États-Unis imposant certes un soft power consumériste, mais pas une soumission complète.
Le Japon (années 1960–90) adopte une société de consommation avancée, mais structure le désir autour de l’harmonie, de la technologie, de l’imitation sociale. Le marketing japonais intègre des valeurs collectives, non individualistes (Cf. Anne Allison, "Millennial Monsters" (2006).
Les pays d’Europe de l’Est et ex-soviétiques ont connu, depuis la fin de la guerre froide, une évolution singulière de leur rapport à la consommation, qui ne se réduit ni à une simple imitation du modèle occidental, ni à une continuité soviétique. Leur trajectoire est marquée par des contradictions profondes entre héritage socialiste, libéralisation brutale et affirmation identitaire post-communiste. Susan Reid, David Crowley, "Style and Socialism" (2000) et Alexei Yurchak, "Everything Was Forever, Until It Was No More" (2006) ont illustré cette première phase.
Les années 1990 ont engraînées libéralisation brutale et choc de la transition : privatisations rapides (cf. "thérapie de choc"), chômage massif, disparition des protections sociales, entrée en force des marques occidentales (Nestlé, McDonald's, Levi’s), symbole de liberté… et d’inégalité, ruée vers la consommation, et consommation ostentatoire par les nouvelles élites, crise morale dans certaines sociétés : corruption, perte de repères, "marchandisation de tout". Katherine Verdery (What Was Socialism, and What Comes Next?, 1996) : critique du consumérisme perçu comme "déraciné" et destructeur de valeurs collectives.
Les Années 2000–2020 seront interprétées sous l'angle d'une réinvention nationale du consumérisme avec une instrumentalisation de la consommation par le pouvoir politique. On parle de naissance d’un consumérisme souverainiste, où l’accès aux biens est présenté comme une victoire nationale, non une imitation de l’Ouest (Cf. Olga Shevchenko, Crisis and the Everyday in Postsocialist Moscow (2009) ; Kristin Ghodsee, The Red Riviera (2005) - sur les tensions entre mémoire socialiste et désir post-moderne).
Le Monde arabo-musulman et l'Afrique sont marqués par l'introduction sélective de biens de consommation occidentaux (technologie, médias), mais adaptés aux normes locales, avec de fortes tensions entre tradition religieuse / communautaire et le consumérisme mondialisé.
En Chine & Inde (depuis 1980–90), on note l'explosion d’une consommation de masse urbaine, combinée à une croissance forte. En Chine, le consumérisme autorisé tant qu’il n’empiète pas sur le contrôle politique; en Inde, s'impose une hybridation entre marques mondiales et codes de caste / religion ...
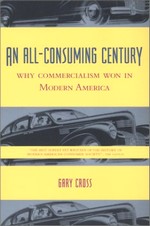
Gary Cross, "An All-Consuming Century: Why Commercialism Won in Modern America" (2000)
Dans "An All-Consuming Century", l’historien américain Gary S. Cross retrace l’histoire du consumérisme américain au XXe siècle. Son objectif est d’expliquer pourquoi et comment la société de consommation a fini par s’imposer comme l’idéologie dominante aux États-Unis, au point d’éclipser les alternatives politiques, religieuses ou culturelles.
L’ouvrage sera largement utilisé dans les cultural studies, les études sur la société de consommation et l’histoire américaine. Il a influencé les réflexions sur la marchandisation de la vie quotidienne dans les années 2000, notamment à travers les travaux de Juliet Schor, Thomas Frank, Andrew Ross.
Une thèse centrale : La consommation comme structure culturelle
Cross insiste sur le fait que le consumérisme n’est pas seulement une pratique économique, mais une culture, une idéologie diffuse qui régule le rapport au temps, au genre, à la famille, à l’identité.
Le livre va confronter histoire sociale, histoire économique, histoire culturelle, et s’appuyer sur des sources variées (manuels de pub, catalogues, journaux, films, objets) pour, contrairement à des auteurs comme Christopher Lasch ou Herbert Marcuse, ne pas chercher ni à idéaliser le passé ni diaboliser la consommation. Pour Cross, la consommation ne fait que répondre à de réels besoins émotionnels, symboliques et sociaux, ce qui explique sa résilience. Et comme ni la gauche politique, ni les religions, ni l’art n’ont su construire des imaginaires aussi concrets et fédérateurs que la consommation de masse, on peut expliquer le “succès” du consumérisme comme réponse pragmatique aux angoisses modernes.
Ses Apports Majeurs ...
- Sa Profondeur historique : le livre démontre comment le consumérisme a absorbé/resignifié les contestations (contre-culture des années 1960 recyclée en marketing "rebelle"), et procède à une analyse fine des mécanismes mis en oeuvre : crédit à la consommation, transformation des fêtes (Noël commercialisé), rôle des médias.
- Concept du "Child-Adult" : une idée que l'on peut considérer comme novatrice, les adultes modernes définissent leur identité par des plaisirs immédiats (loisirs, gadgets), autrefois réservés aux enfants, au détriment des responsabilités citoyennes.
- Critique de la "démocratisation du désir" : le nivellement par la consommation a créé une illusion d'égalité, masquant les inégalités structurelles.
The Irony of the Century
"The beginning of a new century is a good time to reflect on the preceding hundred years. We need such spans to help us make sense of our past and to force us to think about our future. The twentieth century was an especially ironic time. Despite clashes of ideologies, two devastating world wars, and a forty-five-year cold war that ultimately made the United States the leading global power, the century did not culminate in the victory of American political ideas. Rather, the real winner of the century was consumerism. Visions of a political community of stable, shared values and active citizenship have given way to a dynamic but seemingly passive society of consumption in America, and increasingly across the globe.
The very idea of the primacy of political life has receded, despite the vast expansion of government. Instead, a very different concept of society has emerged — a consuming public, defined and developed by individual acquisition and use of mass-produced goods. Consumerism, the belief that goods give meaning to individuals and their roles in society, was victorious even though it had no formal philosophy, no parties, and no obvious leaders. Consumerism was the “ism” that won — despite repeated attacks on it as a threat to folk and high culture, to “true” community and individuality, and to the environment. Groups as diverse as the traditionalist Arts and Crafts movement of the early twentieth century, the modernist literati of the interwar years, and the environmentalists of the 1960s all fought it with vigor. Even though thinkers, politicians, and social organizers struggled against it, none produced effective alternatives.
Why Consumerism Won
Consumerism succeeded where other ideologies failed because it concretely expressed the cardinal political ideals of the century — liberty and democracy — and with relatively little self-destructive behavior or personal humiliation. Consumer goods allowed Americans to free themselves from their old, relatively secure but closed communities and enter the expressive individualism of a dynamic “mass” society. Commodities gave people a sense of freedom, sometimes serving as a substitute for the independence of the shop, craft, or farm that was disappearing as Americans joined the industrial work world. “Passive” consumption may have been an essential element in the emerging mass society of the twentieth century. Still, consumer goods gave people the means to establish new personal identities and to break with old ones without necessarily abandoning family, friends, and the common culture. For example, children of immigrants used amusement parks, new foods, and fashionable clothing to distance themselves from their parents without breaking with them. Even more important, consumer goods became a language, defining, redefining, and easing relationships between friends, family members, lovers, and strangers. Cars and clothes gave identity to young and old, female and male, ethnic majority and minority, telling others who they were and how they expected to be treated. Cosmetics and candy expressed both rebellion and authority, thus providing people with an understanding of themselves in an otherwise indifferent and sometimes unfriendly world. Moreover, goods redefined concepts of the past and future and gave a cadence to the rhythms of daily life when people purchased antiques and novelties and when Christmas became a shopping “season.” The taste, feel, and comfort of manufactured objects, designed to maximize physical satisfaction and to intensify pleasure and excitement, created new understandings of personal freedom.
Consumerism redefined democracy, creating social solidarities and opportunities for participation that transcended suffrage rights or political ideologies. A vision of a world of goods available to American citizens in large part replaced the old ideal of a republic of producers and challenged class, religion, and ethnicity as principles of political solidarity. In particular, the promise of a democracy of consumers co-opted class identity. Consumerism was far more than a political smoke screen. It reflected real social needs and, ironically, often fulfilled those needs with less conflict than did other, more substantial forms of social solidarity. Communities, formed around ownership of suburban homes, country club memberships, and college diplomas, excluded and humiliated outsiders and the poor. But religious, political, and other social groups were at least as discriminatory, and these groups often caused even more resentment and hostility, especially if they made absolute claims. Social or faith groups may actually be less flexible than markets in adjusting to change because of their democratic participatory ethic. When voluntary leisure groups, for example, are dominated by their members, they often unintentionally exclude others or become fractionalized. It has been much easier for commercial companies like Walt Disney or Leisure World, who stand outside the markets they organize, to get people to join. There was less risk of humiliation in disclosing oneself as a “member” of a society of Porsche owners than in joining a group that demanded personal interaction. It was relatively easy to “buy” one’s way into a community of shoppers, and there were so many from which to choose. Consumerism repeatedly and dynamically reinforced democratic principles of participation and equality when new and exciting goods entered the market. The American Way was affirmed as Americans moved from basic Model T Fords to stylish choices in cars in the 1920s and from the radio to the TV in the 1950s.
« Le Paradoxe du Siècle »
« Le début d’un nouveau siècle est propice à une réflexion sur les cent années précédentes. De telles périodes nous aident à donner un sens à notre passé et nous forcent à penser notre avenir. Le vingtième siècle fut une époque particulièrement paradoxale. Malgré les affrontements idéologiques, deux guerres mondiales dévastatrices et une guerre froide de quarante-cinq ans qui ont finalement hissé les États-Unis au rang de puissance mondiale dominante, le siècle n’a pas abouti à la victoire des idées politiques américaines. En réalité, le véritable vainqueur du siècle fut le consumérisme. Les visions d’une communauté politique fondée sur des valeurs stables partagées et une citoyenneté active ont cédé la place, en Amérique et de plus en plus à travers le monde, à une société de consommation dynamique mais apparemment passive.
L’idée même de la primauté de la vie politique s’est estompée, malgré l’immense expansion des gouvernements. À la place a émergé un concept sociétal radicalement différent : un public consommateur, défini et façonné par l’acquisition et l’usage individuels de biens de masse. Le consumérisme – cette croyance selon laquelle les biens confèrent un sens aux individus et à leur rôle dans la société – a triomphé sans philosophie formelle, sans partis et sans leaders identifiables. Le consumérisme fut l’« isme » victorieux, en dépit des attaques répétées le dénonçant comme une menace pour la culture populaire et savante, pour la communauté « authentique » et l’individualité, ainsi que pour l’environnement. Des groupes aussi divers que le mouvement traditionaliste Arts and Crafts du début du siècle, les littérateurs modernistes de l’entre-deux-guerres et les écologistes des années 1960 l’ont combattu avec vigueur. Bien que penseurs, politiciens et organisateurs sociaux aient lutté contre lui, aucun n’a proposé d’alternatives efficaces.
Pourquoi le consumérisme a triomphé
Le consumérisme a réussi là où d’autres idéologies ont échoué parce qu’il exprimait concrètement les idéaux politiques cardinaux du siècle – la liberté et la démocratie – et ce, avec relativement peu de comportements autodestructeurs ou d’humiliations personnelles. Les biens de consommation ont permis aux Américains de s’affranchir de leurs anciennes communautés, relativement sûres mais fermées, pour entrer dans l’individualisme expressif d’une société de « masse » dynamique. Les biens matériels offraient un sentiment de liberté, servant parfois de substitut à l’indépendance de l’atelier artisanal, du métier ou de la ferme qui disparaissaient à mesure que les Américains intégraient le monde du travail industriel. Une consommation « passive » a peut-être été un élément essentiel de la société de masse émergente du vingtième siècle. Pourtant, les biens de consommation ont donné aux individus les moyens de forger de nouvelles identités personnelles et de rompre avec les anciennes sans nécessairement abandonner leur famille, leurs amis ou la culture commune. Par exemple, les enfants d’immigrants utilisaient les parcs d’attractions, les nouvelles denrées alimentaires et les vêtements à la mode pour prendre leurs distances avec leurs parents sans rompre avec eux. Plus important encore, les biens de consommation sont devenus un langage, définissant, redéfinissant et facilitant les relations entre amis, membres de la famille, amants et inconnus. Voitures et vêtements ont conféré une identité aux jeunes et aux vieux, aux femmes et aux hommes, à la majorité ethnique comme aux minorités, indiquant aux autres qui ils étaient et comment ils souhaitaient être traités. Cosmétiques et confiseries exprimaient tant la rébellion que l’autorité, offrant ainsi aux individus une compréhension d’eux-mêmes dans un monde par ailleurs indifférent et parfois hostile. De plus, les biens ont redéfini les concepts du passé et du futur, et ont rythmé le quotidien lorsque les gens achetaient antiquités et nouveautés, et que Noël est devenu une « saison » des achats. Le goût, la texture et le confort des objets manufacturés, conçus pour maximiser la satisfaction physique et intensifier plaisir et excitation, ont créé de nouvelles conceptions de la liberté individuelle.
Le consumérisme a redéfini la démocratie, créant des solidarités sociales et des opportunités de participation dépassant les droits de vote ou les idéologies politiques. Une vision d’un monde de biens accessibles aux citoyens américains a largement remplacé l’ancien idéal d’une république de producteurs et a contesté la classe, la religion et l’origine ethnique comme principes de solidarité politique. En particulier, la promesse d’une démocratie de consommateurs a opéré une récupération des identités de classe. Le consumérisme était bien plus qu’un écran de fumée politique. Il répondait à de réels besoins sociaux et, ironiquement, les satisfaisait souvent avec moins de conflits que d’autres formes plus substantielles de solidarité sociale. Les communautés formées autour de la propriété de maisons de banlieue, des abonnements de country clubs et des diplômes universitaires excluaient et humiliaient les outsiders et les pauvres. Mais les groupes religieux, politiques et autres associations sociales étaient tout aussi discriminatoires, et suscitaient souvent encore plus de ressentiment et d’hostilité, surtout s’ils émettaient des exigences absolues. Les groupes sociaux ou confessionnels peuvent en réalité être moins flexibles que les marchés pour s’adapter au changement, en raison de leur éthique de participation démocratique. Lorsque des groupes de loisirs volontaires, par exemple, sont dominés par leurs membres, ils excluent souvent involontairement d’autres personnes ou se fractionnent. Il a été bien plus facile pour des entreprises commerciales comme Walt Disney ou Leisure World, qui se tiennent à l’extérieur des marchés qu’elles organisent, d’attirer des adhérents. Il y avait moins de risque d’humiliation à se déclarer « membre » d’une société de propriétaires de Porsche qu’à rejoindre un groupe exigeant des interactions personnelles. Il était relativement aisé de s’« acheter » une place dans une communauté d’acheteurs, et le choix était vaste. Le consumérisme a renforcé de manière dynamique et répétée les principes démocratiques de participation et d’égalité lorsque de nouveaux biens passionnants arrivaient sur le marché. L’American Way fut affirmé lorsque les Américains sont passés des modèles T basiques à des choix de voitures stylisées dans les années 1920, et de la radio à la télévision dans les années 1950. »
"In the context of consumerism, liberty is not an abstract right to participate in public discourse or free speech. It means expressing oneself and realizing personal pleasure in and through goods. Democracy does not mean equal rights under the law or common access to the political process but, more concretely, sharing with others in personal ownership and use of particular commodities. Consumerism was realized in daily experiences, always changing, improving, and being redefined to meet the needs of individual Americans in their ordinary but still (to them) special lives as children and parents, wives and husbands, and in thousands of other roles.
In other ways, however, consumerism has been a threat to the kind of individual responsibilities and social solidarities that made political democracy work in the past. The fixation on personal goods has denied the necessity of sacrifice beyond the family. It has allowed little space for social conscience and confined aspiration to the personal realm. Consumerism had no interest in linking the present to the past and future (at least, beyond nostalgia and fantasy). Rear-guard defenders of the simple or cultivated life have had little impact. Indeed, their values have often been commercialized. Only the family, a most fragile institution, had the potential to pull the individual from self-gratification and break up the consuming crowd. Unfortunately, the family has hardly been a constraint on conumption — the home long ago was conquered by the market with mass circulation magazines, radio, TV, and other outlets for advertising domestic goods. And the family lacks stability and critical distance, reduced as it often is to a purchasing unit in a dynamic consumer society. Consumerism has produced a powerful but profoundly ambiguous legacy.
Americans have led the way toward a consumer society (and for this reason, at least, the twentieth century is the American century), but they are by no means solely responsible for it. Consumerism is not American Character incarnate, as European and American critics alike are accustomed to believe. Nor is it merely the extreme end of modernity expressed fully in the New World where, unlike in Europe, the fetters of tradition have always been weak or even powerless.3 Other cultures have created different mixes of consumerism. Accidents of history, geography, and economics have allowed Europeans to produce a greater share of public goods and services than the United States. European nations have been slower to abandon small-scale, class-segmented shops for discount/department store shopping. They have often spent more on cuisine and long-distance vacations than have Americans. After all, by the mid-1990s Britons and Germans worked merely 43.3 and 41.4 weeks per year on average, compared to the 49.2 work weeks of Americans.4 In contrast, the United States has led the way in private consumption of relatively large homes and cars.
To be sure, the globalization of consumer and media industries has erased some of these differences. The declining power of nation-states and regional cultures has meant greater uniformity in consumption styles.
Still, differences remain, and America in the century of consumption has followed its own path. The predominance of markets over other social and cultural institutions in American history is particularly important. Many factors contributed to this. The absence of an established national church, a weak central bureaucracy, the regional division of the elite, the lack of a distinct national “high culture,” the fragmentation of folk cultures due to slavery and diverse immigration, and finally the social and psychological impact of unprecedented mobility all meant that market values encountered relatively few checks. Americans have had a strong tendency to define themselves and their relationships with others through the exchange and use of goods. Americans were hardly unique in this, and important checks on U.S. market culture lasted into the twentieth century, but this tendency made goods especially central to American society.
Contexte consumériste : liberté et démocratie redéfinies
« Dans le cadre du consumérisme, la liberté n’est pas un droit abstrait de participation au débat public ou à la libre expression. Elle signifie s’exprimer et réaliser un plaisir personnel à travers les biens. La démocratie ne renvoie pas à l’égalité des droits devant la loi ou à un accès commun au processus politique, mais, plus concrètement, au partage avec autrui de la propriété et de l’usage de biens spécifiques. Le consumérisme s’est incarné dans l’expérience quotidienne, évoluant sans cesse, se perfectionnant et se redéfinissant pour répondre aux besoins des Américains ordinaires menant des vies à la fois banales et (pour eux) singulières – en tant qu’enfants ou parents, épouses ou maris, et dans des milliers d’autres rôles.
Menaces sur le tissu démocratique
À d’autres égards, toutefois, le consumérisme a sapé les responsabilités individuelles et solidarités sociales qui jadis sous-tendaient la démocratie politique. L’obsession des biens personnels a évacué la nécessité du sacrifice au-delà de la sphère familiale. Il a laissé peu de place à la conscience sociale et cantonné les aspirations à la sphère privée. Le consumérisme ne s’est jamais soucié de relier le présent au passé et au futur (du moins, au-delà de la nostalgie et de la fantaisie). Les défenseurs conservateurs d’une vie simple ou cultivée n’ont eu que peu d’influence. Leurs valeurs ont même souvent été récupérées commercialement. Seule la famille, institution pourtant fragile, aurait pu extraire l’individu de l’auto-gratification et dissoudre la foule consumériste. Malheureusement, elle n’a guère été un frein à la consommation : le foyer fut conquis de longue date par le marché via magazines à grand tirage, radio, télévision et autres vecteurs publicitaires pour biens domestiques. Réduite à une unité d’achat dans une société consumériste dynamique, la famille manque de stabilité et de distance critique. Le consumérisme a légué un héritage puissant mais profondément ambigu.
Spécificités américaines et nuances globales
Si les Américains ont ouvert la voie à la société de consommation (et en ce sens, le XXe siècle est bien le siècle américain), ils n’en portent pas l’entière responsabilité. Le consumérisme n’est pas l’incarnation d’un « Caractère américain », comme le pensent tant les critiques européens qu’américains. Pas plus qu’il ne représente simplement l’aboutissement extrême de la modernité, pleinement exprimé dans le Nouveau Monde où – contrairement à l’Europe – les entraves de la tradition furent toujours faibles, voire impuissantes. D’autres cultures ont forgé des hybrides consuméristes distincts. Des aléas historiques, géographiques et économiques ont permis aux Européens de développer davantage de biens et services publics qu’aux États-Unis. Les nations européennes ont été plus lentes à remplacer les commerces de proximité segmentés par classe sociale par les grands magasins/discounters. Elles ont souvent consacré plus de ressources à la cuisine et aux vacances lointaines que les Américains. Au milieu des années 1990, Britanniques et Allemands travaillaient en moyenne respectivement 43,3 et 41,4 semaines par an, contre 49,2 pour les Américains. À l’inverse, les États-Unis ont mené dans la consommation privée de maisons spacieuses et d’automobiles.
Certes, la mondialisation des industries médiatiques et consuméristes a gommé certaines différences. Le déclin des États-nations et cultures régionales a produit une uniformisation des modes de consommation.
Pourtant, des écarts persistent, et l’Amérique du siècle consumériste a suivi sa propre trajectoire. La prédominance historique des marchés sur les autres institutions socio-culturelles y fut déterminante. Plusieurs facteurs l’expliquent : l’absence d’Église nationale établie, une bureaucratie centrale faible, l’élite régionalement divisée, le manque d’une « haute culture » nationale distincte, la fragmentation des cultures populaires par l’esclavage et l’immigration diverse, et enfin l’impact psychosocial d’une mobilité sans précédent. Tous contribuèrent à ce que les valeurs marchandes rencontrent peu de contre-pouvoirs. Les Américains ont eu une forte tendance à se définir et à nouer leurs relations via l’échange et l’usage de biens. Cette propension n’était pas exclusive aux États-Unis, et des freins importants à leur culture de marché persistèrent jusqu’au XXe siècle, mais elle fit des biens un pivot central de la société américaine. »
"Modern consumerism is a product of broad transformations of industrial society experienced worldwide. In some ways, it is the wedding of technology to the pursuit of happiness. Desire for comfort, variety, and satisfaction are hardly new to the twentieth century. However, in the past humankind was limited in its weak capacity to harness energy, to accelerate and direct chemical processes, and to mold, assemble, and deliver laborsaving machines, shelter, clothing, and nourishment. People were unable to defeat, even briefly, the terrors of nature. Preachers of constraint made sense when the unlimited desire of the rich and powerful led to the exploitation of the many and the horrors of war and conquest. By contrast, in the twentieth century the industrial West learned to release large portions of humanity from many of these natural fetters. The mass production of consumer goods was the magical key. Thus modern technology seems to have freed modern Americans from the need to restrain desire.
Consumer society also emerged when the ancient dual economy of mass subsistence and elite luxury gave way to an economy capable of delivering vast and diverse stores of goods to the general population. The introduction of Henry Ford’s automobile assembly line in 1913 promised a dramatic new possibility — that industrial output could swamp demand for goods. Advertising and appealing shopping centers helped to create wants to match the growing supply of products. The “philosophy” of consumerism was embedded in the words and images of the ad agency and display designer, who welded human physical needs, impulses, and fantasies to packaged goods.
The twentieth-century United States and the culture of consumption have become so closely intertwined that it is difficult for Americans to see consumerism as an ideology or to consider any serious alternatives or modifications to it. Participation in the consumer culture requires wage work, time, and effort, often given without enthusiasm or interest. But this tradeoff seems natural today, an inevitable compromise between freedom and necessity. Maintaining a reciprocal relationship between consumption and work keeps the economic system running and orders daily life. This society of goods is not merely the inevitable consequence of mass production or the manipulation of merchandisers. It is a choice, never consciously made, to define self and community through the ownership of goods.
« Genèses et aliénations du consumérisme moderne »
« Le consumérisme moderne est le produit des transformations profondes des sociétés industrielles à l’échelle mondiale. Il représente, en un sens, l’alliance de la technologie et de la quête du bonheur. Le désir de confort, de variété et d’épanouissement ne naît certes pas au vingtième siècle. Mais par le passé, l’humanité était limitée par son incapacité à maîtriser l’énergie, à accélérer et orienter les processus chimiques, ou à façonner, assembler et diffuser machines, logements, vêtements et nourriture économisant la peine humaine. Les peuples ne pouvaient vaincre, ne fût-ce que temporairement, les terreurs de la nature. Les prêcheurs de tempérance trouvaient alors un écho quand le désir illimité des puissants exploitait les masses et engendrait guerres et conquêtes. Au contraire, le vingtième siècle vit l’Occident industriel libérer d’immenses pans de l’humanité de ces entraves naturelles. La production de masse des biens de consommation en fut la véritable clé magique. La technologie moderne sembla ainsi affranchir les Américains de la nécessité de refréner leurs désirs.
Cette société de consommation émergea aussi lorsque l’antique économie duale – subsistance des masses contre luxe des élites – céda la place à une économie capable de fournir au grand public des biens abondants et diversifiés. L’introduction de la chaîne de montage automobile par Henry Ford en 1913 ouvrit une possibilité inédite : que la production industrielle puisse submerger la demande. Publicité et centres commerciaux séduisants suscitèrent des désirs à la mesure de l’offre croissante. La « philosophie » consumériste s’incarna dans les mots et images des agences de pub et scénographes marchands, qui soudèrent besoins physiques, pulsions et fantasmes humains aux biens emballés.
L’hégémonie culturelle
Les États-Unis du XXe siècle et la culture consumériste sont désormais si intimement liés qu’il est difficile pour les Américains d’y voir une idéologie, ou d’envisager des alternatives significatives. Participer à cette culture exige un travail salarié, du temps et des efforts – souvent consentis sans enthousiasme. Mais ce compromis paraît aujourd’hui naturel, inévitable conciliation entre liberté et nécessité. Maintenir cette réciprocité entre consommation et travail fait tourner le système économique et ordonne le quotidien. Cette société des objets n’est pas seulement la conséquence inéluctable de la production de masse ou des manipulations marchandes. Elle relève d’un choix – jamais formulé explicitement – de définir l’individu et la communauté par la possession de biens. »
(...)
Cross rejette le déterminisme pessimiste de l'École de Francfort (Adorno, Horkheimer, Marcuse) : pour lui, la consommation est aussi adaptative, choisie et investie de sens, et non uniquement imposée. Il ne voit pas le consommateur comme passif, mais comme participant à une logique de désir, de distinction, de sécurité. Il critique l'élitisme culturel implicite de Theodor W. Adorno & Max Horkheimer ("Dialectic of Enlightenment", 1944) ou de Herbert Marcuse ("One-Dimensional Man", 1964) qui valorisent une « haute culture » sans saisir pourquoi les masses préfèrent la consommation.
Cross, historien de la culture focalisé sur les pratiques et les désirs, et intéressé par la logique psychologique et culturelle de la consommation, se démarque d'un J. K. Galbraith ("The Affluent Society", 1958), économiste critique de la structure des préférences qui dénonce un gaspillage rationnel des ressources nationales. Il ne conteste pas le diagnostic économique, dénonce lui aussi une société centrée sur l’offre et la publicité, où les besoins sont artificiellement stimulés, mais cherche à comprendre pourquoi les individus ont consenti à cette logique, et comment elle a répondu à leurs besoins symboliques.
Si Christopher Lasch ("The Culture of Narcissism", 1979), comme Gary Cross, analysent tous deux l’émergence d’un individualisme consumériste centré sur les besoins psychologiques et reconnaissent le rôle de la consommation dans la construction identitaire, ce dernier ne partage pas le catastrophisme de Lasch : il ne voit pas dans le consumérisme la cause d’un narcissisme pathologique et analyse historiquement l’adaptation du marché aux besoins sociaux en se refusant de diagnostiquer une crise morale de la société américaine.
Le livre suit une trame chronologique, divisée par décennies, montrant que chaque crise du XXe siècle a renforcé le consumérisme en le réorientant vers de nouveaux besoins (sécurité, individualité, reconnaissance). Plutôt que d’être une "illusion", le consumérisme est un système culturel efficace pour gérer les tensions de la modernité américaine ...
1. L’invention du consumérisme moderne (1900–1930)
L’essor de la production de masse (Fordisme) rend les biens accessibles. Le consumérisme devient un moyen d’expression individuelle dans une société de plus en plus standardisée.
Apparition des publicités, vitrines, grands magasins : le désir est mis en scène.
2. La crise du consumérisme pendant la Dépression (1930s)
Recul du modèle consumériste au profit de l’idéologie du travail et de la frugalité. Les élites cherchent une culture plus “élevée”, mais les masses restent attachées au confort matériel.
Début de la tension entre élites critiques et classes moyennes consommatrices.
3. L’apogée du modèle (1945–1975)
Le consumérisme devient la norme sociale : banlieues, électroménager, loisirs de masse. Il remplit des fonctions identitaires : différenciation sociale, éducation familiale, genre. La consommation est aussi un outil d’intégration (vétérans, femmes, minorités) — une promesse d’appartenance.
4. Les contre-cultures et les ambiguïtés (1960–1970)
La contestation (hippies, féministes, militants noirs) vise le consumérisme, mais en reprend parfois les formes. Exemple : le marché du “cool”, du psychédélisme ou du “bio” devient lui-même récupéré par l'industrie.
5. L’ère du consumérisme sans entrave (1980–2000)
Montée du néolibéralisme : réduction des États sociaux, exaltation du consommateur libre. Marchandisation de l’enfance, des loisirs, de la vie intime. Les valeurs marchandes remplacent les idéaux collectifs : le citoyen devient "client".
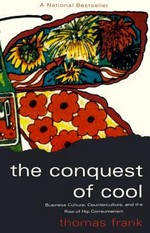
Thomas Frank, "The Conquest of Cool: Business Culture, Counterculture, and the Rise of Hip Consumerism" (1997)
Comment le marché s’approprie l’anticonformisme (des années 1960 à aujourd’hui) - Alors que Cross évoque la récupération culturelle, Frank montre que l’industrie publicitaire elle-même devient moteur d’un anticonformisme domestiqué. Il étudie comment les publicitaires et entreprises des années 1960 ont intégré les codes de la rébellion culturelle pour vendre. Ainsi la "cool attitude", l'anticonformisme, la libération sexuelle deviennent des outils de différenciation commerciale ...
- "one. A Cultural Perpetual Motion Machine: Management Theory and Consumer Revolution in the 1960s"
comment le management d'entreprise dans les années 1960 a intégré des idéaux de rupture, d'innovation constante et d'anti-conformisme. Frank montre que les théoriciens du management ont activement promu une culture du changement, alignée sur les valeurs de la contre-culture, pour soutenir la croissance et la flexibilité du capitalisme. Il décrit une "machine à mouvement perpétuel" culturelle, dans laquelle la rébellion est récupérée pour relancer continuellement le marché.
- "two. Buttoned Down: High Modernism on Madison Avenue"
Ici, Frank revient sur l’ère du "high modernism" publicitaire des années 1950 et début 60, marquée par le formalisme, la hiérarchie, l'efficacité et le style conservateur. Les publicitaires comme ceux de l'agence McCann-Erickson incarnaient une culture rigide et bureaucratique. Cette période est associée à une vision technocratique de la publicité, éloignée des expressions créatives.
- "three. Advertising as Cultural Criticism: Bill Bernbach versus the Mass Society"
Frank se penche sur la figure de Bill Bernbach, cofondateur de l’agence Doyle Dane Bernbach (DDB), pionnier de la publicité créative. Bernbach critiquait la publicité de masse et promouvait une communication plus subtile, ironique et émotionnelle. Sa campagne pour Volkswagen (la Coccinelle) est emblématique : elle alliait minimalisme visuel, humour, et sincérité, en opposition à l’exubérance traditionnelle. Frank analyse cela comme une forme de critique culturelle devenue outil marketing.
- "four. Three Rebels: Advertising Narratives of the Sixties"
Trois figures de la publicité – George Lois, Howard Gossage, et Jerry Della Femina – sont présentées comme des "rebelles" contre l’establishment publicitaire. Ils ont forgé un récit de rupture, incarnant un style provocateur, parfois satirique, et toujours éloigné du modèle corporate classique. Ces narrations internes à la profession ont renforcé l’idée d’une nouvelle ère créative, valorisant l’anticonformisme comme norme professionnelle.
- "five. “How Do We Break These Conformists of Their Conformity?”: Creativity Conquers All"
Ce chapitre détaille la montée de la "créativité" comme valeur suprême dans la publicité. Frank montre comment le monde publicitaire a intégré la rhétorique de la contestation, en faisant de l’innovation et de l’originalité des leviers commerciaux. Des slogans contre le conformisme sont devenus des outils de promotion. L’ironie : les appels à se "libérer" servaient à vendre des produits.
- "six. Think Young: Youth Culture and Creativity"
Comment les publicitaires ont récupéré l’imaginaire de la jeunesse pour en faire un moteur de consommation. La jeunesse devient une catégorie idéologique et esthétique : libre, rebelle, créative. Frank montre comment des campagnes ciblent ce public non seulement pour vendre des produits, mais aussi pour associer des marques à des valeurs d’audace et de renouvellement. Le slogan de Pepsi, “Think Young”, en est l’exemple emblématique : l’âge n’est plus biologique mais culturel.
- "seven. The Varieties of Hip: Advertisements of the 1960s"
De la pluralité des formes que prend la culture hip dans la publicité : du beatnik au bohème, du sarcastique au sincère. Les marques s’approprient les codes de la marginalité, de la créativité et du rejet des normes. Ces esthétiques "hip" servent à différencier les produits dans un marché saturé, tout en flattant le consommateur dans son individualisme. La publicité devient ainsi un miroir déformant de la contestation.
- "eight. Carnival and Cola: Hip versus Square in the Cola Wars"
Ce chapitre se concentre sur les campagnes concurrentes de Coca-Cola et Pepsi. Frank montre comment Pepsi adopte un discours "hip", orienté vers la jeunesse, la rupture et la créativité, tandis que Coca-Cola reste "square", traditionnel, universel, consensuel. Ces deux approches incarnent un clivage culturel plus large entre la modernité dynamique et la stabilité conservatrice. La publicité devient un théâtre idéologique, un carnaval où l’inversion des rôles est la règle.
- "nine. Fashion and Flexibility"
Ce chapitre examine l’impact des modes et des tendances sur la publicité. Frank décrit un système de consommation fondé sur le changement rapide, dans lequel le style devient un vecteur d’identité fluide. Il relie cela à la logique du capitalisme flexible : ce qui était autrefois vu comme "instable" (le goût, la nouveauté, la différence) devient désormais la norme. La publicité joue un rôle central dans cette dynamique en créant le désir de changement permanent.
- "ten. Hip and Obsolescence"
Frank approfondit ici le lien entre culture hip et obsolescence planifiée. Le "cool" n’est jamais stable : il se périme vite. En célébrant l’innovation constante, les valeurs hip alimentent une logique commerciale où le produit devient rapidement dépassé. L’obsession de l’originalité et de la nouveauté, loin de subvertir le capitalisme, en devient un rouage essentiel. Même les gestes de révolte sont prévus pour être remplacés.
- "eleven. Hip as Official Capitalist Style"
Le dernier chapitre développe la thèse centrale de l’ouvrage : la culture hip est devenue le style officiel du capitalisme avancé. Ce qui apparaissait comme critique ou subversif a été intégré au système économique. Frank démontre que la rhétorique de la rébellion, de l’authenticité et de l’anticonformisme alimente la machine marchande. L’entreprise moderne ne se présente plus comme autoritaire, mais comme ouverte, créative, jeune – c’est-à-dire fondamentalement "cool".
"the uses of hip
The changes in the worlds of advertising, fashion, and business in general during the sixties were a greater part of the cultural upheaval of the period than is customarily acknowledged. From the management theory of Douglas McGregor to the advertising-criticism of Bill Bernbach, leading businessmen made a deliberate attempt to smash the idealized but stagnant consensus of the postwar years, and one can trace the cultural trajectory that sixties historians describe with terms like “unraveling” and “coming apart.” But from the perspective of almost forty years, the efforts of American businessmen to break the brittle conventions of the fifties seems more like a first step in the creation of a new ideology of consuming, one we live with still. Not only does hip consumerism recognize the alienation, boredom, and disgust engendered by the demands of modern consumer society, but it makes of those sentiments powerful imperatives of brand loyalty and accelerated consumption.
It’s a circular cultural operation that works through a variety of media. Mark Crispin Miller finds it in television programming, functioning to prevent the very sort of viewer elusiveness so beloved of certain cultural theorists. According to Miller, the moments of carnivalesque and patriarchy-mocking that are so typical of contemporary television are less the concessions to popular resistance that some believe them to be and more an integral part of broadcast strategy. “TV preempts derision by itself evincing endless irony,” he writes.
Thus TV co-opts that smirking disbelief which so annoyed the business titans of the Thirties. . . . TV protects its ads from mockery by doing all the mocking, thereby posing as an ally to the incredulous spectator.
For Miller, television’s pseudo-subversiveness is an essential element of the way it works. Unlike the telescreens in 1984, which demand that people revere authority (and which made up the central symbol for one of the all-time greatest installments of commodified hip, the famous commercial that introduced the Macintosh as an implement of counterhegemonic empowerment in 1984), television gains their assent by mocking authority, leaving only itself. “TV would seem to be an essentially iconoclastic medium,” Miller notes; “and yet it is this inherent subversiveness toward any visible authority that has enabled TV to establish its own total rule—for it is all individuality that TV annihilates, either by not conveying it or by making it look ludicrous.” One can detect the first glimmerings of this strategy of preemptive irony, of advertising that works by mocking advertising convention, in the early Volkswagen advertisements that launched the creative revolution. And, as Miller observes, this strategy has proven particularly lucrative as countercultural participants became prime middle-aged consumers in their own right:
"Through such easy irony the generation that upset the Sixties now distracts itself with an illusion of exceptionalism; for it is that generation, or its wealthiest subgroup, that maintains the spectacle today, both as its authors and as its most esteemed consumers."
Les transformations des mondes de la publicité, de la mode et des affaires en général durant les années soixante ont constitué une part bien plus importante du bouleversement culturel de l'époque qu'on ne le reconnaît habituellement. De la théorie managériale de Douglas McGregor à la critique publicitaire de Bill Bernbach, les chefs d'entreprise ont délibérément tenté de briser le consensus idéalisé mais stagnant de l'après-guerre, et on peut y tracer la trajectoire culturelle que les historiens des années soixante décrivent avec des termes comme « effilochage » ou « dislocation ». Mais avec près de quarante ans de recul, les efforts des hommes d'affaires américains pour rompre avec les conventions rigides des années cinquante ressemblent davantage à une première étape dans la création d'une nouvelle idéologie de la consommation, avec laquelle nous vivons encore. Non seulement le consumérisme hip reconnaît l'aliénation, l'ennui et le dégoût engendrés par les exigences de la société de consommation moderne, mais il transforme ces sentiments en puissants impératifs de fidélité à la marque et d'accélération de la consommation.
C'est une opération culturelle circulaire qui fonctionne à travers divers médias. Mark Crispin Miller l'identifie dans la programmation télévisuelle, où elle sert à empêcher précisément le genre d'élusivité du spectateur tant prisée par certains théoriciens culturels. Selon Miller, les moments carnavalesques et moqueurs envers le patriarcat si typiques de la télévision contemporaine sont moins des concessions à une résistance populaire que certains y voient, et davantage une partie intégrante de la stratégie de diffusion. « La télévision prévient la dérision en manifestant elle-même une ironie sans fin », écrit-il.
Ainsi, la télévision récupère ce scepticisme narquois qui agaçait tant les magnats des affaires des années Trente... La télévision protège ses publicités de la moquerie en se chargeant elle-même de toute la moquerie, se posant ainsi en alliée du spectateur incrédule.
Pour Miller, la pseudo-subversion télévisuelle est un élément essentiel de son fonctionnement. Contrairement aux télécrans de *1984*, qui exigent que les gens vénèrent l'autorité (et qui ont constitué le symbole central de l'une des plus grandes manifestations de hip marchandisé de tous les temps : la célèbre publicité présentant le Macintosh en 1984 comme un outil d'émancipation contre-hégémonique), la télévision obtient l'assentiment du public en se moquant de l'autorité, ne laissant ainsi qu'elle-même. « La télévision semble être un média essentiellement iconoclaste », note Miller ; « et pourtant, c'est cette subversion inhérente envers toute autorité visible qui a permis à la télévision d'établir sa propre domination totale – car c'est toute individualité que la télévision annihile, soit en ne la transmettant pas, soit en la rendant ridicule. » On peut détecter les premières lueurs de cette stratégie d'ironie préemptive, de publicité qui fonctionne en se moquant des conventions publicitaires, dans les premières publicités Volkswagen qui ont lancé la révolution créative. Et, comme le constate Miller, cette stratégie s'est avérée particulièrement lucrative à mesure que les participants à la contre-culture devenaient eux-mêmes des consommateurs principaux d'âge moyen :
« Grâce à une telle ironie facile, la génération qui a bousculé les années Soixante se divertit désormais avec une illusion d'exceptionnalisme ; car c'est cette génération, ou son sous-groupe le plus aisé, qui entretient le spectacle aujourd'hui, à la fois en tant qu'auteurs et en tant que consommateurs les plus estimés. »
"But there is another, even more fundamental cultural rationale for business’s ongoing hunger for rebellion. In the battle between Warren Susman’s two “moral orders,” the ideology of hedonistic consumerism may have prevailed in certain public spaces, but its victory cannot alter the fact that portions of the earlier, more repressive system of values remain necessary to economic production. Daniel Bell finds in this a terrible “contradiction”: the workplace still demands the earlier values of diligence and sublimation, while as consumers we are taught the opposite virtues.
What this abandonment of Puritanism and the Protestant ethic does, of course, is to leave capitalism with no moral or transcendental ethic. It also emphasizes not only the disjunction between the norms of the culture and the norms of the social structure, but also an extraordinary contradiction within the social structure itself. On the one hand, the business corporation wants an individual to work hard, pursue a career, accept delayed gratification—to be, in the crude sense, an organization man. And yet, in its products and its advertisements, the corporation promotes pleasure, instant joy, relaxing and letting go.
But hip consumerism resolves the “contradiction,” at least symbolically. However we may rankle under the bureaucratized monotony of our productive lives, in our consuming lives we are no longer merely affluent, we are rebels. Efficiency may remain the values of daytime, but by night we rejoin the nonstop carnival of our consuming lives. As it turned out, the mass society critique was one with which American capitalism was singularly well prepared to deal—which is why it sometimes seems we will never be rid of it. Hip and square are now permanently locked together, like the images of Coke and Pepsi, in a self-perpetuating pageant of workplace deference and advertising outrage. Our celebrities are not just glamorous, they are insurrectionaries; our police and soldiers are not just good guys, they break the rules for a higher purpose. And through them and our imagined participation in whatever is the latest permutation of the rebel Pepsi Generation, we have not solved, but we have defused the problems of mass society. Impervious to criticism of any kind, and virtually without historical memory, hip has become what Norman Mailer predicted: the public philosophy of the age of flexible accumulation.
"Mais il existe une autre justification culturelle, plus fondamentale encore, à l'appétit constant des entreprises pour la rébellion. Dans la bataille entre les deux « ordres moraux » de Warren Susman, l'idéologie du consumérisme hédoniste a peut-être triomphé dans certains espaces publics, mais sa victoire ne peut masquer le fait que des pans du système de valeurs antérieur, plus répressif, demeurent nécessaires à la production économique. Daniel Bell y décèle une terrible « contradiction » : le lieu de travail exige encore les anciennes valeurs d'assiduité et de sublimation, tandis qu'en tant que consommateurs, on nous enseigne les vertus opposées.
Ce que cet abandon du puritanisme et de l'éthique protestante fait, bien sûr, c'est de priver le capitalisme de toute éthique morale ou transcendante. Cela souligne non seulement la disjonction entre les normes de la culture et les normes de la structure sociale, mais aussi une contradiction extraordinaire au sein même de la structure sociale. D'un côté, l'entreprise veut que l'individu travaille dur, poursuive une carrière, accepte la gratification différée – qu'il soit, au sens brut, un organization man. Et pourtant, dans ses produits et ses publicités, l'entreprise promeut le plaisir, la jouissance immédiate, la détente et le lâcher-prise.
Mais le consumérisme hip résout cette « contradiction », du moins symboliquement. Si accablante que puisse être la monotonie bureaucratique de nos vies productives, dans nos vies de consommateurs, nous ne sommes plus seulement aisés, nous sommes des rebelles. L'efficacité peut rester la valeur du jour, mais la nuit venue, nous retrouvons le carnaval permanent de nos vies consuméristes. Finalement, la critique de la société de masse était celle avec laquelle le capitalisme américain était singulièrement bien armé pour composer – ce qui explique pourquoi il semble parfois que nous ne nous en débarrasserons jamais. Hip et square (branché et ringard) sont désormais indissociables, comme les images de Coca et Pepsi, dans un spectacle autoperpétué de déférence au travail et de transgression publicitaire. Nos célébrités ne sont pas seulement glamour, ce sont des insurgés ; nos policiers et soldats ne sont pas seulement les gentils, ils enfreignent les règles pour une cause supérieure. Et à travers eux, ainsi que notre participation imaginaire à la dernière permutation en date de la Pepsi Generation rebelle, nous n'avons pas résolu, mais désamorcé les problèmes de la société de masse. Imperméable à toute critique, et quasiment sans mémoire historique, le hip est devenu ce que Norman Mailer avait prédit : la philosophie publique de l'ère de l'accumulation flexible.
"find your own historical consciousness
How dark things must have seemed on Madison Avenue back in 1992, with riots breaking out in Los Angeles, nasty wars flaring up all over the just-freed East Bloc, and some unpleasant new things called “class” and “poverty” giving the lie to the happy platitudes that had defined American consuming life throughout the eighties. How fervently the diviners of the American public mind must have wished for some new mass-cultural dispensation, some array of symbols and celebrities that would make them relevant again, that would reestablish their leadership in the great corporate race to stay forever hip. How they must have cursed the fates that had saddled them with such transparently fake frontmen as M. C. Hammer, Vanilla Ice, the New Kids on the Block, and Madonna.
And how they must have rejoiced when the leading minds of the culture industry announced the discovery of an all-new angry generation, the “Twenty-Somethings,” complete with a panoply of musical styles, hairdos, and verbal signifiers ready-made to rejuvenate advertising’s sagging credibility. Armed with quickly produced books and informative cover stories in Advertising Age, Business Week, U.S. News, and Newsweek, admen were eager to take on the inscrutable “Generation X.”
The strangest aspect of what followed wasn’t the immediate onslaught of even hipper advertising, but that the entire “Generation X” discourse repeated—almost mechanically and yet without betraying the slightest inkling that it was doing so—the discussions of youth culture that had appeared in Advertising Age, Madison Avenue, and on all those youth-market panel discussions back in the sixties. The boomers had been said to be extraordinarily cynical and savvy about advertising, impervious to the blunt techniques of the fifties and responsive only to clever pitches that shared their skepticism about mass society: so was Generation X. “Traditional advertising sometimes does not work with twentysomethings,” runs a profile of a Gen X advertising agency in the New York Times. “Excessive exposure to glad handing salesmanship early in life, the theory goes, has made them less susceptible.”14 Business Week concurs. “They are very savvy consumers. . . . far more knowledgeable about and suspicious of advertising than earlier generations passing through their twenties.” “They are media savvy but are said to feel alienated from the mainstream culture,” agrees Advertising Age.15 As it turns out, the consequences this time around are said to be exactly what they were in the sixties. Exactly like the boomers, the “X-ers” are said to respond well to “honest” advertising. “Honesty policy,” explains Business Week:
"Buster cynicism about blatant product pitches has . . . shaped Nike, Inc.’s marketing. Says [the] global marketing manager for the footwear maker’s women’s division: “That’s one of the reasons we decided to be as honest as possible. . . .”
Even the old self-mocking ads of the 1960s were given a new lease on life by the supposed tastes of the “baby busters.”
Busters respond best to messages that take a self-mocking tone. What works, says market researcher Judith Langer, is “advertising that is funny and hip and says, ‘Hey, we know.’”
Most important of all, the twenty-somethings really go for “irreverence.”
Recent TV ads for the Isuzu Rodeo off-road vehicle tap into busters’ feelings of rebellion. One begins with a little girl in a classroom being urged by her teacher to color only between the lines. In the next shot, she’s a twentysomething who abandons the traffic lanes and roars off the highway onto a dirt road.
As the discovery of the rule-breaking boomers merely cemented the victory of the creative revolution, so the discovery of their rebel successors in the 1990s has breathed new life (and new imagery) into the basic wisdom established during those years: hip is the cultural life-blood of the consumer society.
"« Trouvez votre propre conscience historique »
Comme les choses ont dû sembler sombres sur Madison Avenue en 1992 : des émeutes éclataient à Los Angeles, de sales guerres embrasaient le tout juste libéré Bloc de l'Est, et de nouvelles notions déplaisantes appelées « classe » et « pauvreté » démentaient les platitudes heureuses qui avaient défini la vie consumériste américaine tout au long des années quatre-vingt. Avec quelle ferveur les devins de l'esprit public américain ont dû souhaiter une nouvelle dispensation mass culturelle, un éventail de symboles et de célébrités qui les rendraient à nouveau pertinents, qui rétabliraient leur leadership dans la grande course corporative pour rester éternellement hip. Comme ils ont dû maudire le destin qui les avait encombrés de porte-parole aussi transparents que M. C. Hammer, Vanilla Ice, les New Kids on the Block et Madonna.
Et comme ils ont dû se réjouir lorsque les cerveaux de l'industrie culturelle annoncèrent la découverte d'une toute nouvelle génération en colère, les « Vingtenaires » (Twenty-Somethings), dotée d'un attirail complet de styles musicaux, de coiffures et de signifiants verbaux prêts à l'emploi pour redonner de la crédibilité à une publicité en perte de vitesse. Armés de livres produits à la hâte et de dossiers de couverture instructifs dans Advertising Age, Business Week, U.S. News et Newsweek, les publicitaires étaient impatients de s'attaquer à l'insondable « Génération X ».
L'aspect le plus étrange de ce qui suivit ne fut pas l'assaut immédiat d'une publicité encore plus hip, mais que tout le discours sur la « Génération X » répéta - presque mécaniquement et pourtant sans trahir le moindre soupçon qu'il le faisait - les discussions sur la culture jeune qui étaient apparues dans Advertising Age, sur Madison Avenue et dans toutes ces tables rondes sur le marché des jeunes dans les années soixante. On disait des baby-boomers qu'ils étaient extraordinairement cyniques et avertis en matière de publicité, imperméables aux techniques brutales des années cinquante et réceptifs uniquement aux accroches intelligentes qui partageaient leur scepticisme envers la société de masse : il en allait de même pour la Génération X. « La publicité traditionnelle fonctionne parfois mal avec les vingtenaires », indique un portrait d'une agence de pub Gen X dans le New York Times. « L'exposition excessive au matraquage commercial dès leur plus jeune âge, selon la théorie, les a rendus moins sensibles. »¹⁴ Business Week abonde : « Ce sont des consommateurs très avisés... bien plus informés et méfiants envers la publicité que les générations précédentes au même âge. » « Ils sont calés en médias mais on dit qu'ils se sentent aliénés de la culture dominante », renchérit Advertising Age.¹⁵ Il s'avère que les conséquences cette fois-ci sont décrites comme étant exactement les mêmes que dans les années soixante. Exactement comme les boomers, on dit que les « X-ers » réagissent bien à une publicité « honnête ». « Politique d'honnêteté », explique Business Week :
« Le cynisme des Busters [Génération X] envers les arguments produits flagrants... a façonné le marketing de Nike, Inc. [Le] directeur marketing mondial de la division féminine du fabricant de chaussures déclare : "C’est une des raisons pour lesquelles nous avons décidé d’être aussi honnêtes que possible..." »
Même les vieilles publicités auto-dérisoires des années 1960 ont été relancées par les goûts supposés des « baby busters » [autre nom de la Génération X].
« Les Busters répondent mieux aux messages qui adoptent un ton auto-dérisoire. Ce qui fonctionne, explique la chercheuse en marketing Judith Langer, c’est "une publicité drôle et hip qui dit : ‘Hé, on est au courant.’" »
Surtout, les vingtenaires adorent vraiment « l'irrévérence ».
« Des pubs TV récentes pour le véhicule tout-terrain Isuzu Rodeo exploitent le sentiment de rébellion des Busters. L’une commence par une petite fille en classe que son professeur exhorte à ne colorier qu’entre les lignes. Dans le plan suivant, c’est une vingtenaire qui abandonne les voies de circulation et fonce hors de l’autoroute sur un chemin de terre. »
Tout comme la découverte des boomers briseurs de règles n'avait fait que sceller la victoire de la révolution créative, la découverte de leurs successeurs rebelles dans les années 1990 a insufflé une nouvelle vie (et de nouvelles images) à la sagesse fondamentale établie durant ces années : le hip est le sang culturel de la société de consommation.
"Business seems to find whatever it chooses to find in youth culture, and any creative lifestyle reporter can think of a dozen pseudo-historical platitudes to rationalize whatever identity they are seeking to pin on the demographic at hand. What’s strange is that business always seems to want to discover the same thing. Regardless of its objective “content,” and regardless of whether it even exists, rebel youth culture will always be found to fit the same profile, will always be understood as an updating of the 1960s original. Its look and sound must continually vary, but its cultural task does not change. No matter what the kids are actually doing, youth culture as we see it in ads, television, and mass circulation magazines is always a flamboyant affirmation of the core tenets of hip consumerism. Regardless of whatever else the newest “generation” is believed to portend, it is always roughly synonymous with that human faculty known as “skepticism”; it is always described as hostile to mass culture, as a foreign, alien group not as easily convinced as others have been, as a standing challenge to marketers who believe, like Rosser Reeves, in repetition and continuity. The fact of “generations,” then, always requires the business response of “credibility,” which almost always turns out to be a question of hip. And hips, by no coincidence, is a faculty only enjoyed by “creative” businessmen.
The sixties are more than merely the homeland of hip, they are a commercial template for our times, a historical prototype for the construction of cultural machines that transform alienation and despair into consent. Co-optation is something much more complex than the struggle back and forth between capital and youth revolution; it’s also something larger than a mere question of demographics and exploitation. Every few years, it seems, the cycles of the sixties repeat themselves on a smaller scale, with new rebel youth cultures bubbling their way to a happy replenishing of the various culture industries’ depleted arsenal of cool. New generations obsolete the old, new celebrities render old ones ridiculous, and on and on in an ever-ascending spiral of hip upon hip. As adman Merle Steir wrote back in 1967, “Youth has won. Youth must always win. The new naturally replaces the old.” And we will have new generations of youth rebellion as certainly as we will have new generations of mufflers or toothpaste or footwear."
"Les entreprises semblent trouver dans la culture jeune tout ce qu’elles décident d’y trouver, et n’importe quel journaliste lifestyle un peu créatif peut aligner une douzaine de platitudes pseudo-historiques pour justifier l’identité qu’on cherche à coller à la génération du moment. Ce qui est étrange, c’est que le monde des affaires semble toujours vouloir y découvrir la même chose. Quels que soient son « contenu » objectif, et même son existence réelle, la culture jeune rebelle sera toujours présentée comme correspondant au même profil, toujours comprise comme une mise à jour du modèle originel des années 1960. Son apparence et son son doivent varier sans cesse, mais sa mission culturelle, elle, ne change pas. Peu importe ce que font réellement les jeunes, la culture jeune telle qu’on la voit dans les pubs, à la télé ou les magazines grand public est toujours une affirmation flamboyante des principes fondamentaux du consumérisme hip. Quelle que soit la signification qu’on prête à la nouvelle « génération », elle est toujours à peu près synonyme de cette faculté humaine appelée « scepticisme » ; elle est toujours décrite comme hostile à la culture de masse, comme un groupe étranger, aliéné, moins facile à convaincre que ses prédécesseurs, comme un défi permanent pour les marketeurs qui croient, comme Rosser Reeves, à la répétition et à la continuité. Le fait des « générations » exige donc toujours la réponse commerciale de la « crédibilité », qui se révèle presque toujours être une question de hip. Et le hip, ce n’est pas un hasard, est une faculté que seuls les hommes d’affaires « créatifs » possèdent.
Les années soixante sont plus que le simple berceau du hip : elles sont un modèle commercial pour notre époque, un prototype historique pour la construction de machines culturelles qui transforment l’aliénation et le désespoir en consentement. La récupération (co-optation) est bien plus complexe qu’une simple lutte entre le capital et la révolution juvénile ; c’est aussi plus vaste qu’une simple question de démographie et d’exploitation. Tous les quelques années, semble-t-il, le cycle des sixties se répète à plus petite échelle, avec de nouvelles cultures jeunes rebelles qui remontent à la surface pour reconstituer joyeusement l’arsenal épuisé de cool des diverses industries culturelles. Les nouvelles générations rendent les anciennes obsolètes, les nouvelles célébrités ridiculisent les anciennes, et ainsi de suite dans une spirale ascendante de hip sur hip. Comme l’écrivait déjà le publicitaire Merle Steir en 1967 : « La jeunesse a gagné. La jeunesse doit toujours gagner. Le nouveau remplace naturellement l’ancien. » Et nous aurons de nouvelles générations de rébellion juvénile aussi sûrement que nous aurons de nouvelles générations de pots d’échappement, de dentifrice ou de chaussures."
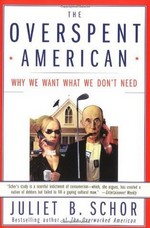
Juliet Schor, "The Overspent American: Why We Want What We Don’t Need" (1998)
Schor montre que le consumérisme n’est pas seulement économique, mais social, symbolique et identitaire.
En articulant des références à Veblen, Bourdieu, et Simmel, elle propose une analyse structurée du désir mimétique et de la logique de distinction.
Comment les normes de consommation s’imposent par comparaison sociale. Là où Cross met l’accent sur la fonction symbolique et intégratrice de la consommation, Schor souligne sa toxicité sociale, stress, isolement, précarité, un cycle anxiogène de consommation fondé sur l’illusion de statut. Les Américains ne consomment pas rationnellement, mais pour suivre des standards sociaux inatteignables, alimentés par les médias. Un diagnostic qui conduit à dénoncer la spirale du surendettement, notamment dans la classe moyenne.
- "Introduction"
Schor pose le cadre général de son analyse : malgré une croissance économique importante dans les années 1980-1990, les Américains ressentent un manque constant de moyens. Elle introduit le concept de "new consumerism", qui associe des aspirations de plus en plus élevées à une pression sociale accrue pour démontrer son statut par la consommation. Ce phénomène entraîne un déséquilibre entre les revenus réels et les attentes de style de vie, poussant à l’endettement et à la surconsommation.
- "Communicating with Commodities: How What We Buy Speaks Volumes"
Du pouvoir symbolique des objets de consommation. Les biens ne sont pas seulement fonctionnels : ils communiquent l'identité, le statut, les valeurs. S'appuyant sur la théorie des signes (Veblen, Bourdieu), elle montre comment les individus utilisent les biens pour "parler" à travers leur apparence, leurs possessions, leurs loisirs. La consommation devient un langage social – codé, hiérarchisé – dans lequel se jouent inclusion, distinction, et aspiration.
- "The Visible Lifestyle: American Symbols of Status"
Schor analyse ici les indicateurs de statut aux États-Unis. Contrairement à l’idée que les Américains seraient détachés des hiérarchies visibles, elle montre une obsession croissante pour les signes extérieurs de réussite : type de voiture, quartier, marque de vêtements, voyages, éducation des enfants. Elle met en lumière une transformation : le modèle de comparaison n’est plus son cercle social immédiat (voisins, collègues), mais les classes supérieures visibles dans les médias, exacerbant les écarts perçus.
- "When Spending Becomes You"
Ce chapitre décrit le phénomène par lequel la consommation devient indissociable de l’identité personnelle. Schor observe que les individus se définissent de plus en plus à travers ce qu’ils achètent. La frontière entre être et avoir se brouille. L’investissement émotionnel dans les marques, les styles de vie, les expériences (restaurants, technologies, éducation) reflète une quête existentielle autant que matérielle. Le "self" devient un projet de consommation continue.
"The most striking feature of household spending in modern America is its sheer volume. The typical middle- to upper-middle-class household occupies more than two thousand square feet of floor space, owns at least two cars, a couple of couches, numerous chairs, beds, and tables, a washer and dryer, more than two televisions, a VCR, and has cable. The kitchen contains a conventional oven, a microwave, a frost-free refrigerator, a blender, a coffee maker, a tea kettle, a food processor, and so many pots, pans, dishes, cups and
glasses, storage containers, kitchen utensils, and pieces of flatware that they aren't even counted. Elsewhere in the house are a personal computer and printer, telephones, an answering machine, a calculator, a stereo or CD player, musical instruments, and many pieces of art —in addition to paintings and reproductions, there are decorative items such as vases, plates, and statuettes, photographs in frames, and knickknacks. In the bathroom are a hair dryer, a scale, perhaps an electric toothbrush or shaver, and cabinets overflowing with towels, shampoos, conditioners, face creams, and other cosmetics. The closets are stuffed with clothes and shoes of all types: dresses, suits, pants, shirts, sweaters, coats, hats, boots, sneakers, flats, pumps, walking shoes, patent leathers, and loafers. And don't forget the jewelry. In addition to watches, the diamond ring, and other high-value items, there's usually a large collection of costume jewelry: bead necklaces, bracelets, and earrings, earrings, earrings. The family room is filled with books, videos, tapes, CDs, magazines, and more photos and knickknacks. The floors are covered with rugs or carpet, and throughout the house are scattered other pieces of furniture, accented perhaps with dried or silk flowers. Stored in the garage or basement is all the sports equipment, such as bicycles and skis, as well as luggage and totes, lawn and garden tools, and broken appliances. (Some developers now routinely build three-car garages —two spaces for the cars, one for the junk.) In addition to all these durable products (of which this is a very incomplete inventory), households spend heavily on services such as child care, movies, restaurants and bars, hotel stays, airplane trips, haircuts, massages, visits to Disney World, lawyer bills, insurance premiums, interest payments, and, sometimes, rental on the storage space where even more stuff resides.
If you are a typical American consumer, you did not always have so much. There was probably a time in your adult life when you could fit everything you owned into your car and drive off into the sunset. Now you need professionals to transport your possessions. You spend hundreds, perhaps thousands of dollars a year to insure or protect them. As you survey your material landscape, you may wonder how this state of affairs came to be. You certainly didn't intend to imitate those medieval armies that became sitting ducks
—unable to move on account of the creature comforts they started lugging around. Each purchase made sense at the time. Many were truly necessary. Some were captivating, giving you that "I just have to have this" feeling. But added together; they raise the possibiUty that yours is a lifestyle of excess.
Howdoes it happen? And so quickly? To understand how your possessions came to fill a full-size moving van, or why you never seem to have enough closet space, we need to begin with the acquisition process. The sequence of events starts with a social act —being exposed to consumer goods. It proceeds through the mental stages of fantasizing, wishing, and rationalizing. Borrowing may be the next step before the process culminates with a purchase. See, want, borrow, buy."
" Le foyer moyen de la classe moyenne à supérieure occupe plus de deux cents mètres carrés, possède au moins deux voitures, deux canapés, de nombreuses chaises, lits et tables, une machine à laver et un sèche-linge, plus de deux téléviseurs, un magnétoscope, et est abonné au câble. La cuisine contient un four traditionnel, un micro-ondes, un réfrigérateur sans givre, un mixeur, une machine à café, une bouilloire, un robot culinaire, et tellement de casseroles, poêles, assiettes, tasses, verres, boîtes de rangement, ustensiles de cuisine et couverts qu'on ne les compte même plus. Ailleurs dans la maison se trouvent un ordinateur personnel et une imprimante, des téléphones, un répondeur, une calculatrice, une chaîne stéréo ou un lecteur CD, des instruments de musique, et de nombreuses œuvres d'art — en plus des peintures et reproductions, il y a des objets décoratifs comme des vases, des assiettes et des statuettes, des photos encadrées et des bibelots. Dans la salle de bain, il y a un sèche-cheveux, une balance, peut-être une brosse à dents électrique ou un rasoir, et des placards qui débordent de serviettes, shampoings, après-shampoings, crèmes pour le visage et autres cosmétiques. Les placards sont remplis à craquer de vêtements et chaussures de toutes sortes : robes, costumes, pantalons, chemises, pulls, manteaux, chapeaux, bottes, baskets, ballerines, escarpins, chaussures de marche, cuirs vernis et mocassins. Et n'oublions pas les bijoux. En plus des montres, de la bague en diamant et d'autres articles de valeur, il y a généralement une grande collection de bijoux fantaisie : colliers de perles, bracelets, et des boucles d'oreilles, encore des boucles d'oreilles. La salle familiale est remplie de livres, vidéos, cassettes, CD, magazines, et encore plus de photos et de bibelots. Les sols sont couverts de tapis ou de moquette, et dans toute la maison sont disséminés d'autres meubles, agrémentés peut-être de fleurs séchées ou en soie. Rangés dans le garage ou la cave se trouve tout le matériel de sport, comme les vélos et les skis, ainsi que des valises et sacs, des outils de jardinage et de pelouse, et des appareils électroménagers en panne. (Certains promoteurs construisent désormais systématiquement des garages triple — deux places pour les voitures, une pour les bricoles.) En plus de tous ces biens durables (dont ceci est un inventaire très incomplet), les ménages dépensent massivement en services tels que la garde d'enfants, les films, les restaurants et bars, les séjours à l'hôtel, les voyages en avion, les coupes de cheveux, les massages, les visites à Disney World, les factures d'avocat, les primes d'assurance, les intérêts d'emprunt et, parfois, le loyer d'un box de stockage où réside encore plus d'objets.
Si vous êtes un consommateur américain typique, vous n'avez pas toujours eu autant. Il y a probablement eu une période dans votre vie adulte où tout ce que vous possédiez tenait dans votre voiture et vous pouviez partir vers de nouveaux horizons. Désormais, vous avez besoin de professionnels pour transporter vos possessions. Vous dépensez des centaines, voire des milliers de dollars par an pour les assurer ou les protéger. En contemplant votre paysage matériel, vous vous demandez peut-être comment cet état de fait a pu se produire. Vous n'aviez certainement pas l'intention d'imiter ces armées médiévales qui devenaient des cibles faciles — incapables de se déplacer à cause du confort qu'elles avaient commencé à trimballer. Chaque achat avait du sens sur le moment. Beaucoup étaient véritablement nécessaires. D'autres étaient irrésistibles, vous donnant ce sentiment de "il faut absolument que je l'ai". Mais additionnés ensemble, ils soulèvent la possibilité que votre mode de vie soit un mode de vie d'excès.
Comment cela arrive-t-il ? Et si rapidement ? Pour comprendre comment vos biens en sont venus à remplir un camion de déménagement, ou pourquoi vous n'avez jamais assez de place dans vos placards, nous devons commencer par le processus d'acquisition. La séquence d'événements commence par un acte social — être exposé aux biens de consommation. Elle se poursuit à travers les étapes mentales que sont la fantaisie, le désir et la rationalisation. L'emprunt peut être l'étape suivante avant que le processus ne culmine avec un achat. Voir, désirer, emprunter, acheter...."
- " The Downshifter Next Door"
Schor introduit ici la figure du "downshifter" : une personne qui choisit volontairement de réduire ses revenus et son niveau de consommation pour retrouver un équilibre personnel, familial ou écologique. Elle décrit différents profils – anciens cadres, familles surendettées, personnes engagées dans des causes sociales – et insiste sur les motivations : réduction du stress, recherche de sens, temps libre. Ce mouvement reste minoritaire, mais témoigne d’une critique implicite du consumérisme dominant.
Des auteurs comme Zygmunt Bauman ou David Harvey rappellent que les solutions individuelles au consumérisme sont souvent neutralisées par les structures sociales et les logiques systémiques du capitalisme.
- "Learning Diderot's Lesson: Stopping the Upward Creep of Desire"
Ce chapitre s’inspire du "paradoxe de Diderot" : l’achat d’un objet (ex. une robe neuve) peut entraîner une spirale de consommation pour que le reste du mode de vie s’y conforme. Schor examine cette logique dans le monde moderne : acquisition d’un bien entraînant le besoin d’en acheter d’autres pour maintenir une cohérence esthétique ou statutaire. Elle appelle à une prise de conscience de cette "escalade du désir" et propose des stratégies pour y résister.
- "Epilogue: Will Consuming Less Wreck the Economy?"
Dans cette conclusion, Schor aborde une objection fréquente : si les gens consomment moins, ne risquent-ils pas de provoquer une crise économique ? Elle répond en montrant que l’économie peut s’adapter à un modèle de croissance qualitative plutôt que quantitative. Elle imagine une économie plus lente, moins énergivore, orientée vers les services, la culture, le care, et les biens durables. Consommer moins, conclut-elle, peut être compatible avec la prospérité – mais cela nécessite un changement structurel.
Parmi les autres ouvrages importants de Juliet Schor, nous noterons,
- "The Overworked American: The Unexpected Decline of Leisure" (1992)
Analyse pionnière montrant que malgré les progrès technologiques, les Américains travaillent de plus en plus. Schor met en lumière l’érosion du temps libre et ses effets sur la santé, la famille, et le bonheur. Un Concept-clé : “work-and-spend cycle” – on travaille plus pour consommer plus, mais on perd en qualité de vie.
- "Born to Buy: The Commercialized Child and the New Consumer Culture" (2004)
Une étude sur le marketing ciblant les enfants. Schor démontre que les jeunes sont soumis à une pression consumériste précoce, qui affecte leur développement psychologique, leur santé et leurs valeurs.
- "Plenitude: The New Economics of True Wealth" (2010)
Schor propose une économie alternative fondée sur la soutenabilité, le "slow living", le travail autonome, l’agriculture urbaine et les réseaux d’échange non marchands.
Thèse centrale : vivre mieux avec moins est possible si l’on transforme nos rapports au temps, au travail, à l’argent et à la nature.
- "After the Gig: How the Sharing Economy Got Hijacked and How to Win It Back" (2020)
Une critique de l’"économie collaborative" (Uber, Airbnb, etc.). Schor démontre que sous un vernis communautaire et technologique, ces plateformes reproduisent les inégalités et l’exploitation. Elle plaide pour des alternatives coopératives et régulées.
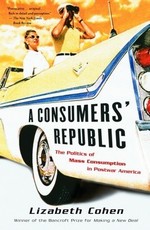
Lizabeth Cohen, "A Consumers’ Republic: The Politics of Mass Consumption in Postwar America" (2003)
Comment l’État a promu la consommation dans l’aménagement des banlieues et les lois.
Un ouvrage qui offre un cadre politico-institutionnel au phénomène que Cross décrit surtout culturellement. Historienne de formation, Cohen mobilise des archives gouvernementales, des publicités, des journaux, des documents d’urbanisme et des études de marché. pour analyser la transformation de la citoyenneté américaine après 1945 (être bon citoyen, c’est acheter une maison, des biens, et contribuer à l’économie) et montre que les politiques de logement, de transport et de crédit ont institutionnalisé le consumérisme.
Son analyse de la transformation spatiale (centres commerciaux, suburbs) est l’une des plus fines dans l’historiographie américaine. Elle montre que la topographie consumériste produit un affaiblissement de la citoyenneté participative et une montée de l’individualisme. Un ouvrage-clé pour comprendre les liens entre capitalisme, démocratie et société de consommation aux États-Unis au XXe siècle...
- Part One. THE ORIGINS OF THE POSTWAR CONSUMERS' REPUBLIC
1. DEPRESSION: Rise of the Citizen Consumer
Cohen examine l’émergence du “citizen consumer” pendant la Grande Dépression. Face à la crise, les politiques du New Deal tentent de restaurer la croissance par la consommation. L’idée se développe que consommer est un acte civique, renforçant l’économie nationale. Cohen montre comment des mouvements syndicaux, des organisations féminines et des groupes de consommateurs utilisent la consommation comme levier de mobilisation politique.
2. WAR: Citizen Consumers Do Battle on the Home Front
Durant la Seconde Guerre mondiale, les consommateurs sont appelés à soutenir l’effort de guerre à travers la modération, le rationnement, l’achat d’obligations, etc. Cohen montre que l’État fédéral institutionnalise l’idée de consommation patriotique. Le "citizen consumer" devient une figure centrale : consommer de manière responsable, c’est soutenir la démocratie. Cette mobilisation crée un précédent pour la consommation comme fondement de l’ordre civique d’après-guerre.
- Part Two. THE BIRTH OF THE CONSUMERS' REPUBLIC
3. RECONVERSION: The Emergence of the Consumers' Republic
Dans l’après-guerre, Cohen décrit la transition d’une économie de guerre vers une économie de marché, marquée par la montée d’une idéologie de consommation de masse comme moteur de prospérité démocratique. Le gouvernement, les entreprises et les associations de consommateurs convergent autour d’un consensus : consommer, c’est construire la démocratie américaine. Elle appelle cette période la naissance d’une “Consumers’ Republic”, dans laquelle l’expansion du marché remplace les revendications d’égalité sociale directe.
4. REBELLION: Forcing Open the Doors of Public Accommodations
Ce chapitre montre comment la logique de consommation devient un outil de lutte pour les droits civiques, notamment dans les années 1950-60. Les Afro-Américains contestent l’exclusion raciale dans les espaces publics commerciaux (restaurants, hôtels, magasins). Le droit à consommer sur un pied d’égalité devient un enjeu de justice. Les campagnes de boycott et les sit-ins révèlent que l’accès à la consommation est un champ de bataille pour la citoyenneté pleine.
- Part Three. THE LANDSCAPE OF MASS CONSUMPTION
5. RESIDENCE: Inequality in Mass Suburbia
Cohen analyse ici la suburbanisation, symbole de la Consumers’ Republic. Mais elle montre que cette consommation résidentielle produit de profondes inégalités raciales et sociales : l’accès au logement est restreint par des politiques discriminatoires (redlining, FHA, GI Bill). Les banlieues blanches deviennent des bastions d’exclusion, où la propriété privée est érigée en valeur civique. La consommation d’espace devient un mécanisme de ségrégation.
6. COMMERCE: Reconfiguring Community Marketplaces
Ce chapitre décrit la transformation des lieux de commerce : centres commerciaux, supermarchés, chaînes de magasins remplacent les centres-villes et les marchés communautaires. Cohen montre que ce changement spatial et architectural a des conséquences sociales majeures : l’individu remplace le citoyen, le quartier devient un marché, et la participation civique décline. Le commerce devient un espace apolitique, consumériste, privatisé.
- Part Four. - THE POLITICAL CULTURE OF MASS CONSUMPTION
7. CULTURE: Segmenting the Mass
Avec la montée des médias et du marketing, les consommateurs sont segmentés par âge, genre, race, style de vie. Cohen montre que la culture de masse se fragmente en niches, avec des produits ciblés pour chaque groupe. Cette segmentation crée une illusion de diversité, mais renforce aussi les stéréotypes. Le citoyen-consommateur devient un "targeted consumer", fragmenté, isolé, difficile à mobiliser collectivement.
8. POLITICS: Purchasers Politicized
Cohen conclut en montrant que la consommation peut redevenir un levier politique. Dans les années 1970-80, boycotts, campagnes éthiques, consommation responsable deviennent des formes de participation. Mais ces mouvements restent souvent limités par les logiques du marché. Elle suggère qu’il est temps de repolitiser la consommation, en retrouvant les idéaux du “citizen consumer” des années 1930-40, capables d’allier justice sociale et démocratie économique.
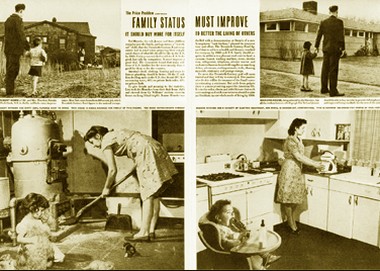
"When readers opened up the May 5, 1947, issue of Life magazine, they beheld what was fast becoming the prevailing answer to the question “reconversion to what?” In a classic Life photo-essay— the magazine's distinctive style of using the lives of ordinary Americans to explore complex contemporary phenomena—readers observed the Hemeke family's adjustment to the postwar era. Entitled “Family Status Must Improve: It Should Buy More for Itself to Better the Living of Others,” the story followed Ted and Jeanne Hemeke and their three children from their old, run-down house, where Ted arrived home in the clothes of a workingman and Jeanne struggled with the “dirty coal furnace” in the kitchen, to their symbolic entry into the new postwar order when they visited a modern ranch-style home that they—and the magazine's editors—clearly wished they could buy. In this imagined new life, Ted wore the middle-class badge of a suit, the children were fashionably dressed, and Jeanne approvingly surveyed a kitchen stocked with shiny new appliances. In the accompanying text, Life's editors asserted that realizing this fantasy would benefit more than the Hemeke family. Citing a Twentieth Century Fund projection for the economy in 1960, Life argued that “a health and decency standard for everyone” required that every American family acquire not only a “pleasant roof over its head” but all kinds of consumer goods to put in it, ranging from a washing machine and a telephone to matching dishes and silverware. As each family refurbished its hearth after a decade and a half of depression and war, the expanded consumer demand would stoke the fires of production, creating new jobs and, in turn, new markets. Mass consumption in postwar America would not be a personal indulgence, but rather a civic responsibility designed to provide “full employment and improved living standards for the rest of the nation.”
Overleaf: In “Family Utopia,” Life magazine's editors presented “an honest representation of the dream of most U.S. families,” based on consumer surveys and retail orders. With this feature, Life endorsed the increasingly common view that the health of the postwar economy would depend on Americans aspiring to own more commodities, here a suburban home, a convertible car, an electric stove, a washing machine, a television, and even a personal helicopter. Life, November 25, 1946. (Courtesy of Bernard Hoffman/TimePix)
« Lorsque les lecteurs ouvrirent le numéro du 5 mai 1947 du magazine Life, ils découvrirent ce qui devenait rapidement la réponse dominante à la question “reconversion vers quoi ?”. Dans un reportage photo emblématique de Life — le style distinctif du magazine consistant à utiliser la vie d'Américains ordinaires pour explorer des phénomènes contemporains complexes — les lecteurs observèrent l'adaptation de la famille Hemeke à l'après-guerre. Intitulé “Le statut familial doit s’améliorer : il faut acheter plus pour soi afin d’améliorer la vie des autres”, l'article suivait Ted et Jeanne Hemeke ainsi que leurs trois enfants, depuis leur vieille maison délabrée où Ted rentrait vêtu en ouvrier et Jeanne luttait contre le “sale poêle à charbon” de la cuisine, jusqu’à leur entrée symbolique dans le nouvel ordre post-guerre lors de leur visite d’une maison moderne de style ranch qu’eux — et les rédacteurs du magazine — désiraient clairement acquérir. Dans cette vie nouvelle imaginée, Ted arborait le costume emblématique de la classe moyenne, les enfants étaient habillés avec élégance, et Jeanne contemplait avec approbation une cuisine équipée d’appareils électroménagers flambant neufs. Dans le texte d'accompagnement, les rédacteurs de Life affirmaient que la réalisation de ce rêve profiterait à plus que la seule famille Hemeke. Citant une projection du Twentieth Century Fund pour l’économie de 1960, Life soutenait que “un niveau de vie décent pour tous” exigeait que chaque famille américaine acquière non seulement “un toit agréable” mais aussi toutes sortes de biens de consommation pour le meubler, allant d’une machine à laver et d’un téléphone à de la vaisselle et des couverts assortis. Tandis que chaque famille réaménagerait son foyer après quinze années de dépression et de guerre, cette demande accrue des consommateurs attiserait les feux de la production, créant de nouveaux emplois et, par ricochet, de nouveaux marchés. La consommation de masse dans l’Amérique d’après-guerre ne serait pas un plaisir égoïste, mais une responsabilité civique destinée à assurer “le plein emploi et l’amélioration du niveau de vie pour le reste de la nation.”
Page suivante : Dans “L’utopie familiale”, les rédacteurs de Life présentèrent “une représentation fidèle du rêve de la plupart des familles américaines”, basée sur des enquêtes de consommation et des commandes de détaillants. Par ce reportage, Life soutenait la vision de plus en plus répandue selon laquelle la santé de l’économie d’après-guerre dépendrait de l’aspiration des Américains à posséder davantage de biens : ici une maison de banlieue, une voiture décapotable, une cuisinière électrique, une machine à laver, une télévision, et même un hélicoptère personnel. Life, 25 novembre 1946. (Avec l’aimable autorisation de Bernard Hoffman/TimePix)
"If couples like Ted and Jeanne Hemeke purchased a new home and new consumer durables to put in it, a study sponsored by the Twentieth Century Fund predicted, they would not only improve their own lives but also make possible a higher standard of living for all Americans. Life, May 5, 1947. (Left, courtesy of Werner Wolff/Blackstar/TimePix; right, courtesy of Albert Fenn/TimePix; text courtesy of Time)
Life's concern with “everyone” and “the rest of the nation” bespoke a commonly held conviction that the revved-up engine of mass consumption promised to fulfill the long-sought goal of delivering an adequate standard of living to all Americans. Another summary of the 875-page Twentieth Century Fund report prepared specifically for merchandisers of electrical products confirmed that equality of condition was anticipated by arguing for its potential to expand markets: “Shifts in the distribution of income will be even more important, from a marketing standpoint, than the general increase in over-all consumer income.”2 Reconversion after World War II raised the hopes of Americans of many political persuasions and social statuses that a more prosperous and equitable American society would finally be possible in the mid-twentieth century due to the enormous, and war-proven, capacities of mass production and mass consumption. The new growth economy of the Consumers' Republic promised more affluence to a greater number of Americans than ever before..."
Si des couples comme Ted et Jeanne Hemeke achetaient une nouvelle maison et des biens de consommation durables pour la meubler, une étude parrainée par le Twentieth Century Fund prédisait qu’ils amélioreraient non seulement leur propre vie, mais rendraient possible un niveau de vie plus élevé pour tous les Américains. Life, 5 mai 1947. (À gauche, avec l’aimable autorisation de Werner Wolff/Blackstar/TimePix ; à droite, avec l’aimable autorisation d’Albert Fenn/TimePix ; texte avec l’aimable autorisation de Time)
La préoccupation de Life pour “tous” et “le reste de la nation” reflétait une conviction largement partagée : le moteur suralimenté de la consommation de masse promettait d’atteindre l’objectif tant recherché d’offrir un niveau de vie décent à tous les Américains¹. Un autre résumé du rapport de 875 pages du Twentieth Century Fund, préparé spécialement pour les marchands de produits électriques, confirmait cette attente d’égalité des conditions en invoquant son potentiel d’élargissement des marchés : “Les changements dans la répartition des revenus seront encore plus importants, d’un point de vue commercial, que l’augmentation générale du revenu global des consommateurs”². La reconversion après la Seconde Guerre mondiale nourrit l’espoir — chez les Américains de toutes sensibilités politiques et statuts sociaux — qu’une société américaine plus prospère et plus équitable serait enfin possible au milieu du XXe siècle, grâce aux capacités immenses (et éprouvées par la guerre) de la production et de la consommation de masse. La nouvelle économie de croissance de la République des consommateurs promettait une prospérité élargie à un plus grand nombre d’Américains que jamais auparavant. »
(...)
Un Concept puissant et original : "Consumers’ Republic" ...
Cohen introduit un concept structurant pour penser les États-Unis de l’après-guerre : une société où la consommation devient la base supposée de la citoyenneté, de la croissance économique, et de la cohésion nationale. Ce cadre d’analyse lui permet de relier histoire politique, économie et culture dans une synthèse cohérente.
Mais laissant entendre que la “Consumers’ Republic” est un projet qui s’effondre ou se fragilise dans les années 1980, on pourrait au contraire considérer que la logique consumériste se radicalise sous une autre forme, par la financiarisation, l’explosion des inégalités, ou l’essor de la consommation numérique.
L'auteur nous montre d'autre part que cette "république des consommateurs" est profondément inégalitaire : exclusion raciale dans l’accès au logement, segmentation commerciale, disparités d’accès à l’espace public. L’universalité affichée de la consommation masque des barrières structurelles. Mais si elle sait intégrer la question raciale, certains critiques (ex. Michael Dawson ou Keeanga-Yamahtta Taylor) estiment qu’elle ne donne pas assez de place aux expériences spécifiques des classes populaires noires et latino-américaines, souvent confrontées à d’autres logiques de consommation (économie informelle, crédit communautaire, etc.).

William Leach,"Land of Desire: Merchants, Power, and the Rise of a New American Culture" (1993)
Naissance de l’idéologie consumériste (1880–1920) - Un ouvrage qui complète celui de Cross en éclairant les racines culturelles et esthétiques du consumérisme, antérieures à celles que celui-ci avait abordé. Il étudie notamment la montée de la culture de la vitrine, du design et du luxe à la fin du XIXe siècle, le rôle des grands magasins, des musées et expositions dans la création d’un imaginaire consumériste.
La Thèse centrale : la consommation de masse n’a pas émergé "naturellement", mais a été activement construite par les marchands, les designers et les publicitaires comme un système idéologique, destiné à modeler les désirs, les valeurs, et l’identité américaine.
Leach s’inscrit dans une tradition critique proche de celle de Thorstein Veblen et de C. Wright Mills. Son originalité : montrer comment les désirs ont été fabriqués plutôt que simplement satisfaits.
Le capitalisme consumériste qui a émergé entre 1890 et 1930, a transformé en profondeur la culture américaine. Il s'agit non seulement d'une mutation économique, mais surtout d’un changement de civilisation. L’univers des désirs matériels devient la norme du progrès. Leach oppose ce système à une tradition républicaine antérieure, fondée sur la frugalité, l’éthique protestante, et la citoyenneté. L’essor du grand magasin, de la publicité, de l'étalage, de la psychologie du consommateur, de la mode et de la lumière artificielle dessine une véritable "culture de la marchandise".
« Préface — La société de consommation américaine moderne n’a pas manqué d’historiens, et une grande partie de leurs travaux récents s’est avérée utile et instructive ; sans eux, en fait, "Land of Desire" (« Terre du Désir ») n’aurait pu être écrit. Cependant, dans le même temps, la plupart des nouvelles publications ont soit si violemment condamné la société de consommation qu'elles rendent incompréhensible son émergence même, soit tellement loué et affirmé celle-ci qu'elles suggèrent que seuls des imbéciles, des puritains ou des masochistes auraient pu y résister ou y trouver à redire.
Aujourd'hui, la tendance est largement dans cette seconde direction - vers l'éloge et l'adulation (toward praise and adulation) - et même des personnes qui se prétendent socialistes ou critiques culturels radicaux ont adopté l'idée que le capitalisme consumériste a été (et est) fondamentalement et positivement libérateur, le meilleur système conçu à ce jour avec le potentiel de satisfaire les besoins et désirs « réels » de tous les êtres humains (and even people who purport to be socialists or radical culture critics have embraced the idea that consumer capitalism has been (and is) basically and positively liberatory, the best system yet devised with the potential for meeting the “real” needs and desires of all human beings).
Ce livre tente une évaluation plus complète de la culture du capitalisme consumériste. Il examine la réalité économique qui l'a fait naître — les entreprises nationales, les détaillants de masse et les banques. Il traite des publicitaires et promoteurs, des artistes de la mise en scène et des créateurs de mode, et de la foule d'intermédiaires et d'escrocs (hommes et femmes) qui ont conçu les séductions envoûtantes au service des affaires. Mais le livre va bien au-delà d'une analyse économique pour appréhender la culture dans son ensemble, comme un ensemble complexe de relations et d'alliances entre différentes sortes de personnes et de groupes — culturels et non-économiques, religieux et politiques — qui ont œuvré de concert pour créer ce que le commerçant John Wanamaker appelait la « terre du désir ».
(The first part of this book is devoted to merchants and their enticements; the second and third parts show how those merchants cooperated with educators, social reformers, politicians, artists, and religious leaders to bring into existence the new economy and culture.)
"La première partie de ce livre est consacrée aux commerçants et à leurs séductions ; les deuxième et troisième parties montrent comment ces commerçants ont coopéré avec des éducateurs, des réformateurs sociaux, des hommes politiques, des artistes et des chefs religieux pour faire émerger la nouvelle économie et culture."
Je tiens à avertir le lecteur que Land of Desire ne se concentre pas sur les questions de consentement et de réception populaires. Le comportement n'est pas le sujet central du livre, bien que de nombreux comportements soient décrits dans ces pages, de nombreuses personnes adhérant à la nouvelle culture, s'y opposant ou la détestant, la célébrant. Néanmoins, mon sujet n'est pas le consentement mais la création de cette culture. Le consentement, certes, a joué un rôle quelconque, mais il n'a pas été décisif. Cette idée peut sembler contradictoire, puisque nous savons que les défenseurs du capitalisme ont toujours affirmé que le capitalisme a été (et est) le système économique le plus démocratique ; il a non seulement exigé mais aussi imploré le consentement populaire pour fonctionner. Les marchés capitalistes ne peuvent fonctionner, affirment de nombreux économistes, que s'ils répondent bien aux besoins et désirs « réels » ou au consentement des consommateurs.
Pourtant, je ne crois pas que le consentement ait été la clé de la création et de la perpétuation de ce nouveau phénomène. En effet, la culture du capitalisme consumériste a peut-être été l'une des cultures publiques les moins consenties jamais créées, et elle était non consentie pour deux raisons. Premièrement, elle n'a pas été produite par « le peuple » mais par des groupes commerciaux en coopération avec d'autres élites, à l'aise avec l'idée de faire des profits et de s'engager à accumuler du capital à une échelle sans cesse croissante. Deuxièmement, elle était non consentie parce que, dans sa simple conduite au jour le jour (mais pas de manière conspiratrice), elle a mis au premier plan une seule vision de la bonne vie et a écarté toutes les autres. De cette manière, elle a appauvri la vie publique américaine, privant le peuple américain de l'accès à la compréhension d'autres façons d'organiser et de concevoir la vie, une compréhension qui aurait pu doter leur consentement à la culture dominante (s'il devait être donné) d'une véritable démocratie. »
- Introduction: The Land of Desire and the Culture of Consumer Capitalism
- I - Strategies of Enticement
1- "The Dawn of a Commercial Empire" analyse la montée des grands magasins (Macy’s, Wanamaker’s, Marshall Field’s), qui deviennent les temples d’un nouveau consumérisme urbain. Les marchands ne vendent plus seulement des biens, mais des expériences sensorielles, esthétiques et psychologiques. Le capital privé devient moteur de l’urbanisation moderne. Leach montre comment le commerce devient un acteur de transformation sociale, mais il sous-estime peut-être la résistance populaire à cette idéologie.- 2 - "Facades of Color, Glass, and Light", les vitrines, l’éclairage électrique, les décorations de façade participent à une véritable mise en scène du désir. L’esthétique de l’opulence sert à naturaliser l’abondance comme horizon. Les références à l’Exposition Universelle de 1893 sont cruciales. Leach anticipe des analyses postmodernes sur l’esthétique de la marchandise (Baudrillard, Debord), sans les citer directement. - 3 - "Interiors", l’agencement intérieur (escaliers monumentaux, salons, coins lecture, jardins d’hiver) transforme le magasin en espace de loisir. On observe un glissement du commerce vers le spectacle permanent. Les femmes deviennent les cibles privilégiées de cette architecture de séduction. Elles sont à la fois actrices et objets du système marchand. Leach souligne sans ambiguïté les ambivalences de cette dynamique. - 4 - "Fashion and the Indispensable Thing", la mode devient une technologie du désir et une forme de régulation sociale. Le système repose sur l’obsolescence planifiée, la création de besoins. Le vêtement devient un langage du statut et un outil de distinction. Leach s’inscrit ici dans une lecture sociologique (Veblen, Simmel), mais avec une optique historique rigoureuse. Il note l’alliance entre mode, publicité et médias émergents.
5 - "Ali Baba’s Lamp: Service for Private and Public Benefit" aborde l’idéologie du service : les magasins se présentent comme bienfaiteurs publics, créateurs d’emplois et d’espaces civilisés. Le discours philanthropique masque la concentration du pouvoir et l’instrumentalisation de la culture. Une analyse décapante de l’hypocrisie bourgeoise. Leach montre comment le capitalisme se donne des allures civiques tout en remodelant la sphère publique selon ses intérêts.
- II - Circuits of Power
6. “Business Runs the World”: Institutional Coalitions Behind the New Order" - Leach expose l’interconnexion entre marchands, banques, urbanistes, éducateurs, musées. Un réseau cohérent travaille à normaliser la consommation. L’école et le monde universitaire participent à cette naturalisation du désir marchand. Chapitre important pour comprendre la dimension systémique du capitalisme culturel. Leach démontre que le consumérisme n’est pas une dérive mais un projet structuré.
7. "Wanamaker’s Simple Life and the Moral Failure of Established Religion" - Le capitalisme consumériste occupe le vide laissé par les Églises traditionnelles, jugées incapables de répondre aux aspirations modernes. Le religieux est récupéré, ritualisé dans les magasins (Noël, Pâques). Wanamaker se présente comme un moraliste marchand. Une lecture puissante du remplacement de la religion par la consommation comme système de croyances et de rites.
8. "Mind Cure and the Happiness Machine" explore les liens entre le consumérisme et le mouvement "New Thought" (pensée positive, auto-suggestion), qui prépare l'avènement d’un consommateur optimiste, adaptable et tourné vers le futur. L’individu est rééduqué à désirer comme on se soigne. Leach fait ici un pas vers la psychologie sociale : il montre comment le système capitaliste façonne la subjectivité même de l’individu moderne.
"... The Wonderful Wizard of Oz was a product of the rise of a new consumer mentality. Along with Porter’s Pollyanna and Patten’s political economy, it was an expression of a new general mind-cure outlook. This philosophy was, in turn, strengthened by the mind-cure religions themselves, as well as by the religious compromises and spiritual concessions of many established religious denominations. Altogether, a new spiritual-ethical climate had grown up, working in relation to a new institutional life in America, with the government, the universities and colleges, the museums, and the art schools, as they collaborated with business in the creation of America’s new culture. It allowed for new myths and dreams, all promising a life of ever-increasing abundance, comfort, and bodily pleasure, “a new heaven and a new earth,” as one mind curer put it.
Most disturbingly, the new “spiritual” perspective reinforced the indifference to pain and suffering fostered by the modern segregation of consumption from production. Mind cure especially, a ready-made consumer mentality, denied that pain and suffering existed at all.
Although several strong voices emerged to contest it, this capitalist ideology of abundance was helping to create a new cultural space being filled by commercial iconography, by visions of goods and of consumer activities in show windows and in advertisements, by fashion shows and interior displays, and by the huge electrical billboards that towered over city streets. As early as 1902, William James, in The Varieties of Religious Experience, noted its appearance: “We have lost the power even of imagining what the ancient idealization of poverty could have meant: the liberation from material attachments, the unbribed soul.”
« Le Magicien d'Oz fut le produit de l'émergence d'une nouvelle mentalité consumériste. Tout comme Pollyanna de Porter et l'économie politique de Patten, il fut l'expression d'une nouvelle vision générale d'inspiration mind cure (guérison par l'esprit). Cette philosophie fut à son tour renforcée par les religions mind cure elles-mêmes, ainsi que par les compromis religieux et concessions spirituelles de nombreuses confessions établies. Dans l'ensemble, un nouveau climat spirituel et éthique s'était développé, fonctionnant en relation avec une nouvelle vie institutionnelle américaine – où le gouvernement, les universités, les musées et les écoles d'art collaboraient avec le monde des affaires pour créer la nouvelle culture américaine. Ce climat permit l'éclosion de nouveaux mythes et rêves, tous promettant une vie d'abondance, de confort et de plaisirs corporels toujours croissants, "un nouveau ciel et une nouvelle terre", selon les termes d'un adepte du mind cure.
Le plus troublant est que cette nouvelle perspective "spirituelle" renforça l'indifférence à la douleur et à la souffriture, favorisée par la ségrégation moderne de la consommation et de la production. Le mind cure en particulier, cette mentalité consumériste préfabriquée, niait purement et simplement l'existence même de la douleur et de la souffrance.
Bien que plusieurs voix fortes s'élevèrent pour le contester, cette idéologie capitaliste de l'abondance contribua à créer un nouvel espace culturel, progressivement envahi par une iconographie commerciale, par des visions de biens et d'activités consuméristes dans les vitrines et les publicités, par les défilés de mode et les présentations d'intérieurs, ainsi que par les immenses panneaux électriques dominant les rues des villes. Dès 1902, William James, dans Les formes multiples de l'expérience religieuse, en constatait l'apparition : "Nous avons perdu jusqu'au pouvoir d'imaginer ce que pouvait signifier l'idéalisation antique de la pauvreté : la libération des attaches matérielles, l'âme incorruptible." »
- Partie III – Managing a Dream Culture: 1922-1932
9. “An Age of Consolidation”: Goods, Money, and Mergermania - Les années 1920 : les grands magasins fusionnent, deviennent des empires. L’économie de l’échelle donne lieu à une centralisation extrême des moyens de production et de distribution. Leach souligne l'essor d'une technocratie commerciale. L'analyse des logiques de concentration reste très actuelle. Le rêve devient massifié, reproduit industriellement.
10. “Sell Them Their Dreams” - La publicité devient la clé de voûte du système. Les agences publicitaires s’emparent des affects, des pulsions, de l’imaginaire collectif. Le rêve américain est un produit à vendre. Le langage publicitaire fusionne avec celui de la psychologie et de la science sociale. Leach anticipe les critiques ultérieures sur la "société du spectacle". Il démontre comment la fabrique du rêve devient l’économie elle-même.
11. "The Spectacles"- Les parades, vitrines animées, films promotionnels et événements sponsorisés transforment la ville en théâtre commercial. L’esthétique du divertissement est mobilisée pour maintenir l’adhésion des masses au système. Ce chapitre est capital pour comprendre le lien entre consumérisme et culture de masse. Leach insiste sur le rôle de la mise en scène permanente comme anesthésie critique.
12. "Herbert Hoover’s Emerald City and Managerial Government" - Hoover incarne l’utopie technocratique : fusion du capitalisme marchand, du gouvernement rationalisé et de la gestion du bonheur social. L’État devient le manager en chef d’un ordre basé sur la consommation. Leach se montre ici particulièrement inquiet de la confusion croissante entre politique et marketing. La démocratie devient elle-même un produit.
"... In this decade, the federal government placed the capstone on the institutional coalition grouped behind the Land of Desire. Prestigious universities built even stronger alliances with the new economy and culture; so did museums, along with a great ensemble of other institutions, from art schools to investment banking groups. Together they galvanized the economic circuits of chain stores, department stores, hotels, restaurants, and movie houses, of public relations firms, model agencies, fashion groups, and advertising businesses, to say nothing of the huge industrial corporate infrastructure that undergirded it all.
The age was a time of the Rainbow Houses, from Stewart Culin at the Brooklyn Museum to Hoover’s dreams for the suburbs. The amenable cultural climate shaped earlier by the religious compromises of John Wanamaker and by others and by the emergence of a mind-cure mentality at home with acquisition and consumption, had apparently won the day. Although groups of people were locked out from it and some resisted it, the new American culture seemed to others (and we will never know how many) in harmony with L. Frank Bauni’s vision of a society in which “wonder” had no “heartache” and every child and adult might find the road to the Emerald City.
A new commercial aesthetic had flowered, a formidable group of cultural and economic intermediaries had emerged, and an elaborate institutional circuitry had evolved, together creating the first culture of its kind that answered entirely to the purposes of the capitalist system and that seemed to establish and legitimate business dominance. Corporate business now orchestrated the myths of America, and it was through business, with the blessings in many ways of the federal government and other agencies, that the American dream had found its most dependable ally. “To each a world opens,” said advertiser Artemas Ward in 1892, “to everyone possibilities are present.” By 1929, after almost fifty years of growth and struggle, the modern American capitalist culture of consumption had finally taken root."
".. « Au cours de cette décennie, le gouvernement fédéral a posé la pierre angulaire de la coalition institutionnelle regroupée derrière la « Terre du Désir » (Land of Desire). Les universités prestigieuses ont forgé des alliances encore plus solides avec la nouvelle économie et culture ; il en fut de même pour les musées, ainsi qu'avec un vaste ensemble d'autres institutions, allant des écoles d'art aux groupes de banque d'investissement. Ensemble, ils dynamisèrent les circuits économiques des chaînes de magasins, grands magasins, hôtels, restaurants et salles de cinéma, des agences de relations publiques, agences de mannequins, groupes de mode et entreprises publicitaires, sans parler de l'immense infrastructure industrielle et corporative qui sous-tendait le tout.
L'époque fut celle des « Maisons Arc-en-Ciel » (Rainbow Houses), de Stewart Culin au Brooklyn Museum aux rêves de Hoover pour les banlieues. Le climat culturel accommodant, façonné plus tôt par les compromis religieux d'un John Wanamaker et d'autres, et par l'émergence d'une mentalité mind cure à l'aise avec l'acquisition et la consommation, avait apparemment triomphé. Bien que des groupes en soient exclus et que certains y résistent, la nouvelle culture américaine semblait à d'autres (et nous ne saurons jamais combien) en harmonie avec la vision de L. Frank Baum d'une société où la « merveille » était sans « déchirement » (heartache) et où chaque enfant et adulte pourrait trouver la route vers la Cité d'Émeraude (Emerald City).
Une nouvelle esthétique commerciale avait fleuri, un groupe formidable d'intermédiaires culturels et économiques était apparu, et un circuit institutionnel élaboré s'était développé, créant ensemble la première culture de son genre entièrement soumise aux objectifs du système capitaliste et semblant établir et légitimer la domination des affaires. Les entreprises corporatives orchestraient désormais les mythes de l'Amérique, et c'était à travers les affaires, avec la bénédiction à bien des égards du gouvernement fédéral et d'autres agences, que le rêve américain avait trouvé son allié le plus sûr. « À chacun s'ouvre un monde, disait le publicitaire Artemas Ward en 1892, à chacun se présentent des possibilités. » En 1929, après près de cinquante ans de croissance et de lutte, la culture capitaliste de consommation moderne américaine avait finalement pris racine. »
Conclusion: Legacies
Leach termine en soulignant que ce modèle s’est durablement imposé. La culture de consommation est devenue l’idéologie dominante, en partie parce qu’elle a su se présenter comme neutre, joyeuse et inévitable. Loin d’être naturelle, elle est le fruit d’un travail idéologique profond, désormais internalisé dans nos habitudes et nos désirs.
Une conclusion pessimiste, mais lucide. Leach ne prône pas un retour à un passé mythique, mais il appelle à dénaturaliser la consommation et à retrouver des formes de citoyenneté non marchandes.
"... Another corporate legacy passed on from the pre-1930 years is the concept of the human being as an insatiable, desiring machine or as an animal governed by an infinity of desires. This concept of humanity argues that what is most “human” about people is their quest after the new, their willingness to violate boundaries, their hatred of the old and the habitual (unless enlisted in behalf of the new, as in fashion and style, or used in some way to promote consumption, as in encouraging brand loyalty or selling old-fashioned Quaker Oats, etc.), and their need to incorporate “more and more”—goods, money, experience, everything. There seems to be much truth in this concept, as such great writers as Emerson, Whitman, and William James long ago explained. It appears that many human beings not only seek but also need to seek new goods, new adventures and experiences, and new insights to feel alive and fulfilled. There may be no inherent limit to what people can or might desire or to what they can or might be invited and tempted to do—economically, sexually, politically, morally. Human beings are infinitely flexible and endowed with considerable imaginative powers. Art historian Anne Hollander has recently argued that the desire for “fluidity” and “permutations,” the enthusiasm for putting on and taking off masks and for experimentation “is ingrained in our civilization.”
At the same time, the conception of the desiring self, as expressed in capitalist terms and exploited by capitalism, offers a one-sided and flawed notion of what it means to be human. It rejects what is also “human” about human beings: their ability to commit themselves, to establish binding relationships, to sink permanent roots, to maintain continuity with previous generations, to remember, to make ethical judgments, to seek pleasure in work, to remain steadfast on behalf of principle and loyal to community or country (to the degree that community or country strives to be just and fair), to seek spiritual transcendence beyond the self, and to fight a cause through to the end.
But however flawed, the capitalist concept of self, the consumer concept of the self, is the reigning American concept. It is a broker’s view of people (e.g., that people have no basic commitment to anything except what is coming next and can be encouraged and seduced—without much ado—to change their minds and habits). It is also youth-oriented, resting on the idea that it is unfortunate, and somehow antihuman, to grow old. It is child-oriented, too, because the very vision of the self it presents is that of a demanding child, susceptible to outbursts of both primal rage and primal yearning. It is also a permissive mind-cure notion that people prefer to be open completely to the “abundance” of the universe and to have no boundaries separating the self from the outside world.
Two other legacies, both related to the idea of the desiring self, have been transmitted to us from the earlier period: one, the myth of the separate world of consumption as the domain of freedom, self-expression, and self-fulfillment; the other, the conception of the market as always expanding and as always without boundaries. Today the myth of consumption as the ideal world of freedom has grown, fostered by commercial media that depict every consumer moment as a liberating one and every purchase as a sexual thrill or as a ticket to happiness. The cultural outcome has been to intensify the old dangers; for despite progressive laws to protect adult and child workers and to expose consumers to the nature of workplace exploitation, the trend toward abstraction, indifference, and narcissism has increased, not decreased. The distance between consumers and workers (in fact but especially in the imagination) has gotten wider, a trend the government and media have conspired to create by denying the true nature of work. Today, the factory goods “made by unknown hands,” as Wesley Clair Mitchell wrote in 1912, are even more unknown, produced, as most of them are, by faceless individuals in Third World countries (or—perhaps in the future—in America’s own Third World cities). Thus Nike, the sneaker company with a $3 billion profit in 1991, whose media promotions have been acclaimed as “the high-water mark of American advertising,” pays its factory workers in Indonesia, who are “mostly women, poor, and malnourished,” $1.03 a day, not enough for food and shelter. But these workers are so far away and have so few advocates that there is little reason for people to care how they are treated, about what their wages are, or about who is responsible for such treatment.
Before 1930, the conception of the market without boundaries and as open to all forms of selling was at the center of much business practice. In 1923 the New York journalist Samuel Strauss, disturbed by the rise of what he called “Consumptionism,” noted to what degree capitalist forces had penetrated through national boundaries. American business had already created the largest domestic market in history; but now, he observed, the movement was reaching into other countries. Strauss was worried about this trend and warned that deeper market intrusions would lead to the destruction of local communities and of local cultures, or of what he called “particularism.” “Make no mistake about it,” he wrote, “[industrialists] believe that boundary lines no longer exist… only people exist… the world is all alike; the world is one.” Strauss feared that the world was being reduced, inch by inch, to the standardized pattern that Simon Patten had believed was the precondition for ethical progress. World War I “had not been fought for democracy or for nationalism,” Strauss wrote, but for “industrialism.” It was waged to ensure that “the power of production would never again be endangered” and that the production of “more next year than this year” would go on unimpeded.
And he was right, by and large, despite disastrous slumps. Today the world without boundaries—a truly “global” world—is with us, in part in reality but, more important, in ideology, as corporate businesses and business-minded governments remind us daily that national boundaries are disappearing, mere old-fashioned obstacles to achieving market share, and that Americans—if they wish to survive—must turn away from the narrow particularism of a special culture, of a special belief, or of a special tradition. The global market conception is the outlook of such orthodox Republican think tanks as the American Enterprise Institute and the Heritage Foundation, both advisers to Presidents Bush and Reagan and both champions of a world without boundaries, of global capitalism, and of mind-cure consumer culture. Global American popular culture—especially the heart of that culture, the consumer entertainments, goods, and services—is “one of the great democratic instruments in history,” according to Ben Wattenberg, a passionate promoter of this view, “good for America and good for the world...."
"« [...] Un autre héritage corporatif transmis par la période pré-1930 est le concept de l'être humain comme une machine désirante insatiable, ou comme un animal gouverné par une infinité de désirs. Cette conception de l'humanité soutient que ce qu'il y a de plus "humain" chez les gens, c'est leur quête de la nouveauté, leur volonté de violer les limites, leur haine de l'ancien et de l'habituel (à moins qu'ils ne soient mis au service du nouveau, comme dans la mode et le style, ou utilisés d'une manière ou d'une autre pour promouvoir la consommation, comme pour encourager la fidélité à une marque ou vendre les vieux flocons d'avoine Quaker, etc.), et leur besoin d'incorporer "toujours plus" — biens, argent, expérience, tout. Cette conception semble contenir beaucoup de vérité, comme de grands écrivains tels qu'Emerson, Whitman et William James l'expliquèrent jadis. Il apparaît que de nombreux êtres humains non seulement cherchent mais ont besoin de chercher de nouveaux biens, de nouvelles aventures et expériences, et de nouvelles perspectives pour se sentir vivants et accomplis. Il n'y aurait peut-être pas de limite inhérente à ce que les gens peuvent ou pourraient désirer, ou à ce qu'on peut ou pourrait les inviter et tenter de faire — économiquement, sexuellement, politiquement, moralement. Les êtres humains sont infiniment flexibles et dotés de pouvoirs d'imagination considérables. L'historienne de l'art Anne Hollander a récemment soutenu que le désir de "fluidité" et de "permutations", l'enthousiasme pour le jeu des masques (les mettre et les enlever) et pour l'expérimentation "est ancré dans notre civilisation".
Dans le même temps, la conception du moi désirant, telle qu'exprimée dans les termes capitalistes et exploitée par le capitalisme, offre une notion unilatérale et défectueuse de ce que signifie être humain. Elle rejette ce qui est aussi "humain" chez les êtres humains : leur capacité à s'engager, à établir des relations durables, à planter des racines permanentes, à maintenir une continuité avec les générations précédentes, à se souvenir, à porter des jugements éthiques, à chercher du plaisir dans le travail, à rester ferme au nom d'un principe et loyal envers une communauté ou un pays (dans la mesure où cette communauté ou ce pays s'efforce d'être juste et équitable), à rechercher une transcendance spirituelle au-delà du soi, et à mener une cause jusqu'au bout.
Mais aussi défectueuse soit-elle, la conception capitaliste du moi, la conception consumériste du moi, est la conception américaine dominante. C'est une vision court-termiste des gens (par exemple, que les gens n'ont aucun engagement fondamental envers quoi que ce soit, sauf envers ce qui vient ensuite, et qu'ils peuvent être encouragés et séduits — sans grande difficulté — à changer d'avis et d'habitudes). Elle est aussi orientée vers la jeunesse, reposant sur l'idée qu'il est malheureux, et d'une certaine manière antihumain, de vieillir. Elle est également orientée vers l'enfant, car la vision même du moi qu'elle présente est celle d'un enfant exigeant, susceptible de crises de rage primale et de désir primal. C'est aussi une notion mind cure permissive selon laquelle les gens préfèrent être complètement ouverts à "l'abondance" de l'univers et ne pas avoir de limites séparant le moi du monde extérieur.
Deux autres héritages, tous deux liés à l'idée du moi désirant, nous ont été transmis depuis la période antérieure : l'un, le mythe d'un monde de la consommation séparé comme domaine de liberté, d'expression de soi et d'accomplissement personnel ; l'autre, la conception du marché comme toujours en expansion et toujours sans limites. Aujourd'hui, le mythe de la consommation comme monde idéal de la liberté s'est amplifié, encouragé par des médias commerciaux qui dépeignent chaque acte de consommation comme libérateur et chaque achat comme un frisson sexuel ou un ticket pour le bonheur. Le résultat culturel a été d'intensifier les anciens dangers ; car malgré des lois progressistes pour protéger les travailleurs adultes et enfants et pour exposer les consommateurs à la nature de l'exploitation au travail, la tendance à l'abstraction, à l'indifférence et au narcissisme a augmenté, et non diminué. La distance entre les consommateurs et les travailleurs (dans les faits mais surtout dans l'imaginaire) s'est élargie, une tendance que le gouvernement et les médias ont conspiré à créer en niant la véritable nature du travail. Aujourd'hui, les biens d'usine "fabriqués par des mains inconnues", comme l'écrivait Wesley Clair Mitchell en 1912, sont encore plus inconnus, produits, comme la plupart d'entre eux, par des individus sans visage dans des pays du Tiers Monde (ou — peut-être à l'avenir — dans les propres villes du Tiers Monde de l'Amérique). Ainsi, Nike, l'entreprise de baskets avec un bénéfice de 3 milliards de dollars en 1991, dont les promotions médiatiques ont été saluées comme "l'apogée de la publicité américaine", paye ses ouvriers d'usine en Indonésie, qui sont "principalement des femmes, pauvres et sous-alimentées", 1,03 dollar par jour, insuffisant pour la nourriture et le logement. Mais ces travailleurs sont si loin et ont si peu de défenseurs que les gens ont peu de raisons de se soucier de leur traitement, de leurs salaires, ou de qui est responsable d'un tel traitement.
Avant 1930, la conception d'un marché sans limites et ouvert à toutes les formes de vente était au cœur de nombreuses pratiques commerciales. En 1923, le journaliste new-yorkais Samuel Strauss, troublé par la montée de ce qu'il appelait le "Consommationnisme" (Consumptionism), constatait à quel point les forces capitalistes avaient pénétré les frontières nationales. Les entreprises américaines avaient déjà créé le plus grand marché intérieur de l'histoire ; mais maintenant, observait-il, le mouvement s'étendait à d'autres pays. Strauss s'inquiétait de cette tendance et avertissait que des intrusions plus profondes du marché conduiraient à la destruction des communautés locales et des cultures locales, ou de ce qu'il appelait les "particularismes". "Ne vous y trompez pas, écrivait-il, [les industriels] croient que les frontières n'existent plus… seules les personnes existent… le monde est partout pareil ; le monde est un." Strauss craignait que le monde ne soit réduit, centimètre par centimètre, au modèle standardisé que Simon Patten croyait être la condition préalable au progrès éthique. La Première Guerre mondiale "n'avait pas été menée pour la démocratie ou pour le nationalisme", écrivait Strauss, mais pour "l'industrialisme". Elle avait été menée pour garantir que "le pouvoir de production ne serait plus jamais menacé" et que la production de "plus l'année prochaine que cette année" se poursuivrait sans entrave.
Et il avait globalement raison, malgré des effondrements désastreux. Aujourd'hui, le monde sans frontières — un monde véritablement "mondial" — est là, en partie dans la réalité mais, plus important encore, dans l'idéologie, alors que les entreprises corporatives et les gouvernements tournés vers les affaires nous rappellent quotidiennement que les frontières nationales disparaissent, de simples obstacles dépassés à la conquête de parts de marché, et que les Américains — s'ils veulent survivre — doivent se détourner du particularisme étroit d'une culture spéciale, d'une croyance spéciale ou d'une tradition spéciale. La conception du marché mondial est la vision de groupes de réflexion républicains orthodoxes comme l'American Enterprise Institute et la Heritage Foundation, tous deux conseillers des présidents Bush et Reagan et champions d'un monde sans frontières, du capitalisme mondial et de la culture consumériste mind cure. La culture populaire américaine mondiale — en particulier le cœur de cette culture, les divertissements, biens et services de consommation — est "l'un des grands instruments démocratiques de l'histoire", selon Ben Wattenberg, un promoteur passionné de cette vision, "bon pour l'Amérique et bon pour le monde". »
(...)
Parmi les limites et Critiques de Gary Cross, "An All-Consuming Century: Why Commercialism Won in Modern America" (2000) ...
- Un déterminisme excessif ? Cross présente le triomphe du consumérisme comme inévitable, sous-estimant les résistances (mouvements anticonsuméristes, syndicats, religiosité). Il occulte partiellement les alternatives historiques (modèles de consommation sobres proposés par les mouvements sociaux).
- L'analyse reste centrée sur les États-Unis sans explorer suffisamment l'exportation de ce modèle (impérialisme culturel) ou ses interactions avec d'autres cultures.
- Une vision pessimiste de l'individu : les consommateurs sont parfois décrits comme passifs, manipulés. Des travaux ultérieurs (ex: Michel de Certeau) soulignent davantage les tactiques de réappropriation par les individus.
- Une certaine sous-estimation du rôle de l'État : bien que mentionné, l'État est souvent vu comme un allié du marché. Sa fonction régulatrice (protection des consommateurs, environnement) est minorée.
L'une des principales objections de l'ouvrage repose sur le fait que Cross n'a pas anticipé la crise écologique qui tend à devenir le principal argument contre le consumérisme ....
- La critique environnementale du consumérisme, cruciale aujourd'hui, n'est pas intégrée à sa réflexion. Cross écrivait en 2000, avant la massification des discours sur l'urgence climatique. Aujourd'hui, les données sont accablantes : le dernier rapport du GIEC montre que la consommation des 10% les plus riches représente 40% des émissions globales. La critique environnementale n'est plus un angle optionnel mais central, comme le prouvent les mouvements comme Extinction Rebellion ou les travaux de Jason Hickel sur la "décroissance". Des travaux comme ceux d'Andreas Malm ("Capital fossile", 2016) lient capitalisme consumériste et destruction écologique. Pourtant, il faut nuancer : certains modèles capitalistes tentent de récupérer cette critique (greenwashing, capitalisme vert) ...
A suivre ...
