- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Svevo - Pirandello
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki
- 1930-1940
- 1930s
- Fitzgerald
- Hemingway
- Faulkner
- Koch
- Céline
- Bernanos
- Jouve
- DosPassos
- Kojève
- Miller-Nin
- Grosz - Dix
- Green
- Ortega y Gasset
- Wittgenstein
- Russell - Carnap
- Artaud
- Jaspers
- Sapir - Piaget
- Guillén
- Garcia Lorca
- Hammett
- A.Christie
- Heidegger
- Icaza
- Huxley
- Hubble
- Caldwell
- Steinbeck
- Waugh
- Blixen
- Rhys
- J.Roth - Doderer
- Aub
- Malraux-StExupéry
- DBarnes-NWest
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bataille
- Char-Michaux
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Bloch
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Lewin - Mayo - Maslow
- Montherlant
- Buzzati - Pavese
- Vittorini
- Fallada
- Malaparte
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Welty
- Boulgakov
- Tamiki - Yôkô
- Weil
- Gadda
- Broch
- Steeman
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Ellison
- Bergman
- Baldwin
- Fromm
- Bradbury - A.C.Clarke
- Tennessee Williams
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Carpentier
- Mishima
- Salinger - Styron
- Pasternak
- Asturias
- O'Connor
- Hoffer
- Matute - MartinGaite
- 1960-1970
- 1960s
- Abe
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- U.Johnson - C.Wolf
- Heller - Toole
- Naipaul
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Onetti - Sábato
- Capote
- Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- McCarthy - Minsky
- Sillitoe
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- Lenz
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Dolls
- Ellis
- Cortázar
- Warhol
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- HarperLee
- Fuentes
- 1970-1980
- 1970s
- Habermas
- Handke
- GarciaMarquez
- Deleuze
- Derrida
- Beck
- Satir
- Kundera
- Hrabal
- Didion
- Guinzbourg
- Lovelock
- Vietnam
- H.S.Thompson - Bukowski
- Pynchon
- E.T.Hall
- Bateson - Watzlawick
- Carver
- Irving
- Milgram
- VargasLlosa
- Puig - Donoso
- Lasch-Sennett
- Crozier - Touraine
- Friedan-Greer
- Jacob-Monod
- Dawkins
- Beattie - Phillips
- Gaddis
- Rawls
- Zinoviev
- H.Searles
- Ballard
- Jong
- Kôno
- Calvino
- Ballester-Delibes
- ASchmidt
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact
Interpretive Cultural Sociology - Jeffrey C. Alexander (1947), "The Meanings of Social Life" (2003), "On the Social Construction of Moral Universalism : The "Holocaust" from War Crime to Trauma Drama" (2001), "The Civil Sphere" (2006), "Trauma : A Social Theory" (2012), "The Dark Side of Modernity" (2013), "Iconic Power: Materiality and Meaning in Social Life" (Alexander, J.C., Bartmanski, D., & Giesen, B. (eds.), 2012) - Philip Smith, "Cultural Theory: An Introduction" (2001) - Clifford Geertz, "The Interpretation of Cultures" (1973) - ...
Beaucoup d'entre nous peuvent vivre sans s'interroger tant sur eux-mêmes que sur le monde qui nous entoure, et s'ils le font, c'est pour évoquer, naturellement, le plus souvent leur environnement culturel : un environnement qui donne forme à nos pensées, à nos sentiments, à nos actions. Jusque-là, la sociologie reconnaissait certes à la CULTURE une place d'importance, mais ses choix en termes d'analyse et de réflexion se portaient naturellement sur la position sociale ou économique des individus ou des groupes.
Pour le théoricien social de Yale, Jeffrey C. Alexander, c'est désormais à la Culture que revient le devant de la scène sociologique, si l'on appelle "culture" la création collective d'idées, de croyances et de valeurs morales d'un groupe donné" : une culture qui peut, et doit, être appréhendée indépendamment de notre société, sans lien avec les conditions d'existence où elle émerge, et pourtant susceptible d'influer sur les individus et les groupes qui s'en inspirent. C'est elle qui nous permet de comprendre notre condition humaine, et c'est à la sociologie dite "culturelle" que revient désormais la tâche d'appréhender comment ces individus et groupes humains créent du sens à partir d'éléments culturels partagés (symboles, valeurs morales, discours) et comment ce sens influe sur leurs actions.
Plus concrètement encore, selon Alexander, définir une société comme capitaliste, communiste ou totalitaire, ne nous aide en rien à comprendre pourquoi tel ou tel individu a réagi de telle ou telle manière : pour en saisir le sens, il convient de s'interroger sur les structures, les significations et les symboles, à l'oeuvre dans cette culture, puis de s'en remettre à leur interprétation comme une oeuvre spécifique, unique, qui ne peut se réduire à un élément élaboré de manière déterministe : le fait culturel devient un texte à déchiffrer, notre monde est toujours celui de grands récits à déconstruire ...
De 2003 à 2013, Jeffrey C. Alexander illustrera sa démarche via trois thématiques parfaitement lisibles,
- sa théorie du trauma culturel (ou comment des événements sont culturellement construits en traumatismes fondateurs).
- son analyse de la "face sombre de la modernité" (qui suppose que la culture et les idéologies modernes peuvent générer leur propre barbarie).
- son étude des performances et des codes culturels dans la vie publique (la politique comme drame culturel).

En 2003, publication de l'article-manifeste fondateur, dans "The Meanings of Social Life",
"La "Sociologie culturelle interprétative" ("Interpretive Cultural Sociology" ou "Strong Program in Cultural Sociology").
Son auteur, Jeffrey C. Alexander, va définir un programme basé sur quatre principes mettant la culture et l'interprétation au cœur de l'explication sociologique. On parle de "Révolution Herméneutique", et le "Strong Program" qui émerge se dessine par réaction aux théories déterministes des années 1970-80, en réhabilitant le pouvoir causal des symboles et la méthode interprétative comme instrumentation scientifique ...
La "sociologie culturelle" se transforme en une analyse de "textes sociaux" à même d'interpréter les phénomènes contemporains, les crises politiques, les révolutions, la légitimité des institutions, les identités collectives, le rôle des réseaux sociaux et plus encore une démocratie devenue un espace de lutte symbolique permanente, où le "sens" est une ressource de pouvoir, où les batailles de sens façonnent le monde réel...
Il s'agit de bâtir une sociologie où la culture (symboles, récits, codes, performances) est une force causale autonome et centrale, étudiée par des méthodes interprétatives rigoureuses, pour en expliquer les dynamiques (conflit, changement, intégration) que le fonctionnalisme, notamment, avait échoué à saisir pleinement ...
Référence: "The Oxford Handbook of Cultural Sociology" (Oxford Handbooks) IRL Press at Oxford University Press, Oxford University Press USA, 2012 - Jeffrey C. Alexander, Ronald N. Jacobs, Philip Smith.

"Strong Program in Cultural Sociology" ("The Strong Program") - Dans les années 1970, David Bloor et Barry Barnes, au sein de l'université d'Édimbourg, développèrent un programme qui défendait une approche radicalement sociologique et causale de la connaissance scientifique, affirmant que même les vérités scientifiques (comme les mathématiques) devaient être expliquées par des facteurs sociaux (intérêts, contexte, pouvoir), sans distinction a priori entre croyances "vraies" (rationnelles) et "fausses" (irrationnelles) : le "Strong Program in the Sociology of Knowledge".
C'est par choix théorique et polémique, qui s'inscrit dans un débat central en sciences sociales, qu'Alexander va emprunter le terme de "Strong Programme" pour désigner "la sociologie culturelle interprétative" qu'il propose.
Mais l'orientation n'est plus matérialiste et causale mais idéaliste et interprétatif : il s'agit d'affirmer la "Force" Autonome de la Culture. C'est en 2003 que le "Strong Program" est explicitement nommé, défini et promu comme un programme de recherche distinct et unifié....
Au coeur de ce "Strong Program", Alexander soutient ...
- que la dimension symbolique et culturelle de la vie sociale n'est pas un simple reflet ou une superstructure déterminée par des forces matérielles (économie, structure sociale, intérêts, pouvoir), mais qu'elle possède une autonomie relative et une efficacité causale propre.
- que la culture n'est pas "faible" (déterminée, épiphénoménale), mais qu'elle est "forte" car elle structure activement les perceptions, les émotions, les actions, les institutions et les conflits sociaux. Les codes culturels, les récits (narratives), les symboles et les performances sont des forces motrices de la vie sociale.
Alexander utilise le qualificatif de "strong" par contraste avec ce qu'il perçoit comme des approches "faibles" (weak) ou réductionnistes de la culture dominantes en sociologie :
- Le Marxisme "classique" : où la culture (idéologie) est largement un reflet des rapports de production et un outil de domination.
- Le Fonctionnalisme (Parsons revisité) : où la culture est un système de valeurs intégratrices, souvent vu comme trop consensuel et apolitique.
- Les Théories de l'Intérêt (Rational Choice) : où la culture est un instrument au service de calculs utilitaires préexistants.
- Certains Structuralismes : où la culture est un système de signes fermé, détaché de l'action et du contexte.
Dans ces approches, la culture est "faible" car dérivée ou instrumentalisée.

A ce titre, la Critique du Structuro-Fonctionnalisme de Talcott Parsons est un point de départ décisif ...
Alexander a en effet été formé dans la tradition parsonienne et a initialement contribué à sa défense (dans les années 1970 et début 1980). Il connaissait donc intimement ses forces et ses limites...
- L'échec à théoriser le Changement et le Conflit : Le modèle parsonien, centré sur l'équilibre, l'intégration et la stabilité, semblait incapable d'expliquer de manière convaincante les mouvements sociaux, les révolutions, ou les crises profondes (comme Mai 68 ou la guerre du Vietnam). Alexander y voyait une vision trop harmonieuse et conservatrice de l'ordre social.
- La Subordination de l'Acteur : L'acteur social dans le fonctionnalisme était largement passif, "sur-socialisé", déterminé par les rôles et les valeurs du système. Alexander voulait redonner une place centrale à l'action, au sens et à l'interprétation des individus et des groupes.
- La Faiblesse de la Culture : Bien que Parsons accordât une place importante aux valeurs et aux systèmes symboliques, la culture y était souvent réduite à une simple "boîte noire" intégratrice ou à un reflet des nécessités fonctionnelles du système. Elle manquait d'autonomie et de pouvoir causal explicite pour rendre compte des dynamiques sociales concrètes. Pour Alexander, c'était une "cultural sociology without culture" (une sociologie culturelle sans culture).
Dans les années 1980, Alexander a mené avec d'autres (comme Paul Colomy) un projet de "néo-fonctionnalisme". L'objectif était de moderniser et d'ouvrir le fonctionnalisme en intégrant le conflit et le changement, en donnant plus plus d' "agency" aux acteurs, et en dialoguant avec d'autres théories (interactionnisme, théorie critique). Alexander tentait encore de maintenir l'intuition centrale de Parsons sur la nécessité d'une théorie générale et systématique de la société, ainsi que sur l'importance des dimensions symboliques. Mais il fut rapidement évident que la culture ne pouvait pas être simplement "ajoutée" au modèle, et qu'elle nécessitait un fondement théorique radicalement différent ...

De l'Influence Décisive de Clifford Geertz et du "Tournant Interprétatif" - La rencontre avec l'anthropologie interprétative de Clifford Geertz a été une révélation pour Alexander.
1) La Culture comme Texte et Système de Sens : Geertz offrait une vision de la culture comme un système de significations publiquement accessible, nécessitant une interprétation dense ("thick description") pour être compris. La culture n'était plus une simple variable, mais le contexte même dans lequel l'action prenait sens.
2) L'Autonomie du Symbolique : Geertz démontrait l'efficacité propre des symboles et des récits dans l'organisation de l'expérience sociale, indépendamment (ou en interaction complexe avec) les structures matérielles.
3) L'Adaptation Sociologique : Alexander a vu dans l'approche de Geertz le fondement possible d'une sociologie culturelle véritablement autonome et interprétative, capable de combler les lacunes du fonctionnalisme tout en conservant son ambition de compréhension systémique. C'est cette synthèse entre l'ambition théorique générale (héritée de Parsons) et la méthode interprétative centrée sur le sens (héritée de Geertz) qui est au cœur du "Strong Program".

Clifford Geertz, "The Interpretation of Cultures" (1973)
(cf. traduction Gallimard, "Bali, interprétation d'une culture"). L'ouvrage fondateur de l’anthropologie interprétative, parfois appelée "symbolic anthropology".
Clifford Geertz (1926–2006) était un anthropologue américain, considéré comme l’un des penseurs les plus influents de l’anthropologie contemporaine. Ce recueil d’essais publiés principalement dans les années 1960 et début 1970, marque une rupture décisive dans l’anthropologie en popularisant la notion de « culture comme texte » et en défendant l’anthropologie interprétative.
Tout en étant parfois accusé de relativisme ou de "littérarisme", Geertz a largement contribué à réhabiliter la culture comme système symbolique vivant, invitant les chercheurs à « lire » les sociétés comme des textes denses, polémiques, contradictoires.
Geertz défend une vision symbolique et interprétative de la culture, qu’il définit comme un « ensemble de mécanismes de contrôle » (webs of significance) dans lequel les hommes sont pris. La culture n’est pas un ensemble de règles strictes ou un système clos ; elle est un texte qu’il faut lire et interpréter.
Geertz introduit la notion de "thick description", empruntée à Gilbert Ryle, et qui devient la pierre angulaire de l'anthropologie interprétative.
La "Thin description" (description « fine superficielle » ou « mince ») décrit ce qui est visible, les faits bruts, le comportement observable. La "Thick description" (description « épaisse » ou « dense ») interprète le geste, le situe dans un contexte culturel, et cherche la signification que ce geste a pour les acteurs eux-mêmes.
Cette distinction permet de replace le sens au cœur de l’analyse (Geertz part du principe que les actes humains ne sont pas « neutres » ou simplement mécaniques ; ils sont chargés de sens, façonnés par la culture) et rend possible une compréhension « de l’intérieur » (emic) : l’anthropologie classique (fonctionnaliste ou structuraliste) avait tendance à décrire « de l’extérieur » (approche etic), en cherchant des structures universelles ou des fonctions générales. Avec la thick description, Geertz veut se rapprocher du point de vue "indigène" (« native’s point of view »), comprendre comment les acteurs eux-mêmes interprètent et vivent leurs pratiques. Pour Geertz, la science sociale ne doit pas seulement expliquer pourquoi un comportement existe, mais ce qu’il signifie.
Son étude ethnographique du combat de coqs balinais constitue l'exemple le plus cité de la méthode interprétative de Geertz, une illustration vivante de sa "lecture" culturelle. Il montre que ces combats sont un "texte" collectif où les Balinais expriment des tensions sociales (hiérarchie, statut, honneur). Le combat de coqs n’est pas qu’un « loisir brutal » ; c’est un espace de symbolisation des structures sociales.
Dans "Religion as a Cultural System", Geertz refuse une explication purement psychologique ou fonctionnaliste (contrairement à Malinowski ou Radcliffe-Brown) et propose une théorie interprétative de la religion comme système symbolique, donnant sens à l’expérience humaine et ordonnant le chaos du monde. Il définit la religion comme une "forme d’expression" qui stabilise les sentiments d’incertitude et d’anxiété.
De même s’intéressera-t-il à la manière dont le pouvoir se construit rituellement, notamment à travers les cérémonies et la mise en scène symbolique (exemple : rois javanais), et introduit la notion de « théâtre d’État » (theatre state), que l'on retrouvera plus tard dans ses écrits.

La question Bourdieu - Tenter de concevoir le pouvoir explicatif de la culture en sociologie entraîne pour Alexander une confrontation directe avec Pierre Bourdieu. Celui-ci ne réduit-il pas en effet la culture à un instrument de domination...
Bourdieu analyse la culture comme un champ de luttes matérielles et symboliques où les dominants imposent leurs catégories de perception (habitus). La culture y est un capital (symbolique, culturel) au service de la reproduction sociale. Pour Alexander, cette approche réduit la culture à un instrument de pouvoir, niant son autonomie et sa capacité à générer du sens indépendamment des intérêts matériels. Il reproche ainsi à Bourdieu de perpétuer une vision déterministe (bien que sophistiquée) où la culture est toujours subordonnée aux structures sociales (champs).
Contre son réductionnisme, Alexander soutient que la culture n'est pas un reflet des structures et que les codes culturels (bien/mal, sacré/profane) ont une logique propre qui dépasse les intérêts de classe (cf. La lutte pour les droits civiques aux États-Unis a mobilisé des récits universels (justice, liberté) qui ne se réduisent pas à des stratégies de domination).
Et pour Alexander, l' "habitus bourdieusien" est trop mécanique et ignore la créativité interprétative des acteurs. Les individus ne sont pas que des produits de leur milieu ; ils performent activement des significations culturelles.
Geertz est mobilisé (symboliquement) contre Bourdieu. Là où Bourdieu voyait d’abord des rapports de force, Geertz (et Alexander) voient des systèmes de sens à décrypter. La culture crée du lien social avant d’être un outil de distinction. Alexander emprunte à Durkheim/Geertz l’idée que le sacré structure l’ordre social. Contrairement à Bourdieu (pour qui le sacré masque des rapports de domination), il y voit une force indépendante qui modèle les émotions collectives (cf. ses travaux sur les traumas nationaux).
Alexander va proposer de "règler" la question par une théorie de la performance. Pour dépasser l'opposition structure/action, il propose une "sociologie de la performance" inspirée du théâtre : les acteurs sociaux mettent en scène des récits culturels (ex: un discours politique, une commémoration) pour créer du sens et de la solidarité. Une performance réussie (successful performance) crée une "fusion" entre les codes culturels (ex: "démocratie") et l’expérience vécue. Elle peut transformer la réalité sociale (ex: le mouvement des droits civiques).
Ainsi ce n’est pas l’habitus qui agit, mais une agency collective nourrie par des ressources symboliques.
Si l'on prend pour exemple l'élection d'Obama élu en 2008, Bourdieu évoquera le résultat d’un capital symbolique acquis dans des champs (université, médias). Alexander la traduira en une performance réussie, celle du récit du "rêve américain" : Obama a incarné les codes de la rédemption nationale, activant des émotions collectives qui ont dépassé les clivages matériels.
Là où Bourdieu voit de la domination, Alexander voit de la signification. Là où l'un voit des stratégies, l'autre voit des récits...
Enfin, le Contexte Intellectuel des Années 1980-1990 invita aussi à une "Reconversion Culturelle" - Alexander a également été influencé par le "tournant culturel" (cultural turn) plus large dans les sciences sociales, qui réhabilitait l'étude des discours, des représentations, des identités et des émotions. La montée des théories du discours (Foucault), de l'analyse narrative (Ricœur), de la sémiotique et des études sur les performances a fourni des outils précieux pour développer son programme.

"Fin de siècle social theory : relativism, reduction, and the problem of reason" (1995)
L’ouvrage apparaît à une époque où la théorie sociale traverse une crise d'identité profonde, marquée par la montée du postmodernisme et le scepticisme radical. Alexander y propose une évaluation critique de l’état de la théorie sociale « fin de siècle », en ciblant particulièrement les tendances relativistes et réductionnistes.
La crise de la théorie sociale contemporaine - Alexander décrit un climat intellectuel dominé par le relativisme épistémologique, qui nie l’existence de vérités stables ou universelles. Il met en cause les théoriciens postmodernes (Lyotard, Baudrillard, etc.) pour leur rejet des grands récits et leur ironie permanente, qu’il juge stériles. Il évoque aussi les réductions sociobiologiques ou naturalistes (par exemple, les lectures évolutionnistes) qui réduisent les phénomènes sociaux à des causes biologiques ou matérialistes simples.
Alexander considère que cette posture relativiste, en attaquant la capacité humaine à raisonner collectivement, ouvre la voie à un nihilisme théorique dangereux. Il y répond en distinguant relativisme radical (tout est contingent, il n’y a aucune norme rationnelle universelle) et relativisme modéré (la connaissance est contextuelle mais pas nécessairement arbitraire). Il défend la possibilité d'une rationalité réflexive, non absolutiste, mais capable de justifier des jugements normatifs. Cette défense d’une « raison forte mais humble » (strong but humble reason) constitue le cœur philosophique du livre.
Alexander propose une théorie sociale ancrée dans la tradition herméneutique, inspirée notamment par Weber et Dilthey, mais aussi par Habermas. Il appelle à un dépassement des dichotomies classiques (subjectif/objectif, agent/structure) au profit d’une analyse relationnelle et dialogique, et insiste sur le rôle du langage, du symbolique et de la culture dans la construction du social.
Un manifeste pour redonner à la sociologie sa capacité à produire des vérités partielles mais solides ...
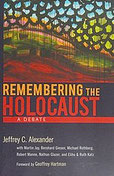
"On the Social Construction of Moral Universalism : The "Holocaust" from War Crime to Trauma Drama" (2001)
Cet article appartient à la phase "cultural sociology" d'Alexander, où il développe sa perspective sur le rôle des significations collectives dans la société. S'intéressant aux aux années d'après-guerre ayant suivi immédiatement la Shoah (qu'il désigne souvent par "Holocauste" entre guillemets pour souligner son statut de construction symbolique), il nous explique qu'elle n'était pas alors perçue à cette époque avec la même répulsion horrifiée qu'elle inspire désormais, et fort justement : dans les décennies qui suivent 1945, la Shoah est perçue surtout comme un crime contre un groupe spécifique, dans la logique des procès de Nuremberg; il s’agit alors d’une dimension "pénale" et "historico-politique", sans forte portée morale universelle. C'est que les Juifs d'Europe, en tant que groupe ethnique, étaient alors mal considérés dans nombre de sociétés, ce qui minorait toute compassion à l'égard des crimes dont ils furent les victimes.
Il fallu attendre leur intégration véritable pour que l'on commence à s'identifier à eux et à leur tragédie. Les structures culturelles nécessaires à la réévaluation de la Shoah en récit symbolique du mal absolu ne furent installées que plus tard. À partir des années 1960-1970 (procès Eichmann, série TV Holocaust, musées, mémoriaux), la Shoah commence à être construite comme un drame moral global, qui dépasse l’histoire juive ou européenne. Alexander parle d’un passage vers un "trauma drama", une structure narrative où les victimes incarnent l’innocence ultime, les bourreaux le mal radical, et les spectateurs sont invités à partager une émotion universelle. Et ce n’est pas le trauma historique qui "impose" sa signification, mais la société qui construit et reconstruit sans cesse le cadre moral qui le rend intelligible.
Ce passage du « crime » à la « catastrophe morale universelle » n’est donc pas automatique, loin de là, mais le résultat d’une construction sociale, portée par des acteurs, des discours, des rituels et des médiatisations.
Certains critiques (notamment historiens) jugeront qu'Alexander néglige la spécificité historique du génocide pour insister presque exclusivement sur sa construction discursive, au risque de paraître "relativiste" et de minimiser l’horreur objective de la Shoah (Alexander contestera fermement cette lecture).
Avec cet article, Alexander montre de façon exemplaire comment un événement historique se transforme en mythe moral universel, non pas en raison de sa seule magnitude, mais grâce à un travail social et culturel complexe. Il nous aide à comprendre pourquoi certaines violences deviennent des "traumas globaux" (Holocauste, 11 septembre, apartheid), tandis que d’autres restent localisées et invisibles dans l’imaginaire mondial.

Publication charnière (2003) : l'ouvrage collectif édité par Alexander, "The Meanings of Social Life: A Cultural Sociology", contient son manifeste fondateur : "The Strong Program in Cultural Sociology: Elements of a Structural Hermeneutics" (traduit en français sous le titre "Le programme fort en sociologie culturelle : Éléments d'une herméneutique structurelle").
Ce texte pose clairement les quatre principes et le nom du programme...
"Modern men and women go about their lives without really knowing why. Why do we work for such a long time every day? Why do we finish one war only to fight another? Why are we so obsessed with technology? Why do we live in an age of scandal? Why do we feel compelled to honor those, like the victims of the Holocaust, who have been murdered for an unjust cause?
If we had to explain these things, we would say “it just makes sense” or “it’s necessary” or “it’s what good people do.” But there is nothing natural about any of this. People don’t naturally do any of these things. We are compelled to be this way.
We are not anywhere as reasonable or rational or sensible as we would like to think. We still lead lives dictated more by unconscious than conscious reason. We are still compelled by feelings of the heart and the fearful instincts of the gut.
America and its allies are waging today a war against terrorism. This is said to be necessary and rational, a means to attain the end of safety. Is the war against terrorism only this, or even primarily this? No, for it rests on fantasy as much as on fact. The effort to protect the people of the United States and Europe is shrouded in the rhetoric of good and evil, of friends and enemies, of honor, conscience, loyalty, of God and country, of civilization and primeval chaos. These are not just ideas. They are feelings, massive ones. Our leaders evoke these rhetorics in solemn tones, and we honor the victims of terrorism in the most rhetorical of benedictions.
These rhetorics are cultural structures. They are deeply constraining but also enabling at the same time. The problem is that we don’t understand them. This is the task of a cultural sociology. It is to bring the unconscious cultural structures that regulate society into the light of the mind. Understanding may change but not dissipate them, for without such structures society cannot survive. We need myths if we are to transcend the banality of material life. We need narratives if we are to make progress and experience tragedy. We need to divide the sacred from profane if we are to pursue the good and protect ourselves from evil.
Of course, social science has always assumed that men and women act without full understanding. Sociologists have attributed this to the force of social structures that are “larger” and more “powerful” than mere individual human beings.
They have pointed, in other words, to the compulsory aspects of social life.
But what fascinates and frightens me are those collective forces that are not compulsory, the social forces to which we enthusiastically and voluntarily respond. If we give our assent to these, without knowing why, it is because of meaning. Materialism is not forced on us. It is also a romance about the sacrality of things. Technology is not only a means. It is also an end, a desire, a lust, a salvationary belief. People are not evil, but they are made to be. Scandals are not born from the facts but constructed out of them, so that we can purify ourselves. We do not mourn mass murder unless we have already identified with the victims, and this only happens once in a while, when the symbols are aligned in the right way.
The secret to the compulsive power of social structures is that they have an inside. They are not only external to actors but internal to them. They are meaningful. These meanings are structured and socially produced, even if they are invisible. We must learn how to make them visible. For Freud, the goal of psychoanalysis was to replace the unconscious with the conscious: “Where Id was, Ego shall be.” Cultural sociology is a kind of social psychoanalysis. Its goal is to bring the social unconscious up for view. To reveal to men and women the myths that think them so that they can make new myths in turn. "
"« Les hommes et femmes modernes mènent leur existence sans vraiment en comprendre les raisons. Pourquoi travaillons-nous si longtemps chaque jour ? Pourquoi achevons-nous une guerre pour en entamer une autre ? Pourquoi cette obsession pour la technologie ? Pourquoi vivons-nous à une époque de scandales ? Pourquoi nous sentons-nous obligés d'honorer ceux, comme les victimes de la Shoah, qui ont été assassinés pour une cause injuste ?
Si nous devions expliquer ces choses, nous dirions "c'est logique", "c'est nécessaire" ou "c'est ce que font les gens bien". Mais rien de tout cela n'est naturel. Les humains ne font naturellement aucune de ces choses. Nous y sommes contraints.
Nous sommes loin d'être aussi raisonnables, rationnels ou sensés que nous aimons le croire. Nous menons encore des vies dictées davantage par la raison inconsciente que consciente. Nous sommes encore mus par les sentiments du cœur et les instincts craintifs du ventre.
L'Amérique et ses alliés mènent aujourd'hui une guerre contre le terrorisme. On dit cela nécessaire et rationnel, un moyen d'atteindre la sécurité. Cette guerre contre le terrorisme n'est-elle que cela, ou même principalement cela ? Non, car elle repose autant sur le fantasme que sur les faits. L'effort pour protéger les peuples des États-Unis et d'Europe est enveloppé dans la rhétorique du bien et du mal, des amis et des ennemis, de l'honneur, de la conscience, de la loyauté, de Dieu et de la patrie, de la civilisation et du chaos primitif. Ce ne sont pas que des idées. Ce sont des sentiments, des sentiments puissants. Nos leaders évoquent ces rhétoriques sur des tons solennels, et nous honorons les victimes du terrorisme par les bénédictions les plus chargées de rhétorique.
Ces rhétoriques sont des structures culturelles. Elles sont profondément contraignantes, mais aussi libératrices à la fois. Le problème est que nous ne les comprenons pas. Telle est la tâche d'une sociologie culturelle. C'est de faire passer les structures culturelles inconscientes qui régulent la société sous la lumière de l'esprit. La compréhension peut les changer mais non les dissiper, car sans de telles structures, la société ne peut survivre. Nous avons besoin de mythes pour transcender la banalité de la vie matérielle. Nous avons besoin de récits pour progresser et vivre la tragédie. Nous devons séparer le sacré du profane pour poursuivre le bien et nous protéger du mal.
Bien sûr, les sciences sociales ont toujours postulé que les hommes et les femmes agissent sans pleine compréhension. Les sociologues ont attribué cela à la force des structures sociales, "plus vastes" et plus "puissantes" que de simples individus humains.
Ils ont pointé, en d'autres termes, les aspects contraignants de la vie sociale.
Mais ce qui me fascine et m'effraie, ce sont ces forces collectives qui ne sont pas contraignantes, ces forces sociales auxquelles nous répondons avec enthousiasme et volonté. Si nous donnons notre assentiment à celles-ci, sans savoir pourquoi, c'est à cause du sens. Le matérialisme ne nous est pas imposé. C'est aussi une romance sur la sacralité des choses. La technologie n'est pas seulement un moyen. C'est aussi une fin, un désir, une convoitise, une croyance salvatrice. Les gens ne sont pas mauvais par nature, mais on les y contraint. Les scandales ne naissent pas des faits mais sont construits à partir d'eux, afin que nous puissions nous purifier. Nous ne pleurons pas les meurtres de masse à moins de nous être déjà identifiés aux victimes, et cela n'arrive qu'occasionnellement, lorsque les symboles s'alignent comme il faut.
Le secret du pouvoir contraignant des structures sociales est qu'elles ont un intérieur. Elles ne sont pas seulement extérieures aux acteurs, elles leur sont aussi intérieures. Elles sont signifiantes. Ces significations sont structurées et socialement produites, même si elles sont invisibles. Nous devons apprendre à les rendre visibles. Pour Freud, le but de la psychanalyse était de remplacer l'inconscient par le conscient : « Là où était le Ça, le Moi doit advenir ». La sociologie culturelle est une sorte de psychanalyse sociale. Son but est de mettre en lumière l'inconscient social. De révéler aux hommes et aux femmes les mythes qui les pensent afin qu'ils puissent à leur tour créer de nouveaux mythes. »
"In the middle 1980s, in the lunch line at the UCLA Faculty Center, I was engaging three sociology colleagues in a heated debate. An assistant professor was struggling for tenure, and the faculty were lining up pro and con. Those skeptical of the appointment objected that the candidate’s work could not even be called sociology. Why not, I asked? He was not sociological, they answered: He paid more attention to the subjective framing and interpreting of social structures than to the nature of those social structures themselves. Because he had abandoned social-structural causality, he had given up on explanation, and thus on sociology itself. I countered: While his work was indeed different, it remained distinctly sociological. I suggested that it might possibly be seen as a kind of “cultural” sociology.
This remark did not succeed in its intended effect. Instead it generated a kind of incredulity—at first mild snickers, then guffaws, and then real belly laughs. Cultural sociology? my colleagues scoffed. This idea struck them not only as deeply offensive to their disciplinary sense but intellectually absurd. The very phrase “cultural sociology” seemed an oxymoron. Culture and sociology could not be combined as adjective and noun. If there were a sociological approach to culture, it should be a sociology of culture. There certainly could not be a cultural approach to sociology.
My colleagues were right about the present and the past of our discipline, but events did not prove them prescient about its future. In the last fifteen years, a new and specifically cultural approach to sociology has come into existence. It never existed before—not in the discipline’s first hundred and fifty years. Nor has such a cultural approach been present in the other social sciences that have concerned themselves with modern or contemporary life.
In the history of the social sciences there has always been a sociology of culture. Whether it had been called the sociology of knowledge, the sociology of art, the sociology of religion, or the sociology of ideology, many sociologists paid respect to the significant effects of collective meanings. However, these sociologists of culture did not concern themselves primarily with interpreting collective meanings, much less with tracing the moral textures and delicate emotional pathways by which individuals and groups come to be influenced by them. Instead, the sociology-of approach sought to explain what created meanings; it aimed to expose how the ideal structures of culture are formed by other structures—of a more material, less ephemeral kind.
By the mid-1980s, an increasing if still small number of social scientists had come to reject this sociology-of approach. As an enthusiastic participant in this rejection, I, too, accused sociology of basic misunderstanding, one that continues to hobble much of the sociological investigation into culture today. To recognize the immense impact of ideals, beliefs, and emotions is not to surrender to an (unsociological) voluntarism. It is not to believe that people are free to do as they will. It is not to lapse into the idealism against which sociology should indeed define itself, nor the wish-fulfilling moralism to which it is a welcome antidote. Cultural sociology can be as hardheaded and critical as materialistic sociology. Cultural sociology makes collective emotions and ideas central to its methods and theories precisely because it is such subjective and internal feelings that so often seem to rule the world. Socially constructed subjectivity forms the will of collectivities; shapes the rules of organizations; defines the moral substance of law; and provides the meaning and motivation for technologies, economies, and military machines.
But if idealism must be avoided, the facts of collective idealization must not be. In our postmodern world, factual statements and fictional narratives are densely interwoven. The binaries of symbolic codes and true/false statements are implanted one on the other. Fantasy and reality are so hopelessly intertwined that we can separate them only in a posthoc way. It was the same in modern society. In this respect, little has changed since traditional life. Classical and modern sociologists did not believe this to be true. They saw the break from the irrationalities” of traditional society as radical and dichotomous. One needs to develop an alternative, more cultural sociology because reality is not nearly as transparent and rational as our sociological forefathers believed.
My sensitivity to this reality, and my ability to understand it, has been mediated by a series of critical intellectual events: the linguistic turn in philosophy, the rediscovery of hermeneutics, the structuralist revolution in the human sciences, the symbolic revolution in anthropology, and the cultural turn in American historiography. Behind all these contemporary developments has been the continuing vitality of psychoanalytic thinking in both intellectual and everyday life. It has been in response to these significant movements in our intellectual environment that the slow, uneven, but nevertheless steadily growing strand of a genuinely cultural sociology has developed.
These essays do not aim at building a new model of culture. They do not engage in generalizing and deductive theory. In this respect they are postfoundational. I see them, rather, to borrow from Merleau-Ponty, as adventures in the dialectics of cultural thought. They move back and forth between theorizing and researching, between interpretations and explanations, between cultural logics and cultural pragmatics. They enter into interpretive disputes with some of the exemplars of classical, modern, and postmodern thinking. ..."
"« Au milieu des années 1980, dans la file d'attente du déjeuner au Faculty Center de l'UCLA, je débattais vivement avec trois collègues sociologues. Un professeur assistant luttait pour obtenir sa titularisation, et la faculté se rangeait pour ou contre. Les sceptiques objectaient que le travail du candidat ne pouvait même pas être qualifié de sociologie. Pourquoi pas ? demandai-je. Il n'est pas sociologique, répondirent-ils : il accordait plus d'attention au cadrage subjectif et à l'interprétation des structures sociales qu'à la nature de ces structures elles-mêmes. En abandonnant la causalité socio-structurelle, il avait renoncé à l'explication, donc à la sociologie elle-même. Je rétorquai : bien que son travail fût effectivement différent, il restait distinctement sociologique. Je suggérai qu'on pourrait peut-être y voir une sorte de sociologie « culturelle ».
Cette remarque n'eut pas l'effet escompté. Elle suscita plutôt une incrédulité – d'abord des ricanements discrets, puis des éclats de rire, et enfin de francs rires gras. Sociologie culturelle ? ricanèrent mes collègues. Cette idée leur parut non seulement profondément offensante pour leur sens disciplinaire, mais intellectuellement absurde. L'expression même de « sociologie culturelle » semblait un oxymore. Culture et sociologie ne pouvaient s'associer comme adjectif et nom. S'il existait une approche sociologique de la culture, ce devrait être une sociologie de la culture. Il ne pouvait certainement pas exister une approche culturelle de la sociologie.
Mes collègues avaient raison sur le présent et le passé de notre discipline, mais les événements ne leur donnèrent pas raison quant à son avenir. Ces quinze dernières années, une nouvelle approche sociologique spécifiquement culturelle a vu le jour. Elle n'avait jamais existé auparavant – pas durant les cent cinquante premières années de la discipline. Une telle approche culturelle n'avait pas non plus été présente dans les autres sciences sociales s'intéressant à la vie moderne ou contemporaine.
Dans l'histoire des sciences sociales, il y a toujours eu une sociologie de la culture. Qu'elle s'appelât sociologie de la connaissance, sociologie de l'art, sociologie de la religion ou sociologie de l'idéologie, beaucoup de sociologues reconnaissaient les effets significatifs des significations collectives. Cependant, ces sociologues de la culture ne se préoccupaient pas principalement d'interpréter les significations collectives, encore moins de retracer les textures morales et les chemins émotionnels subtils par lesquels les individus et les groupes en viennent à être influencés. Au lieu de cela, l'approche "sociologie-de" cherchait à expliquer ce qui créait les significations ; elle visait à exposer comment les structures idéelles de la culture sont formées par d'autres structures – d'une nature plus matérielle, moins éphémère.
Vers le milieu des années 1980, un nombre croissant, bien que restreint, de scientifiques sociaux en étaient venus à rejeter cette approche "sociologie-de". Enthousiaste participant de ce rejet, j'accusai moi aussi la sociologie d'un malentendu fondamental, qui continue d'entraver aujourd'hui une grande partie de la recherche sociologique sur la culture. Reconnaître l'impact immense des idéaux, des croyances et des émotions n'est pas capituler devant un volontarisme (non sociologique). Ce n'est pas croire que les gens sont libres d'agir à leur guise. Ce n'est pas sombrer dans l'idéalisme contre lequel la sociologie doit effectivement se définir, ni dans le moralisme de la réalisation des désirs dont elle est un antidote bienvenu. La sociologie culturelle peut être aussi pragmatique et critique que la sociologie matérialiste. La sociologie culturelle place les émotions et les idées collectives au cœur de ses méthodes et théories précisément parce que ce sont ces sentiments subjectifs et internes qui semblent si souvent régir le monde. La subjectivité socialement construite forme la volonté des collectivités ; façonne les règles des organisations ; définit la substance morale du droit ; et fournit le sens et la motivation aux technologies, aux économies et aux machines militaires.
Mais si l'idéalisme doit être évité, il ne faut pas pour autant ignorer les faits de l'idéalisation collective. Dans notre monde postmoderne, les énoncés factuels et les récits fictionnels sont étroitement tissés ensemble. Les binaires des codes symboliques et des énoncés vrai/faux sont enchâssés l'un dans l'autre. Fantasme et réalité sont si désespérément entremêlés que nous ne pouvons les séparer qu'a posteriori. Il en était de même dans la société moderne. À cet égard, peu de choses ont changé depuis la vie traditionnelle. Les sociologues classiques et modernes ne croyaient pas cela vrai. Ils voyaient la rupture avec les « irrationalités » de la société traditionnelle comme radicale et dichotomique. Il faut développer une sociologie alternative, plus culturelle, parce que la réalité est loin d'être aussi transparente et rationnelle que nos pères fondateurs sociologues ne l'ont cru.
Ma sensibilité à cette réalité, et ma capacité à la comprendre, ont été médiatisées par une série d'événements intellectuels critiques : le tournant linguistique en philosophie, la redécouverte de l'herméneutique, la révolution structuraliste dans les sciences humaines, la révolution symbolique en anthropologie et le cultural turn dans l'historiographie américaine. Derrière tous ces développements contemporains se trouve la vitalité persistante de la pensée psychanalytique, tant dans la vie intellectuelle que quotidienne. C'est en réponse à ces mouvements significatifs de notre environnement intellectuel que s'est développé le courant lent, inégal mais néanmoins régulièrement croissant d'une sociologie culturelle authentique.
Ces essais ne visent pas à construire un nouveau modèle de la culture. Ils ne s'engagent pas dans une théorie généralisante et déductive. En cela, ils sont post-fondationnels. Je les vois plutôt, pour emprunter à Merleau-Ponty, comme des aventures dans la dialectique de la pensée culturelle. Ils vont et viennent entre théorisation et recherche, entre interprétations et explications, entre logiques culturelles et pragmatiques culturelles. Ils entrent dans des disputes interprétatives avec certains représentants de la pensée classique, moderne et postmoderne. »
(...)
Quatre principes ...
1) L'Autonomie de la Culture (Autonomy of Culture) : La culture n'est pas réductible à des facteurs sociaux non-culturels. Elle a sa propre logique et sa propre dynamique.
2) L'Impératif de l'Interprétation (Hermeneutic Imperative) : Comprendre la culture nécessite une interprétation profonde (herméneutique) des codes, récits et symboles, au-delà de l'analyse de surface.
3) L'Engagement avec la Contingence (Engagement with Contingency) : Les significations culturelles sont contextualisées, contestées et sujettes au changement. Il n'y a pas de déterminisme culturel absolu.
4) La Responsabilité Causale (Causal Responsibility) : La culture a un pouvoir causal réel et doit être intégrée comme une variable explicative centrale dans les analyses sociologiques des phénomènes sociaux (mouvements sociaux, démocratie, traumatismes collectifs, etc.).
A ces 4 principes peuvent être rattachées 3 ruptures épistémologiques fondamentales ...
- contre tout réductionnisme : le refus d'expliquer le culturel par le non-culturel (économie, pouvoir).
- pour une sociologie compréhensive : comprendre pourquoi les gens agissent, expliquer comment ils agissent.
- la culture comme "structure profonde" : les codes culturels informent les institutions (droit, politique, médias).

"The Civil Sphere" (2006)
Un tournant majeur dans la sociologie culturelle interprétative. En plaçant les significations symboliques au cœur des conflits politiques, Alexander va renouveler l’étude de la solidarité, de l’exclusion et des transformations morales des sociétés contemporaines. Son influence persiste dans les débats sur le populisme, les identités, et l'espace public numérique...
L'intention centrale de Jeffrey Alexander dans "The Civil Sphere" (2006) et ses prolongements régionaux ("The Civil Sphere in Latin America", "The Civil Sphere in East Asia", "Populism in the Civil Sphere") est de proposer une théorie générale de la démocratie moderne centrée sur le concept de "sphère civile", conçue comme un espace symbolique et institutionnel autonome où se construit la solidarité universelle et où s'affrontent les forces de l'inclusion et de l'exclusion. Il cherche à comprendre comment les sociétés démocratiques génèrent (ou échouent à générer) du lien social au-delà des particularismes, et comment ce processus est miné par les tensions structurelles de la modernité ...

Alexander ne s'intéresse pas à l'origine historique de la démocratie, mais à sa logique interne de fonctionnement dans les sociétés modernes, une logique destinée à produire de la solidarité, de l'inclusion et de l'universel, et ce principalement par la culture.
- c'est par par le partage de significations morales que se constituent les collectifs
- c'est de la performance symbolique que naît la cohésion social
- ce n'est certes pas les seules conditions socio-économiques que peut être dérivée une solidarité.
C'est bien la Culture qui assure le processus permanent d'inclusion, de fragmentation et d'intégration, du moteur démocratique, assurant, par exemple,
- un équilibre entre forces intégratrices (appels à l'universalisme, justice sociale, reconnaissance) et forces désintégratrices (populisme, exclusion des "élites corrompues" ou des "étrangers"), fondamentalismes).
- la dramatisation des exclusions comme "scandales civiques".
- le re-codage des revendications en termes universels ("l'égalité pour tous").
- et les performances rituelles (manifestations, commémorations) incarnant l'idéal démocratique.
L'intention n'est pas ici matérielle ni économique ni sociale, mais symbolique et politique. La démocratie ne vit pas par ses institutions ou ses connotations emblématiques. Les institutions (médias, tribunaux, Parlement) sont les scènes où se joue le drame démocratique, mais n'en sont pas le moteur : ce sont les récits qui le sont, elles n'en sont que le théâtre nécessaire.
Des récits naissent un idéal partagé. Ce sont ces récits qui soutiennent l'institutionnel, l'économique, le social et la liberté, et non l'inverse.
Ce qui est en fin de compte en jeu, c'est de permettre à cet idéal toujours inachevé et fragile, qu'est la démocratie, générant par ailleurs ses propres démons et pathologies, de se reconstruire sans cesse par le conflit culturel.

La force du modèle d’Alexander réside dans sa capacité à penser la société comme une sphère morale et narrative, réactivant et radicalisant Durkheim et son idée de solidarité organique ...
Pour Durkheim (notamment dans "De la division du travail social" (1893), la solidarité organique désigne la cohésion des sociétés modernes, fondée sur la différenciation fonctionnelle et l’interdépendance (contrairement à la solidarité mécanique, basée sur la similarité et les croyances communes dans les sociétés traditionnelles). Cette solidarité organique suppose l’existence d’un système de valeurs partagées, mais ces valeurs sont moins explicites, plus pluralistes et s’appuient sur l’interdépendance des rôles.
Chez Alexander, la cohésion sociale dans les sociétés modernes n’est plus seulement assurée par l’interdépendance économique ou fonctionnelle, mais aussi - et surtout - par un univers symbolique partagé, qu’il appelle la sphère civile, un espace moral et symbolique autonome, qui produit un imaginaire de la solidarité, fondé sur des narrations, des rituels et des performances culturelles (par ex., cérémonies civiques, médias, représentations artistiques). Il insiste sur la capacité de la sphère civile à fabriquer une solidarité inclusive, même dans des sociétés très différenciées et conflictuelles.
Contrairement à Durkheim, qui voyait les valeurs collectives comme relativement stables et "données", Alexander montre qu’elles sont constamment mises en scène, discutées, disputées (dans The Civil Sphere (2006), il analyse comment les mouvements pour les droits civiques aux États-Unis ont reconfiguré la solidarité nationale, en intégrant progressivement des groupes exclus). Et plus encore lorsque Alexander introduit une logique dramatique : la société se met en scène, "joue" sa cohésion via des drames publics. Ce qu’il appelle "dramas civiques" (civic dramas) : moments où la société débat publiquement de ses valeurs, souvent à travers les médias ou des procès symboliques (par ex., procès O.J. Simpson, destitution de Clinton). Dans ces drames, on met en opposition des figures "pures" et "impures", on réaffirme des codes moraux partagés.
Chez Durkheim, la solidarité organique repose surtout sur la division du travail et une morale collective diffuse. Chez Alexander, la solidarité devient une construction symbolique consciente et active, au centre de l’espace public (la "civil sphere"). Au lieu de considérer les valeurs comme héritées ou imposées, il les conçoit comme créées, négociées, médiatisées, souvent dans une logique narrative et dramatique. On passe donc d’une "solidarité structurelle" (Durkheim) à une solidarité performative et discursive (Alexander).
Durkheim n’a pas seulement influencé Alexander via "De la division du travail social" (solidarité organique), mais aussi - et de manière centrale - via "Les formes élémentaires de la vie religieuse" (1912). La religion n’est pas (ou pas seulement) un système de croyances surnaturelles : elle est avant tout un système symbolique, un ensemble de représentations collectives qui créent et réaffirment la cohésion sociale. Alexander s’en inspire de façon décisive ...
Dans "The Civil Sphere" (2006), Alexander reprend explicitement l’idée durkheimienne de la sacralisation, mais il la transpose à la vie politique et publique moderne. La sphère civile fonctionne pour lui comme une "religion laïque" : elle repose sur des idéaux sacrés (liberté, égalité, inclusion), mis en scène par des rituels symboliques (médias, procès, commémorations). Comme chez Durkheim, les rituels sont essentiels pour créer ou restaurer la cohésion collective. Alexander parle de "civil rituals" (par ex., funérailles d’État, cérémonies présidentielles, procès médiatisés) qui réaffirment l’unité morale d’une société. Ces rituels fonctionnent à la manière des rites religieux : ils mobilisent des symboles sacrés, identifient le pur et l’impur, mettent en scène des "sacrifices" ou des "expulsions". C'est dire que même dans les sociétés laïques et modernes, les mécanismes religieux (sacralisation, rituels, mythes) continuent d’organiser la solidarité.On passe ainsi de la religion comme institution autonome à la "religiosité civile" diffuse et omniprésente dans la vie politique et médiatique.
Le lien démocratique est donc d'abord culturel et moral...
A contrario de ce qu'ont soutenu les théories réductionnistes,
- Le marxisme (la solidarité n'est pas un effet de classe).
- Le libéralisme utilitariste (la démocratie n'est pas un marché d'intérêts).
L'apport de la sociologie des médias complète cette approche :
Les études sur les "drames sociaux" (scandales politiques, mouvements sociaux) montrent que l'inclusion / exclusion se joue dans des batailles narratives médiatisées (ex: la lutte des droits civiques comme récit de "victimes civiles" vs "barbares racistes").

Une mécanique centrale anime ainsi la démocratie, la sphère civile comme arène symbolique
a) Un système culturel autonome
Alexander modélise la sphère civile comme un univers sémiotique structuré par des codes binaires ouverture/fermeture, raison/passion, égalité/hiérarchie. Ces codes définissent qui est "digne d'appartenance".
b) Un processus d'inclusion, en charge du travail de traduction
L'inclusion n'est pas automatique : elle exige un travail culturel actif, une dramatisation (un groupe marginalisé (Noirs, femmes, immigrés) peut être présenté comme une victime de l'incivilité), un codage civil (ses demandes doivent être traduites dans le langage des valeurs civiles (ex: "Les droits des LGBT sont l'égalité en action"). L'ensemble est alors agencé en performances de solidarité : rituels (marches, commémorations) et récits médiatiques qui incarnent l'universel (ex: le mouvement #BlackLivesMatter).
c) Une dialectique inclusion/exclusion sans fin
La sphère civile produit toujours de l'exclusion : en définissant le "civil", elle crée son contraire ("l'incivil"). Ainsi le populisme diabolise les élites comme "corrompues" (inciviles) pour inclure un "peuple" idéalisé.
Alexander conçoit la sphère civile comme une arène de solidarité universelle distincte de l'État, du marché, de la famille et des communautés religieuses/ethniques. C'est un espace régulé par des codes culturels démocratiques (liberté, égalité, rationalité, tolérance) qui définissent qui mérite d'être inclus comme membre légitime de la communauté.
L'objectif du sociologue est de montrer que la démocratie ne repose pas seulement sur des institutions formelles, mais sur un travail culturel permanent de traduction des luttes sociales (racisme, genre, pauvreté, etc.) en termes compatibles avec les codes de la sphère civile. Les groupes marginalisés (Noirs, femmes, minorités) doivent être "re-codés" comme victimes légitimes dont l'exclusion viole les valeurs civiles universelles.
Alexander souligne que la sphère civile est en tension permanente avec les autres sphères (marché, religion, État bureaucratique). Son intention est de modéliser ces relations dialectiques : la sphère civile régule les autres sphères (ex : lois contre les discriminations), mais est aussi corrompue par leurs logiques (ex : capitalisme générant des inégalités incompatibles avec la solidarité).
Avec "The Civil Sphere", Alexander propose une théorie ambitieuse de l'intégration démocratique par la culture, prolongée par des études comparatives pour en prouver la pertinence globale. Son intention ultime est de fournir un cadre pour repenser l'émancipation dans des sociétés fracturées, en prenant au sérieux le pouvoir des idéaux universels - sans ignorer leurs limites et leurs détournements.
- La légitimité repose sur des performances symboliques : les acteurs (médias, politiques, mouvements sociaux) doivent incarner les valeurs civiles par des récits, rituels et mises en scène persuasives. Les scandales révèlent les écarts entre idéal civique et réalité.
- Mais il est nécessaire d'adapter le cadre de la sphère civile à des régions où l'État, la religion ou le communautarisme ont un poids différent, de même faut-il étudier comment le colonialisme, les dictatures ou les traditions hiérarchiques entravent ou réorientent les idéaux civils dans ces régions.
- "Populism in the Civil Sphere" (2023, avec des co-auteurs) ...
Comprendre le populisme comme pathologie de la sphère civile :
Le populisme n'est pas un rejet de la démocratie, mais une reconfiguration perverse de ses codes. Il utilise les valeurs civiles (appel au "peuple", dénonciation de la corruption) pour exclure des groupes (élites, immigrés) présentés comme "anti-civils". Alexander défend que seule une réactivation des idéaux inclusifs de la sphère civile peut contrer le populisme, et non un retour au technocratisme ou au libéralisme élitiste.

Des limitations du modèle de "spère civile" d'Alexander ...
Alexander insiste beaucoup sur la capacité intégrative des rituels et "dramas civiques" (civil dramas). Il suppose que la sphère civile peut restaurer ou renforcer la solidarité morale en société. Cette perspective peut apparaître trop optimiste, voire idéalisée...
- Dans la réalité, beaucoup d’exclusions persistent (inégalités raciales, économiques, postcoloniales) malgré ces rituels. La sphère civile peut aussi être cooptée par des intérêts privés ou être profondément polarisée (exemple des États-Unis aujourd’hui). Craig Calhoun (2007, "Nations Matter: Culture, History, and the Cosmopolitan Dream", Routledge)) souligne qu’Alexander sous-estime la profondeur des clivages structurels et économiques qui divisent les sociétés contemporaines, et surestime la capacité de la communication morale à les résoudre
- La sociologie culturelle d'Alexander met quasi exclusivement l’accent sur les significations, narrations et performances symboliques, au risque de négliger la matérialité des rapports sociaux : conditions économiques, modes de production, luttes de classes, infrastructures matérielles. Les dynamiques de domination ou d’exploitation économique sont souvent évoquées très superficiellement ou en termes symboliques.
- Alexander radicalise la perspective interprétative (héritée de Geertz), ce qui l'amène à voir presque tout en termes de "dramas", "scripts" et "rituels" : au risque d'une "sur-interprétation". Tout devient texte à lire, parfois au détriment des expériences matérielles vécues ou en sous-estimant des logiques d’action non scriptées ou non médiatisées.
- Alexander met en avant la capacité des rituels civiques à rétablir la solidarité et à résoudre les crises symboliques. Mais beaucoup de rituels échouent ou produisent l’effet inverse (exacerbation des fractures, rejet, polarisation accrue). Les "failures of performance" sont souvent sous-analysées. Philip Smith (2010, "Why War? The Cultural Logic of Iraq, the Gulf War, and Suez", University of Chicago Press) souligne que les échecs des rituels et des performances ne sont pas juste "accidentels", mais révélateurs des contradictions structurelles de la sphère civile.

"Performance and Power" (2011)
La scène politique (et sociale en général) est avant tout un espace symbolique et émotionnel. Les dirigeants, militants ou artistes ne « possèdent » pas le pouvoir, ils le construisent par une performance acceptée.
Une approche qui permet de comprendre pourquoi certaines figures politiques réussissent à créer un mouvement populaire durable, quand d’autres échouent malgré des ressources économiques ou militaires importantes ...
Dans "Performance and Power", Jeffrey C. Alexander développe sa théorie de la « performance sociale », prolongement de sa sociologie culturelle (notamment Cultural Pragmatics).
Son objectif est de montrer que le pouvoir, loin d’être purement instrumental ou coercitif, est profondément dépendant de la capacité à « bien performer » devant un public social. L'ouvrage examine les conditions sous lesquelles une performance sociale (qu’elle soit politique, religieuse, artistique ou quotidienne) peut réussir à générer du pouvoir ou, au contraire, échouer.
Performance sociale : toute action sociale visant à persuader ou à influencer un public par des signes symboliques, des gestes, des discours, et des rituels. Les performances peuvent être spontanées ou très scénarisées, mais elles visent toujours à établir une connexion crédible entre acteurs et spectateurs.
Alexander identifie plusieurs dimensions cruciales pour une performance « réussie » :
- la Sincérité perçue : les acteurs doivent paraître authentiques et cohérents avec les valeurs qu’ils prétendent incarner.
- des scripts et desrécits puissants : la performance doit s’appuyer sur des récits culturels partagés (ex. : mythes nationaux, valeurs démocratiques).
- des symboles et objets rituels : la mise en scène s’appuie sur des artefacts, des lieux, des drapeaux, des chants, etc., pour renforcer la charge affective.
- l'existence d'une compétence dramaturgique : les acteurs doivent maîtriser le « code » culturel de la performance (gestes, langage, posture) pour convaincre.
- des fusions réussies entre acteurs et public : ce qu’Alexander appelle « fusion » (fusion) : lorsque le public accepte la performance comme vérité et se sent directement impliqué.
- Du lien entre performances et pouvoir : le pouvoir n’est pas une « substance » préexistante mais un effet performatif. Par exemple, un leader politique n’a de pouvoir que s’il arrive à convaincre la société (public) de la légitimité de ses actes ou de sa vision. Les institutions (justice, armée, médias) sont elles-mêmes dépendantes d’une performance permanente de légitimité.
Alexander illustre sa théorie par plusieurs exemples contemporains ou historiques, notamment :
- La présidence américaine (analyses de Ronald Reagan et Barack Obama comme des «performeurs» charismatiques).
- Les mouvements sociaux (mouvements pacifistes, antinucléaires, etc.).
- Le monde artistique (artistes contemporains et musiciens).
-Les crises de crédibilité (affaires politiques ou scandales où les leaders échouent à maintenir la fusion avec le public).
- La rupture entre "fusion" et "dédoublement" : quand la performance échoue, la « fusion » se rompt. Les spectateurs deviennent sceptiques, voient la « mécanique » de la mise en scène, et la confiance s’effondre. Exemple : le scandale du Watergate (Nixon) où l’échec dramaturgique a entraîné la perte du pouvoir symbolique.
Alexander propose une synthèse entre la sociologie dramaturgique (Goffman) et la sociologie culturelle (Durkheim, Parsons), tout en la réactualisant dans le contexte médiatique contemporain. Il insiste sur le rôle des émotions et des symboles, et pas seulement des intérêts ou des structures économiques. Il montre que le pouvoir n’est jamais purement coercitif, mais toujours co-produit par les spectateurs (public). Réhabilitation du rôle de la culture et des symboles dans l’exercice du pouvoir...
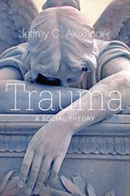
"Trauma : A Social Theory" (2012)
L'intention centrale de Jeffrey Alexander dans "Trauma: A Social Theory" (2012) est de développer une théorie sociologique générale et systématique du trauma collectif, en démontrant que celui-ci n'est pas une réaction naturelle ou individuelle à un événement violent, mais le résultat d'un processus culturel actif de construction sociale.
Proposant plusieurs exemples, - 9/11, la guerre du Vietnam, la Shoah, l’Afrique du Sud post-apartheid-, il cherche à établir un cadre théorique robuste pour comprendre comment les sociétés transforment des événements historiques en "traumas culturels" porteurs de significations morales profondes et structurantes. (cf. "cultural trauma theory", amorcée dans ses travaux antérieurs, "Cultural Trauma and Collective Identity", 2004).
Le trauma comme construction culturelle : ce n'est pas l'événement lui-même qui crée le trauma, mais le travail culturel intense qui l'interprète, le représente et le diffuse comme un événement traumatique fondamental pour l'identité du groupe. Alexander entend démontrer que la désignation d'un événement comme "traumatique" pour un groupe entier (nation, ethnie, communauté) est le fruit d'un processus actif, conflictuel et souvent long, mené par des "porteurs de trauma" (carrier groups) - intellectuels, artistes, médias, institutions religieuses ou politiques, militants.
L'événement brut doit être ré-narré, symbolisé et investi d'une signification morale nouvelle (souvent comme une rupture fondamentale, un mal absolu), et la construction du trauma passe elle-même par des performances (récits, commémorations, œuvres d'art, procès, musées, documentaires) qui rendent le trauma "réel" et partagé pour la collectivité.
Avec la création d'une "Empreinte" (Piercing), le succès du processus est assuré et signifie que le trauma perce (pierces) la conscience collective, devenant un élément central et incontournable de l'identité et de la mémoire du groupe. Il crée une "communauté affective de victimes".
Comme dans son travail précédent, Alexander soutient que les traumas culturels réussis deviennent souvent la base de nouvelles revendications universalistes en matière de droits humains, de justice et de reconnaissance ("Plus jamais ça"). Son intention est aussi de souligner que ces traumas peuvent être à la fois intégrateurs (créant une solidarité autour de valeurs partagées) et divisifs (exacerbant les tensions entre groupes définis comme bourreaux et victimes).

"The Dark Side of Modernity" (2013)
L'intention fondamentale d'Alexander dans "The Dark Side of Modernity" est de proposer une sociologie critique radicale qui démystifie l'idéalisation de la modernité. Il démontre que la barbarie est une possibilité permanente et structurellement ancrée dans le projet moderne. Ce livre représente un approfondissement et un élargissement de ses travaux antérieurs sur le trauma culturel, en situant l'origine de ces traumas dans les contradictions et pathologies intrinsèques de la modernité elle-même. C'est un appel à reconnaître cette face sombre pour mieux la combattre par un engagement renouvelé en faveur des institutions et valeurs civilisatrices.
La modernité a permis l’individualisation, la démocratisation, mais elle a aussi produit la Shoah, le colonialisme, l’exclusion raciale, les violences de masse. Il s’agit d’une "pathologie interne", pas d’un accident extérieur.
Il reprend des textes déjà publié ou repris et condensé, "The social construction of moral universals: The 'Holocaust' from war crime to trauma drama" (2001), "Cultural trauma and collective identity" (2004), "Civil society as civil repair" où il analyse comment la sphère civile tente de "réparer" les blessures sociales par des performances publiques, des rituels et des "dramas", et reprend sa réflexion sur la puissance symbolique des images et objets matériels (monuments, musées, iconographie politique) développée dans "Iconic Power" (2012). Alexander prend acte des critiques formulées à son égard (notamment par Calhoun, Olick, Eyerman), qui l’accusaient d’être trop culturaliste et optimiste, et il admet explicitement que la modernité ne produit pas seulement des solidarités, mais aussi des destructions. Il se rapproche d’une lecture plus critique, proche parfois de Zygmunt Bauman (avec "Modernity and the Holocaust"), en montrant que la rationalité moderne est aussi productrice de barbarie et lie davantage l’analyse symbolique aux questions de domination et d’inégalités structurelles.

"Iconic Power: Materiality and Meaning in Social Life" (Alexander, J.C., Bartmanski, D., & Giesen, B. (eds.), 2012).
La sociologie culturelle s'ouvre au sensoriel, au corporel et au visuel dans la construction sociale et participe aux tentatives d'expliquer la puissance des images à l’ère numérique et des médias sociaux. Les notions d"’iconic power" et d’"iconic consciousness" sont parmi les concepts les plus originaux et récents qu’Alexander a développés (surtout à partir de 2010–2012), et ils sont devenus très influents dans les études culturelles, visuelles et médiatiques.
L’iconic power désigne la capacité des images, objets ou performances visuelles à produire des effets sociaux puissants - à mobiliser des émotions collectives, forger des identités, créer des solidarités ou des exclusions. Autrement dit, c'est une évolution importante pour Alexander et sa sociologie culturelle : ce n’est pas seulement le contenu narratif ou discursif qui compte, mais la forme visuelle et sensorielle elle-même (cf. la vidéo de la mort de George Floyd (2020) : l’image en mouvement a cristallisé l’indignation mondiale, devenant un "icône" du mouvement Black Lives Matter).
L’iconic power repose sur plusieurs mécanismes :
- une perceptibilité immédiate : une image qui frappe, qui se comprend d’un coup.
- l'émotionalité : elle provoque un choc affectif direct.
- la reproductibilité : elle peut circuler, être partagée, détournée (mèmes, manifestations).
- la symbolisation : elle cristallise une valeur ou une idée morale.
L’iconic consciousness (conscience iconique) désigne notre capacité collective à percevoir et à "lire" des images comme dotées d’une profondeur symbolique. Ce n’est pas simplement "voir" une image, mais la ressentir et y projeter une signification morale ou politique. Une statue déboulonnée (par ex. Edward Colston à Bristol) n’est pas qu’un objet qui tombe : elle devient un symbole de réparation historique ou de contestation.
Et nous parlerons de "conscience" parce qu’il s’agit d’un processus actif auquel nous participons collectivement, par la sacralisation, la diabolition et ou l'émotion via le support de l'image. Ces processus sont structurés par la culture, les médias, les traditions narratives et les codes esthétiques.

"What Makes a Social Crisis? : The Societalization of Social Problems" (2019)
Jeffrey C. Alexander propose ici une nouvelle conceptualisation des « crises sociales ». Critiquant les approches classiques qui se limitent à analyser les crises comme des ruptures ponctuelles ou comme des conséquences de dysfonctionnements institutionnels, il soutient que celles-ci doivent être interprétées comme des moments où des « problèmes sociaux » spécifiques débordent leur cadre institutionnel initial et deviennent des enjeux collectifs largement débattus - un processus qu’il appelle "sociétalisation" (societalization).
La "sociétalisation" désigne le processus par lequel un problème spécifique, initialement limité à une sphère particulière (ex. : l’Église, les universités, la police), devient une question qui engage la société entière.
Contrairement à la « publicisation » (publicization) ou à la « médiatisation » (mediatization), la sociétalisation implique une redéfinition morale et culturelle plus profonde, provoquant une réorganisation possible des institutions.
La société, en tant que système symbolique et moral, se mobilise pour « réparer » ou « purger » les institutions jugées corrompues ou inefficaces.
Trois exemples principaux sont évoqués ...
- La crise des abus sexuels dans l’Église catholique
Au départ, les abus étaient considérés comme des déviations individuelles ou locales. Avec le temps, ils ont été perçus comme un problème systémique lié à l’ensemble de l’institution ecclésiale, exigeant une transformation structurelle (règlements internes, supervision accrue, réformes).
- La crise de la sécurité automobile aux États-Unis (années 1960)
Initialement, les accidents étaient imputés aux erreurs humaines. Après le livre "Unsafe at Any Speed" de Ralph Nader (1965), la question est devenue celle de la responsabilité structurelle des constructeurs automobiles. Cela a conduit à une mobilisation sociale et à la création de nouvelles agences de régulation (comme la NHTSA).
- Le mouvement #MeToo
Commencé comme dénonciation d’abus spécifiques dans le milieu du cinéma, le mouvement s'est rapidement transformé en question sociale générale concernant le sexisme structurel et la culture du harcèlement, dépassant largement Hollywood.
Alexander identifie plusieurs conditions nécessaires à une "sociétalisation" ...
- Des Cadres narratifs partagés : il faut un récit collectif puissant qui rende le problème intelligible à tous (par ex. la corruption morale, la violence structurelle).
- Des Sphères médiatiques indépendantes et critiques : la presse et les médias sociaux jouent un rôle décisif en diffusant et amplifiant ces récits.
- Des Réseaux de « repair actors » : présence d’acteurs (journalistes, ONG, juristes, militants) capables de porter des solutions et de maintenir la pression.
- Une Crise de légitimation institutionnelle : les institutions doivent être perçues comme incapables de résoudre seules le problème.
En mettant en avant la "sociétalisation", Alexander donne une clé pour comprendre comment certains scandales ou dysfonctionnements deviennent des affaires d’État ou des crises nationales, tandis que d’autres restent confinés.
La sociétalisation peut mener à :
- des réformes structurelles profondes (changements législatifs, transformations culturelles internes).
- une re-légitimation de certaines institutions si elles réussissent à se réformer.
- des effets pervers possibles, comme la polarisation accrue ou le cynisme généralisé.
