- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Svevo - Pirandello
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki
- 1930-1940
- 1930s
- Fitzgerald
- Hemingway
- Faulkner
- Koch
- Céline
- Bernanos
- Jouve
- DosPassos
- Kojève
- Miller-Nin
- Grosz - Dix
- Green
- Ortega y Gasset
- Wittgenstein
- Russell - Carnap
- Artaud
- Jaspers
- Sapir - Piaget
- Guillén
- Garcia Lorca
- Hammett
- A.Christie
- Heidegger
- Icaza
- Huxley
- Hubble
- Caldwell
- Steinbeck
- Waugh
- Blixen
- Rhys
- J.Roth - Doderer
- Aub
- Malraux-StExupéry
- DBarnes-NWest
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bataille
- Char-Michaux
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Bloch
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Lewin - Mayo - Maslow
- Montherlant
- Buzzati - Pavese
- Vittorini
- Fallada
- Malaparte
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Welty
- Boulgakov
- Tamiki - Yôkô
- Weil
- Gadda
- Broch
- Steeman
- Jouhandeau
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Ellison
- Bergman
- Baldwin
- Fromm
- Bradbury - A.C.Clarke
- Tennessee Williams
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Carpentier
- Mishima
- Salinger - Styron
- Pasternak
- Asturias
- O'Connor
- Hoffer
- Matute - MartinGaite
- 1960-1970
- 1960s
- Abe
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- U.Johnson - C.Wolf
- Heller - Toole
- Naipaul
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Onetti - Sábato
- Capote
- Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- McCarthy - Minsky
- Sillitoe
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- Lenz
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Dolls
- Ellis
- Cortázar
- Warhol
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- HarperLee
- Fuentes
- 1970-1980
- 1970s
- Habermas
- Handke
- GarciaMarquez
- Deleuze
- Derrida
- Beck
- Satir
- Kundera
- Hrabal
- Didion
- Guinzbourg
- Lovelock
- Vietnam
- H.S.Thompson - Bukowski
- Pynchon
- E.T.Hall
- Bateson - Watzlawick
- Carver
- Irving
- Milgram
- VargasLlosa
- Puig - Donoso
- Lasch-Sennett
- Crozier - Touraine
- Friedan-Greer
- Jacob-Monod
- Dawkins
- Beattie - Phillips
- Gaddis
- Rawls
- Zinoviev
- H.Searles
- Ballard
- Jong
- Kôno
- Calvino
- Ballester-Delibes
- ASchmidt
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact

LatinaAmerica - Isabel Allende (1942), "La casa de los espiritus" (1982, La maison aux esprits), "De amor y de sombra" (1984, D'amour et d'ombre), "Eva Luna" (1987, Eva Luna), "El plan infinito" (1991, Le Plan infini) - Roberto Bolaño (1953-2003), "Los detectives salvajes" (1998, Les Détectives sauvages), "2666" (2004) - ..
Last update : 03/03/2017

Une réécriture de l'histoire latino-américaine par deux personnalités, chiliennes, bien différentes, très différentes, mais un thème qui semble s'imposer en ce début du XXIe siècle, particulièrement exacerbé pour peu que l'on ait vécu le phénomène des dictatures de l'Amérique latine - (le mal existe, et la littérature doit le affronter, même si elle ne peut le vaincre) -,
- l'impuissance de notre condition humaine ...
- Et la littérature, comme le dernier refuge ...
(Chili, années 1980s)
Isabel Allende (1942) et Roberto Bolaño (1953) écrivent tous deux après le Boom latino-américain (García Márquez, Cortázar), et s'en distancient, Allende reprenant certains codes du réalisme magique, mais avec une approche plus accessible, et Bolaño rompant avec cette tradition, en privilégiant une écriture plus sèche, métaphorique et critique. Tous deux furent marqués par des traumatismes politiques (le coup d'État de 1973 au Chili pour Allende, les dictatures et violences en Amérique latine pour Bolaño).
Bolaño a vécu par la suite en exil au Mexique et en Espagne, tandis qu'Allende s'est installée aux États-Unis après la mort de son oncle Salvador Allende. Allende, dans "La Maison aux esprits" (1982), mêle histoire familiale et politique, s'inspirant du réalisme magique, Bolaño, dans "2666" (2004) ou "Les Détectives sauvages" (1998), aborde la violence et les marges, avec une esthétique plus fragmentée et sombre. Et malgré des traitements très différents, Allende explore ses souvenirs familiaux, Bolaño les traces effacées de l'histoire, la violence est centrale chez celui-ci (féminicides, dictatures), et plus allégorique chez la première.
Allende est associée au féminisme et à l’héritage socialiste et vue comme une romancière grand public. Bolaño se livre à une critique désenchantée des avant-gardes : il est considéré à ce jour comme un auteur "culte" des lettres latino-américaines postmodernes ..

Le Chili est le pays le plus long et étroit du monde (4 300 km de long, de la frontière péruvienne au Cap Horn) pour seulement 177 km de large en moyenne. C'est aussi l’un des pays les plus sismiques du monde (le tremblement de terre le plus puissant jamais enregistré, 9,5 en 1960, y a eu lieu) et qui possède 4 des 5 principaux climats de la planète (désertique, méditerranéen, polaire, océanique), d'où une biodiversité conséquente et quelques records, le désert d’Atacama, le plus aride au monde (avec des paysages lunaires et des geysers à 4 000 m d’altitude), la Patagonie chilienne, avec ses glaciers (comme le Glacier Grey) et ses fjords sauvages, l’île de Pâques (Rapa Nui), territoire chilien perdu dans le Pacifique, célèbre pour ses moaï, le Cap Horn, lieu mythique des navigateurs et la forêt valdivienne, l’une des seules forêts tempérées humides au monde ...
Leader mondial en cuivre (1er producteur, 28% du cuivre mondial), le Chili pourrait être l'un des pays les plus développés d’Amérique latine (IDH élevé, économie stable). Mais souvent présenté comme un pays à forte classe moyenne (65% de sa population, selon la Banque Mondiale), cette réalité coexiste avec des inégalités très profondes et persistantes, héritées de son modèle économique néolibéral (1% des plus riches capte 25% des revenus nationaux, le Chili, champion des inégalités en OCDE). Et si cette classe a augmenté depuis les années 1990 (croissance économique), elle stagne depuis 2015 (ralentissement économique) : les protestations de 2019 ("Estallido Social") ont révélé la frustration de cette classe moyenne (le modèle chilien semble à un tournant) ..
Mais c'est aussi le seul pays au monde où un gouvernement marxiste a été renversé par un coup d’État (1973) : Le Chili a vécu 17 ans de dictature militaire (Pinochet), laissant des traces profondes dans sa société...

Comment un pays qui combine sans doute autant de contrastes géographiques et une histoire aussi intense, peut-il posséder une présence culturelle si peu visible ...
Certes le Chili a donné naissance à deux Prix Nobel de littérature (Gabriela Mistral en 1945 et Pablo Neruda en 1971), ce qui est exceptionnel pour un pays de sa taille, et Isabel Allende (La Maison aux esprits) est l’autrice hispanophone la plus lue au monde. Mais le Chili est loin des grands centres éditoriaux (Europe, États-Unis), son marché éditorial est restreint, on n'y compte peu de traductions comparé à l’espagnol d’Espagne ou même à l’argentin. Et l’ombre de Neruda, sa notoriété mondiale, ont éclipsé nombre d’autres grands auteurs (comme Roberto Bolaño, pourtant culte en Europe).
En comparaison, le Mexique possède une industrie culturelle massive (telenovelas, cinéma, muralisme), l’Argentine bénéficie d’un lectorat plus large et d’une tradition éditoriale solide, et le Brésil, par sa taille et sa langue, a un marché intérieur énorme.
Enfin, il faut rappeler que la Dictature de Pinochet (1973-1990) a sans doute coupé l’élan culturel du Chili, celui-ci ayant affronté un exil massif des intellectuels (beaucoup sont partis en Europe ou au Mexique, entre 200 000 et 1 million de Chiliens ont fui la dictature, selon les sources), censure et répression des mouvements artistiques (la Nueva Canción Chilena a été décimée après l’assassinat de Victor Jara), soit une génération perdue (et une répression massive, 40 000 victimes de torture, selon la Commission Valech, 3 000 disparus ou exécutés) : le Chili a mis des décennies à reconstruire sa scène culturelle ("El derecho de vivir en paz" , de Victor Jara) ...
Isabel Allende et Roberto Bolaño abordent tous deux la dictature chilienne (1973–1990) dans leurs œuvres, mais avec des perspectives, des styles et des tonalités très différents...
Allende donne une voix aux victimes et inscrit la dictature dans une narrative de survie et de transmission. Dans "La Maison aux esprits" (1982), Allende transpose l’histoire du Chili à travers la saga des Trueba, mêlant destin personnel et politique. Le coup d’État (ici nommé "le Désastre") est présenté comme une rupture violente, avec des parallèles évidents avec Pinochet (le personnage du "Candide"). "D’amour et d’ombre" (1984) dépeint directement la répression, en suivant une journaliste qui découvre un charnier, inspiré des crimes réels de la dictature. Allende utilise le merveilleux (les esprits, les prophéties) pour montrer la persistance de la mémoire malgré l’oppression. La violence est souvent suggérée et ses personnages féminins (Clara, Alba) incarnent une résistance passive ou active à la tyrannie, symbolisant l’espoir. Certains critiques lui reprocheront une vision parfois romancée ou édulcorée de la violence, comparée à l’approche plus brutale de Bolaño.
C'est l'un des points forts de ce dernier que de savoir nous montrer comment la terreur s’insinue dans les détails du quotidien, corrompant même la littérature. Bolaño s’intéresse moins aux victimes qu’aux mécanismes du mal. Dans "Estrella distante" (1996), il suit un tortionnaire-poète (inspiré du réel Carlos Wieder), artiste de la mort qui incarne l’alliance perverse entre art et barbarie. "Nocturno du Chili" (2000) dépeint un prêtre littéraire complice de la dictature, révélant la lâcheté des élites intellectuelles. Contrairement au lyrisme d’Allende, Bolaño utilise un ton froid, sarcastique ou halluciné. La violence est décrite avec une précision clinique (que l'on pense aux scènes de torture dans "2666"). Pas d’héroïsme non plus chez Bolaño : ses personnages sont souvent des anti-héros, des collaborateurs ou des témoins passifs. La dictature est un cauchemar absurde, sans rédemption.
Au fond, leurs approches sont complémentaires : l’une montre comment on survit à l’histoire, l’autre comment on y participe...

Isabel Allende (1942)
Native de Lima (Pérou), Isabel Allende s'installe au Chili au divorce de ses parents. En 1973, lorsque Pinochet assassine son oncle, le président Salvador Allende, et que débute une dictature militaire qui a vu onze mille Chiliens périr sous la torture, elle entreprend de recueillir les témoignages des survivants du régime. "De amor y de sombra" (D'amour et d'ombre, 1987) fait référence à la découverte des corps des "desaparecidos" (les disparus) dans un puits de mine en 1978. L'intrigue du roman repose sur une trame autobiographique, la jeune journaliste qui découvre le corps des victimes des forces de sécurité de Pinochet ressemble dans son parcours à l'évolution que connut Isabel Allende elle-même, fuyant avec sa mère le Chili vers l'Europe, s'exilant au Vénézuela avec enfant et premier mari, d'éducation catholique et conservatrice, journaliste frivole découvrant le féminisme et l'activisme politique. Il reste quelques traces de cette première existence, ne serait-ce, dans ce roman, que la coexistence d'un récit engagé politiquement et d'une histoire d'amour de type "novela rosa" tant apprécié des lectrices de toutes conditions. Au-delà de ce mixte populisme-politique, c'est bien une page d'histoire, souvent oubliée, qui est ainsi évoquée. C'est avec "La casa de los espiritus", en 1982, qu'Isabel Allende débarque en littérature et acquiert immédiatement une belle notoriété (plus de 65 millions d'exemplaires de ses oeuvres traduits dans plus de 30 langues) : "De amor y de sombra" (1987), "Eva Luna" (1987), "Los cuentos de Eva Luna" (1988), "Paula" (1994), "Retrato en sepia" (2000), "La ciudad de las bestias" (2002), "Inès del Alma Mia" (2006), "La Isla bajo el mar" (2009), "El Juego de Ripper" (2014)...

"Mi país inventado" (Mon pays inventé, 2003) d'Isabel Allende
Écrit après les attentats du 11 septembre 2001, ce livre est une lettre d'amour au Chili, le pays qu'Allende a dû quitter après le coup d'État de 1973 (qui a renversé son oncle, Salvador Allende). Son identité déchirée entre son pays natal et son pays d'adoption (les États-Unis)...
Allende décrit le Chili comme une terre de violence politique et de magie populaire, où le surnaturel côtoie le quotidien : évocation des paysages (désert d'Atacama, Patagonie) et des traditions (la cueca, la cuisine), et récits de son enfance dans la haute société chilienne, marquée par les absences (père disparu) et les figures féminines fortes (sa mère, sa grand-mère). Des allusions à "La Maison aux esprits", son premier roman inspiré de sa famille.
Le coup d'État de 1973, le récit de la journée du 11 septembre, vécue comme une rupture traumatique. Critique des années Pinochet et de la culture de la peur puis la vie aux États-Unis. Comparaison entre la mentalité chilienne (passionnée, fataliste) et américaine (pragmatique, optimiste). Réflexions sur le déracinement. Allende admet que son Chili est idéalisé – un pays reconstruit par la mémoire et l’écriture : Je suis née dans un pays qui n’existe plus...

"La casa de los espiritus" (1982, La maison aux esprits)
Ecrit en exil (Venezuela), le roman a été perçu comme une dénonciation de Pinochet : paru 9 ans après le coup d’État, il a touché une Amérique latine en pleine crise. - La historia de la familia Trueba a lo largo de cuatro generaciones, una historia de amor y dolor, de identidad y de historia - ... C'est une chronique d'une période sombre et sanglante, son énorme succès vient pour une grande part de son mélange inédit de genres, réalisme magique (esprits, prédictions) inspiré de García Márquez, mais avec une voix féminine unique, des femmes fortes (Clara, Blanca, Alba) qui incarnent l’émancipation progressive et la résistance face au patriarcat et à la dictature, et l'histoire politique, celle de la montée des tensions sociales et de la dictature, sujet tabou en 1982 ... (Trad. Claude et Carmen Durand, Fayard)
Première génération : Clara et Esteban
L'histoire commence avec Clara del Valle, une jeune femme qui possède des dons surnaturels (elle peut voir les esprits, prédire l'avenir et déplacer des objets par la pensée). Après la mort tragique de sa sœur Rosa, fiancée d'Esteban Trueba, Clara décide de se réfugier dans un silence total durant plusieurs années. Cette mort dès le premier chapitre explique le destin d'Esteban : la mort de Rosa transforme sa frustration amoureuse en une rage sociale qui déterminera tous ses actes (accumulation de richesses, violence envers les paysans, mariage de substitution avec Clara). Rosa, c'est aussi le Chili pré-industriel, sa beauté fragile et sa mort soudaine symbolisent la fin d'un monde aristocratique idéalisé (comme le Chili du XIXᵉ siècle) que la modernité va balayer. Et la mort de Rosa va de même activer les dons spirituels de Clara, établissant le réalisme magique comme norme narrative. Rosa mourut sans ouvrir les yeux, mais Clara continua à voir pour elle. La dernière scène du roman montrera Alba (petite-fille) écrivant l'histoire familiale sous le regard des esprits de Rosa et Clara, bouclant la boucle ouverte par cette mort inaugurale...
Après la mort de Rosa, sa sœur aînée, Clara, se mettra à percevoir des esprits autour d'elle. Plutôt que d'en avoir peur, elle adoptera une attitude sereine, affirmant clairement sa position par rapport au surnaturel. Clara fait comprendre aux membres de sa famille que les morts ne représentent aucun danger réel et qu’il n’est pas nécessaire de les craindre, car ils font partie intégrante de la vie quotidienne...
"La pequeña Clara leía mucho. Su interés por la lectura era indiscriminado y le daban lo mismo los libros mágicos de los baúles encantados de su tío Marcos, que los documentos del Partido Liberal que su padre guardaba en su estudio. Llenaba incontables cuadernos con sus anotaciones privadas, donde fueron quedando registrados los acontecimientos de ese tiempo, que gracias a eso no se perdieron borrados por la neblina del olvido, y ahora yo puedo usarlos para rescatar su memoria.
Clara clarividente conocía el significado de los sueños. Esta habilidad era natural en ella y no requería los engorrosos estudios cabalísticos queusaba el tío Marcos con más esfuerzo y menos acierto. El primero en darse cuenta de eso fue Honorio, el jardinero de la casa, que soñó un día con culebras que andaban entre sus pies y que, para quitárselas de encima, les daba de patadas hasta que conseguía aplastar a diecinueve.
Se lo contó a la niña mientras podaba las rosas, sólo para entretenerla, porque la quería mucho y le daba lástima que fuera muda. Clara sacó la pizarrita del bolsillo de su delantal y escribió la interpretación del sueño de Honorio: tendrás mucho dinero, te durará poco, lo ganarás sin esfuerzo, juega al diecinueve. Honorio no sabía leer, pero Nívea le leyó el mensaje entre burlas y risas. El jardinero hizo lo que le decían y se ganó ochenta pesos en una timba clandestina que había detrás de una bodega de carbón. Se los gastó en un traje nuevo, una borrachera memorable con todos sus amigos y una muñeca de loza para Clara. A partir de entonces la niña tuvo mucho trabajo descifrando sueños a escondidas de su madre, porque cuando se supo la historia de Honorio iban a preguntarle qué quería decir volar sobre una torre con alas de cisne; ir en una barca a la deriva y que cante una sirena con voz de viuda; que nazcan dos gemelos pegados por la espalda, cada uno con una espada en la mano, y Clara anotaba sin vacilar en la pizarrita que la torre es la muerte y el que vuela por encima se salvará de morir en un accidente, el que naufraga y escucha a la sirena perderá su trabajo y pasará penurias, pero lo ayudará una mujer con la que hará un negocio; los gemelos son marido y mujer forzados en un mismo destino, hiriéndose mutuamente con golpes de espada.
"La petite Clara lisait beaucoup. Son intérêt pour la lecture était sans discrimination, et elle se nourrissait aussi bien des livres magiques tirés des malles enchantées de son oncle Marcos que des documents du Parti libéral que son père conservait dans son bureau. Elle remplissait d’innombrables carnets de notes personnelles, où furent consignés les événements de cette époque, préservés ainsi des brumes de l’oubli, et qui me permettent aujourd’hui de ressusciter sa mémoire.
Clara la clairvoyante comprenait le sens des rêves. Ce don lui était naturel et ne nécessitait pas les laborieuses études cabalistiques auxquelles s’adonnait son oncle Marcos avec plus d’efforts que de succès. Le premier à s’en apercevoir fut Honorio, le jardinier de la maison, qui rêva un jour de serpents glissant entre ses pieds. Pour s’en débarrasser, il leur donnait des coups de pied jusqu’à en écraser dix-neuf.
Il raconta cela à l’enfant alors qu’il taillait les rosiers, simplement pour la distraire, car il l’aimait beaucoup et la plaignait d’être muette. Clara sortit l’ardoise de la poche de son tablier et y écrivit l’interprétation du rêve d’Honorio : « Tu auras beaucoup d’argent, il ne durera pas, tu le gagneras sans effort, joue sur le dix-neuf. » Honorio ne savait pas lire, mais Nívea lui lut le message entre rires et moqueries. Le jardinier suivit le conseil et gagna quatre-vingts pesos dans une partie clandestine organisée derrière un dépôt de charbon. Il les dépensa en un costume neuf, une mémorable beuverie avec ses amis et une poupée de porcelaine pour Clara. À partir de ce jour, la fillette eut fort à faire, interprétant les rêves en cachette de sa mère, car lorsque l’histoire d’Honorio se répandit, on vint lui demander ce que signifiait : « voler au-dessus d’une tour avec des ailes de cygne », « dériver en barque en entendant une sirène chanter d’une voix de veuve », ou « voir naître deux jumeaux collés par le dos, chacun une épée à la main ». Et Clara notait sans hésiter sur son ardoise : « La tour, c’est la mort, et celui qui vole au-dessus échappera à un accident. Celui qui naufrage et entend la sirène perdra son travail et connaîtra la misère, mais une femme l’aidera dans une affaire. Les jumeaux sont un mari et une femme liés par un même destin, se blessant mutuellement à coups d’épée. »"
Los sueños no eran lo único que Clara adivinaba. También veía el futuro y conocía la intención de la gente, virtudes que mantuvo a lo largo de su vida y acrecentó con el tiempo. Anunció la muerte de su padrino, don Salomón Valdés, que era corredor de la Bolsa de Comercio y que creyendo haberlo perdido todo, se colgó de la lámpara en su elegante oficina. Allí lo encontraron, por insistencia de Clara, con el aspecto de un carnero mustio, tal como ella lo describió en la pizarra. Predijo la hernia de su padre, todos los temblores de tierra y otras alteraciones de lanaturaleza, la única vez que cayó nieve en la capital matando de frío a los pobres en las poblaciones y a los rosales en los jardines de los ricos, y la identidad del asesino de las colegialas, mucho antes que la policía descubriera el segundo cadáver, pero nadie la creyó y Severo no quiso que su hija opinara sobre cosas de criminales que no tenían parentesco con la familia. Clara se dio cuenta a la primera mirada que Getulio Armando iba a estafar a su padre con el negocio de las ovejas australianas, porque se lo leyó en el color del aura. Se lo escribió a su padre, pero éste no le hizo caso y cuando vino a acordarse de las predicciones de su hija menor, había perdido la mitad de su fortuna y su socio andaba por el Caribe, convertido en hombre rico, con un serrallo de negras culonas y un barco propio para tomar el sol.
La habilidad de Clara para mover objetos sin tocarlos no se pasó con la menstruación, como vaticinaba la Nana, sino que se fue acentuando hasta tener tanta práctica, que podía mover las teclas del piano con la tapa cerrada, aunque nunca pudo desplazar el instrumento por la sala, como era su deseo. En esas extravagancias ocupaba la mayor parte de su energía y de su tiempo. Desarrolló la capacidad de adivinar un asombroso porcentaje de las cartas de la baraja e inventó juegos de irrealidad para divertir a sus hermanos. Su padre le prohibió escrutar el futuro en los naipes e invocar fantasmas y espíritus traviesos que molestaban al resto de la familia y aterrorizaban a la servidumbre, pero Nívea comprendió que mientras más limitaciones y sustos tenía que soportar su hija menor, más lunática se ponía, de modo que decidió dejarla en paz con sus trucos de espiritista, sus juegos de pitonisa y su silencio de caverna, tratando de amarla sin condiciones y aceptarla tal cual era. Clara creció como una planta salvaje, a pesar de las recomendaciones del doctor Cuevas, que había traído de Europa la novedad de los baños de agua fría y los golpes de electricidad para curar a los locos.
"Les rêves n’étaient pas la seule chose que Clara devinait. Elle voyait aussi l’avenir et percevait les intentions des gens, des dons qu’elle conserva toute sa vie et qui s’amplifièrent avec le temps. Elle annonça la mort de son parrain, don Salomón Valdés, agent de change qui, croyant avoir tout perdu, se pendit au lustre de son élégant bureau. On le retrouva là, sur l’insistance de Clara, avec l’allure d’un mouton flétri, comme elle l’avait décrit sur son ardoise. Elle prédit la hernie de son père, tous les tremblements de terre et autres bouleversements de la nature, l’unique chute de neige dans la capitale qui glaça les pauvres des bidonvilles et les rosiers des jardins des riches, ainsi que l’identité de l’assassin des collégiennes, bien avant que la police ne découvre le second cadavre. Mais personne ne la crut, et Severo ne voulut pas que sa fille s’exprime sur des affaires criminelles étrangères à la famille.
Clara comprit dès le premier regard que Getulio Armando allait escroquer son père avec l’affaire des moutons australiens, lisant cette trahison dans la couleur de son aura. Elle l’écrivit à son père, qui n’en tint pas compte. Quand il se souvint des prédictions de sa cadette, il avait perdu la moitié de sa fortune, et son associé naviguait dans les Caraïbes, devenu riche, entouré d’un sérail de femmes plantureuses et d’un yacht pour prendre le soleil.
Le don de Clara pour déplacer les objets sans les toucher ne disparut pas à l’arrivée de ses règles, comme l’avait prédit Nana, mais s’accentua jusqu’à lui permettre de jouer du piano couvert, bien qu’elle ne parvînt jamais à faire glisser l’instrument à travers la pièce comme elle en rêvait. Elle consacrait l’essentiel de son temps et de son énergie à ces extravagances. Elle développa une capacité à deviner un pourcentage stupéfiant des cartes du jeu et inventa des divertissements irréels pour amuser ses frères. Son père lui interdit de prédire l’avenir avec les cartes et d’invoquer fantômes et esprits facétieux qui perturbaient la famille et terrorisaient les domestiques. Mais Nívea comprit que plus sa fille subissait de contraintes et de peurs, plus elle devenait fantasque. Elle choisit donc de la laisser vivre en paix avec ses tours de spiritisme, ses jeux de pythonisse et son silence de grotte, s’efforçant de l’aimer sans conditions et de l’accepter telle qu’elle était. Clara grandit comme une plante sauvage, malgré les recommandations du docteur Cuevas, qui avait rapporté d’Europe la nouveauté des bains froids et des électrochocs pour soigner les fous."
Esteban devient en effet riche propriétaire terrien grâce à la gestion tyrannique de son domaine « Las Tres Marías », et finit par épouser Clara, fascinée par sa personnalité singulière. Leur relation est complexe : Esteban est autoritaire et violent, tandis que Clara, douce et distante, entretient une relation spirituelle avec le monde invisible. Le couple s'installe dans "la casa de los espíritus", une demeure où se mêlent amour, conflits et prédictions. Leurs enfants vont grandir dans un Chili en pleine mutation ...
Deuxième génération : Blanca et Pedro Tercero García
Le couple a trois enfants : Blanca, Jaime et Nicolás, Jaime deviendra un médecin humaniste) et Nicolás, un dandy instable, incarnant ainsi des destins opposés. Blanca tombe amoureuse, dès son enfance, de Pedro Tercero García, fils d’un ouvrier agricole. Leur relation clandestine et interdite illustre la division profonde des classes sociales. Esteban, devenu un riche propriétaire terrien et sénateur conservateur, incarne l'ordre ancien, tandis que Pedro Tercero symbolise les aspirations sociales des opprimés. Blanca tombe enceinte de Pedro Tercero et met au monde une fille, Alba.
Clara est la colonne vertébrale du récit. Sa mort sera un moment clé du roman, à la fois poétique et chargé de sens symbolique. Clara meurt dans son sommeil, sans agonie, un jour d'hiver où "les esprits vinrent la chercher". Elle avait prédit sa propre mort s'y était préparée en rangeant ses affaires. Avant de mourir, elle réunira toute la famille (même Esteban, son mari tyrannique) pour un dîner d'adieu improvisé. Elle lèguera à Alba, sa petite-fille, ses carnets de prédictions, qui deviendront la mémoire du roman. Son corps se transfigurera, ses cheveux blancs retrouveront soudain leur couleur d'enfance (rousse comme ceux de Rosa). Elle rejoindra les esprits qu'elle a toujours côtoyés, notamment sa sœur Rosa la Bella. Contrairement aux autres personnages (Rosa empoisonnée, Jaime torturé), Clara part pacifiquement, en harmonie avec le surnaturel. Sa mort marque la disparition de la magie dans la maison, laissant place au chaos politique (le coup d'État approche). Ses carnets sauveront l'histoire familiale de l'oubli, tout comme le roman d'Allende sauve la mémoire du Chili. Clara meurt, mais ses prédictions et son amour persistent à travers Alba, qui écrit l'histoire...
Troisième génération : Alba, révolution et dictature
Alba, fille de Blanca, grandit proche de son grand-père Esteban Trueba, qui, malgré son caractère rude, développe une affection particulière pour elle. Alba devient une figure centrale, impliquée dans les luttes politiques progressistes du pays. Elle tombe amoureuse de Miguel, un révolutionnaire de gauche. Pendant ce temps, Esteban s'engage politiquement dans le parti conservateur, devenant sénateur et incarnant les élites conservatrices du pays.
Lorsqu'une dictature militaire (qui évoque clairement celle de Pinochet, évocation transparente du 11 septembre 1973) s'installe, Alba est emprisonnée et torturée en raison de ses engagements politiques et de son amour pour Miguel. Ironiquement, son bourreau est Esteban García, un enfant illégitime et oublié d’Esteban Trueba, né d’un viol commis par ce dernier dans son domaine. Le roman illustre ainsi comment la violence d’Esteban Trueba revient hanter la famille sous la forme d'une vengeance symbolique.
Réconciliation et mémoire
Après l'arrestation d'Alba, Esteban Trueba prend conscience des conséquences tragiques de ses choix. Il fait tout son possible pour libérer sa petite-fille et finit par reconnaître ses erreurs passées. Alba, finalement libérée, décide d'écrire l'histoire familiale pour préserver la mémoire et briser le cycle de la violence et de la vengeance. Les esprits de Clara et Rosa hantent toujours la maison, rappelant que le passé ne meurt jamais vraiment...

"La casa de los espíritus" (The House of the Spirits) fut adaptée cinématographiquement en 1993 par le réalisateur danois Bille August, avec Meryl Streep (Clara del Valle Trueba), Glenn Close (Férula Trueba), Jeremy Irons (Esteban Trueba), Winona Ryder, et Antonio Banderas, remporta quelques prix mais fut un échec commercial...
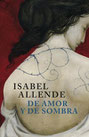
"De amor y de sombra" (1984, D'amour et d'ombre)
Una historia de amor que acontece durante la dictadura militar de Chile.. "Un roman solaire: Irène, fille d'une grande bourgeoise excentrique et déchue qui a transformé sa résidence en hospice de vieillards, noue avec Francisco, fils d'émigrants rescapés de la guerre civile espagnole, une relation d'amitié complice que l'épreuve transmue peu à peu en un amour indissoluble. Un roman des ténèbres: journaliste, Irène se trouve incidemment à l'origine de la révélation d'un de ces massacres politiques dont abondent les annales des dictatures d'Amérique du Sud. La répression se tourne alors contre elle, contre Francisco, manque plusieurs fois de les faire disparaître et les condamne finalement à l'exil, nouveaux émigrants d'une nouvelle guerre civile... Passant sans cesse de l'ombre à la lumière et de l'amour à la terreur, ce second roman d'Isabel Allende fait vivre des dizaines de personnages pathétiques ou burlesques, de la jeune paysanne épileptique et faiseuse de miracles au général fantoche qui régit le pays depuis son bunker, du prêtre-ouvrier des bidonvilles à l'inventeur de la machine à cueillir les noix de coco, du clown à la retraite à l'officier tortionnaire, du vieil anarchiste impénitent au coiffeur pour dames homosexuel et résistant _ et, surtout, ces inoubliables figures de mères, d'épouses, de filles, qui font de l'auteur de La Maison aux Esprits la romancière par excellence du destin des femmes latino-américaines." (Trad. Claude et Carmen Durand, Fayard)

"Eva Luna" (1987, Eva Luna)
Una narrativa poética a la vez que extravagante.. "Elle s'appelle Eva, qui veut dire vie, sa mère ayant voulu qu'elle y morde à belles dents; Eva Luna, parce qu'elle fut conçue par un Indien de la tribu des Fils de la Lune piqué par un aspic, que sa mère arracha à l'agonie en lui faisant l'amour. Petite bonniche rebelle et émerveillée, écoutant aux portes et abreuvée de feuilletons radiophoniques, elle a le don d'inventer des histoires rocambolesques, improbables, renversantes, drôles et dramatiques comme la vie même, ce qui lui vaudra plus tard de sortir de la misère, de la servitude et de l'anonymat. Entre-temps, son destin aura croisé celui de dizaines de personnages plus hauts en couleur les uns que les autres _ sa marraine, qui donnera le jour à un monstre à deux têtes, l'une blanche et l'autre noire; grand-mère Elvira, qui couche dans son cercueil et sera sauvée par cette arche de fortune lors d'une inondation catastrophique; la Madame, puissante maquerelle de la capitale, et Mimi, travesti promu star de la télévision nationale; Huberto Naranjo, gosse de la rue qui grandira dans les maquis de la guérilla; oncle Rupert et tante Burgel, aubergistes et fabricants de pendules à coucous dans un village danubien au coeur des montagnes tropicales; leurs filles dodues à ravir et voluptueuses à souhait; et un dictateur, un tortionnaire au gardénia à la boutonnière, un commerçant moyen-oriental au coeur tendre et aux caresses savantes, sa femme Zulema, vaincue par la fatigue de vivre, un gros journaliste sagace et épicurien, un ministre déféquant sur une chaise percée tendue de velours épiscopal..., sans oublier Rolf en qui Eva reconnaîtra l'homme de sa vie, puisque à en vivre une, il lui faut bien concevoir que certaines histoires finissent bien." (Trad. Claude et Carmen Durand, Fayard)

"Los cuentos de Eva Luna" (1988, Les Contes d'Eva Luna)
"Le personnage d'Eva Luna, dans le roman du même nom, n'avait pas sa pareille pour raconter des histoires aussi extraordinaires que véridiques, tirées notamment de la chronique du village d'Agua Santa. C'est un vaste éventail de ces "contes" de la moderne Shéhérazade latino-américaine que rassemble ce livre. En fait, vingt-trois petits romans dont chacun est un condensé de la virtuosité et de la richesse narratives d'Isabel Allende. Unité d'inspiration dans la formidable variété des situations, permanence de l'ironie sensible et foisonnante dans des registres qui vont du burlesque au lugubre, de l'ingénuité au deuil, de la nostalgie à la colère, de l'amour à la révolte. Ces vingt-trois petits chefs-d'oeuvre sont à dévorer d'une traite ou à déguster, mais plus probablement encore destinés à connaître successivement les deux lectures." (Trad. Claude et Carmen Durand, Fayard)
"Dos palabras" (Deux mots)
Belisa Crepusculario, une jeune femme pauvre, survit en vendant des mots (poèmes, lettres, slogans) dans les marchés. Un jour, le Colonel, un homme brutal et illettré, la kidnappe pour qu'elle lui rédige un discours politique. Belisa lui apprend aussi deux mots secrets qu’elle refuse de révéler au lecteur. Ces mots changent le Colonel, qui devient obsédé par leur sens, abandonnant même la guerre pour les comprendre. Le conte illustre la thèse du livre : les histoires peuvent changer le monde.
"Si me tocaras el corazón" (Si tu touchais mon cœur)
Un médecin solitaire, Hidalgo, soigne une prostituée gravement malade, Casilda, dans un bordel d’Amérique latine. Malgré son cynisme initial, il tombe amoureux d’elle en découvrant sa vulnérabilité et son humanité. Casilda, habituée à la violence des hommes, résiste d’abord à sa tendresse. Quand elle meurt, Hidalgo réalise trop tard qu’elle portait un enfant—peut-être le sien—et que son incapacité à exprimer ses sentiments a scellé leur tragédie.
La niña fea" (La fille laide)
Ce conte raconte l’histoire d’une jeune fille, considérée comme laide par sa famille et son entourage, qui subit moqueries et rejet. Sa mère, frustrée par sa propre vie, la traite avec mépris, tandis que son père, bien que moins cruel, reste passif. Un jour, un artiste de passage remarque la singularité de son visage et lui offre un miroir en lui disant qu’elle a une beauté unique. Ce geste transforme sa perception d’elle-même, lui donnant la force de quitter son environnement toxique pour chercher une vie meilleure.
"Clarisa"
Clarisa naît dans une famille aisée, mais dès son enfance, elle se distingue par son innocence radicale et son mépris des conventions sociales. Elle donne ses vêtements aux pauvres, parle aux mendiants comme à des égaux, et prie avec une ferveur qui agace son entourage. Sa famille tente en vain de la "normaliser" (mariage, éducation religieuse stricte), mais Clarisa reste inadaptée au monde matériel. Adulte, Clarisa vit dans la pauvreté volontaire, accueillant sans distinction tous ceux qui frappent à sa porte : voleurs, prostituées (comme Elena Mejías), malades mentaux. Un jour, elle prédit sa propre mort et s’allonge par terre, enveloppée dans un drap, pour "attendre Dieu": et meurt dans l’indifférence générale...
Clarisa et Elena forment un duo opposé mais complémentaire, mais des femmes toujours définies par les hommes, pureté spirituelle de l'une, incarnation charnelle de l'autre, mais la société ne tolère ni l’excès de vertu ni l’excès de liberté...
"Une petite perverse
A onze ans, Elena Mejías était encore un jeune chiot sous-alimenté avec sa peau sans éclat d'enfant solitaire, les brèches de sa bouche dues à une dentition tardive, ses cheveux souris, et une ossature saillante qui paraissait disproportionnée pour sa taille, menaçant de percer aux genoux et aux coudes. Rien dans son allure ne laissait soupçonner ses rêves torrides ni deviner la créature passionnée qu'elle était en réalité. Elle passait inaperçue parmi le mobilier quelconque et les rideaux fanés de la pension que tenait sa mère. Elle n'était rien d'autre qu'une petite chatte mélancolique jouant au milieu des géraniums poussiéreux et des hautes fougères de la courette intérieure, ou bien encore transitant du fourneau de la cuisine aux tables de la salle à manger avec les assiettes du dîner. Rares étaient les fois où un client la remarquait et s'il le faisait, c'était uniquement pour lui ordonner de répandre de l'insecticide sur les nids de cafards ou d'aller remplir le broc du cabinet de toilette quand la carcasse cliquetante de la pompe refusait de faire monter l'eau jusqu'à l'étage. Epuisée par la chaleur et les travaux domestiques, sa mère n'avait pas le cœur à lui prodiguer des marques de tendresse, ni même le temps de la regarder, si bien que le jour où Elena commença à se métamorphoser en un être différent, elle ne se rendit compte de rien. Durant sa prime enfance, ç'avait été une petite fille timide et taciturne, s'amusant toute la sainte journée à des jeux mystérieux, parlant toute seule dans les coins et suçant son pouce. Elle ne sortait que pour se rendre à l'école ou au marché et ne semblait prêter aucun intérêt à la meute turbulente des gosses de son âge qui jouaient dans la rue. La transformation d'Elena Mejías coïncida avec l'arrivée de Juan Iosé Bernal, le Rossignol, comme lui-même s'était surnommé et comme le proclamait l'affiche qu'il avait punaisée au mur de sa chambre. Les pensionnaires étaient composés en majorité d'étudiants et d'employés de quelque obscure succursale de l'administration. Des messieurs-dames comme il faut, disait la mère qui se glorifiait de ne point accepter n'importe qui sous leur toit, uniquement des personnes de valeur exerçant une activité connue, des gens de bonnes vie et mœurs, suffisamment solvables pour verser le mois d'avance et disposés à se conformer au règlement de la pension, plus proche de celui d'un séminaire que des usages d'un hôtel. Une veuve doit veiller à sa réputation et savoir se faire respecter, je ne veux pas que mon établissement devienne un repaire de vagabonds et de dépravés, répétait à tout bout de champ la mère, afin que personne - Elena moins que tout autre - ne vînt à l'oublier. Une des tâches de la fillette consistait à surveiller les hôtes et à mettre sa mère au courant du moindre détail suspect. Ce travail d'espionne n'avait fait qu'accentuer son côté incorporel: sa présence silencieuse se fondait dans l'ombre des chambres, puis elle réapparaissait subitement, comme finissant par s'en revenir de sphères invisibles. Mère et fille s'activaient de concert aux multiples besognes de la pension, chacune s'immergeant dans sa routine muette, sans nul besoin de communiquer avec l'autre. Elles se parlaient en vérité fort peu, et quand elles le faisaient, profitant du répit de l'heure de la sieste, c'était à propos des clients. Elena s'efforçait parfois d'enjoliver l'existence grisâtre de ces hommes et de ces femmes de passage, transitant par chez elles sans y laisser de souvenirs; elle les gratifiait de tel ou tel événement extraordinaire, les peignant en couleurs grâce aux cadeau d'amours clandestines ou de quelque drame, mais sa mère avait un flair infaillible pour détecter ses affabulations..."

"El plan infinito" (1991, Le Plan infini)
"Ce nouveau roman d'Isabel Allende plonge ses lecteurs dans un monde à la fois familier et inédit. Familier parce qu'on y retrouve cette saga d'un groupe humain que la romancière chilienne cultive d'un livre à l'autre, avec ses conflits, ses drames, ses joies, sa chaleur, cette humanité qu'Isabel Allende excelle à capter dans ses manifestations les plus universelles et les plus quotidiennes à la fois. Inédit parce qu'ici le cadre n'est plus le Chili, comme dans les romans précédents de l'auteur, mais les Etats-Unis et plus précisément ce monde particulier, chatoyant et excessif qu'est la Californie. Deux familles croisent ici leurs destinées. Celle d'un prédicateur qui sillonne l'Ouest américain dans un camion pittoresque et vétuste, sorte de nouvelle arche de Noé. Si elle a fait du fils de cette famille, Gregory Reeves, le personnage central de son roman, Isabel Allende brosse un portrait saisissant du père, homme sévère et torturé, dont la mort viendra démentir la vie, une vie passée à prêcher la recherche de ce " plan infini ", de cet " harmonieux éther " qui attend chaque être après sa mort. L'autre famille, celle des Morales, vient du Mexique et s'efforce de survivre, dans le maintien de ses valeurs et de sa dignité, dans un " quartier " de Los Angeles où la violence ponctue la vie quotidienne. Avec beaucoup d'habileté, Isabel Allende croise et décroise les fils de ces différentes trajectoires qui finissent par tisser la toile d'une fresque contemporaine, d'où se détachent les mythes et les drames de notre XXe siècle finissant: l'explosion urbaine, la marginalisation et l'exclusion de groupes sociaux, le développement du mouvement hippie et du " Flower Power ", la guerre du Vietnam, l'avènement du féminisme et la libération des moeurs, la banalisation de la drogue, la course à l'argent des classes moyennes. Le lecteur est projeté d'une séquence à l'autre, comme dans un film au montage précis et haletant, jusqu'au dénouement final où l'auteur elle-même se trouve impliquée." (Trad. Claude et Carmen Durand, Fayard)

"Paula" (1994)
La historia de su familia a su propia hija en coma y que finalmente falleció... "Depuis la Maison aux esprits, Isabel Allende se plaît à explorer l'univers passionnant des sagas familiales. Mieux que quiconque, elle sait décrire les avatars à travers le temps de ces tribus dont tous les membres, proches ou lointains, se rejoignent pour former une chaîne que les vicissitudes les plus diverses ne peuvent rompre, car l'amour en soude les multiples maillons. La mort elle-même est impuissante: les esprits habitent les mémoires et s'unissent aux vivants. Le 8 décembre 1991, la fille d'Isabel, Paula, sombre dans un profond coma dont l'issue est incertaine. Sa mère entame alors un douloureux combat contre la maladie, contre le temps qui passe, aussi, et emporte chaque jour un peu plus son enfant. Dans sa détresse, elle décide de s'en remettre à l'écriture, qui lui permettra de remonter le fil du temps et d'appeler à l'aide sa longue lignée d'ancêtres, selon la tradition instaurée par son " clan ". Elle évoque ainsi l'histoire, tantôt amusante, tantôt bouleversante, des grands-parents de Paula, se laisse emporter dans un récit où se mêlent souvenirs d'enfance, témoignages historiques, voire confidences, tous adressés à la jeune malade. La tragédie qui frappe sa fille la conduit à jeter sur son passé un regard lucide et critique, et c'est avec une simplicité parfois empreinte d'ironie qu'elle nous raconte l'éveil de ses sens, ses difficultés d'épouse et de mère, ses efforts pour s'affirmer dans une société machiste ou son exil, après le coup d'Etat militaire. Tout au long de cette oeuvre qu'elle voudrait salutaire, Isabel Allende tente à la fois d'exorciser sa propre angoisse et d'éloigner sa fille du gouffre: peut-être, en fouillant sa mémoire, trouvera-t-elle dans quelque recoin un remède pour échapper à l'horreur clinique du moment et, surtout, faire revenir Paula à la vie." (Trad. Claude et Carmen Durand, Fayard)

Roberto Bolaño puise son inspiration dans un mélange d'expériences personnelles, d'engagements politiques et d'une vision littéraire profondément ancrée dans les tragédies du XXᵉ siècle...
Son œuvre, marquée
- par la violence ("2666" lie explicitement l’Allemagne nazie et les féminicides de Ciudad Juárez),
- l'impuissance (dans "2666", les meurtres de Santa Teresa sont permis par la corruption, le machisme et l’indifférence internationale, et dans "Los detectives salvajes", la violence est liée à l’échec des avant-gardes artistiques.),
- et l'errance (l'expérience nécessaire du monde),
... est une réponse aux désillusions historiques et artistiques de son époque ...
Chilien exilé après le coup d’État de Pinochet (1973),
- il a vécu au Mexique, en Espagne et en France, toujours en marge des cercles littéraires établis,
- ses personnages (Belano, Lima, Archimboldi) reflètent cette condition d’étranger perpétuel,
- jeune militant de gauche en Amérique latine, il a connu l’échec des utopies politiques (cf. La littérature nazie en Amérique, où il parodie les idéologies déchues).
- et ses influences littéraires et philosophiques sont celles de l'excès; Borges et le labyrinthe, Céline et la violence moderne, les poètes maudits (Rimbaud, Lautréamont), l'indépassable Kafka ..
Au final, l'impuissance est la marque essentielle de notre condition moderne ...
- L’artiste est impuissant, en fin de compte, par nature : Archimboldi, Belano ou Lima échouent à "sauver" le monde par l’écriture. La littérature est à la fois nécessaire et inefficace.
- L’histoire n'est qu'un vaste cycle de répétition : les crimes de Santa Teresa (2666) ou la quête vaine des realvisceralistas (Los detectives...) montrent que les erreurs se répètent.
- Écrire permet tout juste de résister à l’oubli, aussi Bolaño documente les tragédies ignorées (féminicides, exils) comme un acte de mémoire.
- et ses fins ouvertes reflètent un monde sans rédemption, où la lutte continue malgré tout...

Roberto Bolaño (1953-2003)
Né à Santiago (Chili), fils d’un camionneur et d’une enseignante, exilé au Mexique (où sa famille émigre), il regagne son pays en 1973 pour soutenir Allende, mais est arrêté brièvement après le coup d’État de Pinochet. Il s’installe alors au Mexique, puis en Espagne (1977), où il vit dans la pauvreté avant de se consacrer à l’écriture. Bolaño a d'abord écrit de la poésie avant de se consacrer au roman, - "Les Chiens romantiques" se présentent comme une sorte d’anthologie de la poésie de Bolano depuis son arrivée en Espagne jusqu’à la fin des années 90 - . Militant de gauche, il a fui la dictature de Pinochet, vécu dans la pauvreté, et travaillé comme plongeur, vigile ou vendeur de cigarettes avant de percer littérairement. Il décède à 50 ans à Barcelone d’une insuffisance hépatique, laissant une œuvre inachevée mais déjà mythique.
Avant "Los detectives salvajes", Bolaño était une figure culte pour un cercle restreint d'admirateurs. Depuis, ses ventes se sont multipliées. À l'époque, Bolaño était gravement malade et le savait.
Pendant les cinq dernières années de sa vie, il écrivit avec frénésie, laissant derrière lui un héritage monumental. Il est considéré comme l’un des plus grands écrivains latino-américains du XXIe siècle pour son écriture hybride et explosive : ses romans fusionnent polar, autobiographie, poésie et histoire, enquêtes et fragments de vies, ses phrases sont longues, ses digressions nombreuses, son humour noir et on lui prête une urgence narrative qui donne l’impression que "tout peut arriver".
Il réinvente un réalisme magique à sa mesure, loin du lyrisme de García Márquez : Bolaño préfère le "réalisme viscéral", teinté d’onirisme. la littérature est vécue comme un combat face à des intrigues impossibles, la violence politique est omniprésente et les marginaux, ses "héros", des marginaux ou des anti-héros, souvent lâches ou perdus ..

"La literatura nazi en América" (1996)
Bolaño vit sur un continent où le nazisme ne meurt pas en 1945, mais se recycle dans les dictatures latino-américaines (Bolaño ne parle pas directement de Pinochet ou Videla, mais révèle comment le fascisme survit dans la culture) et certains personnages ont des liens avec des régimes réels (l'Argentine pendant la Guerre sale). Bolaño invente donc une galerie d'écrivains imaginaires (poètes, romanciers, essayistes) liés au nazisme, au fascisme ou à l'ultra-droite en Amérique latine et aux États-Unis, des années 1930 jusqu'à un futur proche. Chaque entrée est une biographie littéraire fausse, mais tellement réaliste qu'elle semble tirée d'un document historique. Un Prologue fictif écrit par un éditeur imaginaire qui présente ces vies comme une "mise en garde".
17 entrées, des auteurs organisés par thèmes (ex. : "Les mythomanes", "Les sœurs magiques"). Parmi ces "écrivains nazis" inventés par Bolaño, Edelmira Thompson de Mendiluce, une poétesse argentine riche, admiratrice d'Hitler et d'Eva Perón; Carlos Ramírez Hoffman, pilote et poète chilien qui écrit des vers avec des avions dans le ciel (personnage repris dans Étoile distante); Luz Mendiluce; fille d'Edelmira, auteure de romans ésotériques, morte dans un asile; Max Mirebalais, un haïtien obsédé par la pureté raciale.
Et un épilogue, un récit à la première personne sur Edelmira Thompson de Mendiluce, une poétesse nazie argentine...
Bolaño nous ainsi montre comment le fascisme s'infiltre dans la culture, ces écrivains ne sont pas des brutes, mais des artistes cultivés et sophistiqués. Mais si beaucoup sont médiocres ou ratés, leur idéologie leur donne une identité.

"Estrella distante" (1996)
Le Chili est un pays fantôme, hanté par ses morts. Nouvelle dans "La literatura nazi en América" qui sera développé en roman. Chili, 1973, après le coup d'État de Pinochet, un mystérieux poète, Carlos Wieder, apparaît dans les cercles littéraires de Concepción. Le narrateur est anonyme, un ancien étudiant en poésie (proche de Bolaño lui-même) qui raconte comment Wieder, officier de l'armée de l'air (inspiré du vrai criminel nazi Paul Schäfer), mêle art et terreur.
Wieder incarne l'esthétique fasciste : il transforme la violence en spectacle (comme les régimes totalitaires). Il écrit des poèmes dans le ciel avec un avion (d'abord des vers, puis des messages fascistes), expose des photos de ses victimes torturées comme une "œuvre d'art" et assassine deux sœurs poètes, Verónica et Angelica Garmendia, pour disparaître soudainement. Des années plus tard, le narrateur et un détective, Abel Romero, traquent Wieder en Europe (Espagne, France), où il vit sous de fausses identités. Wieder échappera-t-il à la justice ? Son dernier poème suggère qu'il se suicide, mais rien n'est certain...
Le roman est un mémorial pour les artistes tués sous Pinochet (comme le vrai poète Víctor Jara) ...

"Amuleto" (1999) de Roberto Bolaño,
Un roman court mais intense, une longue tirade poétique, sans chapitres, centrée sur le personnage d'Auxilio Lacouture, une exilée uruguayenne surnommée "la mère de la poésie mexicaine". Auxilio, comme Bolaño, est une exilée qui reconstruit son identité à travers les mots et le roman se lit comme un mémorial pour les victimes de 1968 et les rêves brisés des révolutionnaires...
Mexico, 1968, le roman s’ouvre lors du massacre de Tlatelolco (répression étudiante par le gouvernement mexicain, quelques jours avant les Jeux Olympiques). Auxilio, seule femme restée dans l’Université autonome de Mexico (UNAM) pendant l’assaut militaire, se cache dans les toilettes et vit une expérience hors du temps : elle revoit sa vie, son arrivée au Mexique, ses amitiés avec les poètes (dont Arturo Belano et Ulises Lima, héros de Los detectives salvajes), raconte des épisodes réels et imaginaires, mêlant souvenirs, prophéties et cauchemars. Elle se décrit comme la protectrice des poètes realvisceralistas, ces artistes marginaux qui fuient les dictatures d’Amérique latine. Auxilio a une prémonition (un réalisme magique, mais teinté de désespoir), une "rivière de sang" qui engloutit Mexico, symbole des violences passées et futures (guerres, disparitions). Elle évoque son départ pour l’Europe, comme un exil sans retour (le destin d’Arturo Belano)..

"Nocturno de Chile" (2000, By Night in Chile)
Bolaño règle ses comptes avec l’intelligentsia chilienne (il a fui le pays après le coup d’État de 1973). Monologue fiévreux écrit peu avant sa mort, et confession hallucinée d'un prêtre-poète chilien sur son rôle sous la dictature de Pinochet. Sebastián Urrutia Lacroix, un prêtre catholique, critique littéraire et poète chilien, revoit sa vie sur son lit de mort. Entre souvenirs réels et délires, il tente de justifier son silence complice pendant la dictature militaire (1973-1990), et le personnage du prêtre renvoie aux évêques qui ont soutenu la dictature. Le récit saute entre les années 1960 (où il fréquente les élites littéraires) et les années 1980 (où il ferme les yeux sur les tortures). Parmi les éléments clés, sa rencontre avec Farewell, un écrivain réactionnaire qui l’initie à la critique, un voyage en Europe pour étudier la préservation des églises (où il croise des fascistes), et sa découverte que la villa d’un ami est un centre de torture, où les prisonniers sont interrogés la nuit… pendant qu’il discute littérature au salon (la villa de Maria Canales évoque la Villa Grimaldi, un vrai centre de torture à Santiago).
Bolaño dénonce ici les artistes et penseurs qui ont pactisé avec Pinochet, un sujet tabou au Chili). Urrutia incarne l’auto-illusion parfaite : il se croit innocent car il "n’a pas tué", mais son silence est coupable...
"Ahora me muero, pero tengo muchas cosas que decir todavía. Estaba en paz conmigo mismo. Mudo y en paz. Pero de improviso surgieron las cosas. Ese joven envejecido es el culpable. Yo estaba en paz. Ahora no estoy en paz. Hay que aclarar algunos puntos. Así que me apoyaré en un codo y levantaré la cabeza, mi noble cabeza temblorosa, y rebuscaré en el rincón de los recuerdos aquellos actos que me justifican y que por lo tanto desdicen las infamias que el joven envejecido ha esparcido en mi descrédito en una sola noche relampagueante. Mi pretendido descrédito. Hay que ser responsable. Eso lo he dicho toda mi vida. Uno tiene la obligación moral de ser responsable de sus actos y también de sus palabras e incluso de sus silencios, sí, de sus silencios, porque también los silencios ascienden al cielo y los oye Dios y sólo Dios los comprende y los juzga, así que mucho cuidado con los silencios. Yo soy responsable de todo. Mis silencios son inmaculados. Que quede claro. Pero sobre todo que le quede claro a Dios. Lo demás es prescindible. Dios no. No sé de qué estoy hablando. A veces me sorprendo a mí mismo apoyado en un codo. Divago y sueño y procuro estar en paz conmigo mismo. Pero a veces hasta de mi propio nombre me olvido. Me llamo Sebastián Urrutia Lacroix. Soy chileno. Mis ancestros, por parte de padre, eran originarios de las Vascongadas o del País Vasco o de Euskadi, como se dice hoy. Por parte de madre provengo de las dulces tierras de Francia, de una aldea cuyo nombre en español significa Hombre en tierra u Hombre a pie, mi francés, en estas postreras horas, ya no es tan bueno como antes. Pero aún tengo fuerzas para recordar y para responder a los agravios de ese joven envejecido quede pronto ha llegado a la puerta de mi casa y sin mediar provocación y sin venir a cuento me ha insultado. Eso que quede claro. Yo no busco la confrontación, nunca la he buscado, yo busco la paz, la responsabilidad de los actos y de las palabras y de los silencios. Soy un hombre razonable..."
"Maintenant, je me meurs, mais j’ai encore beaucoup de choses à dire. J’étais en paix avec moi-même. Muet et en paix. Mais soudain, les choses ont surgi. Ce jeune homme vieilli est le coupable. J’étais en paix. Maintenant, je ne suis pas en paix. Il faut clarifier certains points. Alors je m’appuierai sur un coude et je lèverai la tête, ma noble tête tremblante, et je fouillerai dans le coin des souvenirs ces actes qui me justifient et qui, par conséquent, démentent les infamies que le jeune homme vieilli a répandues pour me discréditer en une seule nuit fulgurante. Mon prétendu discrédit. Il faut être responsable. Cela, je l’ai dit toute ma vie. On a l’obligation morale d’être responsable de ses actes, de ses paroles, et même de ses silences, oui, de ses silences, car les silences aussi montent au ciel, Dieu les entend et seul Dieu les comprend et les juge, alors attention aux silences. Je suis responsable de tout. Mes silences sont immaculés. Que cela soit clair. Mais surtout, que cela soit clair pour Dieu. Le reste est superflu. Dieu, non. Je ne sais pas de quoi je parle. Parfois, je me surprends appuyé sur un coude. Je divague et je rêve et je m’efforce d’être en paix avec moi-même. Mais parfois, j’oublie jusqu’à mon propre nom. Je m’appelle Sebastián Urrutia Lacroix. Je suis chilien. Mes ancêtres paternels étaient originaires des provinces basques ou du Pays basque ou d’Euskadi, comme on dit aujourd’hui. Du côté de ma mère, je viens des douces terres de France, d’un village dont le nom en espagnol signifie Homme à terre ou Homme à pied, mon français, en ces dernières heures, n’est plus aussi bon qu’avant. Mais j’ai encore la force de me souvenir et de répondre aux outrages de ce jeune homme vieilli qui est venu frapper à ma porte et, sans provocation ni raison, m’a insulté. Que cela soit clair. Je ne cherche pas la confrontation, je ne l’ai jamais cherchée, je cherche la paix, la responsabilité des actes, des paroles et des silences. Je suis un homme raisonnable."

"El gaucho insufrible" (publié à titre posthume)
Publié en 2003 (recueil de cinq nouvelles), la plus célèbre donne son nom au livre: un gaucho argentin, vieux et misérable, erre dans la pampa en se plaignant de tout. Il finit par rencontrer un cheval philosophique qui lui donne des leçons de vie absurdes. Une parodie des figures mythiques argentines (le gaucho, le tango). Dans "La Neige", un écrivain chilien exilé en Espagne se souvient d’un hiver à Barcelone où il a failli mourir de froid. De la précarité des artistes. Dans "L’Appel du téléphone", un homme reçoit un appel nocturne d’une femme qui prétend être son amante… mais il ne la reconnaît pas. Dans Le Vagabond", un clochard à Paris raconte sa vie à un inconnu, mélangeant souvenirs réels et inventions. La fiction comme survie. Dans "Dentiste", un dentiste mexicain raconte une histoire de vengeance liée à la drogue toute l'ironie cruelle typique de Bolaño).
"El gaucho insufrible", le gaucho, autrefois symbole de liberté dans la pampa argentine, est maintenant un vieil homme misérable, ronchon et pathétique, errant sans but, se plaignant de tout (du vent, des chevaux, de la modernité), jusqu’à ce qu’il rencontre un cheval philosophe.
Le cheval (animal mythique de la pampa) lui parle avec un détachement ironique, lui reprochant son narcissisme et son incapacité à s’adapter. Le cheval lui propose de "devenir vent" pour échapper à sa condition. Mais le gaucho, refusant toute sagesse, finit seul, toujours aussi insupportable, tandis que le cheval s’en va en riant. Et la pampa, indifférente, continue sans lui.
" Hace muchos años tuve un amigo que se llamaba Jim y desde entonces nunca he vuelto a ver a un norteamericano más triste. Desesperados he visto muchos. Tristes, como Jim, ninguno. Una vez se marchó a Perú, en un viaje que debía durar más de seis meses, pero al cabo de poco tiempo volví a verlo. ¿En qué consiste la poesía, Jim?, le preguntaban los niños mendigos de México. Jim los escuchaba mirando las nubes y luego se ponía a vomitar.
Léxico, elocuencia, búsqueda de la verdad. Epifanía. Como cuando se te aparece la Virgen. En Centroamérica lo asaltaron varias veces, lo que resultaba extraordinario para alguien que había sido marine y antiguo combatiente en Vietnam. No más peleas, decía Jim. Ahora soy poeta y busco lo extraordinario para decirlo con palabras comunes y corrientes. ¿Tú crees que existen palabras comunes y corrientes? Yo creo que sí, decía Jim. Su mujer era una poeta chicana que amenazaba, cada cierto tiempo, con abandonarlo. Me mostró una foto de ella. No era particularmente bonita. Su rostro expresaba sufrimiento y debajo del sufrimiento asomaba la rabia. La imaginé en un apartamento de San Francisco o en una casa de Los Ángeles, con las ventanas cerradas y las cortinas abiertas, sentada a la mesa, comiendo trocitos de pan de molde y un plato de sopa verde. Por lo visto a Jim le gustaban las morenas, las mujeres secretas de la historia, decía sin dar mayores explicaciones. A mí, por el contrario, me gustaban las rubias. Una vez lo vi contemplando a los tragafuegos de las calles del DF. Lo vi de espaldas y no lo saludé, pero evidentemente era Jim. El pelo mal cortado, la camisa blanca y sucia, la espalda cargada como si aún sintiera el peso de la mochila. El cuello rojo, un cuello que evocaba, dealguna manera, un linchamiento en el campo, un campo en blanco y negro, sin anuncios ni luces de estaciones de gasolina, un campo tal como es o como debería ser el campo: baldíos sin solución de continuidad, habitaciones de ladrillo o blindadas de donde hemos escapado y que esperan nuestro regreso. Jim tenía las manos en los bolsillos ..."
"Il y a de nombreuses années, j’ai eu un ami qui s’appelait Jim, et depuis, je n’ai jamais revu d’Américain plus triste. Désespérés, j’en ai vu beaucoup. Aussi tristes que Jim, aucun. Une fois, il est parti pour le Pérou, un voyage qui devait durer plus de six mois, mais peu de temps après, je l’ai revu. « En quoi consiste la poésie, Jim ? » lui demandaient les enfants mendiants du Mexique. Jim les écoutait en regardant les nuages, puis se mettait à vomir.
Lexique, éloquence, quête de la vérité. Épiphanie. Comme quand la Vierge t’apparaît. En Amérique centrale, il s’est fait agresser plusieurs fois, ce qui était extraordinaire pour un ancien marine, un vétéran du Vietnam. « Plus de combats », disait Jim. « Maintenant, je suis poète, et je cherche l’extraordinaire pour le dire avec des mots ordinaires. » — « Tu crois qu’il existe des mots ordinaires ? » — « Je crois que oui », répondait Jim.
Sa femme était une poétesse chicana qui menaçait, de temps en temps, de le quitter. Il m’a montré une photo d’elle. Elle n’était pas particulièrement belle. Son visage exprimait la souffrance, et sous la souffrance pointait la rage. Je l’imaginais dans un appartement de San Francisco ou une maison de Los Angeles, fenêtres fermées mais rideaux ouverts, assise à table, mangeant des morceaux de pain de mie et un bol de soupe verte. Apparemment, Jim aimait les brunes, « les femmes secrètes de l’Histoire », disait-il sans plus d’explications. Moi, au contraire, j’aimais les blondes.
Un jour, je l’ai vu contempler les avaleurs de feu dans les rues de Mexico. Je l’ai vu de dos et ne l’ai pas salué, mais c’était indéniablement Jim. Les cheveux mal coupés, la chemise blanche et sale, le dos voûté comme s’il portait encore le poids de son sac à dos. La nuque rouge, une nuque qui évoquait, d’une certaine manière, un lynchage dans les champs, un champ en noir et blanc, sans panneaux publicitaires ni lumières de stations-service, un champ tel qu’il est ou tel qu’il devrait être : des friches à perte de vue, des pièces en brique ou blindées d’où nous nous sommes échappés et qui attendent notre retour. Jim avait les mains dans les poches." ...

"Ámberes" (1980, mais publié à titre posthume en 2002)
"Escribí este libro para mí mismo, y ni de eso estoy muy seguro" - Un puzzle littéraire donné comme un champ de bataille littéraire, scènes de drogue, de sexe, de errance à Barcelone et au Mexique, champ de bataille d’un jeune auteur qui invente sa voix dans le chaos, Bolaño se met en scène en train d’écrire, de fuir, de se perdre, on y trouve en germe tous ses thèmes futurs, et phrases s'accumulent comme des preuves d’existence. "Amberes", une ville belge (Anvers) où Bolaño n’a jamais mis les pieds, un lieu fantasmé, symbole d’exil et un jeu de mots avec "ámbar" (ambre), la fossilisation des souvenirs. Une oeuvre culte, admirée par les fans pour son audace.
"Los utensilios de limpieza
Alabaré estas carreteras y estos instantes. Paraguas de vagabundos abandonados en explanadas al fondo de las cuales se yerguen supermercados blancos. Es verano y los policías beben en la última mesa del bar. Junto al tocadiscos una muchacha escucha canciones de moda.
Alguien camina a estas horas lejos de aquí, alejándose de aquí, dispuesto a no volver más. ¿Un muchacho desnudo sentado junto a su tienda en el interior del bosque? La muchacha entró en el baño con pasos inseguros y se puso a vomitar. Bien mirado, es poco el tiempo que nos dan para construir nuestra vida en la tierra, quiero decir: asegurar algo, casarse, esperar la muerte. Sus ojos en el espejo como cartas desplegadas en una habitación en penumbra; el bulto que respira, hundido en la cama con ella. Los hombres hablan de rateros muertos, precios de chalets en la costa, pagas extras. Un día moriré de cáncer. Los utensilios de limpieza comienzan a levitar en su imaginación. Ella dice: podría seguir y seguir. El muchacho entró en la habitación y la cogió de los hombros. Ambos lloraron como personajes de películas diferentes proyectadas en la misma pantalla. Escena roja de cuerpos que abren la espita del gas. La mano huesuda y hermosa hizo girar la llave. Escoge una sola de estas frases: «Escapé de la tortura»… «Un hotel desconocido»… «No más caminos»…
"Les ustensiles de nettoyage"
Je louerai ces routes et ces instants. Des parapluies de vagabonds abandonnés sur des esplanades au fond desquelles se dressent des supermarchés blancs. C'est l'été et les policiers boivent à la dernière table du bar. Près du tourne-disque, une jeune fille écoute des chansons à la mode. Quelqu'un marche à cette heure, loin d'ici, s'éloignant d'ici, décidé à ne plus jamais revenir. Un garçon nu assis près de sa tente au cœur de la forêt ? La jeune fille est entrée dans les toilettes d'un pas chancelant et s'est mise à vomir.
À bien y réfléchir,
le temps qu'on nous donne pour bâtir notre vie sur terre est bien court,
je veux dire : assurer quelque chose, se marier, attendre la mort.
Ses yeux dans le miroir comme des cartes étalées dans une pièce à demi éclairée ; la masse qui respire, enfouie dans le lit avec elle. Les hommes parlent de voleurs morts, de prix des villas sur la côte, de primes exceptionnelles.
Un jour, je mourrai d'un cancer.
Les ustensiles de nettoyage se mettent à léviter dans son imagination.
Elle dit : Je pourrais continuer encore et encore. Le garçon est entré dans la pièce et l'a saisie par les épaules. Tous deux ont pleuré comme des personnages de films différents projetés sur le même écran. Scène rouge de corps qui ouvrent le robinet du gaz. La main osseuse et belle a tourné la clé.
Choisis une seule de ces phrases :
« J'ai échappé à la torture »
« Un hôtel inconnu »
« Plus de chemins »

"Putas assassines" (2001) de Roberto Bolaño
Recueil de 13 nouvelles, paru deux ans avant sa mort, mélange de polar, réalisme cru et fantastique. Dans "Putas asesinas" (Putas assassines), un écrivain médiocre vit avec une prostituée qui le méprise. Un jour, elle le menace avec un couteau, révélant une violence latente. La relation toxique entre l’art et la prostitution et l'échec masculin. Dans "El Ojo Silva" (L’Œil de Silva), un ancien militant de gauche, Silva, est obsédé par un photographe qui a peut-être collaboré avec la dictature chilienne. La paranoïa post-dictature, on ne sait qui ment et qui trahit. Dans "Prefiguración de Lalo Cura" (Préfiguration de Lalo Cura), un jeune policier, Lalo Cura, enquête sur des meurtres de femmes au Mexique (préfiguration des thèmes de "2666" et la violence systémique contre les femmes. Dans "Dentista", un dentiste mexicain raconte comment il a vengé son frère, tué par des narcos. L’humour noir (le dentiste utilise ses outils pour torturer). Dans "Últimos atardeceres en la tierra" (Derniers Crépuscules sur terre), un père et son fils traversent le Mexique en voiture, fuyant on ne sait quoi. Une atmosphère de fin du monde. Bolaño avait un fils...

"Los detectives salvajes" (1998, Les Détectives sauvages)
Récit éclaté d’une quête poétique en Amérique latine, culte chez les écrivains. La parution des "Détectives sauvages" ébranla la scène littéraire internationale. L'ouvrage a été comparé aux grands romans hispano-américains du XXe siècle et largement primé. L’auteur a vécu au Mexique de 1968 à 1976, et une partie du contenu du livre est autobiographique. Le roman débute dans la ville de Mexico, en 1976 et avec et le journal d'un adolescent qui raconte le tournant que prend sa vie quand sa passion pour la littérature l'amène à se joindre à un groupe d'avant-garde, les réalistes viscéraux (realvisceralistas), un gang littéraire fondé par par Arturo Belano et Ulises Lima.
Les réalistes viscéraux s’inspirent de l’estridentisme, mouvement littéraire d’avant-garde fondé en 1921 par le poète mexicain Manuel Maples Arce: en fait, Bolaño et Mario Santiago étaient les leaders d’un mouvement littéraire semblable au réalisme viscéral appelé "infrarealisme", qui était plus une attitude envers la vie qu’un ensemble de principes esthétiques. Le « Manifeste infraréaliste » de Bolaño, écrit en 1976, présente certains des principes fondamentaux de l’infraréalisme, comme le fait de tout laisser derrière soi, de voir le monde et de trouver la poésie dans la vie. Les infraréalistes s’opposaient à l’establishment littéraire mexicain dirigé par Octavio Paz): mais l’infraréalisme échouera, comme tous les mouvements artistiques. La poésie ne sert à rien, mais c’est tout ce qui nous reste...
Une épopée littéraire, poétique et chaotique, mêlant quête existentielle, marginalité et mythologie, celle des poètes maudits ...
Le livre est divisé en trois parties, avec des styles narratifs différents ...
- "Mexicans Lost in Mexico" (1975), le journal intime de Juan García Madero, un jeune poète naïf de 17 ans, un journal qui alterne anecdotes, poèmes et réflexions. La première partie sert de prélude à l’odyssée qui suivra dans les deuxième et troisième parties, où le récit devient polyphonique et encore plus labyrinthique...
Le récit commence le 2 novembre 1975 avec les notes de Juan, un étudiant en droit qui abandonne ses études pour se consacrer à la poésie. Il est recruté par Ulises Lima et Arturo Belano, les fondateurs du mouvement realvisceralista, une avant-garde littéraire marginale opposée à l’establishment poétique mexicain. Juan découvre un milieu bohème, rempli de poètes, d’artistes et d’excentriques, et se lie avec des figures comme Lupe, une prostituée, et Cesárea Tinajero, une poétesse mystérieuse des années 1920 que Lima et Belano cherchent à redécouvrir. Juan décrit les réunions dans des cafés et des maisons abandonnées, où les poètes discutent de littérature, de politique et de sexe. Il rencontre María Font, Angélica Font (dont il tombe amoureux), et Xóchitl García, une jeune femme qui le séduit. Les realvisceralistas sont méprisés par les cercles littéraires officiels, mais Ulises et Arturo persistent dans leur quête artistique.
La situation se complique lorsque Lupe, une prostituée travaillant pour un caïd nommé Alberto, s’enfuit avec les realvisceralistas. Alberto la recherche et menace le groupe. Ulises, Arturo, Juan et Lupe décident de quitter Mexico pour le désert de Sonora, à la recherche de Cesárea Tinajero, une poétesse oubliée des années 1920, fondatrice mythique de l’infraréalisme.
(une recherche qui symbolise la quête d’une poésie pure, hors des normes). Le 31 décembre 1975, ils partent en voiture, marquant la fin de la première partie.
- "The Savage Detectives" (1976-1996), une série de témoignages fragmentés de plus de 50 personnages (amis, amantes, inconnus, ennemis) qui racontent leurs rencontres avec Belano et Lima au cours de leurs pérégrinations reconstituées sur deux décennies, à travers le Mexique, l’Europe, l’Afrique et Israël.
Arturo Belano est l’alter ego de Roberto Bolaño, Ulises Lima est inspiré de Mario Santiago, un poète mexicain qui était un ami proche de Bolaño. Belano et Lima sont des "détectives" qui ne résolvent rien, cherchant une vérité insaisissable. Les deux poètes deviennent des fantômes, passant de pays en pays sans but clair...
Parmi les figures marquantes croisées en chemin, Auxilio Lacouture, poétesse uruguayenne, "mère" des realvisceralistas (son monologue ouvre le roman), Amadeo Salvatierra, un vieil écrivain qui leur parle de Cesárea Tinajero, Jacinto Requena & Rafael Barrios, des poètes rivaux qui les méprisent, Norma & Laura Jáuregui, des amantes de Belano, déçues par son incapacité à s’ancrer...
C'est d'abord le départ de Mexico et la recherche de Cesárea Tinajero (1976). Après avoir fui avec Lupe (cf. fin de la 1ère partie), Belano, Lima, Juan García Madero et Lupe traversent le désert de Sonora. Leur quête de Cesárea Tinajero, poétesse oubliée du mouvement stridentiste, les mène dans des villages reculés, mais ils ne la trouvent jamais. Les traces de Juan et de Lupe vont se perdre dans le désert (leur sort reste un mystère).
Puis une errance internationale (1980-1996) - Belano et Lima se séparent et voyagent séparément, vivant de petits boulots, de trafics et de poésie. On suit Ulises Lima au Mexique : (il traîne avec des gangs, vend des livres, inspire des jeunes poètes, en Israël (il vit dans un kibboutz, tombe amoureux d’une soldate, tente d’écrire) et en Afrique (il se perd dans des conflits locaux et vit dans la misère). Quant à Arturo Belano, on le suit à Barcelone (il y fréquente des exilés latinos, bagarres, drogues, et affrontement avec un critique littéraire dans un duel au couteau, il travaille comme plongeur, écrit sans succès), à Paris (il y traîne avec des clochards et tombe malade) et en Afrique (Guerre au Congo) où il s’engage comme mercenaire dans une guerre absurde.
Retours et échecs : Belano revient au Mexique dans les années 1990, usé, presque oublié. Lima disparaît périodiquement, devenant une légende underground. Aucun n’a publié de grand œuvre ; leur vie est leur seule poésie. La deuxième partie s’achève sur des voix éparses, laissant le destin de Belano et Lima en suspens.
- La 3e partie ("Los desiertos de Sonora", The Sonora Desert, 1976) revient au journal de Juan García Madero, bouclant la boucle narrative pour une conclusion énigmatique. La quête se solde par un échec, mais l’aventure devient légende ...
La fuite dans le désert, début janvier 1976 : après avoir quitté Mexico pour échapper au proxénète Alberto, le groupe (Juan, Lupe, Belano et Lima) erre dans le nord du Mexique. Ils cherchent Cesárea Tinajero, la poétesse mythique dont ils ont entendu parler par le vieux Amadeo Salvatierra. Le récit de Juan mêle observations triviales (panne de voiture, rencontres avec des paysans) et moments poétiques, reflétant son initiation à la vie réelle.
Dans un village perdu, ils trouvent enfin une trace de Cesárea : une vieille femme qui vit dans une masure, oubliée de tous. Cesárea montre aux jeunes hommes un de ses poèmes, un texte minimaliste et énigmatique, presque illisible. Ce moment anticlimactique symbolise l’échec de leur quête – la poésie qu’ils cherchaient est insaisissable, décevante.
Peu après, Alberto et ses hommes retrouvent le groupe. Dans la confrontation, Cesárea est tuée en protégeant Lupe. Belano et Lima abattent Alberto, puis s’enfuient.
C'est alors la dispersion finale : Belano et Lima disparaissent dans le désert, entamant leur vie d’errance (qui sera racontée dans la 2e partie). Juan et Lupe restent ensemble, mais leur destin est laissé ouvert. Le dernier mot du roman est "Y luego me desperté" ("Et puis je me suis réveillé"), suggérant un rêve, une mort, ou une renaissance.
La 3e partie répond à la 1ère, créant une structure circulaire. Le roman ne se conclut pas, il s’évapore...

"2666" (2004)
Le titre est peut-être une date, aucune explication unique n'a été donné par l'auteur, mais il suggère inévitablement une œuvre posthume. Le roman, écrit juste avant que Bolaño ne meure, sème un doute et les cinq parties du récit transforment celui-ci en rêve insaisissable : celui d'un écrivain, Benno von Archimboldi, un écrivain allemand fictif et énigmatique, mais qui, à la différence des intellectuels érudits qui le traquent , a choisi d’affronter le réel que personnifie la petit ville frontière de Santa Teresa (Mexique). Benno von Archimboldi, mythe de l’auteur génial et insaisissable, fait référence à Giuseppe Arcimboldo (1526–1593), un peintre maniériste célèbre pour ses portraits composés de fruits, légumes et objets divers, notre écrivain recompose la réalité comme les portraits grotesques du peintre...
"La parte de los críticos" (The Part About the Critics) - Dans la première partie, ils sont quatre critiques littéraires, quatre universitaires européens, spécialistes de Benno von Archimboldi, le recherchant dans leurs textes. Pelletier (français), Morini (italien), Liz Norton (britannique), Espinoza (espagnol) n'existent que dans un monde de séminaires, de rivalités académiques et de désirs romantiques. Et s'ils en viennent à penser que Archimboldi se cacherait à Santa Teresa, ce n'est certes pas pour s'intéresser à la réalité qui les entoure : ls ne voient pas (ou ignorent) les féminicides qui s’y produisent. Santa Teresa incarne le Tiers-Monde sanglant, la ville est rongée par la corruption, les meurtres de femmes, et l’indifférence, mais nos universitaires européens n’en perçoivent que des détails anecdotiques (la chaleur, la poussière). Opposant l’érudition européenne à la violence mexicaine, cette première partie fonctionne comme une métaphore de l’aveuglement des élites face à l’horreur du monde.
"La parte de Amalfitano" (The Part About Amalfitano) - La seconde partie, un pont entre la quête intellectuelle (Partie 1) et l’horreur brute (Partie 4). Les universitaires de la Partie 1 cherchaient Archimboldi, Amalfitano, lui, va se noyer dans ses pensées. Óscar Amalfitano est un exilé chilien, professeur de philosophie fuyant la dictature (il porte le poids de deux dictatures, l'Espagne franquiste, le Chili de Pinochet) qui incarne l’intellectuel déraciné, hanté par le passé. Son délire montre l’impossibilité d’oublier (les fantômes reviennent toujours) - Il dialoguera avec un fantôme (peut-être son beau-père, un anarchiste espagnol) qui lui parlera de la Guerre civile espagnole et des disparus -, et son impuissance. Amalfitano accroche un manuel de géométrie à une corde à linge, comme un "artiste conceptuel" (ou un fou) : la raison (les mathématiques, la logique) exposée aux vents du désert et au chaos. C'est aussi un homme brisé, sa femme, Lola, l’a quitté pour un poète révolutionnaire ; sa fille, Rosa, vit avec lui à Santa Teresa (ville fictive inspirée de Ciudad Juárez), mais il ne parvient pas à la protéger. Il pressent que Rosa est en danger dans cette ville où la folie est contagieuse et où les femmes sont assassinées en masse, mais il est trop passif pour agir. Dans cette ville frontalière, il perd peu à peu contact avec la réalité ...
"La parte de Fate" (The Part About Fate) - Dans la troisième partie, un journaliste sportif afro-américain du nom de Oscar Fate arrive à Santa Teresa pour couvrir un match de boxe mais se retrouve enquêtant sur des crimes perpétrés contre des femmes. Comme les critiques européens de la 1ère partie, c'est un outsider, mais contrairement à eux, il s’intéresse à la violence locale. Il doit interviewer El Negro Mercado, un boxeur vieillissant, et découvre des meurtres. Il rencontre Rosa Amalfitano, la fille du professeur de la 2ème partie, et apprendque des centaines de femmes ont été assassinées. Il interviewe des activistes, prostituées, et un policier cynique, mais aucune réponse claire n’émerge. Et Son rédacteur en chef veut un article "grand public", pas une enquête sur les meurtres. Ils quitteront tous deux la ville.
"La parte de los crímenes" (The Part About the Crimes) - La quatrième partie est la plus longue et la plus insoutenable du livre : un inventaire clinique de 108 meurtres de femmes à Santa Teresa (Ciudad Juárez), où la violence est devenue un phénomène banal, systémique et impuni. Une succession de corps retrouvés (violés, mutilés, abandonnés dans le désert) et des meurtres de femmes décrits comme des faits divers. Les victimes sont majoritairement des ouvrières pauvres des maquiladoras (usines frontalières), sacrifiées par le capitalisme globalisé.
Et quelques personnages récurrents (policiers, dont Lalo Cura, un flic idéaliste dans un système pourri, des journalistes, des médecins, et même un prêtre, Father Sebastián) ) qui ne résolvent rien. Contrairement à un polar classique, il n’y a ni coupable identifié, ni justice, et les journaux minimisent les crimes ("mortes de causes inconnues").
Et un thèse implicite : les meurtres sont le produit d’une société entière (machisme, capitalisme sauvage, État complice). Ainsi la littérature ne peut parvenir à "expliquer" la violence : elle peut juste la montrer. La 4ème partie est un trou noir : plus on lit, plus on comprend que le mal est sans fond.
L'Épilogue de "2666" (La parte de Archimboldi / The Part About Archimboldi) révèle enfin l’énigme centrale du roman : le lien entre Benno von Archimboldi, l’écrivain mythique, et les féminicides de Santa Teresa. Il va unifier les parties apparemment disjointes du roman, Santa Teresa, Archimboldi, et l’Histoire (guerre, Mexique) et transformer Archimboldi d’énigme littéraire en figure tragique, hantée par la culpabilité et l’héritage de la violence...
On découvre qu’Archimboldi s’appelle en réalité Hans Reiter, né dans un village allemand pauvre dans les années 1920. Enfant solitaire et passionné de lecture, il est fasciné par la mer et les profondeurs (symboles récurrents chez Bolaño). Pendant la Seconde Guerre mondiale, enrôlé dans la Wehrmacht, il participe à l’invasion de l’URSS. Un épisode clé montre son indifférence à la violence nazie, soulignant son ambiguïté morale.
Et la révélation du lien avec Santa Teresa : Archimboldi apprend que son neveu, Klaus Haas (un ancien soldat américain emprisonné à Santa Teresa pour meurtres en série), est accusé des féminicides. Bien que l’innocence de Haas soit suggérée, Archimboldi décide de se rendre au Mexique pour le sauver. Ce voyage explique pourquoi les critiques littéraires de la 1ère partie traquaient Archimboldi au Mexique, et relie indirectement l’écrivain à l’horreur de Santa Teresa.
L’écriture face au mal, Archimboldi, comme Bolaño, incarne l’artiste témoin des ténèbres du XXe siècle (guerre, violence systémique) et son œuvre naît de cette confrontation. Mais c'est un sentiment d'impuissance totale qui ne peut que dominer : malgré son génie, Archimboldi ne peut rien contre la machine meurtrière de Santa Teresa, miroir de l’impuissance de la littérature face au réel ...

"2666", l'original en espagnol, s'est vendu à plus de 500 000 exemplaires, la traduction anglaise (2008) est restée 20 semaines dans la liste des best-sellers du New York Times, et fut publié en France aux Éditions Bourgois (2008), dans les listes "meilleurs livres de l’année". Il serait étudié dans les départements de littérature du monde entier ...
