- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Svevo - Pirandello
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki
- 1930-1940
- 1930s
- Fitzgerald
- Hemingway
- Faulkner
- Koch
- Céline
- Bernanos
- Jouve
- DosPassos
- Kojève
- Miller-Nin
- Grosz - Dix
- Green
- Ortega y Gasset
- Wittgenstein
- Russell - Carnap
- Artaud
- Jaspers
- Sapir - Piaget
- Guillén
- Garcia Lorca
- Hammett
- A.Christie
- Heidegger
- Icaza
- Huxley
- Hubble
- Caldwell
- Steinbeck
- Waugh
- Blixen
- Rhys
- J.Roth - Doderer
- Aub
- Malraux-StExupéry
- DBarnes-NWest
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bataille
- Char-Michaux
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Bloch
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Lewin - Mayo - Maslow
- Montherlant
- Buzzati - Pavese
- Vittorini
- Fallada
- Malaparte
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Welty
- Boulgakov
- Tamiki - Yôkô
- Weil
- Gadda
- Broch
- Steeman
- Jouhandeau
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Ellison
- Bergman
- Baldwin
- Fromm
- Bradbury - A.C.Clarke
- Tennessee Williams
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Carpentier
- Mishima
- Salinger - Styron
- Pasternak
- Asturias
- O'Connor
- Hoffer
- Matute - MartinGaite
- 1960-1970
- 1960s
- Abe
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- U.Johnson - C.Wolf
- Heller - Toole
- Naipaul
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Onetti - Sábato
- Capote
- Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- McCarthy - Minsky
- Sillitoe
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- Lenz
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Dolls
- Ellis
- Cortázar
- Warhol
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- HarperLee
- Fuentes
- 1970-1980
- 1970s
- Habermas
- Handke
- GarciaMarquez
- Deleuze
- Derrida
- Beck
- Satir
- Kundera
- Hrabal
- Didion
- Guinzbourg
- Lovelock
- Vietnam
- H.S.Thompson - Bukowski
- Pynchon
- E.T.Hall
- Bateson - Watzlawick
- Carver
- Irving
- Milgram
- VargasLlosa
- Puig - Donoso
- Lasch-Sennett
- Crozier - Touraine
- Friedan-Greer
- Jacob-Monod
- Dawkins
- Beattie - Phillips
- Gaddis
- Rawls
- Zinoviev
- H.Searles
- Ballard
- Jong
- Kôno
- Calvino
- Ballester-Delibes
- ASchmidt
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact
Political Notes - Realities
Moralisme politique et Réalisme politique -
Reinhart Koselleck (1923–2006), "Critik und Krise" (1959, trad. Critique and Crisis), "Vergangene Zukunft" (1979, trad. Futures Past) - ...
Last update: 11/11/2016

En politique, on peut être "PRAGMATIQUE" en se contentant tout simplement de chercher des solutions optimales à un problème donné. Certes, on ne viendra peut-être jamais à bout des guerres et des conflits, pas plus qu'on ne pourra résoudre les questions sur certaines valeurs morales telles que la liberté et l'égalité. Mais il est possible d'améliorer nos modèles constitutionnels et les politiques à appliquer, ou de faire en sorte que les membres d'un gouvernement soient les plus compétents possible. Le philosophe chinois Confucius
compte ainsi parmi les premiers penseurs politiques à s'être focalisés sur les capacités et les vertus d'un conseil de sages ...
Mais on peut aussi regarder la politique non pas seulement comme un moyen d'atteindre des objectifs et de résoudre les problèmes de notre existence en société (bien qu'elle joue un rôle indispensable dans ce domaine), mais une activité pour laquelle nous devons décider des règles à suivre et des finalités à atteindre à l'échelle d'une société donnée ...
Le "REALISME POLITIQUE" et le "MORALISME POLITIQUE" sont deux grands courants de pensée qui, adoptant un point de vue très large, se proposent d'analyser la politique dans son ensemble, ainsi que ses rapports avec d'autres aspects de la condition humaine. Une opposition qui trouve ses racines dans la philosophie antique (Platon vs. Thucydide) mais a été systématisée à la Renaissance (Machiavel marquant un tournant réaliste) et approfondie au XXᵉ siècle avec l’école réaliste en relations internationales (Morgenthau, Kissinger)...
Le MORALISTE POLITIQUE considère que la politique est une branche de la science morale (éthique) : il s'agit foncièrement de construire une société meilleure ...
Aristote, qui ne pensait pas que tous les êtres humains devaient être autorisés à participer à la vie politique, soutenait que l`idée que la politique est une activité collective orientée vers des finalités communes : la politique doit viser des buts
substantiels ou protéger certaines valeurs. telles que la justice, l'égalité, la liberté, le bonheur, la fraternité ou la souveraineté nationale. Dans sa conception la plus radicale, le moralisme peut donner lieu à des descriptions de sociétés idéales, des utopies (La République" (vers 380 av. J.-C.), Platon - Thomas More, 1516).
Le moralisme politique postule donc que la politique doit être guidée par des principes éthiques universels (justice, liberté, égalité, etc.). Il considère que les dirigeants doivent agir selon des valeurs morales, même si cela peut parfois sembler idéaliste ou peu pragmatique.
On peut ainsi parmi ses inspirateurs compter,
- Platon (dans La République) : le gouvernant doit être un philosophe-roi, guidé par la vérité et la justice.
- Emmanuel Kant : Dans "Vers la paix perpétuelle", il défend une politique fondée sur la morale et le droit.
- John Rawls (Théorie de la justice) : la justice doit être le fondement des institutions politiques.
Le REALISME POLITIQUE, en revanche, considère que la politique est avant tout une lutte pour le pouvoir, où les considérations morales sont secondaires. Les réalistes privilégient l'efficacité, la stabilité et l'intérêt national, même si cela implique des compromis éthiques.
Origines et représentants :
- Thucydide (Histoire de la guerre du Péloponnèse) : il montre comment les États agissent par intérêt et par peur plutôt que par morale.
- Nicolas Machiavel (Le Prince) : Soutient que le dirigeant doit parfois agir avec ruse et force pour maintenir l’ordre.
- Thomas Hobbes (Léviathan) : L’État doit avant tout assurer la sécurité, même au détriment de certaines libertés.
- Hans Morgenthau (Politics Among Nations) : Théoricien des relations internationales, il défend une approche pragmatique où le pouvoir prime sur la morale.

Aux antipodes du moralisme, cet autre courant majeur considère donc que la politique est avant tout une question de POUVOIR ...
C'est le POUVOIR qui permet d'atteindre des objectifs, de vaincre des ennemis et d'établir des compromis. Si l'on n'est pas en capacité de s'emparer puis d'exercer le pouvoir, les valeurs, si nobles et vertueuses soient-elles, ne sont d'aucune utilité.
Les tenants de cette pensée, que l'on nomme REALISME, s'intéressent notamment au pouvoir, aux conflits, aux guerres, et font souvent preuve de cynisme lorsqu'ils analysent les motivations de l'être humain.
Les deux plus grands penseurs qui s'inscrivent dans ce courant sont historiquement sans doute Nicolas Machiavel et Thomas Hobbes, qui vécurent tous deux lors de périodes de troubles et de guerres civiles, respectivement au XVIe et au XVIIe siècles. Pour l'ltalien Machiavel ("Le Prince" (Il Principe, 1532, publié à titre posthume), "Discours sur la première décade de Tite-Live" (Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, 1531), l'être humain est par nature «menteur» et « ingrat ››, mais aucunement noble ou vertueux. Aussi un dirigeant ne doit se préoccuper que de l'exercice du pouvoir. Pour Hobbes ("Léviathan", 1651), en l'absence de lois, les êtres humains se feraient la guerre
en permanence : ce n'est qu'au moyen d'un «contrat social» qu'un souverain peut exercer un pouvoir absolu sur ses sujets et préserver la société de cet "état de nature"....
.. Et le REALISME soutient que la politique est un champ de forces où LE LANGAGE LUI-MÊME EST UN ENJEU DE POUVOIR. En ce sens, son œuvre nous offre des outils précieux pour une analyse réaliste des idéologies et des crises modernes ...

Reinhart Koselleck (1923–2006) est un historien et théoricien politique allemand, considéré comme l’un des penseurs les plus importants du XXᵉ siècle pour l’étude des concepts politiques et de leur évolution dans l’histoire.
Il est notamment connu pour avoir cofondé l’approche de la « Begriffsgeschichte » (histoire conceptuelle) et pour ses analyses profondes des liens entre langage, temps historique et pouvoir ("The Practice of Conceptual History", 2002).
Il a étudie l’histoire, la philosophie et la sociologie après la Seconde Guerre mondiale, fut marqué par l’expérience du nazisme et de la reconstruction. Parmi ses mentors, on cite Carl Schmitt (théoricien du politique), Martin Heidegger (philosophie du temps), et Hans-Georg Gadamer (herméneutique). Il a dirigé un projet collectif, le lexique « Geschichtliche Grundbegriffe » (8 volumes, 1972–1997), une encyclopédie retraçant la transformation des concepts politiques clés (comme "État", "démocratie", "révolution") entre 1750 et 1850.
Ni marxiste ni libéral, il refuse les grands récits téléologiques (comme le « progrès inévitable »). Anti-utopiste, les projets politiques fondés sur des abstractions (égalité parfaite, paix perpétuelle) ignorent la complexité du réel. La modernité génère à la fois de l’émancipation et de nouvelles formes de violence (guerres totales, totalitarismes) : Koselleck, auteur oublié, nspirera les études critiques de la modernité d'un Agamben et de Foucault .. ("History in the Plural: An Introduction to the Work of Reinhart Koselleck", Niklas Olsen, 2011).
Koselleck montre que les mots politiques ne sont pas neutres et que leur sens change avec les conflits sociaux (La « liberté » en 1789 (révolutionnaire) vs. en 1989 (libérale) n’a pas le même sens). Son approche historico-conceptuelle (Begriffsgeschichte) éclaire les dynamiques du pouvoir, de la souveraineté et des conflits politiques en croisant histoire sociale et analyse linguistique : révélant comment les concepts structurent le pouvoir.
Lorsque le réalisme politique insiste sur l’autonomie du politique (la politique comme sphère distincte de la morale),la conflictualité inhérente aux relations de pouvoir, l’historicité des concepts politiques (leur sens évolue avec les luttes de pouvoir), Koselleck étudie précisément comment les concepts politiques se transforment dans les crises, ce qui rejoint le réalisme dans sa méfiance envers les abstractions morales et son attention aux rapports de force concrets.
Dans "Critique and Crisis" (1959), Koselleck montre comment la critique morale des Lumières (Kant, Rousseau) a contribué à saper l’autorité de l’Ancien Régime, menant à des crises révolutionnaires. Les moralistes (comme les philosophes des Lumières) croyaient pouvoir juger le pouvoir depuis une position extérieure, mais Koselleck révèle que cette critique elle-même devient un instrument de pouvoir. La morale en politique est ainsi souvent une arme dans des luttes d’influence, et non pas un guide désintéressé.
Dans "Futures Past" (1979), Koselleck analyse comment des concepts comme "État", "révolution", "crise" changent de sens entre le XVIIᵉ et le XIXᵉ siècle. Ainsi, la "révolution" passe d’un sens cyclique (retour à un ordre ancien) à un sens progressiste (rupture vers un avenir radicalement nouveau). Pour les réalistes, ces glissements sémantiques ne sont pas neutres mais reflètent des luttes pour l’hégémonie politique.
Historien et philologue, Koselleck s’intéresse aux effets imprévisibles des concepts politiques, et non seulement à leur instrumentalisation calculée. Mais si sa méthode n'est certes pas destinée à être prescriptive, il montre que les idées morales ou utopiques (comme les droits de l’homme ou le progrès) sont aussi des armes politiques, ce qui rejoint la méfiance réaliste envers l’idéalisme. Il révèle que la souveraineté et l’ordre politique sont toujours menacés par des conflits sémantiques (les guerres de mots sont des guerres de pouvoir et vice-versa). Son analyse de la temporalité politique (comment les attentes d’avenir structurent le présent) aide à comprendre les stratégies des acteurs ....
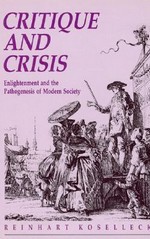
"Critik und Krise" (1959, trad. Critique and Crisis)
L'ouvrage qui a établi la réputation de l'auteur, une histoire des Lumières en miniature, fondamentale pour notre compréhension de cette période et de ses conséquences. Comme Tocqueville, Koselleck voit les intellectuels des Lumières comme un groupe de spectateurs déracinés et irréalistes qui ont semé les graines des tensions politiques modernes qui ont fleuri pour la première fois lors de la Révolution française. Il soutient que c’est la scission qui s’est développée entre l’État et la société au cours des Lumières qui a favorisé l’émergence de cette élite intellectuelle séparée des réalités de la politique. Koselleck décrit comment cette disjonction entre l’autorité politique proprement dite et ses sujets a conduit à des sphères privées qui sont devenues plus tard des centres d’autorité morale et, finalement, des modèles pour la société politique qui ont peu ou pas pris en compte les contraintes dans lesquelles les politiciens doivent inévitablement travailler. Ainsi, la philosophie bourgeoise progressiste, qui semblait offrir la promesse d’un monde unifié et pacifique, produisait en fait tout le contraire...
Koselleck nous montre comment la critique morale des Lumières, en sapant l’autorité de l’État absolutiste, a paradoxalement préparé le terrain pour des crises politiques majeures (notamment la Révolution française). Il montre que la prétention à juger le pouvoir depuis une position "extérieure" (la morale, la raison) a engendré une politisation de la critique, transformant celle-ci en une force révolutionnaire destructrice. Koselleck anticipe les travaux de Michel Foucault sur les liens entre savoir et pouvoir...
1. Les origines : La naissance de la critique morale (XVIIᵉ–XVIIIᵉ siècles) ..
Contexte : Après les guerres de religion (XVIᵉ–XVIIᵉ siècles), l’État absolutiste (ex. Hobbes, Louis XIV) émerge pour imposer la paix en séparant radicalement : le domaine public (l’État, garant de l’ordre), et le domaine privé (la morale, la religion, la conscience individuelle).
Mais cette séparation crée un espace où les intellectuels (philosophes, écrivains) développent une critique morale de l’État, sans en assumer les responsabilités politiques.
2. La critique des Lumières : Une arme politique masquée ..
Kant, Rousseau, Diderot prétendent juger le pouvoir au nom de la raison universelle, mais leur critique se place hors du champ politique (dans des salons, des livres, des loges maçonniques), et devient une contre-société invisible mais puissante, minant la légitimité de l’Ancien Régime.
Ainsi la "Lettre sur la tolérance" de Locke ou "Le Contrat socia" de Rousseau ne sont pas de simples traités philosophiques, mais des armes dans une guerre sémantique contre l’absolutisme.
3. La crise : Quand la morale dévore la politique ..
La critique, initialement apolitique, finit par politiser la morale : des concepts comme "liberté", "égalité", "droits naturels" deviennent des mots d’ordre révolutionnaires. La Révolution française (1789) est ainsi l’aboutissement de ce processus : la morale se venge de la politique en détruisant l’ordre existant.
Paradoxalement, on notera que les Lumières voulaient émanciper l’homme, mais leur critique a engendré une violence politique inédite (Terreur, guerres napoléoniennes).
Koselleck s’inspire de Carl Schmitt (théoricien de la souveraineté) pour montrer que toute critique absolue du pouvoir (au nom de la morale ou de l’histoire) mène à des conflits insolubles. La politique ne peut pas être fondée sur des principes abstraits (comme la "vertu" chez Rousseau), mais doit composer avec la contingence et le conflit. Le moralisme (Kant, Rousseau) devient une arme politique, sapant l’ordre sans proposer d’alternative stable. Et Koselleck rejoint Machiavel en soulignant que la morale en politique peut masquer des rapports de force...

"Vergangene Zukunft" (1979, trad. Futures Past)
Koselleck nous démontre ici comment les conceptions du temps – notamment la relation entre passé, présent et futur – ont évolué entre le Moyen Âge et la modernité, transformant radicalement l’expérience politique. Il montre que la modernité invente une nouvelle temporalité, marquée par l’idée d’un futur ouvert et imprévisible, ce qui bouleverse les attentes politiques et accélère les crises...
Une œuvre majeure pour saisir comment le temps structure nos espoirs, nos peurs et nos conflits politiques, de la Révolution française à l’ère numérique.
1. La rupture de la modernité : Du temps cyclique au temps linéaire ..
- Temps prémoderne (Moyen Âge, Renaissance) : Le temps est cyclique ou providentiel (eschatologie chrétienne). Le futur est un retour (restauration d’un ordre ancien) ou l’accomplissement d’un plan divin.
- Modernité (à partir du XVIIIᵉ siècle) : Le temps devient linéaire et progressif (influence des Lumières, des révolutions). Le futur est perçu comme un horizon radicalement neuf (progrès, utopies).
- Conséquence politique : Les idéologies (libéralisme, socialisme) promettent un avenir meilleur, mais créent aussi des attentes impossibles à satisfaire.
- Sattelzeit ("période charnière", 1750–1850) : Moment où les concepts politiques modernes ("État", "révolution", "progrès") prennent leur sens actuel.
2. L’émergence du "champ d’expérience" et de l’"horizon d’attente" ...
- Champ d’expérience (Erfahrungsraum) : Le passé tel qu’il est vécu et interprété. En modernité, il est de plus en plus déconnecté du futur (les leçons du passé semblent moins applicables).
- Horizon d’attente (Erwartungshorizont) : Les projections dans le futur, devenues autonomes par rapport au passé. A noter le fossé croissant entre ce que nous vivons et ce que nous espérons génère des crises. Le populisme, les mouvements révolutionnaires, et même l’écologie politique reposent sur des attentes temporelles ("Il est trop tard pour être pessimiste") ...
Exemple : La Révolution française (1789) rompt avec l’histoire en promettant un monde entièrement nouveau.
- Tension politique : Plus l’écart entre expérience et attente se creuse, plus les sociétés deviennent instables (révolutions, crises).
3. L’accélération du temps historique ...
- La modernité accélère le temps : Innovations technologiques (ex. révolution industrielle), changements politiques brutaux (révolutions, guerres).
- Effets sur la politique : Les régimes doivent désormais gérer des attentes toujours renouvelées (démocratie, croissance économique). Les idéologies (communisme, fascisme) exploitent cette accélération en promettant un avenir radieux.
- Le temps n’est plus un cadre neutre, mais un enjeu politique (ex. les régimes totalitaires veulent contrôler le futur).
4. Critique des philosophies de l’histoire
Koselleck rejette les grands récits téléologiques (Hegel, Marx) qui prétendent connaître la fin de l’histoire. La "historia magistra vitae" est morte : Le passé ne peut plus servir de guide fixe, car le futur est devenu imprévisible. Conséquence : Les sociétés modernes sont condamnées à naviguer dans l’incertitude, ce qui explique les crises répétées.
Une oeuvre inspirante pour les théoriciens de la modernité liquide (Zygmunt Bauman) et de l’accélération sociale (Hartmut Rosa)...
La modernité de la fin du XVIIIe siècle a transformé tous les domaines de la vie européenne, intellectuelle, industrielle et sociale. L’expérience du temps lui-même n’a pas été la moins affectée : le changement toujours plus rapide laissait aux gens des intervalles de temps plus brefs pour acquérir de nouvelles expériences et s’adapter. Dans ce livre provocateur et érudit, Reinhart Koselleck, éminent philosophe de l’histoire, explore le concept du temps historique en posant la question : quel genre d’expérience est ouverte par l’émergence de la modernité ?
S’appuyant sur une extraordinaire panoplie de témoignages et de textes des hommes politiques, philosophes, théologiens et poètes aux peintures de la Renaissance et aux rêves des citoyens allemands pendant le Troisième Reich, Koselleck montre qu’avec l’avènement de la modernité, le passé et l’avenir se sont « déplacés » les uns par rapport aux autres. Les promesses de la modernité, liberté, progrès, amélioration humaine infinie ont produit un monde qui s’accélérait vers un futur inconnu et inconnaissable dans lequel attendait la possibilité d’atteindre une réalisation utopique.
L’histoire, affirme Koselleck, est apparue à ce moment crucial comme une nouvelle temporalité offrant des moyens nettement nouveaux d’assimiler l’expérience. Dans le contexte actuel de la mondialisation et des crises qui en découlent, le monde moderne est une fois de plus confronté à une crise d’alignement de l’expérience passée et présente. Réaliser que chaque présent était autrefois un futur imaginé peut nous aider à nous replacer dans une temporalité organisée par la pensée humaine et les fins humaines autant que par les contingences des événements incontrôlés. (Note de l'éditeur)

"Sediments of Time: On Possible Histories (Cultural Memory in the Present)", written by Reinhart Koselleck (2000) -
Les essais les plus importants de l’historien allemand Reinhart Koselleck, dont plusieurs sont essentiels à sa théorie de l’histoire. Le volume met en lumière les préoccupations cruciales de Koselleck, y compris sa théorie des sédiments du temps; sa théorie de la répétition historique, de la durée et de l’accélération; ses rencontres avec l’herméneutique philosophique et la pensée politique et juridique; son souci des limites du sens historique; et ses vues sur la commémoration historique, y compris celle de la Seconde Guerre mondiale et de l’Holocauste. Une introduction critique aborde certains des défis et potentiels de la réception de Koselleck dans le monde anglophone...
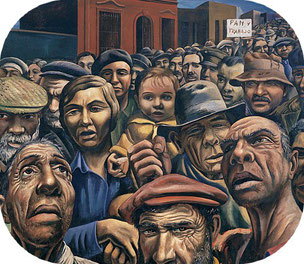
The Sense of Reality in Politics - "Tout fait connu et établi peut être nié", prendre conscience de cette réalité invite à s'interroger constamment, sur son propre cheminement culturel et social, sur l'offre sociale et politique qui nous est faite, sur la légitimité et les demandes d'acquiescement qui nous sont sans cesse réitérées au cours de notre existence, le risque constant que doit endiguer tout esprit critique n'est pas seulement de se laisser gagner par une image qui flatterait la réalité, mais qui se substituerait totalement à celle-ci.. Mais la "réalité" est-elle pour cela affaire d'opinion? Sommes-nous condamnés un monde irrémédiablement relativiste? But is "reality" a matter of opinion for this reason? Are we doomed to a world that is irremediably relativistic? - Pero, ¿es la "realidad" una cuestión de opinión por esta razón? ¿Estamos condenados a un mundo irremediablemente relativista?
"Le pouvoir, par sa nature même, ne peut jamais produire un substitut pour la stabilité assurée de la réalité factuelle, qui, parce qu'elle est passée, a grandi jusqu'à une dimension hors de notre portée. Les faits s'affirment eux-mêmes par leur obstination, et leur fragilité est étrangement combinée avec une grande résistance à la torsion – cette même irréversibilité qui est le cachet de toute action humaine. Dans leur opiniâtreté, les faits sont supérieurs au pouvoir ; ils sont moins passagers que les formations du pouvoir, qui adviennent quand des hommes s'assemblent pour un but, mais disparaissent dès que le but est atteint ou manqué. Ce caractère transitoire fait du pouvoir un instrument hautement incertain pour mener à bien une permanence d'aucune sorte, et, par conséquent, non seulement la vérité et les faits ne sont pas en sécurité entre ses mains, mais aussi bien la non-vérité et les non-faits.." (Hannah Arendt, Between Past and Future, 1961)

Notre monde est un océan d'événements, devenus faits historiques pour certains, et par le biais desquels s'impose pour chacun d'entre nous une "vérité" de l'existence, de notre existence, de nos existences partagées. Or cette vérité peut faire l'objet de déformations, pour réécrire l'histoire, justifier une action, accélérer ou optimiser une intervention, repositionner un pouvoir ou une légitimité, semer le trouble et accroître les déséquilibres ou renoncements. Hannah Arendt (Between Past and Future, 1961, "Truth and Politics") montre que non seulement la manipulation des faits et de l'opinion est constitutive de tous les systèmes totalitaires, mais que cette tentation de manipulation gagne toutes les démocraties libérales. Il ne s'agit plus "simplement" de travestir ou de dissimuler les secrets ou les interventions d'un pouvoir, économique, social ou politique, mais de s'attaquer potentiellement à toutes les "vérités" historiques pour les réduire à un statut d' "opinion". La justification des crimes commis par le régime nazi ou les interventions armées à l'encontre de tel ou tel pays sont des exemples emblématiques de cette tentation constante. Vérité et mythe ont depuis longtemps coexisté : Ernest Renan, dès les années 1880, soulignait à quel point toute identité nationale dépend d'une mémoire sélective et déformée des évènements du passé; un Hans-Georg Gadamer montre l'importance, dans les années 1960 de la création collective de la vérité. Avec un certain cynisme, on a toujours souligné combien les mythes constituaient des éléments sociaux d'intégration malgré leur manque de véracité. Cette tendance à vouloir construire, pour servir de multiples intérêts, une réalité sociale et historique "alternative" remonte donc à la nuit des temps, mais aujourd'hui cette tendance semble désormais en passe d'être non seulement généralisée mais acceptée : et enrichir la panoplie des outils politiques à disposition de toutes les ambitions..
Il n'y a pas de politique ni même de société possibles sans cette "pragmatique du langage" que décrit Jürgen Habermas ("Wahrheit und Rechtfertigung. Philosophische Aufsätze", 1999) et qui porte les principes, les valeurs, les rôles, les catégories mentales et conceptuelles qui rendent possible l'entente rationnelle avec autrui à propos de la vérité des faits, de la justesse des actes et des normes.
Nous sentons bien pourtant qu'il n'y a pas une parfaite adéquation entre la contingence du développement historique et naturel de nos possibilités d'existence et cette normativité qui nous fait sujet parlant et agissant dans un monde déjà constitué et orienté par un vivre ensemble qui semble implicite.
Nous semblons en effet partager une même vision fondamentale de la réalité sociale que nous partageons et pourtant nous n'accédons pas à cette "réalité nue" qui se dévoile parfois lorsqu'apparaissent des dysfonctionnements, des incohérences, des incompréhensions, des tensions, des innovations, qui viennent affecter l'entente rationnelle dans laquelle nous sommes ce que nous sommes.
Des distorsions de sens apparaissent ainsi et fragilisent tant nos existences que notre compréhension du monde. La pensée politique est bien le théâtre par excellence de tous ses risques de distorsions de sens susceptibles de remettre en cause tant l'entente rationnelle et que notre propre effort de rationalité.
Dans l'histoire comme dans la philosophie de l'histoire, l'interprétation est inévitable, en premier lieu via le choix des faits qui sont soumis à interprétation (on connaît la remarque de Bergson qui écrivait que les historiens ne sélectionnent dans les faits que ceux qui lui permettront d'expliquer son propre présent); puis via le récit et la perspective que l'on entend donner à cette interprétation (donner un sens à des événements qui n'en ont peut être pas crée d'autres faits qui peuvent se substituer aux faits primitifs, bruts). Toute histoire n'est pas pour autant impossible, au fond toute science humaine porte en elle les mêmes hésitations quant à l'objectivité qui peut en être inférée. Si chaque génération est amenée à recomposer son histoire, mais aussi sa représentation du monde, de la société et de soi, il y a quand même un fond de réalité et une matière historique que ne peuvent être remodelée à souhait ou simplement effacée de nos mémoires.
"Est-ce qu'il existe aucun fait qui soit indépendant de l'opinion et de l'interprétation ? Des générations d'historiens et de philosophes de l'histoire n'ont-elles pas démontré l'impossibilité de constater des faits sans les interpréter, puisque ceux-ci doivent d'abord être extraits d'un chaos de purs événements (et les principes du choix ne sont assurément pas des données de fait), puis être arrangés en une histoire qui ne peut être racontée que dans une certaine perspective, qui n'a rien à voir avec ce qui a eu lieu à l'origine ? Il ne fait pas de doute que ces difficultés, et bien d'autres encore, inhérentes aux sciences historiques, soient réelles, mais elles ne constituent pas une preuve contre l'existence de la matière factuelle, pas plus qu'elles ne peuvent servir de justification à l'effacement des lignes de démarcation entre le fait, l'opinion et l'interprétation, ni d'excuse à l'historien pour manipuler les faits comme il lui plaît. Même si nous admettons que chaque génération ait le droit d'écrire sa propre histoire, nous refusons d'admettre qu'elle ait le droit de remanier les faits en harmonie avec sa perspective propre ; nous n'admettons pas le droit de porter atteinte à la matière factuelle elle-même. Pour illustrer ce point, et nous excuser de ne pas pousser la question plus loin : durant les années vingt, peu avant sa mort, se trouvait engagé dans une conversation amicale avec un représentant de la République de Weimar au sujet des responsabilités quant au déclenchement de la Première Guerre mondiale. On demanda à : « À votre avis, qu’est-ce que les historiens futurs penseront de ce problème embarrassant et controversé ? » Il répondit : « Ça, je n’en sais rien, mais ce dont je suis sûr, c’est qu’ils ne diront pas que la Belgique a envahi l’Allemagne..." (Hannah Arendt ).
